16/05/2009
Eduquons, et c'est pas une insulte!
11:02 Publié dans Au secours la France d'après est revenue | Lien permanent | Commentaires (0)
03/05/2009
Train des indes...
Climbing the Ghats by MG (Aug. 12, 2007) from Mani Vijay on Vimeo.
Le train poussif avançait péniblement, tiré par une locomotive diesel en zigzaguant sur les rails tortueux qui s’élançait entre les plantations de thé. Dans une vallée large et ensoleillée, le convoi grimpait dans ces paysages qui semblaient peignés et sagement taillés par un jardinier scrupuleux. Pas un arbrisseau plus haut que l’autre. Impeccablement. De loin les champs dessinaient un puzzle verdoyant dans lequel se faufilaient les ouvrières. Parfois, ça et là, dans le paysage perçaient des villages verts ou bleus, de terre battue et couverts de tôles de zinc qui se reflètaient comme des plaques d’argent. Accrochées à flanc de colline, les maisons sont serrées les unes contre les autres pour économiser le terrain. Ces villages aux maisons de poupées ponctuaient de leur présence cette épaisse moquette végétale dans laquelle parfois des drapeaux rouges, marqués de la faucille et du marteau, faidaient des point comme des perles de sang dans cette immense étendue. Tout le paysage courait sur ces monts dodus d’où émergeaient quelques grands arbres aux troncs noirs qui montaient droit au ciel. Ils étendaient des maigres branches où poussaient des feuilles éparses dispensant un semblant d’ombre.
Jadis, ici, ce n’était qu’une forêt primitive, où vivait paisiblement le tigre, l’éléphant, le perroquet, le paradisier. La terre, il a bien fallu, comme tout le reste, qu’elle crache son profit et qu’elle devienne rentable. Tondue et pelée sous la houlette des dominants. Un immense bâtiment au toit vert frappée du sigle de la famille Tata, collecte tout ce thé. Qui veut travailler ici doit posséder des arpents de terre. Les terres, les récoltes, les hommes, les routes, le ciel bleu, tout ici leur appartient. Cela semble bien impossible de pouvoir échapper à leur empreinte.
Dans la gare attendait une locomotive à vapeur qui crachait déjà son nuage blanc et le conducteur actionna le sifflet. On aurait pu croire à un modèle réduit. Changement de motrice, nous voilà après une longue demi-heure, attelés à cette nouvelle machine qui siffle, peste et avance en grimaçant sur ses rails. Deux trains par jour sur cette ligne construite au début du siècle dernier par les Anglais qui allaient se mettre au frais en altitude, en attendant la mousson. Temps modernes obligent, la montée s’effectue au diesel, la descente au charbon. Le convoi s’ébranle lentement. Quand nous abordons la descente, les freineurs installés sur les plates-formes à l’extérieur des wagons, un à chaque extrémité, tournent la manivelle en laiton brillant de leurs freins pour contenir l’accélération du convoi. On dirait un être vivant. Le dragon crache ses escarbilles et des petits feux s’allument ça et là le long de la voie. Souvent des débuts d’incendie ont noirci le bord des rails. Le petit train avançait lentement malgré la descente. Passer de deux mille à trois cents mètres d’altitude, sur une distance de trente kilomètres, rend l’exercice périlleux. A l’arrêt d’une gare entourée de hauts arbres, où, sous les frondaisons, à l’abri de la lumière, on cultive le cardamome, des bandes de singes encadrés de vieux mâles aux babines retroussées montrent leurs crocs. Des femelles flanquées de jeunes grimpés sur le dos surgissent et courent après le train. Ces agiles soudards regardent à l’intérieur des wagons prêts à chaparder tout ce qui passe à leur portée. Une distance de quelques mètres seulement sépare cette horde de petits humains accourus aux sifflement de la locomotive qui s’arrête là au milieu de nulle part. Des singes, il en arrive de partout ; des arbres, des rochers. Certains sont assis sur le ballast et attendent des fruits ou des gâteaux que des hindous ne tardent pas à leur jeter. Ce ne sont alors que courses poursuites cavalcades et bagarres entre mâles dominants quand un plus jeune s’empare d’une part de nourriture avant le chef.
Ces petits humains ont le contour des yeux plus blanc qui se détache sur leur pelage marron, comme s’il était maquillés. Cela leur donne un regard si expressif qu’ils vous dévisagent avec presque autant d’intensité qu’un mendiant attendant en souriant son aumône. Le cul posé à même la pierre, excités à la vue de la nourriture, les impudiques exhibent des sexes turgescents, sortis en érection de leurs fourreaux. Des femelles s’approchent plus près encore des wagons. Un gros mâle monte sur le toit, tandis qu’un autre s’installe entre les deux wagons à la place désertée par le freineur parti boire un thé épicé au buffet de la gare miniature. Sur le ballast, les macaques attendent près des hommes qui boivent et mangent des samosas debout au buffet. Leurs silhouettes font comme si d’étranges chiens s’étaient mélangés à une troupe d’humains. Ils gardent une distance de sécurité, bien qu’ils sachent ne pas craindre pour leur vie.
Soudain, des cris proviennent d’un des wagons. Un mâle s’est emparé du biberon qui dépassait d’un sac et nonchalamment presque avec agilité a rejoint la frondaison d’un acacia flamboyant, mordant la tétine pour mieux disposer de ses mains et escalader le tronc. En sécurité sur une haute branche, narguant le public des humains, il a arraché le tétine et il a bu lentement le lait. Fier de son forfait, le soudard provoquait l’assistance des voyageurs incrédules par tant d’audace et d’intelligence et pour rire de ce bon tour joué aux humains, quand il a eu fini de boire le lait qui lui dégoulinait des babines, il a laissé tomber le biberon qui ne l’intéressait plus. On se serait attendu à le voir roter d’aise.
18:22 | Lien permanent | Commentaires (0)
Précis d'humiliation
Par Bernard Noël

Toujours, l’État s’innocente au nom du Bien public de la violence qu’il exerce. Et naturellement, il représente cette violence comme la garantie même de ce Bien, alors qu’elle n’est rien d’autre que la garantie de son pouvoir. Cette réalité demeure masquée d’ordinaire par l’obligation d’assurer la protection des personnes et des propriétés, c’est-à-dire leur sécurité. Tant que cette apparence est respectée, tout paraît à chacun normal et conforme à l’ordre social. La situation ne montre sa vraie nature qu’à partir d’un excès de protection qui révèle un excès de présence policière. Dès lors, chacun commence à percevoir une violence latente, qui ne simule d’être un service public que pour asservir ses usagers. Quand les choses en sont là, l’État doit bien sûr inventer de nouveaux dangers pour justifier le renforcement exagéré de sa police : le danger le plus apte aujourd’hui à servir d’excuse est le terrorisme.
Le prétexte du terrorisme a été beaucoup utilisé depuis un siècle, et d’abord par les troupes d’occupation. La fin d’une guerre met fin aux occupations de territoires qu’elle a provoquées sauf si une colonisation lui succède. Quand les colonisés se révoltent, les occupants les combattent au nom de la lutte contre le terrorisme. Tout résistant est donc qualifié de « terroriste » aussi illégitime que soit l’occupation. En cas de « libération », le terroriste jusque-là traité de « criminel » devient un « héros » ou bien un « martyr » s’il a été tué ou exécuté.
Les héros et les martyrs se sont multipliés depuis que les guerres ont troqué la volonté de domination contre celle d’éradiquer le « terrorisme ». Cette dernière volonté est devenue universelle depuis les attentats du 11 septembre 2001 contre les tours du World Trade Center : elle a même été sacralisée sous l’appellation de guerre du Bien contre le Mal. Tous les oppresseurs de la planète ont sauté sur l’occasion de considérer leurs opposants comme des suppôts du Mal, et il s’en est suivi des guerres salutaires, des tortures honorables, des prisons secrètes et des massacres démocratiques. Dans le même temps, la propagande médiatique a normalisé les actes arbitraires et les assassinats de résistants pourvu qu’ils soient « ciblés ».
Tandis que le Bien luttait ainsi contre le Mal, il a repris à ce dernier des méthodes qui le rendent pire que le mal. Conséquence : la plupart des États – en vue de ce Bien là - ont entouré leur pouvoir de précautions si outrées qu’elles sont une menace pour les citoyens et pour leurs droits. Il est par exemple outré que le Président d’une République, qui passe encore pour démocratique, s’entoure de milliers de policiers quand il se produit en public. Et il est également outré que ces policiers, quand ils encombrent les rues, les gares et les lieux publics, traitent leurs concitoyens avec une arrogance et souvent une brutalité qui prouvent à quel point ils sont loin d’être au service de la sécurité.
Nous sommes dans la zone trouble où le rôle des institutions et de leur personnel devient douteux. Une menace est dans l’air, dont la violence potentielle est figurée par le comportement des forces de l’ordre, mais elle nous atteint pour le moment sous d’autres formes, qui semblent ne pas dépendre directement du pouvoir. Sans doute ce pouvoir n’est-il pas à l’origine de la crise économique qui violente une bonne partie de la population, mais sa manière de la gérer est si évidemment au bénéfice exclusif de ses responsables que ce comportement fait bien davantage violence qu’une franche répression. L’injustice est tout à coup flagrante entre le sort fait aux grands patrons et le désastre social généré par la gestion due à cette caste de privilégiés, un simple clan et pas même une élite.
La violence policière courante s’exerce sur la voie publique ; la violence économique brutalise la vie privée. Tant qu’on ne reçoit pas des coups de matraque, on peut croire qu’ils sont réservés à qui les mérite, alors que licenciements massifs et chômage sont ressentis comme immérités.D’autant plus immérités que l’information annonce en parallèle des bénéfices exorbitants pour certaines entreprises et des gratifications démesurées pour leurs dirigeants et leurs actionnaires. Au fond, l’exercice du pouvoir étant d’abord affaire de « com » (communication) et de séduction médiatique, l’État et ses institutions n’ont, en temps ordinaire, qu’une existence virtuelle pour la majorité des citoyens, et l’information n’a pas davantage de consistance tant qu’elle ne se transforme pas en réalité douloureuse. Alors, quand la situation devient franchement difficile, la douleur subie est décuplée par la comparaison entre le sort des privilégiés et la pauvreté générale de telle sorte que, au lieu de faire rêver, les images « people » suscitent la rage. Le spectacle ne met plus en scène qu’une différence insupportable et l’image, au lieu de fasciner, se retourne contre elle-même en exhibant ce qu’elle masquait. Brusquement, les cerveaux ne sont plus du tout disponibles !
Cette prise de conscience n’apporte pas pour autant la clarté car le pouvoir dispose des moyens de semer la confusion. Qu’est-ce qui, dans la « Crise », relève du système et qu’est-ce qui relève de l’erreur de gestion ? Son désastre est imputé à la spéculation, mais qui a spéculé sinon principalement les banques en accumulant des titres aux dividendes mirifiques soudain devenus « pourris ». Cette pourriture aurait dû ne mortifier que ses acquéreurs puisqu’elle se situait hors de l’économie réelle mais les banques ayant failli, c’est tout le système monétaire qui s’effondre et avec lui l’économie.
Le pouvoir se précipite donc au secours des banques afin de sauver l’économie et, dit-il, de préserver les emplois et la subsistance des citoyens. Pourtant, il y a peu de semaines, la ministre de l’économie assurait que la Crise épargnerait le pays, puis, brusquement, il a fallu de toute urgence donner quelques centaines de milliards à nos banques jusque-là sensées plus prudentes qu’ailleurs. Et cela fait, la Crise a commencé à balayer entreprises et emplois comme si le remède précipitait le mal.
La violence ordinaire que subissait le monde du travail avec la réduction des acquis sociaux s’est trouvée décuplée en quelques semaines par la multiplication des fermetures d’entreprises et des licenciements. En résumé, l’État aurait sauvé les banques pour écarter l’approche d’un krach et cette intervention aurait bien eu des effets bénéfiques puisque les banques affichent des bilans positifs, cependant que les industries ferment et licencient en masse. Qu’en conclure sinon soit à un échec du pouvoir, soit à un mensonge de ce même pouvoir puisque le sauvetage des banques s’est soldé par un désastre?
Faute d’une opposition politique crédible, ce sont les syndicats qui réagissent et qui, pour une fois, s’unissent pour déclencher grèves et manifestations. Le 29 janvier, plus de deux millions de gens défilent dans une centaine de villes. Le Président fixe un rendez-vous aux syndicats trois semaines plus tard et ceux-ci, en dépit du succès de leur action, acceptent ce délai et ne programment une nouvelle journée d’action que pour le 19 mars. Résultat de la négociation : le « social » recevra moins du centième de ce qu’ont reçu les banques. Résultat de la journée du 19 mars : trois millions de manifestants dans un plus grand nombre de villes et refus de la part du pouvoir de nouvelles négociations.
La crudité des rapports de force est dans la différence entre le don fait aux banques et l’obole accordée au social. La minorité gouvernementale compte sur l’impuissance de la majorité populaire et la servilité de ses représentants pour que l’Ordre perdure tel qu’en lui-même à son service. On parle ici et là de situation « prérévolutionnaire », mais cela n’empêche ni les provocations patronales ni les vulgarités vaniteuses du Président. Aux déploiements policiers s’ajoutent des humiliations qui ont le double effet d’exciter la colère et de la décourager. Une colère qui n’agit pas épuise très vite l’énergie qu’elle a suscitée.
La majorité populaire, qui fut séduite et dupée par le Président et son clan, a cessé d’être leur dupe mais sans aller au-delà d’une frustration douloureuse. Il ne suffit pas d’être la victime d’un système pour avoir la volonté de s’organiser afin de le renverser. Les jacqueries sont bien plus nombreuses dans l’histoire que les révolutions : tout porte à croire que le pouvoir les souhaite afin de les réprimer de façon exemplaire. Entre une force sûre d’elle-même et une masse inorganisée n’ayant pour elle que sa rage devant les injustices qu’elle subit, une violence va croissant qui n’a que de faux exutoires comme les séquestrations de patrons ou les sabotages. Ces actes, spontanés et sans lendemain, sont des actes désespérés.
Il existe désormais un désespoir programmé, qui est la forme nouvelle d’une violence oppressive ayant pour but de briser la volonté de résistance. Et de le faire en poussant les victimes à bout afin de leur démontrer que leur révolte ne peut rien, ce qui transforme l’impuissance en humiliation. Cette violence est systématiquement pratiquée par l’un des pays les plus représentatifs de la politique du bloc capitaliste : elle consiste à réduire la population d’un territoire au désespoir et à la maintenir interminablement dans cet état. Des incursions guerrières, des bombardements, des assassinats corsent régulièrement l’effet de l’encerclement et de l’embargo. Le propos est d’épuiser les victimes pour qu’elles fuient enfin le pays ou bien se laissent domestiquer.
L’expérimentation du désespoir est poussée là vers son paroxysme parce qu’elle est le substitut d’un désir de meurtre collectif qui n’ose pas se réaliser. Mais n’y a-t-il pas un désir semblable, qui bien sûr ne s’avouera jamais, dans la destruction mortifère des services publics, la mise à la rue de gens par milliers, la chasse aux émigrés ? Cette suggestion n’est exagérée que dans la mesure où les promoteurs de ces méfaits se gardent d’en publier clairement les conséquences. Toutefois à force de délocalisations, de pertes d’emplois, de suppressions de lits dans les hôpitaux, de remplacement du service par la rentabilité, d’éloges du travail quand il devient introuvable, une situation générale est créée qui, peu à peu, met une part toujours plus grande de la population sous le seuil du supportable et l’obligation de le supporter.
Naturellement, le pouvoir accuse la Crise pour s’innocenter, mais la Crise ne fait qu’accélérer ce que le Clan appelait des réformes. Et il ose même assurer que la poursuite des réformes pourrait avoir raison de la Crise… Les victimes de cette surenchère libérale sont évidemment aussi exaspérées qu’ impuissantes, donc mûres pour le désespoir car la force de leur colère va s’épuiser entre un pouvoir qui les défie du haut de sa police, une gauche inexistante et des syndicats prenant soin de ne pas utiliser l’arme pourtant imbattable de la grève générale.
Pousser à la révolte et rendre cette révolte impossible afin de mater définitivement les classes qui doivent subir l’exploitation n’est que la partie la plus violente d’un plan déjà mis en œuvre depuis longtemps. Sans doute cette accélération opportune a-t-elle été provoquée par la Crise et ses conséquences économiques, lesquelles ont mis de la crudité dans les intérêts antipopulaires de la domination, mais la volonté d’établir une passivité générale au moyen des media avait déjà poussé très loin son plan. Cette passivité s’est trouvée brusquement troublée par des atteintes insupportables à la vie courante si bien - comme dit plus haut – que les cerveaux ont cessé d’être massivement disponibles. Il fallait dès lors décourager la résistance pour que son mouvement rendu en lui-même impuissant devienne le lieu d’une humiliation exemplaire ne laissant pas d’autre alternative que la soumission. Ainsi le pouvoir économique, qui détient la réalité du pouvoir, dévoile sa nature totalitaire et son mépris à l’égard d’une majorité qu’il s’agit de maintenir dans la servilité en attendant qu’il soit un jour nécessaire de l’exterminer.
© Bernard Noël
voila ceki di wiki sur les publications du nobelisable Bernard Noël/......
Chez P.O.L.
La Maladie du sens, 2001
Le 19 octobre 1977, Flammarion, 1979, rééd. 1998
Treize cases du je, 1998
La Langue d'Anna, 1998
Portrait du monde, 1988
La Reconstitution, 1988
Onze romans d'oeil, 1988
Journal du regard, 1988
Le Reste du voyage, 1997
Le Syndrome de Gramsci, 1994
L'Ombre du double, 1993
Chez Fata Morgana
Le tu et le silence, Fata Morgana, 1998
La rumeur de l'air, Fata Morgana, 1986
La moitié du geste, Fata Morgana, 1982
L'été langue morte, Fata Morgana, 1982
D'une main obscure, Fata Morgana, 1980
Le Château de Hors, Fata Morgana, 1979
Une messe blanche, Fata Morgana, 1977
À vif enfin la nuit, Fata Morgana, 1968
Chez d'autres éditeurs
Le Roman d'Adam et Eve, L'Atelier des Brisants, 2001
Magritte, 1998
À côté de pourquoi, Æncrages & Co, 1995
L'Espace du désir, l’Écarlate, 1995
La Maladie de la chair, Petite bibliothèque Ombre, 1995
La Castration mentale, Ulysse fin de siècle, 1994
La Chute des temps, poésie/Gallimard, 1993, ISBN 2-07-032773-6
Le Château de Cène, Jérôme Martineau, 1992
Écrit de la mer, Æncrages & Co, 1991
Les premiers mots, Flammarion, 1990
La rencontre avec Tatarka, Talus d'Approches, 1986
Fables pour ne pas, Unes, 1985
L'enfer, dit-on…, Herscher, 1983
La chute des temps, Flammarion, 1983
Poèmes 1, Flammarion/Textes, 1983
Bruits de langues, Talus d'Approches, 1980
Lecture du chilom, Brandes, 1977
L'Outrage aux mots, Pauvert, 1975
Treize cases du je, Flammarion, 1975
Le Dictionnaire de la Commune, Hazan, 1971 (Flammarion, coll."Champs", 1978, 2 vol.)
La face de silence, Flammarion, 1967 (Prix Artaud)
Extraits du corps, Minuit, 1958
Les yeux chimères, Caractères, 1953
Œuvres poétiques [modifier]
Aux éditions de la galerie Remarque
D'un regard l'autre ill Paul Trajman
Extraits du temps ill Leonardo Rosa
Lettre verticale ill Leonardo Rosa
Aux éditions Unes , éditions de tête et éditions courantes
Fable pour cacher,1982. ill Serge Plagnol
L'air est les yeux,1982.ill. J. Voss
A partir de la fin, 1984.
La vieille maison, 1984. ill. Serge Plagnol
Fable pour le vent, 1985.ill. J.J. Ceccarelli
Fables pour ne pas, 1985.ill. G. Pastor
Carte d'identité, 1986. ill. C. Deblé
Fenêtres fermées, 1987. ill. C. Deblé
Extraits du corps, 1988. ill. G. Pastor
Le Lieu des signes, 1988. ill. J.J. Ceccarelli
La grille du temps, 1995. ill. Olivier Debré
Où va la poésie? 1997.
Vers Henri Michaux, 1998.
Correspondances, 1998. ill. C. Reins et Fred Deux
Petit traité du tu, 1998. ill M. Latil
Aux éditions de la Canopée
L'Ombre du double ill. par Thierry Le Saec
Aux éditions A Travers
Un silence lapide ill. par Jacques Clauzel
La Chute des temps
L'Eté langue morte
La Moitié du geste
La Rumeur de l'air
Sur un pli du temps
Le Syndrome de Gramsci (1993)
La Langue d'Anna (1998)
Aux éditions L'Atelier des Brisants
Onze Voies de fait / Héloïse et Abélard (2002)
Aux éditions Fissile
Sonnets de la mort (2006)
Livres d'art [modifier]
Aux éditions Belfond
Les peintres du Désir
Aux éditions Flammarion
David, Paris (1989)
Aux éditions galerie Remarque
livre d'artiste ill Paul Trajman D'un regard l'autre
livre d'artiste ill Leonardo Rosa Extraits du temps
livre d'artiste ill Leonardo Rosa Lettre verticale
Aux éditions Unes
(tirages de tête et éditions courantes)
Fable pour cacher,1982. ill Serge Plagnol
L'air est les yeux,1982.ill. J. Voss
A partir de la fin, 1984.
La vieille maison, 1984. ill. Serge Plagnol
Fable pour le vent, 1985.ill. J.J. Ceccarelli
Fables pour ne pas, 1985.ill. G. Pastor
Carte d'identité, 1986. ill. C. Deblé
Fenêtres fermées, 1987. ill. C. Deblé
Extraits du corps, 1988. ill. G. Pastor
Le Lieu des signes, 1988. ill. J.J. Ceccarelli
La grille du temps, 1995. ill. Olivier Debré
Où va la poésie? 1997.
Vers Henri Michaux, 1998.
Correspondances, 1998. ill. C. Reins et Fred Deux
Petit traité du tu, 1998. ill M. Latil
Aux éditions l'Entretoise
livre d'artiste ill. par Bernadette Griot-Cullafroz
Extraits du corps
Aux éditions de la Canopée
livre d'artiste ill. par Thierry Le Saec L'Ombre du double
Aux éditions Le silence qui roule
Dans l’écart, Collectif, ill. de Marie Alloy.
voir l'ouvrage (diffusion Art Point France)
10:34 | Lien permanent | Commentaires (0)
07/04/2009
Hé Daniel Fano vous connaissez ?

Les peintures sont de Jean Rustin
Je recommande La lecture de Fano à tous ceux que je croise sur mon chemin en disant
-hé Fano vous connaissez?
-Qui vous dites?
-Fano des Carnets du dessert de lune!!!!
En général on me regarde comme si j'étais un cinglé... Pas grave, pas grave...
-les carnets de quoi?
-Du dessert de lune!
-Mais qui a trouvé un nom pareil?
-Un éditeur belge...
-ils sont bizarre les belges, et vous avez dit comment?
-FANO!!! sans point sur le i....
L'auteur
Né en 1947, Daniel Fano a fait le journaliste à Bruxelles de 1971 à 2007. Encouragé par Joyce Mansour, Henri Michaux et Dominique de Roux, il est entré en littérature en 1966. Auteur culte depuis sa révélation par Marc Dachy et Bernard Delvaille en 1973-74. Après Un Champion de mélancolie (Editions Unes, 1986), il a subi un long silence éditorial qui ne s'est arrêté qu'avec la publication de Fables et fantaisies aux Carnets du Dessert de Lune, en 2003. Ses ouvrages parus depuis lui ont valu le Prix de la SCAM Belgique en 2007.
DANIEL FANO entretien avec ROGER LAHU
Avais-tu un projet très précis en te lançant dans la tétralogie et lequel ?
- A l'origine, au printemps 2003, je voulais juste poser un acte d'amitié. Jean-Louis Massot, en publiant Fables et fantaisies (un choix de petites proses retrouvées), m'avait sorti de dix-sept ans de silence éditorial et, pour l'en remercier, il m'a semblé qu'il fallait lui assurer ma fidélité. Je lui ai donc promis quatre livres, un par année, produits expressément pour lui. Je voulais donner à cette suite un caractère testamentaire. Le premier tome s'est développé comme une sorte d'inventaire de choses du passé que je devais ne pas oublier, mêlées à des choses à faire avant de mourir. Evidemment, l'aventure de l'écriture m'a conduit sur des chemins inattendus. L'ouvrage est assez léger, à mon sens, parce que je ne savais pas jusqu'où je pouvais aller, je me retenais pour ne pas embarrasser Jean-Louis, que je ne connaissais pas assez. Quand je lui ai livré L'Année de la dernière chance, j'ai compris qu'avec lui, je pouvais aller bien plus loin, plus fort. D'où Le Privilège du fou et Sur les ruines de l'Europe, où, au lieu de dribbler gentiment le journal intime et l'autobiographie, je me suis enfoncé avec détermination dans le cauchemar de l'Histoire.
Ce "cauchemar climatisé" dont parle Henry Miller, n'est-ce pas ? Tu en exprimes toute l'horreur - mais aussi l'absurdité, voire les côtés risibles - en utilisant une technique d'écriture qui s'apparente au cut-up de William Burroughs - autre grand contempteur des Temps Modernes. Acceptes-tu cette "filiation" ?
- Je serais bien présomptueux de m'autoproclamer héritier spirituel de Burroughs, mais il est évident qu'il figure au premier rang des écrivains qui ont formé ma vision du monde et ont influencé ma façon d'écrire. Ceci dit, je ne fais pas dans le cut-up, je suis plutôt coutumier de la parataxe.
Peux-tu expliquer comment, au juste, tu travailles : comment accumules-tu la somme énorme de références en tous genres qui grouillent dans tes livres, comment les assembles-tu, comment mixes-tu fiction et "données brutes" ?
- D'abord, je lis beaucoup de journaux, de magazines, je lis les articles et interviews sur les faits de société, les guerres en cours, en soulignant des phrases, des paragraphes qui, pour moi, sont symptomatiques de la confusion des esprits et de l'ensauvagement radical de l'humanité. Je les découpe et les classe par thèmes dans des chemises. Quand j'y reviens, je cherche des correspondances, des connexions possibles entre ces informations, je les soumets au régime des coïncidences et des contradictions. Parallèlement, je parcours des "vieux" ouvrages historiques centrés sur tous les conflits depuis la Guerre d'Espagne, achetés chez les bouquinistes, où je pointe des anecdotes et réflexions qu'on retrouve rarement dans les publications actuelles. Je procède avec ce matériau livresque de la même façon qu'avec le matériau presse. Je ne réalise jamais de collage de fragments bruts, je transforme "en littérature" dès que je porte sur le papier la première version de la plus petite à la plus grande séquence. Chaque séquence est construite sur des jeux d'échos, d'assonances. A l'intérieur de la séquence, je peux réactiver des pratiques observées, par exemple, chez les Objectivistes américains (Reznikoff, Zukowski) ou les Formalistes russes (Chklovski, Tynianov). J'insère aussi des micro-fictions de mon crû, très Série Noire ou roman d'espionnage, avec des personnages imaginaires et récurrents dont la création est, pour la plupart d'entre eux, antérieure à la tétralogie (Monsieur Typhus est apparu vers1978). Je n'ai raconté là que le tout début du processus de composition mais ça donne une idée de comment je bricole mon affaire, non ? C'est difficile d'en rendre compte "en général". C'est une sorte de cocktail où entrent tant d'ingrédients à doses tellement variables ! Ainsi, pour écrire Sur les ruines de l'Europe et sa suite, je me suis spécialement intéressé aux films d'horreur, où j'ai découvert une dimension politique, subversive même, alors que je m'attendais à y trouver essentiellement du Grand-Guignol.
Jeux d'échos… Assonances… Objectivistes américains : autant de références indirectes à la poésie, même si aujourd'hui la question des "genres" littéraires est en grande part obsolète, considères-tu ton travail d'écriture comme un travail de poète ou de prosateur ?
- Ce que je publie au Castor Astral (La Nostalgie du classique en 2004 et, en juin 2007, Comme un secret ninja) passe immédiatement pour de la poésie - à cause du dispositif "en drapeau", sans doute. Pour la tétralogie, c'est moins évident, bien que je trace derrière des œuvres assurément poétiques (j'aurais dû ajouter les Cantos de Pound, La Terre Vaine de T.S. Eliot, Mobile de Butor), c'est d'abord la prose qui est visible. En fait, il s'agit de "poésie dans la prose", plus précisément de poésie narrative, un peu dans la ligne (brisée, d'accord) de Nazim Hikmet et de ses Paysages humains. Personnellement, je trouve qu'il y a trop de lyrisme dans Le Privilège du fou et Sur les ruines de l'Europe. La "suite", La Vie est un cheval mort, sera plus hybride, mélange de "vrais" poèmes (que j'appelle poèmes appliqués) et textes journalistiques - voire dépêches "sans style", par exemple (modèle: Paterson de William Carlos Williams). Moi, j'aime que ça gratte, grince, tousse et boite. Poésie, oui, mais à cloche-pied.
Quels livres de poésie "à cloche-pied" ou plus "appliqués" - pour reprendre tes "appellations" - font partie de ta bibliothèque essentielle et t'accompagne depuis longtemps ou depuis peu ?
- Quand je parle de "poésie à cloche-pied" ou de "poèmes appliqués", je parle exclusivement de ma production à moi. Considérant la barbarie du monde, je ne peux qu'ironiser sur le caractère futile, dérisoire de ma petite entreprise. Qu'est-ce que c'est que ce type qui n'est dupe d'à peu près rien, qui acquiesce à la condamnation d'Artaud ("Toute l'écriture est de la cochonnerie") et persiste néanmoins dans l'illusion littéraire ? Mettons que ce fils d'ouvrier a investi ce mode d'expression de la caste bourgeoise et qu'il en a fait un usage décalé, hors de son rôle de divertissement, de soumission caractérisée à "l'ordre des choses". Dans mes bons jours (soit, ils sont rares), même si c'est très amateur, très limité, tout ça, je me dis que ce n'est pas si mal, après tout.
Paru dans Liqueur 44 n°79, décembre 2006.
dessin de couv de la vie est un cheval mort paru aux éditions Les carnets du dessert de lune.
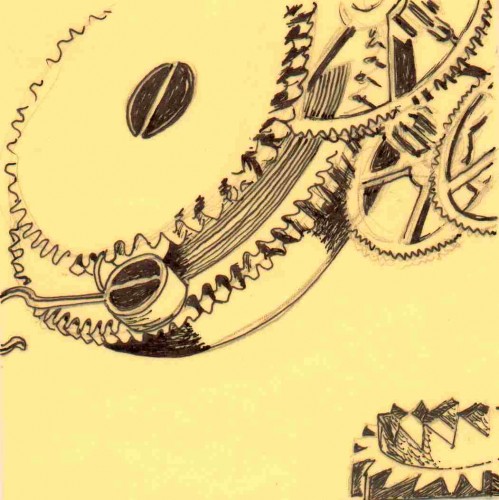
LE CHANT DES ARMES
Parus presque simultanément, La vie est un cheval mort (Les Carnets du Dessert de Lune) et Le repaire du biographe (La Pierre d’Alun) proposent une exploration étourdissante des zones les plus sombres du « cauchemar de l’Histoire ». Les assemblages textuels de Daniel Fano inventorient les horreurs du passé tout en se confrontant à un présent détraqué.
En 2003 Daniel Fano publiait Fables et fantaisies, après dix-sept années de silence, sous l’égide de Jean-Louis Massot. Ayant posé cet « acte d’amitié », il promet à l’éditeur des Carnets du Dessert de Lune une tétralogie dont le premier tome – L’année de la dernière chance – paraît l’année suivante. Suivront Le privilège du fou (2005), Sur les ruines de l’Europe (2006) et aujourd’hui La vie est un cheval mort.
Dans la lignée de ses prédécesseurs, cet ultime opus de la tétralogie – dont Graziella Federico a illustré les couvertures – est un texte long et volcanique, opposé polaire des poèmes et miniatures qui constituent La nostalgie du classique et Comme un secret ninja, parus respectivement en 2005 et 2007 au Castor Astral. Malgré ce format inhabituel, on retrouve tous les éléments qui nourrissent l’œuvre de Daniel Fano, à savoir les rapports entre politique, médias et violence
Les soixante-quatre sections de La vie est un cheval mort déploient le panorama cauchemardesque d’un monde enfermé dans la contemplation morbide de son propre spectacle, un monde où tout message, immédiatement digéré par le Moloch de l’ère contemporaine, est réduit à un borborygme vidé de tout sens. Plus court, et enrichi d’illustrations de Jean-François Octave, Le repaire du biographe peut s’envisager comme une œuvre sœur, hantée par la même vision – quoique que moins résolument pessimiste.
Les deux textes s’abreuvent à la même source : le spectacle médiatique désormais perpétuel à l’œuvre dans nos sociétés occidentales. En ressort une observation apocalyptique de notre monde où passé et présent se chevauchent en une cacophonie cruelle, tableau rêvé d’un Jérôme Bosch de l’ère post-atomique où des actrices porno devisent avec des terroristes uruguayens, où Auschwitz résonne de tubes disco, où Goebbels tape sur l’épaule de Mick Jagger sur fond de trafic de cadavres et de dessous chics.
Beretta et Bacardi, Mao et Madonna.
Ouvrages polyphoniques, La vie est un cheval mort et Le Repaire sont des travaux d’assemblage. Daniel Fano puise sa matière dans les journaux, les magazines et les livres d’histoire politique. Réécrits et recomposés, les fragments sont ensuite disposés dans un jeu d’assonances et de possibles liens souterrains :
Au début du mois, cinq cents policiers avaient envahi le bidonville, jeté la population entière hors de ses habitations, l'avait forcée à rester à plat ventre dans la rue des heures durant.
Des fouilles et interrogatoires, il ressortit qu'une trentaine de ces personnes pouvaient être qualifiées de suspectes : elles furent abattues sur place, à bout portant.
Les stars du porno cèdent à la tentation du tatouage : « Un tattoo, c'est un atout de séduction supplémentaire… comme un bijou, en fait. Chez les filles, c'est très sexe, et ça renforce le côté viril des garçons. »
Priscilla Sol en a deux, Alyson Ray en a trois : un petit papillon “derrière l'omoplate”, un scorpion, « mon signe astrologique », sur la fesse droite, et sur le mollet même côté, une rose : « Je ne sais pas pourquoi, parce que je n'aime pas trop les fleurs ».
À ces extraits tirés du réel s’ajoutent des microfictions élaborées par l’auteur, réminiscences de la Série noire et des fictions hardboiled américaines, où l’on retrouve Monsieur Typhus, Rosetta Stone, Jimmy Ravel et Patricia Bartok, personnages récurrents dans une grande partie de l’œuvre de Daniel Fano (voir, entre autres, Un champion de mélancolie et Souvenirs of You) et s’agitent à la manière de pantins sortis d’un film d’espionnage de série B :
Jimmy Ravel se retourna (vitesse de serpent), pointa sur la silhouette bondissante le canon de son Beretta 9 mm.
Monsieur Typhus frappa du tranchant de la main au larynx : le gominé glissa dans la matière cervicale de son acolyte.
Cette violence stylisée peine cependant à égaler la sauvagerie du réel. Le repaire du biographe évoque Mao souriant « avec beaucoup de douceur quand on lui montrait les photos de Liu Shaoqi supplicié en train de mourir dans ses excréments ». Dans La vie est un cheval mort, le laconisme de la description de l’assassinat de Kennedy à travers le film de Zapruder rend la scène encore plus saisissante : « Tout de suite après, c’est l’image 313, la tête qui explose. »
Si la technique de montage-assemblage de Daniel Fano évoque les cut-up pratiqués par William Burroughs – dont l’influence est manifeste et revendiquée –, l’auteur préfère se définir comme un « coutumier de la parataxe ». Procédé propre à rendre la langue parlée, il est ici utilisé pour juxtaposer une multitude de paroles désincarnées. La technique de Fano recrée ces bruits de fond chers à Don DeLillo, bande sonore d’une époque saturée d’informations, productrice de discours où annonces d’attentats, messages publicitaires et déclarations galvaudées sont reçus sans aucun ordre de valeur : les textes de Daniel Fano sont la reproduction du langage déshumanisé d’une société qui l’est tout autant, des « textes-machines » qui fonctionnent à la manière d’une TSF détraquée ou celle d’un appareil photo dont l’objectif alternerait sans cesse entre le grand angle le plus édifiant et le plan rapproché le plus trivial.
Malgré le travail de réécriture que nous avons observé sur les différents fragments, la présence du poète ne se manifeste que dans le travail de mémoire (l’auteur admettant parler de lui à travers les allusions historiques post-1947 – année de sa naissance) et la mise en séquences de voix qui ne sont pas les siennes. Cette science de l’effacement au profit du réel, Fano la tire du modernisme américain, des collages journalistiques de Dos Passos et de William Carlos Williams à la poésie objectiviste de Zukofsky et Reznikoff. Ce dernier défend l’idée d’un auteur « qui ne décrit pas directement ses émotions mais ce qu'il voit, ce qu'il entend, qui s'en tient presque à un témoignage de tribunal. » On pourrait considérer cette attitude, dans cette époque où chaque discours est désormais potentiellement récupérable et réversible, comme une stratégie de défense contre cette même récupération : en se faisant témoin, le poète évite toute prétention moralisante et donneuse de leçon. Il ricane, tout au plus, comme au sujet d’Ulrike Meinhof :
Une Angela Davis dopée au romantisme germanique.
Elle a des yeux inexpressifs.
Sa disgrâce physique n'a pas été étrangère à sa décision de se consacrer tout entière à la cause révolutionnaire.
Elle considère les abat-jour comme des objets de luxe : là où elle se pose, ils sont impitoyablement supprimés.
Elle apparaît comme un exemple typique.
Sa révolte est celle des enfants gâtés contre l'ennui distillé par une société de consommation sans suspense parce que sans dangers.
Elle n'a manifestement pas potassé son Lénine, sans quoi elle aurait su que les faits sont têtus.
Cet humour grinçant serait-il le porte-à-faux nécessaire pour empêcher les textes de Fano de tomber dans le piège du nihilisme ? Il insuffle en tout cas une dimension jubilatoire à ces deux ouvrages, que l’on peut envisager, aux côtés de son œuvre tout entière, comme les fragments éparpillés d’un témoignage terminal au procès du monde contemporain.
Jean-François Caro

La vie est un cheval mort, Bruxelles, Les Carnets du Dessert de Lune, 2009, 148 pages.
Voici le quatrième tome de la tétralogie inaugurée en 2004 avec L'Année de la dernière chance et poursuivie avec Le Privilège du fou et Sur les ruines de l'Europe.
D'ampleur plus vaste, cet opus est peut-être le plus marqué par l'humour – un humour noir et glacé à souhait. L'auteur y traite beaucoup (mais pas seulement) du terrorisme durant les quatre dernières décennies, des Tupamaros à Al-Qaida en passant par la Bande à Baader et Septembre Noir.
Chroniqueur du chaos, le moraliste se garde bien de jouer les prêcheurs, de servir une cause partisane. C'est qu'il est réfractaire aux formatages idéologiques, d'où qu'ils viennent. Donc, ici, pas de démonstration appliquée, pas de message univoque, mais un montage de faits avérés, divulgués dans la grande presse ou dans des livres qui furent d'une brûlante actualité. L'auteur ne se contente pas de déboulonner les vieilles et les nouvelles idoles, il montre le si peu de différence qu'il y a entre un journal télévisé et un film pornographique, il balaye toutes les illusions possibles, il montre les progrès d'un désastre inéluctable, le genre humain fasciné par son propre suicide en cours. Il n'est pas cynique, indifférent au sort du monde puisqu'il flirte avec la satire, ne manque pas une occasion de brocarder les formes les plus médiatisées de la vulgarité et de la grossièreté, de la bêtise arrogante et criminelle. Simplement, il se souvient de l'histoire de Loth dans la Bible : il sait que rien ne sera sauvé
Son ouvrage est essentiellement polyphonique. Il ne pose pas à l'auteur omniscient, il opère un montage de voix multiples, de paroles contradictoires, antagonistes, paroles creuses, futiles, odieuses, corrompues par les propagandes ("Le Docteur Goebbels envoie des messages de félicitation à tous les maîtres actuels de la communication, de l'information. Il reconnaît que les nazis n'étaient que des amateurs dans l'art de l'euphémisme"). Il enregistre le lourd déficit de la pensée, l'emprise totalitaire des esprits confus, il fait tourner le carrousel des mots dont le sens a été neutralisé, explosé, dispersé ("démocratie", "révolution", etc.).
Ses personnages imaginaires (particulièrement, Monsieur Typhus, Rita Remington, Rosetta Stone, Jimmy Ravel et Patricia Bartok) sont plus présents que jamais pour mieux souligner les horreurs de l'Histoire : en effet, malgré leurs prodigieux efforts réitérés , ils ne parviennent jamais à égaler – pas même à approcher – les "héros" du réel dans les actes crapuleux qu'ils commettent.
La fin de la tétralogie ne signifie nullement que l'entreprise est clôturée. Elle ouvre au contraire quantité de pistes qui déboucheront sur de nouvelles expériences et publications, notamment Typhus et compagnie (extraits déjà parus dans les revues Liqueur 44 et Luna-Park), d'ores et déjà promis aux Carnets du Dessert de Lune.
BULLETIN DE COMMANDE.pdfBULLETIN DE COMMANDE
à télécharger
en cliquant ici

16:58 | Lien permanent | Commentaires (0)
03/04/2009
Quand Charley tape son souk.....
Interview traduit par Flémal, le même qui traduit les prochain ouvrages de Pélieu en français... Une fine équipe je vous dis que ça...

Par Doug Holder
Dernièrement, j’ai fait circuler un mail demandant à des poètes ce que signifiait être « un poète raté ». Le poète A.D. Winans me mit en rapport avec le poète Charles Plymell qui – avec ironie – me proposa d’organiser un cours sur ce sujet énigmatique tout en me demandant, en guise de paiement, un chèque substantiel et/ou une réserve de came.
Charles Plymell est un poète et écrivain dont on néglige souvent l’implication dans la scène littéraire beat des années 50 et 60. Originaire de Kansas City, il quitta New York City au début des années 60 pour s’installer à Gough Street, San Francisco, où il partagea une maison avec Allen Ginsberg et Neal Cassady, dès 1963. Bien qu’il ait un peu en retrait par rapport à des personnages de la Beat tels Jack Kerouac et Allen Gisnsberg, Charles Plymell eut une grande influence. Sur sa petite presse des éditions « Charry Valley », il a publié des auteurs beat comme William Burroughs, Robert Peters et Herbert Huncke. Ginsberg a dit de Plymell qu’il était la première personne à l’avoir initié à la musique de Bob Dylan.
Plymell a eu une énorme influence dans le domaine de la BD beat, et il publia le premier numéro de ZAP COMIX sur sa presse, à San Francisco. Plymell a déclaré qu’il travaillait d’arrache-pied sur cette interview en compagnie de sa femme, l’éditrice d’avant-garde et cofondatrice de « Cherry Valley Editions », Pamela Beach, en cette torride journée de juin.

Vous êtes généralement connu comme « poète beat ». Est-ce une définition correcte ?
C’est chiant de ne pas être connu du tout, je présume, et c’est là le hic. Sautez sur la renommée quand vous le pouvez, ou adaptez votre esprit à plus de pénombre. Burroughs a dit un jour qu’il ne s’était jamais vu dans la peau d’un beat. Il voyait toujours la façon littéraire de dire les choses. Moi pas, si bien que je suis toujours embourbé dans les marécages sémantiques. Est-ce « correct » ? Je suppose que ce l’est, dans un sens littéraire historique où les étiquettes servent de désignations rapides dès qu’elles adoptent des connotations plus larges débordant sur l’histoire sociale. Par exemple, j’ai été très réticent, durant toutes ces dernières années, à contribuer à la Beat Scene de Kevin Ring, parce que je n’ai jamais pu considérer Bukowski, Fante et bien d’autres comme beat, mais à la brosse plus large, même si la couche est plus fine, elle étale l’étiquette à dessein, et nous y sommes justement. Justifier mes réticences pourrait sembler stupide. Mais non, personnellement, je déteste être éclipsé par une mouvance. En tant qu’outsider passionné, c’est toujours un signe que mon œuvre est demeurée à la périphérie d’un groupe. Selon mes propres normes, c’est tout aussi bien, toutefois. Je n’ai jamais aimé de sauter dans le biotope de quelqu’un d’autre (pour plus d’une nuit, du moins).
Vous avez dit que le Kansas City des années 50 avait été votre milieu favori, même quand vous étiez à Haight, dans les années 60. Pourquoi ?
Pour de nombreuses raisons, j’ai passé ma jeunesse à aller voir les géants du jazz, de la musique de couleur, du rhythm’n’blues hors des sentiers battus, et les chansons traditionnelles des grands noms dans les beuglants à un dollar l’entrée. Les jeunes de Haight n’ont pas cette éducation culturelle. Nous étions également à même d’avoir tout le peyotl que nous voulions et nous avions des rituels très enthousiastes sur les rives du cours d’eau. Personne n’était conscient de ce qu’il se passait quelque chose, sauf nous, si bien qu’il n’y avait pas d’ennui. Quand j’écris, à propos de mon ami de longue date, Ronnie le rapide, alias Barbitol Bob, qu’il me lisait du Pound au « Zip’s Club », c’était bien avant qu’on ait entendu parler de la Beat. Nous n’étions pas au fait des derniers phénomènes culturels de Life ou Time, mais nous n’en avions que faire. Nous passions nos nuits à la benzédrine et à la boo (marihuana), faisant le tour des clubs avec les musiciens des orchestres et les présentateurs des clubs, comme Mickey Shaughnessy, l’acteur, tout en discutant, en rigolant, en faisant les dingues jusqu’à l’heure du petit déjeuner ou en roulant hors des sentiers battus pour aller rendre visite – et fumer et boire avec eux – aux gars du style Fats Domino, et sa Caddy de 49, venu de La Nouvelle-Orléans. On allait dans un petit club où il y avait un peu de monde toute la nuit, sans discontinuer. Nous avions quelque chose de particuler, dans le Midwest, nous planions des journées entières d’affilée en achetant dans les drugstores des trucs bien plus forts que les amphétamines que Kerouac utilisait quand il écrivait. Je n’en ai jamais entendu parler du tout ailleurs, dans les autres classiques de drogues ni dans la littérature. Bob et moi avions été en taule ensemble à Wichita, en tant qu’ex-étudiants de l’école supérieure et petits truands du comprimé, mais nous lisions toujours de la grande littérature et nous avions toujours à notre disposition les grands noms de la musique au « Mrs. Dunbar’s Barbeque ». Il y a des choses qui doivent se passer en temps voulu et à l’endroit voulu, et qui ne sont pas censées se reproduire. Nous avions même étudié le zen et aussi ce new age de merde !
Je peux toujours me rappeler les années et ce que je faisais d’après les voitures que j’avais. En 49, pourtant, j’étais du côté des Dakota, à bosser sur un caterpillar (plus tard, Neal – Cassady – s’est approprié une partie de l’histoire pour un riff) près de la réserve et j’avais emprunté une Dodge 48 à un ami de mon père qui devait rentrer au Texas. Les permis de conduire, ça n’existait pas, à l’époque, dans cet État, de sorte que j’étais redescendu vers l’Oklahoma et que j’avais rejoint ma mère, qui travaillait dans un show de cascades en bagnole, planant par-dessus une rangée de voitures ou fonçant à travers une palissade en feu… enfin, ce genre de trucs. J’ai eu une nouvelle Chevrolet 51 à San Antonio que j’ai conduite jusqu’en Californie du Sud, où je suis resté un bout de temps. Puis retour au Kansas et descente sur Guadalajara et retour, puis un voyage à Baja pour me procurer de la benzédrine et de l’herbe et ma 38 Special, après quoi, j’ai suivi la saison des rodéos, chevauchant des taureaux Brahma et des broncos à cru. Travaillé dans les pipelines, aussi. Puis je suis allé un bout de temps à Hollywood, où j’ai acheté ma Buick Roadmaster 53 et je suis remonté dans l’Oregon pour travailler avec une équipe de dynamiteurs et construire un barrage sur le fleuve Columbia. J’ai acheté un remorqueur pour vivre dessus ; je l’avais baptisé le « Little Toot » (le petit coup de sirène). Puis je suis parti pour le Montana, l’Idaho et le Wyoming avec ma sœur, qui écumait les villes comme prostituée. Puis retour à Kansas City et à Wichita pour les cérémonies du peyotl et j’ai ensuite travaillé pour le Santa Fe, après quoi, je suis remonté, en traversant Denver et en refranchissant le col où j’étais passé tout môme, dans la Buick 39 de ma mère, et je suis retourné à San Francisco. Ce ne sont que quelques faits saillants des années où j’avais de nouvelles voitures, ou assez nouvelles, qui correspondaient à mes voyages de l’époque. J’ai rencontré Neal en 62 et ce fut alors qu’il me lut certains de ses péripéties marquantes du bouquin. De façon assez compréhensible, je n’étais pas tellement emballé, de sorte qu’il ne m’en a lu que deux ou trois passages. J’aimais rouler avec lui et l’amener au boulot sur ma moto.
Ainsi donc, à l’époque où je suis retourné une fois de plus à San Francisco (directement à droite, en décrochant de la Benzedrine Highway, route 66, mon trajet habituel et la découverte de Kerouac, en 1962). J’habitais dans le premier pâté de maisons juste au-dessus et après Ashbury, à Haight Street. Un couple d’autres amis de Wichita et les gens qu’ils fréquentaient étaient là. Conner avait une expo à la Batman Gallery et Ronnie le rapide vivait avec sa famille dans une Chevrolet 52. Je travaillais comme imprimeur et j’imprimais donc des trucs sur le côté. Je créais des collages et j’ai eu une expo à la Batman Gallery aussi et, en plus, je réalisai deux ou trois films en 16 mm qui firent fureur. Ils sont allés à l’Ann Arbor Film Festival, par le biais de mes amis de Wichita. Nous avions du LSD de Sandoz, puis de l’Owsley. On ne parlait pas encore d’« acide ». Nous avions également de la mescaline pure provenant d’un labo en Angleterre. Brautigan et moi, nous sommes allés nous asseoir dans un café et avons observé les changements qui s’étaient produits dans le quartier. Ç’avait été un vieux quartier russe avec de grands cafés qui servaient des pirogues farcies et de la bonne nourriture… Malheureusement, tout cela devait se barrer en couille et il me vint à l’esprit que les nouveaux venus n’étaient guère débrouillards et que la plupart d’entre eux n’avaient pas d’éducation formelle, comme les beat qui avaient constitué la précédente scène, centrée autour de City Lights et de l’attention naitonale qu’avait suscitée le mot « fuck » (baiser). Ainsi donc, je demandai à Brautigan ce qu’il advenait d’eux. Il donnait en plein dans leurs signes extérieurs. Neal me rappelait les gens avec qui j’avais glandé dans les années 50 depuis Denver jusqu’à K.C. Je m’entendais bien avec lui et, plus tard, quand Ginsberg revint d’Inde en 63, lui et Neal allaient partager l’appart de Gough Street avec moi. Je crois que Ginsberg connaissait le côté sauvage de Neal et qu’il me considérait comme une force stabilisatrice. Ainsi, j’emmenais Neal avec moi, à moto, pour qu’il se rende à son boulot, dans un magasin de pneus Goodyear situé sur Van Ness, puis j’allais à mon propre boulot, à l’imprimerie, comme les gens ringards des années 50 dont les jeunes parlent aujourd’hui. Eh bien, avec tout le cirque qu’il y avait en ville, ça n’allait pas durer longtemps !
Quelqu’un vient justement de m’envoyer une note disant que Bo Diddley est mort. Il venait de l’ancienne musique de rhythm’n’blues et de couleur que j’écoutais dans les années 50. Il était l’un des nombreux originaux qui n’ont pas reçu leur dû, du moins pleinement. Une anecdote, à ce propos : Nous vivions à un pâté de maisons ou deux de l’Avalon Ballroom, dans un appart où nous imprimions Zap, et nous organisions des soirées à poil et quelqu’un nous avait rendu visite pour nous dire de nous amener et d’aller voir le groupe qu’il faisait passer. Un drôle de nom : Pink Floyd. Un autre « nom étrange » jouait à l’Avalon à cette époque où le groupe du jour faisait salle comble, attirant des foules de hippies et jouant à fond une musique psychédélique dans des flashes de lumières stroboscopiques. Une nuit, on avait baissé les lumières et il y avait une douzaine de personnes à peu près. Bo Diddley prit place au bas de la scène, sur le devant du parquet de danse et commença par dire : « Merci, merci, merci ! Et me voici, maintenant, et je vais jouer rien que pour VOUS ! », comme s’il avait voulu insister sur l’absence d’héritage culturel, éducatif et branché des nouveaux arrivages de jeunes. Naturellement, comme nous vivions au même endroit, nous avions des billets de faveur déposés à City Lights pour aller voir Janis Joplin & Big Brother au Fillmore, quelques pâtés de maisons plus loin, dans la direction opposée. Après être passés à City Lights pour prendre les billets, la nuit s’élargit avec d’autres endroits encore où faire un arrêt, nous mettre à planer et, finalement, louper une performance historiquement importante là où les Joplin, Doors, Dylan, Rolling Stones et autres Beatles allaient bientôt réintroduire la grande musique traditionnelle qui avait été oubliée.
Bien que San Francisco dût devenir une ville bâtie sur le rock’n’roll dans les années 60, alle allait finalement devoir payer un tribut au jazz et au blues de Kansas City des années 50 pour parachever sa grandeur. Ma nostalgie couvrait les deux décennies.
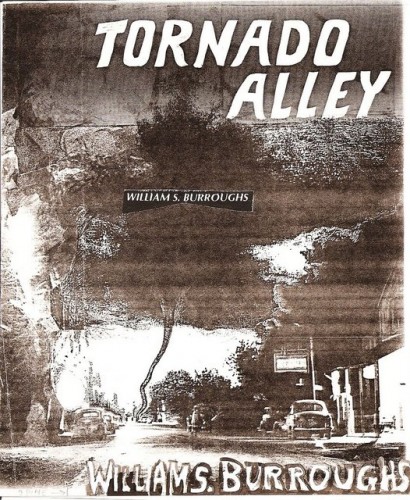
D’après les interviews que j’ai lues, vous avez été très branché sur les drogues. Des gens comme Bukowski ont juré que la boisson, la bringue, etc. étaient essentielles dans son processus de création. Rétrospectivement, tout ce LSD et le reste, était-ce une entrave ou un adjuvant ?
C’est la vieille question « à plusieurs niveaux », comme nous le disions si souvent, durant cette période. Quelqu’un avait fait remarquer qu’il pensait que nous étions en permanence sur un élévateur ! Il est difficile de répondre. La chimie du cerveau va toujours à l’infini dans de nouveaux territoires. À coup sûr, la spontanéité et l’improvisation dans le lobe frontal sont stimulées quand on retient toute cette fumée de cannabis. Les associations semblent favorables et utiles pour les musiciens de jazz, par exemple, et ça a probablement été prouvé par des expériences anecdotiques et par l’empirisme. Le cannabis, dans d’autres arts qui requièrent en même temps des motifs critiques et symboliques de l’œil au lieu de l’oreille, et toute l’implication entre le langage et le cerveau, semble davantage problématique. Il est essentiel pour les gens créatifs d’emprunter cette voie de l’excès, à moins que, d’aventure, ils ne soient innocents ou idiots. Il me serait impossible de peser ces apports via une étude tellement vague, avec un si grand nombre de variables, de ce qu’est que le substrat de la personnalité sur une masse biochimique. L’étude du cas le plus concret en resterait probablement à Kublaï Khan. Il est étrange que deux des forces les plus motivantes pour l’homme moderne qui apparaissent au sommet du paradigme sont la drogue et l’argent. Dans la colonne B, le sexe et le rock’n’roll. Ou peut-être le sexe tout au-dessus.
Albert Hofmann désapprouvait l’usage récréatif du LSD. Il estimait que les jeunes devraient l’utilioser de façon plus rituelle. C’est votre avis ?
Ouais, j’ai lu sa notice nécrologique récente et j’ai dit que c’était le gars qui utilisait du pain de seigle pour ses toasts et son thé. Oui, il y avait un conseil intelligent dans la notice nécrologique. Le juste milieu est toujours un bon conseil. J’étais plus profondément concerné par la variété que par la quantité. Même avec la benzédrine des années 50, mon corps aurait besoin d’interruptions pour récupérer au lieu de maximaliser le tout, ce qui semblait être une approche universelle pour beaucoup, dans le genre compétition plutôt que selon ce qu’aurait dicté le bon sens commun. Il y avait une certaine excitation à suivre en compagnie de Neal la piste des amphés mais, en réalité, plus il en consommait, plutôt les symptômes de consommation excessive entraient en jeu et son souci de défendre son titre de parleur le plus rapide de l’Ouest devenait plus lassant. Ainsi, il y a toujours un sommet à partir duquel la force rétrograde vers les réalités entropiques.
Il y a toujours eu une demande implicite d’ouverture des portes de l’univers intérieur. Je me souviens de ce que, juste avant l’explosion de Haight, nous étions une flopée à être en plein trip dans un appart au bas de la rue, plus bas que chez McClure. Nous avions fermé les portes à clef et nous exprimions une certaine crainte à propos de retourner là-bas à nouveau. Il y avait des motifs de crainte tout le long du chemin. Les miroires allaient changer votre visage en d’autres visages. Evidemment, c’étaient des fioles Sandoz à l’époque, à moins que Owsley ne fût déjà apparu, alors…Enfin, l’un et l’autre, c’était de la marchandise pure et seuls des fous n’auraient pas eu de trépidations personnelles ou de contre-indications. McClure s’est amené à la porte à peu près au même moment où nous nous dissolvions dans le trip et nous ne l’avons pas laissé entrer. Il avait l’air de plaisanter à propos des trips et c’était très inquiétant pour nous parce que nous avions quitté pour de bon la voie des paysages connus. Je ne sais pas si oui ou non il avait quelque expérience à ce sujet, à l’époque, mais je suis sûr qu’il en aurait pris en se faisant accompagner de ses amis médecins ou, du moins, dans des circonstances très fiables. Il ne fallait pas jouer avec cela dans les environnements normaux de la société. Je tremble rien qu’à imaginer comment les jeunes pourraient en prendre de façon aussi désinvolte. Bien sûr, je ne sais pas à quel degré les doses étaient diluées ou contaminées dès les tout premiers jours. Même une décennie plus tôt, dans les années 50, avec le peyotl, nous gravitions naturellement vers un comportement rituel là-bas dans le fond, vers les berges du cours d’eau. L’expérience en elle-même semblait requérir la cérémonie au moins d’une distorsion dans le souiffle d’une force plus élevée. Je viens de voir une stupide émission de TV sur le peyotl et d’autres expériences flashantes en provenance d’anciens chercheurs s’intéressant à Leary et à Haight. Mon Dieu ! Eh bien, ça montre que la culture est ce qu’il y a de plus contaminé. Et je me suis mis à penser à toutes les distinctions cool et branchées entourant les joints de mes jeunes années et, ensuite, j’ai essayé de m’imaginer Laura Bush et ses amis de l’amicale de l’université en train de fumer de la marihuana. Ha ! La dévaluation et la déflation dissolvent ce qui est mythique. La teinture de l’esprit n’a plus de but une fois qu’elle est moulue dans les saloperies toxiques qui se traînent le long de la voix publique expresse de la technologie accessible à tous. Dieu ne nous donnera que ce que nos mains peuvent faire et ce que nos cerveaux pourront découvrir dans la science. Notre esprit n’a pas jailli de notre image debout. La chimie des drogues se contente de remuer la gueule. Certains aiment se libérer des filets de sécurité sociale, ils haïssent les contrôles et ils chantent la liberté d’effectuer le grand plongeon cosmique. Hart Crane a dit que le fond de la mer était cruel.

City Lights 1963: Phil Whalen, Bob Branaman, Gary Goodrow, Allen Ginsberg, Bob Kaufman, Larry Ferlinghetti, Alan Russo, Charles Plymell
Un grand nombre d’entre nous, les petits imprimeurs, ont des doléances à l’égard de l’« Académie ». Vous aviez une petite presse et ce n’est pas le grand amour non plus entre vous et l’Académie…
Je ne suis plus impliqué là-dedans d’une façon ou d’une autre. La publication a changé beaucoup depuis que j’ai été actif dans le domaine. De toute façon, j’étais quelqu’un qui devait être radié de la liste des donations pour appartenance à des associations d’anciens universitaires. Toute activité institutionnelle a toujours besoin d’un souffre-douleur ou d’un bouc émissaire. De façon assez ironique, il s’agit toujours de la personne qui aurait pu en tirer le meilleur profit. Après une vie d’engagement, je ne lis ma poésie que lorsque des amis organisent un rassemblement intéressant ou lorsqu’un pays à la culture florissante m’invite à un forum. Je suis probablement l’un des rares poètes à avoir besoin d’honoraires pour vivre plutôt que d’un rappel de son curriculum vitae. Si je puis ajouter un peu de rab à mon chèque de sécurité sociale d’à peine 700 dollars par mois, je le fais. Sur le plan des publications, je ne vois plus de poésie et je lis surtout de la physique et je passe de longues nuits à réfléchir à ce que je ne comprends pas et, parfois, je lis ce que mes copains des « comix » me font parvenir. Si je veux conserver des pensées sous forme de combinaisons verbales que j’aimerais revoir, ou si je veux avoir quelque chose à proposer à mes invités, etc., je l’imprime en privé. Cette façon de faire et l’impression on-line, c’est beaucoup plus simple et ça coûte vraiment peu, il n’y a pas de frais de stockage, etc. Je n’ai plus rien à voir avec la subsidiation des publications depuis les années 70. Cela m’a pris un bout de temps avant de comprendre que tout financement, qu’il soit privé ou public, n’aurait rien à voir avec moi. Ma femme me l’a déjà dit il y a bien longtemps. Les gens m’envoient toujours des bouquins dédiés à leur premier maître et flanqués de tout ce blabla reprenant les subventions et distinctions qu’ils ont reçues. Je vois les noms qui réapparaissaient sur le plan du financement lorsque les petites publications sont entrées sur le net : il est assez facile de voir la corruption et de voir qui était l’ami de qui. Je les liquide. Progressivement, j’en reçois moins. J’ai utilisé l’analogie avec le bureau de l’agriculture qui voulait aider les petits fermiers au moyen de subsides. Ils ont gardé l’administration pour eux-mêmes jusqu’au moment où les bureaucraties l’ont emporté sur les petits fermiers. Où il est, ce petit fermier, aujourd’hui ? Peut-être Willie Nelson le sait-il, lui ! Tout le reste, ce sont des spéculateurs qui ont manipulé les subsides. Le monde universitaire et les politicards traditionnels se récompenseront toujours eux-mêmes d’abord et ils créeront leurs légions pour favoriser leurs propres organisations. Au nom du lait ou au nom de l’art, toutes les petites villes ont leurs produits subsidiés et homogénéisés, à l’ère du vinyle.
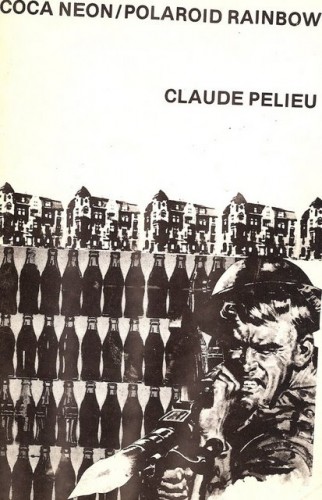
Dans une interview accordée à Jon Randall, vous disiez que Ginsberg souscrivait à tout ce qui était politiquement correct et profitablement correct. À une certaine époque, ç’avait été dans la publicité, non ?
J’ai toujours pensé que c’était apparent. Je me rappelle l’avoir emmené à une réunion de dotation nationale où il fit en sorte qu’aussitôt, il parvint à décrocher des subsides pour lui et Peter et tous ses copains du Lower East Side, dont certains m’avaient demandé d’écrire sur eux. À peu près à la même époque, mon ami Rod McKuen était en ville et je lui avais demandé s’il ne pouvait rien faire pour aider Cherry Valley Editions et j’avais demandé à Allen de lire avec pour une soirée bénéfices, mais Allen dit que cela devrait se faire ailleurs et au Kansas, Il ne voulait offenser personne de sa circonscription. Cela, après que je l’avais introduit à sa grande lecture à la bibliothèque Shakespeare de Folger. Il me dit, la première fois que nous nous rencontrâmes, qu’il avait travaillé comme chercheur de marché. Si c’était le cas, je pensais qu’il utilisait toutes ces ficelles à bon escient pour goupiller sa carrière. Il était excellent dans ce genre de chose. Je pensais que c’était une bonne chose à avoir, mais ça demandait un tas de boulot. Il était au téléphone, cette fois. Je ne pense pas que Burroughs faisait de la pub, mais il aimait que d’autres fassent la sienne. Comme il disait : et vous pas ? Bremser, lui, c’était pas le genre. Neal, lui, c’était justement sa force.
Nous avons un ami commun, Hugh Fox, une icône de la scène des petits éditeurs. Récemment, Ibbetson Street Press a publié ses mémoires controversés : Way, Way Off the Road. Comment vous, les gars, vous êtes-vous connectés, à l’époque ?
J’ai connu Hugh surtout à l’époque de l’édition, dans les années 70. Nous avons publié son bouquin et il était copain avec la mère de Pam, Mary Beach, et son mari Claude Pélieu. Il s’en allait toujours à KC ou à Rio avec des histoires incongrues d’un très grand intérêt. Tout ce dont il avait besoin, c’était de quelqu’un qui lui cherchât un marché ! Eh bien, nous étions au Nouveau-Mexique pour une conférence sur la littérature, voici trente ou quarante ans et je m’assis dans un endroit où il y avait des présentations et une bonne femme sur son trente et un vient de mon côté. C’était Hugh ! Plus tard, nous sommes allés à une party, à la maison d’un Mexicain, à l’intérieur du pays. C’était un écrivain dont j’ai oublié le nom, mais le le voyais partout, à l’époque. Manifestement, il avait des lins avec le directeur des programmes qui finit par être soûl et qui se mit à me peloter. Plus tard, à l’hôtel, la directeur eut la chambre en face de la mienne et il ouvrit sa porte, sortit sa bite. Il voulait que je la lui suce. Elle était petite, sombre et recourbée, de sorte que je refusai. Je ne sus jamais si c’était la grande demande ou pas. Cela me frustra parce que j’avais entendu des histoires de gens qui avaient du pouvoir au niveau du gouvernement et qui vendaient leur influence moyennant des rapports sexuels et des histoires du même tonneau, maios je ne connaissais pas le protocole. Pas étonnant qu’ils se fussent donné le nom de fraternités ou confréries. Je présume que ça continue de la sorte aujourd’hui pour beaucoup de gens, comme le foot taper. C’était si peu romantique, mais le sexe sur la scène beat, c’était comme ça aussi. La majeure partie de l’affaire, c’était une industrie du genre service, quasiment clinique. J’avais besoin de faire plus de recherche, dans ce secteur. Au Kansas, tout était considéré comme allant de soi, mais ce n’était pas lié au pouvoir, de sorte que je me sentais comme les hippies ignorants, pas de copains malins, pas de liens avec l’éducation, pas de subventions !
Un ami à moi, Jack Powers, qui a fondé Stone Soup Poets à Boston, dit que « On the Road » de Kerouac l’a libéré des contraintes de son contexte catholique irlandais de Boston. Comment cela vous a-t-il affecté ? Vous avez écrit un bouquin sur un thème similaire : « Last of the Moccasins »…
Ouais, je me souviens de Jack. Il m’avait fait écouter « Blues Eyes Crying in the Rain », de Willie Nelson, au Stone Soup. Je présume que les rebelles d’Austin commençaient à se faire connaître, à l’époque. La version de Willie en était vraiument une, naturellement. Jack m’a regardé avec un regard sans expression quand je lui ai dit que ma mère me la chantait déjà dans le temps. Elle l’avait appris de Roy Acuff à la radio. Le bouquin de Kerouac a été une catharsis pour des tas de jeunots de par le monde entier. Je ne l’ai jamais lu. Neal m’en lisait des passages et j’en ai découvert d’autres dans des anthologies de littérature. Ma catharsis ne peut sans doute pas être mise en rapport avec un événement. Elle était rpobablement sur la route. Je ne suis pas sûr de la ligne du temps quand il écrivit son bouquin, mais j’avais décidément campé à l’arrière d’un vieux camion International (à peu près la même année que l’autocar Further original) et j’avais conduit une Buick 39 de l’autre côté des Rocheuses. J’étais probablement dans les Dakota, à ce moment, dormant dans la prairie. Et, en 52, je retournais à KC pour écouter Jay McShann et, plus tard, Charley Parker. Il était plus vieux et avait une bonne oreille pour le jazz et il était l’un des rares poètes capables de mettre de la poésie dessus. Allen me lisait ses poèmes de Mexico City Blues. Je ne suis jamais entré dans sa prose. À l’exception de son jazz, je ne fus pas impressionné par lui et je pensais que la plupart des gens de la Beat étaient assez ringards, dans les débuts. Je croyais que Huncke était un véritable hipster, Neal un phénomène et que Burroughs supplantait toutes les étiquettes. Ma jeunesse fut très éloignée des mentalités de ward-heads des villes de la côte est. La géographie culturelle était différente. Ma géographie allait du Mississippi à la Californie. La liberté géographique expansive était une catharsis continuelle, pour moi, avec peut-être un peu de peyotl ajouté à la définition médicale ! City Lights publia mon bouquin et, à peu près en même temps, refusa un livre de Kerouac et un autre de Burroughs, ds sorte que je ne sais pas quelle était la situation de l’édition. Mon bouquin se trouvait sur bien des rayons et sans paiement de droits d’auteur. Europa Verlag en Autriche l’a publié et j’ai dû partager l’avance avec City Lights. Plus tard, mes droits furent retransférés et le livre ressortit chez Mother Road, avec la fabuleuse couverture de l’artiste renommé Robert Williams, qui déclara qu’il n’était pas un artiste pour couverture mais qu’il en avait fait une pour moi en raison de mon histoire avec les Comix, du fait que j’avais été le premier éditeur de Zap et que j’étais également le premier à avoir imprimé S. Clay Wilson quand nous vivions à Lawrence, Kansas. En attendant, j’ai refilé mon dernier exemplaire du bouquin avec la couverture de Robert Williams à un collectionneur, un type sourd qui passait par hasard et que j’avais rencontré lors d’une séance de signature de Robert Williams à NYC, voici des années. De sorte que cette publication est rapidement devenue très rare mais quelqu’un (je me demande bien qui) a finalement sorti la version City Lights des caves et les libraires et les collectionneurs ont la première édition de City Lights en vente un peu partout, désormais. J’ai trouvé ça dur, de devoir partager avec des beatniks millionnaires !

Avec Neal Cassidy en 1963
En tant que petit éditeur, je suis intéressé d’en savoir plus sur la petite maison d’édition que vous avez fondée, « Cherry Valley »…
Il serait impossible de faire la liste des publications. Une partie a commencé avec Josh Norton, ici, à Cherry Valley, où nous avons reçu une ou deux petites subventions pour publier, et des poètes et écrivains célèbres ont apporté du travail et des donations. Pam Beach Plymell en sait davantage à ce sujet. Elle l’est également à propos de sa mère, feue Mary Beach, et du volumineux travail de traduction de bouuqins beat de son mari, Claude Pélieu, de leurs propres publications et de leurs archives d’arts visuels. La renommée, c’est ce qui vend les indépendants. Et il vaut mieux faire partie de quelque chose comme un mouvement ou lié aux résultats pour vendre des œuvres originales, de nos jours. Il y a très peu de littérature, chez les éditeurs plus importants. La majeure partie de ce qu’ils font est réservée à des gens qui sont connus à la télévision afin qu’on ait une copie tangible de ce qu’ils pensent. Le livre est devenu plus un phénomène d’archivation et davantage un objet en soi pour les artistes moins connus de notre époque. Nous n’avons pas d’archives pour Cherry Valley. Nous les avons vendues pour assurer nos besoins vitaux. L’université d’État de Wichita en a de complètes, je pense, et Byron Coley et Thurston Moore, à eux deux, en ont de complètes aussi à leur Yod Space de Florence. Ils ont rencontré le dernier poète artiste restant, qu’ils n’avaient pas et que nous avons publié, Paul Grillo, lors de l’expo de Claude et Mary à NYC organisée par John McWhinnie l’automne dernier.
Quels sont les poètes vivants ou morts qui correspondent à vos normes personnelles ?
Je ne subis pas de nouvelles influences parce que je lis surtout de la physique et de la science et des choses que je ne puis comprendre. Je pense que le plus grand esprit poétique de ce pays a été Loren Eiseley. Sa palette était aussi étendue que celle de Shakespeare. Je pensais qu’il n’avait pas un véhicule en prosodie formelle et en genre comme celui de Shakespeare pour utiliser la poésie et que sa prose, dans ses livres, comme « The Star Thrower », était plus poétique que la plupart des œuvres poétiques en général. Fou que j’étais, j’ai essayé de lui suggérer la chose et il m’a répondu humblement qu’il faisait beaucoup d’efforts pour essayer de placer ses mots de façon à ce que l’agencement lui plaise ou quelque chose du genre. Quand je suis allé le voir à son bureau au musée de l’Université de Pennsylvanie, je fus comme pétrifié sur place quand il sortit de son bureau. Un regard sur sa présence tout aussi minuscule m’incita à filer en douce, comme un rat, du musée. Je ne sais pas pourquoi. Son esprit sur la Platte et le mien sur le Cimarron doivent avoir fusionné à Cathedral Rocks, sur la piste nord-sud où l’on entendit la voix de la cérémonie de la « tente agitée », une catharsis sur la piste, en effet. Hart Crane, sorti d’Akron, avant l’industrie littéraire à fric, à l’époque où nous savions ce que coûtait une vraie bouteille de lait, écrivait : « Ils ont joué des ragtimes et des danses à notre porte / et nous les avons surpayé parce que nous en avions envie. » Quelques bouts de viande de Pound, ses admirables traductions – avec Noel Stock – de l’époque de Cléopâtre, prises sur les hiéroglyphes des poteries brisées, ont des allures didactiques ; elles proviennent de la vie de tous les jours, c’est très dans le genre de ce que les poètes m’envoient aujourd’hui. Les « poètes des Iles » et toutes les allusions historiques d’Hérodote. Je n’aime pas les pièces fascistes des Grecs. Les pièces m’ennuient toujours, quoi qu’il en soit, sauf « The Iceman Cometh » (Le marchand de glaces est passé) et certaines des « pièces filmées » de Tennessee Williams. Les Sonnets de Shakespeare et la poésie dans ses pièces. Gore Vidal et Burroughs demeurent toujours actuels. J. H. Fabre, le poète français de la science, les sociétés d’insectes de Wilson. Le dernier écrivain que j’ai lu (je ne lis totalement les œuvres difficiles, mais je picore dedans et je lis des extraits pour réfléchir ou pour guider mes rêves) : « Entangled Minds » de Dean Radin, « Wholeness and the Implicate Order » de David Bohm, bien qu’il se soit mis à blablater et à se réfugier dans le Za Zen, à l’instar de Gary Snyder ou l’un ou l’autre ; Richard Dawkins, « The Selfish Dream », Nadeau et « The Non-Local Universe » de Kafatos, « Body Lectric » de Becker & Seldon, qui a trait aux raisons qui pourraient disperser ou retarder l’intellect national. Cela explique aussi certains trucs de ma propre « voie vers la catharsis » en me rééclairant sur le fait que mes jeunes années se sont passées uniquement avec l’électricité de la terre, qui a une extrémité ouverte, plutôt qu’avec l’électricité produite par l’homme, qui est en circuit fermé. Les autres livres et lectures ont servi à m’aider à concrétiser une théorie que j’imagine depuis longtemps ; des endroits à force de gravité plus faible en tant qu’infime mesure de la force magnétique plus puissante.
---- Doug Holder/ Ibbetson Update/ Juin 2008/Somerville, Mass.

Charles Plymell Publications
Books:
Apocalypse Rose, Dave Haselwood Books, San Francisco, CA, 1967.
Neon Poems, Atom Mind Publications, Syracuse, NY, 1970.
The Last of the Moccasins, City Lights Books, San Francisco, CA, 1971; Mother Road Publications, 1996.
Moccasins Ein Beat-Kaleidoskop, Europaverlag, Vienna, Austria, 1980.
Over the Stage of Kansas, Telephone Books, NYC, 1973.
The Trashing of America, Kulchur Foundation, NYC, 1975.
Blue Orchid Numero Uno, Telephone Books, 1977.
Panik in Dodge City, Expanded Media Editions, Bonn, W. Germany, 1981.
Forever Wider, 1954-1984, Scarecrow Press, Metuchen, NJ, 1985.
Was Poe Afraid?, Bogg Publications, Arlington, VA, 1990.
Hand on the Doorknob, Water Row Books, Sudbury, MA, 2000
Anthologies:
Mark in Time, New Glide Publications, San Francisco, CA, 1971.
And The Roses Race Around Her Name, Stonehill, NYC, 1975.
Turpentin on the Rocks, Maro Verlag, Augsburg, W. Germany, 1978.
A Quois Bon, Le Soleil Noir, Paris, France, 1978.
Planet Detroit, Anthology of Urban Poetry, Detroit, MI, 1983.
Second Coming Anthology, Second Coming Press, San Francisco, CA, 1984.
The World, Crown Publishers, 1991.
Editors' Choice III, The Spirit That Moves Us, New York, 1992.
The Age of Koestler, The Spirit of the Wind Press, Kalamazoo, MI, 1995.

19:17 | Lien permanent | Commentaires (0)
01/04/2009
Moi, je lis le prince Pélieu.....
Ce texte est extrait du recueil collectif autour de Pélieu en librairie sous peu....
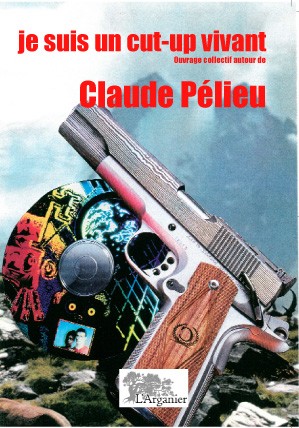
Butagaz
Texte inédit écrit à Colleville en novembre 1993, Butagaz se présente comme une série de notes éparses sur le collage, rédigées en préparation d’une interview de Claude Pélieu par Bruno Sourdin. Butagaz présente de façon clairvoyante et magistrale la vision qu’avait Claude Pélieu du collage et de l’inscription de l’art dans l’histoire.
Cue Cards
for an interview, Déc 93
the one & only
galerie Galea
Elvire Alerini
Centre d’Art Contemporain
& FRAC
Collages – murs d’écrans d’un monde fragmenté. Troubles, séduction, amusement.
Fashion, TV, Spectacles, Advertisement : l’art du 20e siècle.
Le collagiste fait bien ce qu’il fait. Si il le fait mal il recommence encore et encore pour que tout soit OK.
Si la peinture est une plaie ouverte le collage est un pansement sur le film de notre culture et de l’histoire. Le collagiste est un moine, un sage, c’est l’infirmier du vide, du tout, du rien. Un moine lumineux et déviant voyageant, immobile, entre nulle part et ailleurs.
Nous sommes, dit-on, dans les milieux spécialisés, bien informés, des héros culturels, des héros jetables, adaptés aux poubelles, plus ou moins bio-dégradables - comme n’importe quels produits de consommation, bien empaquetés, réduits en miettes entre disparition et simulation.
Nouveau degré POP, nouveau langage, nouveaux signes, nouveaux codes, nouvelles mouvances. Ready made et effacements. Empreintes aléatoires anonymes. Farces et attrapes proliférantes.
Répétitions iconiques.
Rites. Mythes. Répétitions médiatiques. Point d’ironie.
Violence diffuse, lointaine.
Mémoire collective du village global menacé. Domaine public.
La vie ne tient qu’à un film. Emotions diluées dans l’éternité, l’éternullité planétaire, le déchet exilé avec les excès du banal et du quotidien.
Collage : hasard et nécessité.
Je suis un junkie de l’image – régleur de code, éboueur de signes – tatouant la peau du langage.
Collisions des regards.
La coupure mesure les dimensions du temps, de l’espace donné, du passé, du présent, du futur.
États de conscience arrachés à l’accidentel.
Négatifs de la mémoire collective.
Ready-mades aidés.
Ready-médusés dit l’un.
Le hasard est toujours l’invité d’honneur dans le Studio Réalité.
Hyperfiction.
Quant aux « détournements » nous n’avons rien inventé.
L’anonyme bazooké choisit l’envers ou l’endroit.
Action-collage :
Une énigme qui tutoie l’oubli, le passé, le présent, le futur.
Vides et pleins qui attirent l’œil du spectateur. Flash griffant, éraflant, retournant le sur le moment, pour le moment, enchantement, ravissemement, puzzle. La réalité désintégrée.
Résidus anonymes.
Dé/collage muet.
Double langage de l’infirmier du vide.
Télé-Karma pour une autre fois.
Hasard et coup de foudre.
Rassurante étrangeté.
Violence en écho réanimant les images mortes des anonymes médusés.
La peau du collage absorbe, avale, déglutit, cautérise.
Visions hygiéniques disjonctées.
La coupure véritable.
La rédition climatisée de l’entre-deux.
C’est bien du réel qu’il s’agit.
Notre culture POP est chic et cool. Bref, on a déjà tout dit, mais pas comme il le fallait.
Note :
Bon encore des idées en l’air.
Incurable interminable baratin de l’artiste, de l’auteur, du critique, du regardeur avec ses passions, ses illusions, ses ouragans de fictions, ses effractions paisibles.
Bon encore des mots.
L’image-image, le vulgaire, le toc, le vu, l’entendu, le pire, le meilleur, l’imagisme unique et fragmentaire. Bon que dire – le collectionneur PRIVÉ, anonyme en général, a plus d’importance pour l’artiste que l’Administration Totale qui passe les commandes – et que dire des chemins de croix dans l’espace muséal où règne l’éternullité de ces personnes « déplacées » que nous sommes.
Bon, personnellement, un livre de plus, de moins, une expo, une rétro, tout ça m’est égal.
Je suis totalement indifférent, sauf à la moindre des choses.
Bon, encore des paroles en l’air.
Tout peut arriver – par hasard – voilà.
Seule la misère physique et morale est universelle.
Quand on entre dans le village global pop on se retrouve toujours en équilibre précaire. L’exil ne se nourrit plus des ordures imbéciles des souvenirs.
La mémoire nomade du collagiste ose tout et ranime l’histoire du regard moderne.
Espace muséal saturé d’objets inertes et morts. Espace bureaucratique d’une culture niant l’unité de l’âme et du corps, effaçant la modernité, désarmorçant les créations libertaires.
Les consommateurs de la culture et les abonnés toujours absents empoisonnent le radar-lecture, vont de régression en régression.
Le collage s’inscrit dans la chair de l’icône, l’image d’image. Le collagiste fait ce qu’il veut envers et contre tous, traquant le secret d’un mystère, la pièce manquante du puzzle.
Le sens commun du collage :
utiliser les mêmes images qui circulent et s’échangent entre les mondes.
Le non-sens du collage :
conjurer les stratégies perverses et criminelles du médium télévisuel et de la publicité.
Le collage transforme et recycle ce qui est. Donne à voir ce qui devrait être.
Héros jetables célébrant la fin de l’immortalité et de l’événement culturel.
Innocence, plaisir, jeu, dérive, tout ça au cœur d’un univers schizo post-industriel où tout est culture business et management, politiquement correct. Alors coller, déchirer, couper, assembler. Là où il y a à voir se trame le pire, de la politique globale à la détresse du quotidien. Le collage est un moyen de transport.
L’art n’a aucune efficacité politique directe.
La politique n’admet aucun poète, la poésie ne sert aucune idéologie, aucune religion.
L’art ne peut pas être utilisé à des fins de propagande ou de religion.
Warhol et Cézanne allaient à la messe. Les œuvres dites « mystiques » ou engagées en politique restent dans l’estomac des partis et des églises. Il arrive que poètes et artistes entrent dans l’action politique directe, mais là ils abandonnent leurs activités consciemment pour s’y consacrer. Ce sont les idiots, pour ou contre, qui ne digèrent pas. J. G. a bien démontré tout cela.
Si je savais ce qu’est la vie, l’art, Dieu, l’univers, je serais philosophe et j’écrirais des livres.
Malgré le « chiant » institutionnalisme, médiatisé, l’art et l’histoire continuent. Nous en sommes « ready-médusés ».
Censure, crise du sida, marasmes économiques, la planète livrée aux éléments refoulés, à l’intolérance, à la cruauté, à la violence, affectent chacun d’entre nous de près ou de loin.
Les Sous-Cultures mises au monde par l’ancienne contre-culture et la « pop culture » ont poussé la « génération de l’image » - toutes les étiquettes se liquéfient dans le miroir faussé de la culture dominante de tous les pays qui récupère tous ces ratages.
L’inquiétante étrangeté, les clichés médiatiques des contrôleurs et des spécialistes, ceux du monde de l’art, de l’Administration Totale, sont autant de poisons qui déstabilisent et anéantissent ce qui devient de l’art, du « grand art ».
Critiques, conservateurs, archivistes, commissaires, agents très spéciaux, théoriciens, font des artistes ce qu’ils veulent. Artistes sérieux, artistes ratés, artistes maudits, artistes grabataires, artistes mondains, artistes datés, oubliés, standardisés, vidés, officiels, etc. Par exemple : Toute l’Histoire du Rock issue de la culture populaire est reléguée aux oubliettes – le Président Clinton est plus jeune que Mick Jagger – l’art n’est pas de la culture, le travail de l’artiste n’est pas un bilan façonné par la Machine de Contrôle. Tous ces petits bidules + ou – subversifs, osés, bien léchés, bricolés hi-tech, ne nous révèlent aucun mystère. « L’art du collage » : jeu, amusement, farce, mystère, magie, poésie – tout ceci appartient à tout le monde et chacun peut en faire à sa tête.
Infection focale et vocale du « ready-made aidé » nourrit encore la notion d’objet d’art.
Nous savons tout de l’Industrie Culturelle, la Culture dominante, l’effondrement des idéologies, la disparition des utopies, le marché de l’art, les politiques culturelles, le pilonnage médiatique.
Collage, assemblage, montage, ce sont des mots de passe, des pansements sans discours, un dialogue obsolète historique.
Il n’y a pas de « raison d’être », il est merveilleux d’être sans fondations, sans racines, sans langage, redevables à personne.
Colleville, novembre 1993.
Et en prime Charley Plymell en train de lire ses textes, vous êtes gâté vous!!!!!
21:59 Publié dans Des écrivains qui vous bousculent | Lien permanent | Commentaires (0)
31/03/2009
Tous à vos cassettes!!!!!!
22:58 Publié dans La vie des bêtes racontée aux enfants | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, crise financière
28/03/2009
SONIC YOUTH
Par BEN de FRERETOC
Sonic Youth sont des amis à Claude Pélieu, raison suffisante pour en parler sur ce blog, Non?
Si j'avais suivi l'ordre chronologique, Washing machine aurait été le premier dans la liste des "disques qui ont changé ma vie". Bien-sûr, avant les Sonic Youth, j'ai dû choper un ou deux Beatles, mais ça n'avait rien à voir, les Beatles appartiennent à tout le monde, ce sont des génies universels. Leur imagerie, leur musique sont connues de tous, imprimés, qu'on le veuille ou non, dans toutes nos rétines. Et surtout, ils n'étaient plus là. Enfin, je veux dire, difficile de les voir en concert quand on a 15 piges en 1996... La rubrique "disques qui changent la vie" est, je m'en aperçois, devenue régulièrement le lieu de flashbacks sentant légèrement le renfermé, la nostalgie maladive. Mais qu'on ne me jette pas la pierre, 2008 a eu son lot de disques qui ont changé ma vie, et qui auront leur place, j'en suis sûr, dans quelques années dans cette même rubrique. Le temps fera son affaire et saura choisir les grands et reléguer les moins grands aux oubliettes, au rang des anecdotes...
Mais pour le moment, l'heure est au flashback. Sonic Youth. Washing machine. J'enclenche le mode "Grand-père Simpson" : à l'époque... euh à l'époque, rien. Nada. A la télé, Johnny, jusque là, rien de nouveau. Pour moi, la musique c'est le classique, celui de mes parents. La musique est donc sacrée. Elle est toujours associée dans mon imaginaire de gosse à quelque chose de particulièrement grave, une affaire sérieuse. Chants grégoriens, requiems, messes, j'aimais tout ça. J'aime encore d'ailleurs. Le rock, j'avais vaguement entendu parler, mais encore une fois, les seuls trucs qui me revenaient aux oreilles n'étaient que des daubes fm, et ce connard ultime qu'est Johnny, qui sacralise tout ce que j'ai toujours haï : musique, paroles, voix de merde, personnalité à gerber, à la fois beauf et réac', l'horreur. A 12 ans je le sentais déjà, et pourtant ça fait 40 ans que 60 millions de français se font berner... Passons.
Et puis, il y a eu la médiathèque, la porte de sortie de cet univers étriqué et la porte d'entrée vers de nouveaux univers musicaux... Et ce fameux Washing machine, des non moins fameux Sonic Youth. La pochette ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu jusqu'alors. Elle semblait bricolée, le cliché sorti tout droit d'un appareil jetable, pris au début d'une soirée entre potes. L'intérieur est à l'avenant, on peut voir les quatre membres de Sonic Youth (des potes à moi depuis le temps...) : soit, oyez, oyez Mister Lee Ranaldo, Mr Steeve Shelley, Mr Thurston Moore et Miss Kim Gordon. Les clichés sont naïfs, gorgés de soleil, il s'en dégage une honnêteté à des kilomètres des horreurs pondues à l'époque. Un côté "do it yourself" que j'ai tout de suite adoré.
Même si je commençais à peine à m'intéresser au rock, et que mes connaissances dans ce domaine étaient extrêmement limitées, je savais tout de même l'importance d'un groupe comme Sonic Youth. Leur réputation était déjà énorme. D'après ce que j'avais compris, ce groupe était intouchable. Respecté par tous. Une référence. En écoutant pour la première fois leur musique avec Washing machine j'ai pu réaliser à quel point tout ça n'était pas volé. Quand j'y repense : c'est le premier disque de rock que j'ai écouté, et il y avait tout dedans : de la pop, du punk, de l'expérimentation, des mecs qui jouaient de leurs grattes d'une manière indescriptible. Ils les faisaient sonner comme personne, entre arpèges pop, dissonances, saturation. J'ai pris en pleine tronche leur musique sur ce disque : compromis parfait entre leurs expérimentations bruitistes et hypnotiques et leurs envies de mélodies pop. Là, il y avait quelque chose de terriblement novateur : ces gars faisaient de l'expérimentation un terrain de jeu, débarrassé de prises de tête esthétiques. La pop redevenait sauvage, jouée toutes guitares dehors.
Sur ce disque, il n'y a que des grands morceaux, traversés de grands moments. Sonic Youth, ce sont trois voix, celle de Thurston Moore, celle de Lee Ranaldo et celle de Kim Gordon. Chaque morceau a donc son ambiance, sur laquelle vient se poser une de ces voix. Impossible, dès lors, de s'ennuyer à l'écoute d'un disque du groupe. Ecouter Washing machine c'est s'offrir un kaléidoscope hallucinant des meilleurs musiques de la seconde moitié du XX è siècle, rien de moins. De la pop empoisonnée de la superbe et inquiétante Little trouble girl (laissée aux bons soins de miss Gordon), au punk de Panty lies en passant par le déluge de la fin de Unwind morceau dans lequel on entend un enchevêtrement génial de guitares, qui donnent l'impression d'assister au début d'un orage, avec les premières gouttes qui tombent, puis tout se fait plus violent, puis puissant, un vrai déluge sonique. Mais le morceau de bravoure reste The diamond sea, qui clôt l'album. Vingt minutes touchées par la grâce, entre rêve et cauchemar, qui nous embarque dans une odyssée homérique, dont on ressort désorienté, hébété, sans savoir réellement ce qui nous est arrivé. Un trip intense, qui brouille durablement les repères.
Après Washing machine, la messe était dite : mes classeurs se couvriraient de machines à laver griffonées au stylo bic, je chercherai toujours une Little trouble girl, ma jeunesse serait sonique. Après ça, tout a changé. Tout a pris un sens nouveau. Les Sonic Youth ont déchiré le rideau de fumée qui obscurcissait ma vision des choses, ils m'ont montré un autre chemin, que je n'ai jamais cessé de suivre.
00:15 | Lien permanent | Commentaires (1)
06/03/2009
Au bord de la crise de nerfs....

carnaval biarnes cavalcade
La crise, une outre gorgée de fantasmes
Par Mouloud Akkouche
Sans argent ni relations, un ami décida dernièrement d’ouvrir une maison d’édition. Très fier, il m’appela pour m’annoncer la nouvelle et commença à détailler son projet. "Tu es complètement fou !", le coupai-je, inquiet de son intention. Fallait absolument le modérer. Et j’ai alors égrené toutes les difficultés d’une telle entreprise avant de conclure par: "Une véritable folie dans la période que nous traversons!"
Argument imparable. Il répliqua mais, peu à peu, son enthousiasme se réduisit, grignoté par le sacro-saint principe de réalité. En raccrochant, j’étais satisfait: son épouse et ses filles n’auraient pas à rembourser d’inévitables dettes.
Peu après, le flash d’infos -rarement très joyeux- sur France Inter me poussa à m’interroger sur ma réaction. Pourquoi l’avoir dissuadé d’ouvrir sa maison d’édition? D’où provenait mon appréhension?
Après réflexion, j’ai fini par comprendre. Une grande part de mon attitude provenait de mon pessimisme naturel; la bouteille pas à moitié pleine mais brisée. Pour le reste, j’étais sous son influence.
Depuis qu’elle est arrivée, rares ceux qui osent continuer de bouger, projeter, dire "je t’aime"… Elle nous suit partout, se réveille dans nos lits et s’endort entre nos bras. Invisible, elle passe de maison en appartement, de la ville à la campagne, de banlieues huppées en quartiers populaires, de PME en multinationales... Elle court, elle court… Elle est passée par ici, elle passera par-là… Même l’Inuit, isolé sur sa banquise, ne peut lui échapper. Tout le monde l’aura sans doute reconnue.
Est-elle réelle? S’agit-il d’un outil subliminal pour nous rendre encore plus dociles? Une culpabilisation mondiale? En fait, cette crise existe bel et bien et a des répercussions dans tous les secteurs de l’économie. Pas un individu n’échappe au coup de grisou des grandes places boursières.
La planète est une gigantesque salle d'attente
Calculette à la main et visages sombres sur les petits écrans, des spécialistes annoncent doctement chaque jour un lendemain pire. Un peu moins somme toute pour quelques-uns. Toutefois aussi fortunés soient-ils, eux aussi subissent les effets de cette crise planétaire et doivent ralentir leurs trains de vie. Que dire de ceux qui n’ont qu’un train de survie?
Chaque habitant de la planète est donc contaminé par ce virus issu des labos financiers. Autour de moi, je ne cesse d’entendre "Y a plus de fric, la Bourse s’effondre, les décideurs ne veulent plus décider, on peut rien faire, les subventions sont gelées…".
Comme la plupart, je relaie ce genre d’informations qui, répétées en boucle, paralysent même les plus combatifs. A force de tirer ce fil invisible d’une crise déjà fort médiatisée et par surcroît alimentée par tous, chacun se condamne à l’immobilisme. A quoi bon. Plus rien de possible en ce moment. Il faut attendre. Quoi? Personne ne sait vraiment. Et la planète devenue une gigantesque salle d’attente.
Ne pouvant influer directement sur les rouages de la finance, pourquoi ne pas essayer d’entreprendre, écrire, peindre, tourner, aimer, ouvrir une maison d’édition, rêver, rompre, ne rien faire… Tenter -ne serait que quelques minutes par jour- d’échapper à la morosité ambiante.
Les châteaux de sable n’ont certes jamais empêché les raz-de-marée mais égayent les plages. La crise, réelle et chargée de fantasmes, finira bien par se dégonfler.
En attendant, continuons de…

22:17 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : crise économique, temps modernes, faits de société
28/02/2009
Au quotidien....
Des assistantes sociales et de la première d(r)ame de France
Par Mouloud Akkouche
Le 25 février 2009 dans une gare française, je croise un gosse d’environ sept ans. Un dépliant publicitaire à la main, il marche très à l’aise dans la foule. Pourtant son visage porte des traces de coups dont deux yeux au beurre noir.
Il suit un homme qui lui ressemble beaucoup, sans doute son père ou un autre membre de la famille. Je les observe et pense évidemment que cet homme ou un autre adulte maltraite cet enfant.
Que faire dans la cohue? Alerter l’un des flics flanqués de jeunes bidasses promenant leur fusil mitrailleur? Aller demander des explications au type avec l’enfant? Si je me trompais? Comment intervenir sans aucune preuve?
Et, finalement pressé comme tous les autres passants -d’autres l’avaient aussi remarqué-, je continue mon chemin. Lâche et impuissant, incapable de lui apporter la moindre aide. Après tout je ne suis pas éduc de rue, me dédouane-je en accélérant le pas.
Aujourd’hui, je me rappelle cette expression qu’il m’arrive parfois d’employer en rigolant: "Fais pas ton assistante sociale" ou "Arrête de nous la jouer éduc". Facile à dire quand on passe sa journée à écrire, protégé de la boue du monde par un écran.
Ce jour-là, face à un regard vide, j’ai compris réellement la nécessité des travailleurs sociaux. Heureusement que toutes ces petites mains de la République sont présentes au quotidien dans nos villes et campagnes.
Contrairement à un célèbre porteur de sac de riz, ces travailleurs sociaux ne passent pas leur temps devant des caméras ou à cirer les pompes de dictateurs africains ou grand ponte de l’industrie pétrolière. Après la perte d’un maroquin de ministre lors d’un changement de gouvernement, Bernard Kouchner s’était plaint à un journal télévisé de son sort de nouveau chômeur. Aussi bon comédien qu’un autre Bernard.
Pas assez rentables ces feignants!
Peu après son arrivée à l’Elysée, la nouvelle première dame de France déclarait:
"Je voudrais aider les femmes, les enfants, lutter contre l'ignorance et contre l'exclusion."
On ne peut qu’applaudir à une telle initiative humaniste. Apparemment moins portée sur l’argent que son mari qui se fit augmenter de 170 % et qui, pendant un certain temps, cumula salaire de ministre de l’Intérieur et de président de la République, sans parler du reste, dénoncé par quelques journalistes.
Mais la façade sympathique s’effaça très vite; en excellente pro pour son actu, elle n’hésita pas à faire l’article de son nouveau disque en l’offrant aux ministres qui, ravis d’une dédicace élyséenne, s’en firent immédiatement l’écho sur le petit écran.
Mais, très altruiste, notre première dame distribuera une grosse somme à une association caritative. Un geste qui la rend désormais intouchable. Comme une autre première dame avec ses pièces jaunes. Danielle Mitterrand ou Claude Pompidou, même si je ne partage pas du tout leurs idées politiques, ont une autre envergure.
Des milliers de postes qui ne seront pas renouvelés dans la fonction publique
Tandis que madame la Présidente officie donc dans son rôle de dame patronnesse, son époux décide de supprimer -de ne pas renouveler passe mieux- des milliers de postes dans la fonction publique. Pas assez rentables, ces feignants qui interviennent pendant les tempêtes ou vous soignent à l’hôpital public…
Certains énarques, critiquant sans cesse le manque de rentabilité du service public et les impôts trop lourds, oublient que leur années d’étude dans une école publique ont été financées par les impôts de tous. Mais l’écrire ou en parler vous relègue aussitôt dans le clan des horribles poujadistes.
Bref, parmi cette charrette de fonctionnaires, il y aura des assistantes sociales et éducateurs: professionnels -sans disque à vendre- qui, jour après jour, s’échinent sur le terrain. Pas des citoyens qui, comme moi et d’autres, se contentent de constater et dénoncer après une bouffée d’indignation. Puis on passe à autre chose.
Peut-être que, en ce moment, un éducateur de rue rescapé du dégraissage tente, lui, d’apporter une aide réelle à ce gosse paumé dans une gare. Un gosse sans Rolex qui n’a pas attendu 50 ans pour rater sa vie.
publié pour la première fois par Rue 89
21:18 | Lien permanent | Commentaires (0)
Passage des Indes (2)

Andréa a penché un peu la tête sur le coté, et m’a regardé comme pour me gronder.
— Dis donc tu vas bien toi, tu maigris trop me lança-t-elle ?
— Oui, je sais mais je me suis attrapé deux ou trois diarrhées de suite.
— Tu as pris des médicaments au moins.
— Oui, mais ça s’arrête et puis ça recommence.
— Faut bien soigner ça. Tu n’as pas de sang ? Pas de fièvre ?
— Non.
— Bon. Alors Intétrix ou Imossel c’est le meilleur. J’en ai plein la pharmacie. Et puis j’ai ça aussi dit-elle ouvrant la porte de la réserve. Elle en revint avec une bouteille de pastis.
— Ce sont des amis qui me l’ont rapporté de France. Il faut que tu en boives un ou deux fonds de verre sans eau Et il faut que tu manges plus. Tu maigris à vue d’œil c’est pas bien. Il ne faut pas que tu tombes malade. Ici le climat est très dur, comme tu t’en es aperçu.
Elle se préoccupait de ma santé comme s’il s’était agi d’un de ses enfants tout en faisant fi de la sienne. Étrangement cela me rassurait aussi, de savoir que j’avais été adopté par la vieille soeur. Car l’orphelinat était un lieu où je comprenais ce qui se passait contrairement à tous les autres où je pouvais aller dans ce foutu pays. J’avais pensé que grâce a elle j’apprendrais beaucoup de l’Inde. Moi aussi j’y avais trouvé refuge.
— Depuis que je suis ici les choses ont bien changées. Je me souviens qu’on allait en vélo et ça faisait rire les Indiens. Il n’y avait qu’une seule route empierrée et peu de voitures. C’est étrange de voir comment la vie a évolué. Tout cela est vraiment proche, le temps ne se déroule pas comme en Europe, tout ici est plus lent ; le temps s’écoule d’une façon si paisible qu’il en paraît étrange. Je ne veux pas retourner en France. Pourquoi faire ? Ma vie est ici, auprès des enfants.

matin de Noël 2003 à l'orphelinat. les plus jeunes découvrent leurs cadeaux et embrassent leur maman Andréa...
16:26 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : soeur andréa, orphelinat, pondicherry
27/02/2009
Au revoir Andréa !
Soeur Andréa in memoriam.

soeur Andréa décembre 2003
Un mail est tombé envoyé par Devi probablement, la plus âgée des filles de l'orphelinat..... maman a ete hospitalisee et maintenant elle est morte.
J'ai eu le chance de croiser soeur Andréa lors de mon séjour en Inde et d'habiter à l'orphelinat pendant six mois entre septembre 2003 et mars 2004... Je m'étais promis de retourner rapidement à Pondicherry, la vie en a décidé autrement. Andréa déjà affaiblie par sa maladie, continuait à diriger sa grande maison parfois depuis son lit où il lui arrivait de rester allongée toute la journée. Malgré son état de santé elle faisait preuve d'un charisme et d'une attention de tous les instants aux enfants. Les amis, tous laïcs, qui sont passés nous voir en Inde, ont été subjugué par cette femme qui avait réussi à convaincre et à construire cette maison pour les enfants.
Biographie extraite du site de l'orphelinat:
Arrivée en Inde à l'age de 29 ans, Soeur Andréa consacre sa vie au service des pauvres : d'abord auprès des lépreux pendant 12 ans, puis comme bénévole au service social du consulat français de Pondichéry pendant 12 autres années alors qu'elle travaillait au lycée français.
Ces années au consulat lui ont permis de réaliser l'importance de la misère et l'insuffisante scolarisation des enfants.
En 1981, à l'age de 50 ans et avec l'accord de l'archevêque de Pondichéry, elle décide de créer une institution pour accueillir les enfants des rues, orphelins ou abandonnés : c'est la fondation de P.A.V.O.
Les dix-huit premiers enfants sont accueillis dans une maison en location.
Dès 1985, l'orphelinat dispose en propre de son premier bâtiment, dans le quartier Venkata Nagar au sein de la ville indienne. Grâce à des dons et au financement de l'association A.A.V.O., des locaux annexes viennent progressivement compléter le bâtiment principal.
Aujourd'hui l'orphelinat accueille environ 75 enfants, certains dès leur naissance, et jusqu'à leur autonomie vers 21-23 ans, l'age de la majorité étant fixé à 21 ans en Inde.
L'orphelinat aide aussi à l'extérieur de l'orphelinat plus de 80 enfants issus de familles très défavorisées : ces enfants peuvent ainsi continuer à vivre chez eux.
Si vous voulez en savoir plus sur Andréa et son oeuvre et contribuer à sa pérennité Cliquez Ici
Passage des Indes.
Extraits du roman à paraître.
Dans cette pièce toute sombre, éclairée seulement par deux fenêtres peu lumineuses car recouvertes d’un fin grillage censé en interdire l’accès aux moustiques, on ne distinguait pas immédiatement en venant du dehors la masse allongée du corps sur un lit au fond. Le ventilateur brassait efficacement l’air. La vieille sœur dormait sur un lit en bois dont l’armature soutenait des lanières de corde qui lui servait de sommier. Depuis son antre où elle semblait à l’agonie, elle surveillait l’orphelinat. Sa chambre, lieu stratégique de passage entre les bureaux et le réfectoire lui permettait d’entendre tout ce qui se passait.
Andréa ne s’était pas levée de la journée. Elle récupérait de sa nuit blanche. Son taux de sucre anormalement élevé la faisait terriblement souffrir des jambes. Elle se réveillera quand elle aura faim où lorsque la douleur sera trop importante. Parfois elle pleurait, autant par souffrance que par désespoir de se voir affaiblie alors qu’il y avait encore tant à faire. Pourtant elle ne prenait pas son insuline régulièrement prétextant que la veille son taux de glycémie était très bas et qu’elle se sentait bien. Cela lui faisait sur les jambes des marques à l’endroit où elle appuyait, comme un mastic mou qui aurait gardé l’empreinte du doigt.
Les jours où sa santé lui permettait, elle trottinait et d’un œil vigilant et inspectait tout. Des bureaux aux cuisines, elle donnait de la voix et sermonnait, râlait, pestait, tempêtait. Depuis son opération, comme elle ne pouvait plus monter à l’étage dans les dortoirs des grandes filles pour constater l’état de propreté, elle se contentait de vérifier si toutes les assiettes et les verres en inox étaient bien à leur place dans les étagères, ce qui lui donnait une indication sur l’état de rangement des dortoirs. Les plus grandes tentaient de faire régner l’ordre, certaines y arrivaient, à coups de décibels et de torgnoles ; ce qui est bien plus efficace.
Les assiette et les verres portaient le numéro de l’enfant. Pas de couteau ni de fourchettes prévues dans l’équipement ; simplement une cuiller. Et ceux qui avaient égaré la leur mangeaient à la main, ce qui la mettait en colère.
Les grandes, censées aider à maintenir le cap, étaient les plus souvent absentes au réfectoire. Elles se faisaient apporter leurs repas dans les dortoirs par une plus jeune. Quand la sœur inspectait les gamelles, chacun devait avoir son matériel au complet devant lui. Elle vérifiait le numéro de quelques-uns. Comme ce n’était jamais les bons, il fallait organiser un loto pour que chaque propriétaire retrouve son matériel. Loi du genre oblige, les plus grandes dérobent aux plus petites, les leur. Ils partaient à la chasse au trésor récupérer dans les dortoirs sous les lits ou dans les armoires, les assiettes manquantes.
— C’est pas possible d’être aussi indiscipliné. Vous faites n’importe quoi. La nourriture est interdite dans les dortoirs. J’ai trouvé la porte d’entrée grande ouverte cet après-midi et un rat énorme dans le dortoir des petits. Vous savez bien qu’il faut la fermer à cause des rats. Et en plus vous montez la nourriture qui les attire. Vous faites n’importe quoi… Les petits dorment en bas, il aurait pu les mordre. Un rat gros comme un chat et il était très agressif. Il a fallu se mettre à plusieurs pour le chasser. Rien ne va plus dans cette maison…
Puis il fallait attendre que la prière soit finie pour passer à table.
Quand le réfectoire bruyant résonnait des cris des gosses, cela ne manquait pas d’attirer la sœur qui arrivait de son antre en râlant :
— Non mais, c’est quoi ce bazar ? Vous faites n’importe quoi...
Elle menait sa nombreuse famille comme elle pouvait. Son autorité remise en cause par les plus grandes, les plus retors aussi, l’obligeait à des colères tonitruantes dont elle se serait bien passée. Elle arrive encore à régenter tout son monde, bien qu’elle sache que depuis sa maladie, la maison ne tournait plus comme elle l’aurait voulue.

Joseph, c’est un petit maigre, ingénu, chez qui toutes les misères du monde, se sont données rendez-vous. Pas un jour sans une chute, ou un coup de poing généreusement offert par un plus grand. Une sorte de clown triste qui ne peut exister qu’en faisant des bêtises. Et il en fait, dans le cadre de la loi de l’emmerdement maximum, appelée aussi loi de Murphy. À Dipawali, fête ô combien pétaradante qui consiste pendant deux jours à faire exploser des pétards en ribambelles, tous plus dangereux les uns que les autres, d’énormes détonations retentissent dans toute les quartiers. Tirs de mitrailleuse, claquements solitaires ; depuis les terrasses on pourrait croire que les combats d’une guerre civile à l’arme légère se déroulent en ville. Et ce n’est pas la mousson qui calme les pétaradantes joies, bien au contraire. Plus il pleut, plus les autochtones redoublent d’allégresse explosive. C’est qu’il faut les honorer les dieux ; alors ils y vont de leurs pétards. Dipawali c’est le jour où les services d’urgence sont débordés, tympans crevés, doigts brûlés, oeil énucléé...
Dipawali c’est aussi le jour où les enfants désargentés tirent leurs pétards de seconde qualité; ceux ramassés dans la rue parce qu’ils n’ont pas explosé. En dépiautant les couches superposées de papier il est possible de retrouver le bout de la mèche et de tirer dessus pour en obtenir une. Avantage ; ils sont moins cher. Inconvénient ; la mèche est bien plus courte, voire quasiment inexistante et le pétard explose très vite et bien plus fort... En réunissant les divers éléments : l’orphelinat, des pétards à mèche très courte, Joseph et Dipawali : les conditions de l’application de la loi de Murphy étaient réunies.
L’idée absolument lumineuse du petit Joseph a été de mettre un pétard dans un sac plastique après l’avoir allumé. Il a bien réussi, mais l’explosion a fait fondre le plastique et lui a douloureusement endolori la main. Un des garçons est venu me chercher pour lui porter secours. Joseph pleurait et tenait la main plongée dans un pichet rempli d’eau.
— Mais qu’est ce que tu as foutu ? Fais-moi voire ta main...
— Faut pas le dire à maman.
— T’occupe ouvre ta main ?
— Je peux pas, gémit-il.
J’ai essayé de regarder l'état de la plaie, j’ai vu des cloques, du plastique fondu, mais la poudre brûlée recouvrait tout d’une couche grisâtre et grasse.
— Désolé mon vieux mais je ne peux rien pour toi. Il faut nettoyer ça avec de l’alcool, et voir si rien n’est cassé. C’est pas normal que tu ne puisses pas bouger tes doigts. Je t’accompagne chez Dolorès.
Il ne voulait pas le bougre.
— Elle va me punir, parce que j'ai fait une bêtise.
— Mais non, mais non, elle ne va pas te punir. De toute façon tu es obligé d'aller la voir... Tu n'as pas le choix...
Il me suivait et gardait toujours la main plongée dans le pichet. Quand Dolorès nous a vu, elle a compris. Elle n’a pas réfléchi et s’est levée comme elle a pu, a réclamé ses deux grandes filles pour l'aider et venir avec elle. Son ami médecin et propriétaire de la clinique ne l'a fait jamais payer ni pour elle ni pour les enfants. Et ça fait du monde son orphelinat.
Sans hésiter elle l’a emmené à la clinique, vérifier qu’aucune fracture ne l’avait estropié, le piquer contre le tétanos... Considérant que la leçon avait suffisamment était douloureuse il n’a pas eu droit à sa paire de baffe bien méritée. Elle se contenta de le regarder avec un léger sourire narquois et de le traiter d’andouille; son insulte préférée.

l'heure du départ après six mois à Pondy, mars 2004
11:44 Publié dans un peu de poésie dans ce monde.... | Lien permanent | Commentaires (5)
10/02/2009
SŒUR PERDUE
Soeur perdue
Une nouvelle de Mouloud Akkouche

Sur la nationale, elle ralentit le rythme et se détendit. Douze kilomètres la séparait du village. Un moteur ronronna et elle leva le pouce. Le conducteur accéléra en la reconnaissant. Elle ôta son blouson qu’elle roula en boule dans le sac et reprit la route, T.Shirt collé au dos et nuque brûlante.
Une voiture freina d’un coup sec. La radio allumée à fond. Un jeune type au crâne rasé la dévisageait. Son sourire dévoila un piercing à la langue.
-Tu me reconnais ?
- T’as le permis toi maintenant ?
Il baissa le son.
-Je t’emmène.
Elle monta. L’habitacle empestait la sueur. Il démarra dans un crissement de pneus.
-C’était comment ?
Elle soupira.
Quinze jours avant, elle sortait de prison. Seule dans une ville inconnue avec quelques billets en poche. Et plus du tout envie de remonter sur un braquage. Après avoir trouvé un hôtel minable, elle poussa la porte de plusieurs boîtes d’intérim, sans succès. Mais chaque jour, on lui proposait de vendre son cul ou de la came. Elle quitta la ville.
-Tu veux pas en parler ?
Il dévorait des yeux la poitrine de Béatrice.
-La route, c’est devant.
Elle pencha la tête dehors, cheveux plaqués contre le visage, paupières closes et bouche ouverte. Elle poussa un cri et tendit l’oreille. Pas un bruit. Elle gueula plus fort. Les falaises lui répondirent. Elle sourit.
-Dépose-moi là.
-Tu veux pas que je t’emmène là-haut?
Elle claqua la portière.
*
Le cimetière était désert. Elle s’accroupit devant la tombe : Le Boiteux 1901-2007. Elle avait gardé toutes ses lettres. Le seul à lui avoir écrit.
Le jour où elle débarqua à ‘’La ferme des Pierres‘’ avec une éducatrice, il la détailla des pieds à la tête et lui tourna le dos. « Tu peux pas avoir de gosses, c’est comme ça ! engueula-t-il ma future mère, pourquoi t’es allé adopter cette gosse-là qui parle même pas notre langue ? Une gitane amnésique trouvée sur la route ».
Il en voulait à sa fille d’avoir forcé le destin. Des mois durant, il ignora l’adoptée, refusa de manger à la même table qu’elle, ne lui adressait jamais la parole. Jusqu’au moment où elle déboula dans la cuisine, une perche de 24 cm à la main. Dès la sortie de l’école, elle le rejoignait dans sa maison isolée à l’orée d’une chênaie. Le bougon solitaire l’emmenait à la chasse et la pêche. Elle assimilait très vite les noms des animaux, des fleurs, des arbres, connaissait la moindre sente, lisait les traces sur le sol, interprétait vents et nuages, déchiffrait les vols d’oiseaux... Rien ne lui échappait. Le boiteux, soulagé de transmettre ce que sa fille méprisait, lui légua un héritage de gestes et sensations. Le seul à pouvoir lui arracher des sourires.
Un matin d’hiver, tous deux chassaient sous la pluie. Après des heures, trempés jusqu’aux os, ils réussirent enfin à localiser un chevreuil au bord de la rivière : très jeune. Il leva la tête, pattes tendues. Ses nasaux frémissants sondaient l’air. Il bondit et courut. Ils se lancèrent à sa poursuite. Soudain, talonné par les chiens, l’animal se roula frénétiquement sur le sol. Les aboiements très près. Il se releva et reprit sa course, le corps couvert de boue. Truffes au sol, les chiens reniflèrent. En vain. Il ne pouvait être loin. Légèrement en hauteur, Béatrice et Le Boiteux examinèrent chaque bosquet. Les chiens piétinèrent sans succès. « Je le vois ! » murmura-t-elle, l’index replié sur la détente. Son premier gros gibier. Le vieil homme leva le canon et la balle se perdit dans les frondaisons. Elle se fâcha. Il siffla les chiens avant de tourner les talons sans explication. Le chevreuil rejoignit ses congénères. Jamais Béatrice ne comprit le geste du Boiteux.
Deux mois plus tard, il se barricada avec son fusil de chasse, prêt à défendre sa peau contre des ennemis invisibles, ennemis dégueulés par le passé. Il tirait au moindre mouvement. Béatrice, seule autorisée a pénétrer dans l’étable, réussit à le calmer. Fusil cassé en deux sur l’avant-bras, il sortit sous l’œil des gendarmes. Pour finir dans une maison de retraite.
Et elle commença à dégringoler.
*
Elle les retrouva comme elle les avait laissés. Son père, attablé devant un journal ouvert, et sa mère, l’œil dans le vague, assise dos à la cheminée. Pas l’air surpris. Son arrivée avait dû déjà faire le tour du village.
Après un échange de regards gênés, elle posa son sac et les embrassa.
-Quatre ans, souffla sa mère, c’est long…
-Tu paieras pas plus cher assis, fit son père.
Elle s’installa sur le banc.
La cafetière siffla sur la gazinière. Sa mère se leva aussitôt et éteignit le feu.
-Ma fille, répéta-t-elle en lui tapotant la main, ma fille… Tu es revenue.
-Quoi de neuf ici ?
-Que du vieux, souffla sa mère.
Béatrice détestait cette phrase.
-Regarde-moi un peu. Qu’est-ce que tu as changé ! Une vraie femme. Encore plus belle que sur la photo du journal.
Elle désigna un cadre posé sur un meuble : Béatrice à 15 ans sur la première marche d’un podium, une médaille autour du cou. Visage fermé.
-Tu vas faire quoi maintenant ?
Elle se tourna vers lui. Pas de réponse. Cette interrogation ne l’avait pas effleurée. Trop préoccupée à larguer le passé, elle n’avait pas songé au reste… Et au lendemain…
-Elle vient à peine d’arriver. Laisse-lui le temps de reprendre ses marques.
Béatrice la remercia d’un hochement de tête.
-J’ai pas pu ouvrir la maison du boiteux. Vous avez changé les serrures ?
Son père marmonna :
-On l’a vendue.
Elle pâlit.
-Pourquoi ?
-Pas le choix.
-Qui l’a achetée ?
-Un type de la ville. Il est venu qu’une fois. Il a tout laissé en état. Je crois qu’il va en faire un gîte.
-Le Boiteux est mort comment ?
-De sa belle mort, répondit sa mère.
-Comment ça ?
-Ben, il est mort dans son sommeil…
Béatrice se rappela sa dernière lettre.
‘’ Dans cet hospice de merde, même le ciel n’a plus d’odeur. ‘’
-Tu dois mourir de faim.
Pendant le repas, son père lui expliqua que, trop vieux, il ne pouvait plus s’occuper de l’exploitation. Sa voix tremblotait. Il baissa les yeux. Sa mère semblait soulagée, elle avait toujours détesté le travail de la terre. Ils voulaient vendre et prendre un appartement pour leur retraite. Bien sûr, elle pourrait les suivre.
Sans un mot, Béatrice se leva et alla devant la fenêtre. Le cèdre du Liban avait beaucoup plus résisté que les autres arbres. La fierté du Boiteux.
- Je voudrais reprendre l’exploitation.
Son père sourit.
*
La porte ne résista pas au coup de pied. Elle reconnut aussitôt l’odeur. La cave était toujours aussi encombrée. Elle grimpa l’escalier. Beaucoup de meubles avaient disparu. Pas le fauteuil abîmé devant la cheminée, le fauteuil où elle lui racontait ses cauchemars : les gosses -toujours- sans regard, le blond frisé jouant du saxo au bord d’une piscine, le type lui donnant des coups dans une caravane. Elle n’en avait parlé qu’à lui.
Les têtes de sangliers fidèles au poste à l’entrée de la cuisine. Comme à chaque fois, elle les salua d’une geste machinal avant d’entrer. Rien n’avait bougé.
Elle s’assit à sa place habituelle : face au siège du Boiteux. Elle ravala une larme. Après un rapide tour de la maison, elle monta au grenier.
Personne d’autre qu’elle ne connaissait sa cachette. « Quand je serai mort, tu pourras aller voir. Pas avant. Tu me le promets ? ». Elle poussa un meuble et s’ agenouilla. Les lames ôtées, elle plongea la main et remonta une boîte en métal.
Après une hésitation, elle l’ouvrit. Ses médailles de guerre, des photos de son épouse, lui au volant de son premier tracteur. Beaucoup de lettres à sa femme, la plupart pendant la seconde guerre. Allait-elle les donner à ses parents ? Pendant qu’elle les rangeait, une enveloppe plus récente attira son attention. Elle lui était adressée, l’expéditeur ne lui disait rien. A l’intérieur : une lettre et une photo. Une gamine de six sept ans, sourire aux lèvres, portait un bébé. Près d’elle, un panneau de signalisation avec un nom de village.
15 juin 1995
Délia,
Autant commencer par ça : votre vraie prénom est Délia. Je ne connais pas votre nom. Il ne reste plus de votre passé que cette photo de vous trouvée dans vos vêtements. Vous ne vous en sépariez jamais, même pour dormir. Difficile de remuer ce passé…
Vous avez été retrouvée le 6 mai 1986 par l’un de nos employés près de la clinique. Fauchée par une voiture, vous étiez grièvement blessée. Pendant une semaine, votre père et les autres membres de votre groupe ont fouillé partout et interrogé les commerçants. Une femme est venue me voir à la clinique ; elle répétait : « Délia, Délia ». Cette femme était debout devant l’entrée, votre chambre au-dessus d’elle. Une petite fille l’accompagnait, elle vous ressemblait beaucoup. Je lui ai répondu que je ne vous avais jamais vue. Quelques jours plus tard, tous levaient le camp. Sans même une main courante à la gendarmerie.
A l’époque, le patron de la clinique avait un ami dont le fils requerrait en urgence d’une greffe de rein. Quand il a su qu’une gosse du voyage sans identité était arrivé dans le coma, il m’a demandé de prendre un rein et le greffer sur le fils de son ami. Je vous mentirai en disant que j’ai hésité longtemps. Non, j’ai tout de suite accepté quand il m’a annoncé la somme pour l’intervention. Je ne pensais qu’à ouvrir ma future clinique. Bref, 14 jours après l’opération, nous vous avons endormie et déposée sur le bord d’une route. Le lendemain, un article de la presse local annonçait que vous aviez été trouvée par des chasseurs et confiée à la DASS. Entre temps, j’ai ouvert ma clinique dans une autre région. Quelques années plus tard, j’ai vu un reportage télévisée sur l’athlétisme. Jamais je n’aurais pu vous reconnaître. Mais votre mère adoptive raconta au journaliste votre trajectoire et j’ai tout de suite compris. Aucun doute. Après des mois d’hésitation, j’ai fini par venir dans votre village. Je vous ai vu plusieurs fois mais jamais je n’ai osé vous parler. Incapable. Aujourd’hui, sur mon bateau loin de tout et près de la mort, je veux que vous sachiez la vérité. Je vous ai sauvée après l’accident pour, deux jours après, voler votre rein et votre mémoire. Maintenant vous savez tout Délia.
Vous trouverez ci-dessous le nom et l’adresse de l’homme qui vit avec votre rein. Même si cette greffe lui a évité une mort certaine, il n’a aucune responsabilité dans cette affaire. Le seul vrai responsable de ce crime c’est moi. Si je n’avais pas accepté, jamais vous n’auriez subi ce prélèvement sauvage.
Bien sûr, je suis conscient que cette lettre et ce chèque n’effaceront rien du tout. Rien ne pourra remplacer un rein arraché à une petite fille. Je le sais bien.
Bernard Lefort
Adossée au mur, elle lut et relut la lettre. Abasourdie. La photo à ses pieds, retournée sur le parquet. Pourquoi le Boiteux lui avait-il caché ce courrier ? Sans doute par peur de la perdre. Elle lui en voulait d’avoir décidé à sa place.
La colère monta d’un coup. Aujourd’hui, ses fantômes portaient des noms. Elle grimaça et ferma le poing. Le chirurgien, trop facile de pleurnicher, boufferait le chèque et la lettre. Ensuite elle irait cracher sa douleur au transplanté. Elle les haïssait tous, lui et tous les autres qui lui avaient volé un rein et dévié le cours de son histoire. Plus question de souffrir seule. Elle hurla, cris mêlés de rage et douleur. Impuissance. Elle boxa un placard.
A bout de souffle, elle se laissa tomber sur un fauteuil. Elle resta un long moment immobile. Remonter jusqu’à cette gamine sur la photo ? Se retrouver ? Tirer un trait sur le passé ? Se venger ? Trop abattue pour prendre une décision. Jamais aussi coincée.
Elle comprit le geste du Boiteux.
La dernière parution de Mouloud.

Et un petit morceau musical de la petite famille Rodinka de Limoux, de Drahomira qu'on croirait directement sortie d'un film d'Emir Kusturica...
09:06 | Lien permanent | Commentaires (0)
06/02/2009
Pélieu de profondis
article paru dans le numéro de février du Mensuel Littéraire et poétique (Bruxelles).
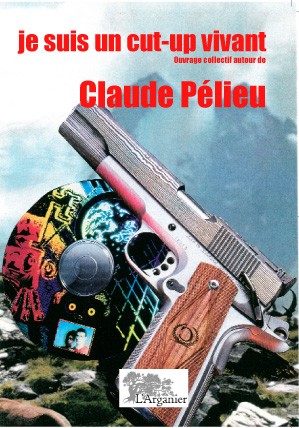
À la veille de Noël 2002, Claude Pélieu a fait sa dernière pirouette, lui qui ne croyait plus au Père Noël depuis longtemps. Il laissait de part et d’autre de l’Atlantique, des amis fidèles consternés par sa disparition. Parmi eux, Alain Jégou a eu à cœur de projeter un ouvrage collectif consacré à Pélieu. L’entreprise nécessita une pleine année occupée à rassembler textes et témoignages des derniers témoins de la « constellation Pélieu ». Il fallut aussi trouver suffisamment de souscripteurs pour financer l’impression de ce volume redevable d’aucune aide publique dans une indépendance que n’eût pas désavouée Pélieu. Le résultat est à la hauteur de l’attente. Je suis un cut-up vivant constitue sans doute le plus bel hommage à ce poète extravagant qui n’obtint en France qu’une reconnaissance timide malgré le soutien de quelques éditeurs et de poètes conquis. Fort de 282 pages l’ouvrage réunit plus de 40 participants, auteurs, artistes, musiciens aux nationalités multiples. Témoignages, lettres, collages, textes de Pélieu composent ce sommaire alléchant qu’il serait trop long de détailler ici. Je suis un cut-up vivant, un titre qui reflète parfaitement l’œuvre éclatée de Pélieu. Il s’explique d’ailleurs, dans des notes préparatoires à un entretien avec Bruno Sourdin, sur sa conception du « collage » : si la peinture est une plaie ouverte le collage est un pansement sur le film de notre culture et de l’histoire. Le collagiste est un moine, un sage, c’est l’infirmier du vide, du tout, du rien. Un moine lumineux et déviant voyageant, immobile, entre nulle part et ailleurs. La coupure est là pour marquer sans doute un réel insaisissable dans es émiettements, tel un puzzle jamais rassemblé. Claude Pélieu a mené jusqu’au bout une révolte dénuée de toute complaisance. Il a rendu à la poésie toute sa liberté, vomissant au besoin ses lettres de noblesse. Son dernier texte, la Crevaille, est offert à tout souscripteur du présent volume. Alors, même si, de sa tombe, vous entendez Pélieu ricaner : n’achetez pas ça, c’est que des conneries, n’en croyez pas un mot.
Alain Helissen
23:59 Publié dans Des écrivains qui vous bousculent | Lien permanent | Commentaires (0)
René Barde- paysan poéte
Quand l'écho du pas de Calais rend compte de la soupe à la chaussette
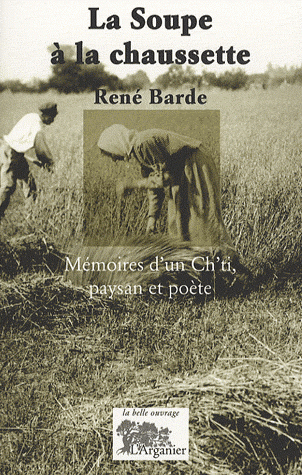
Raymond Besson, lecteur internaute arrageois a eu le « coup de foudre » pour un livre récent : « La soupe à la chaussette. Mémoires d’un Ch’ti paysan et poète ». Il nous présente sa « fiche de lecture ».
« Prenez le petit dernier d’une famille de paysans âpres au gain, mettez-lui la tête dans les étoiles et un poil dans la main… Gageons que vous en ferez un enfant mal dans sa peau, souffre-douleur de la fratrie, puis un adulte instable et hyperesthésique. En l’occurrence, certains enfants rentreraient dans le rang ; René Barde, lui, va se replier sur lui-même et faire de sa vie une étrange aventure faite de paresse, de mysticisme contrarié, de pudeur maladive, de rébellions incongrues, d’ascétisme outrancier… et de littérature. Car l’enfant n’a qu’un seul rêve : devenir écrivain. Hélas ! Sa condition misérable dans un Paris hostile, exacerbée par la faim, le froid, l’humidité, la promiscuité…, va transformer l’existence de René Barde en un vrai calvaire : les joies seront rares, l’amour absent, l’amitié déçue, le succès inexistant. Et l’homme, comme l’avait fait l’enfant, va se recroqueviller dans un dénuement qui finira par altérer sa santé, mais jamais il ne doutera qu’il a choisi le bon chemin : « L’abandon est la marque de mon destin, et c’est sans crainte que je vois le présent approcher l’autre rive. Oui, vraiment, j’ai gagné la partie. » Lourde introspection qui met parfois le lecteur mal à l’aise, doutant que l’on puisse vouloir la misère, en marge des siens et de la société. Il en vient souvent à pester contre cet homme qui aurait pu être heureux si, ici ou là, il avait su vaincre son défaut majeur : la peur de vivre.
Ce livre change de ce qu’on lit traditionnellement, en matière d’autobiographie. Et puis, cette volonté incompréhensible de « réussir ses échecs » peut fasciner. Comme l’homme est étrange ! Quelle débauche d’énergie pour rater sa vie ! Cela tient de la folie ou du mysticisme, ou des deux. Par ailleurs, au plan de l’atmosphère, on peut avoir une petite pensée pour Céline dans Mort à crédit et, parfois, pour ces auteurs bouffis de souffrance comme Violette Leduc ou Albertine Sarrazin. L’ouvrage est émouvant, partagé qu’est l’auteur entre le récit d’une enfance où l’on découvre un pays, un village (Marles-les-Mines), une famille, leurs mœurs, et une réflexion permanente quasi philosophique (masochiste et perverse) sur la volonté de n’être point de ce monde-là ou de quelque autre monde, même quand la bonne fortune semble vous tendre la main. Et puis, souvent, jaillissent de très belles pages de littérature : le jeu que la fratrie pratique en proposant aux chats – comme le pompon d’un manège – les oiseaux capturés dans leur sommeil ; la saillie et le poulinage de la jument Marmotte ; les rencontres de Barde avec tous les fous furieux qui passent à portée de voix ; les épisodes de mysticisme qui émaillent sa vie ; le saindoux pourri qu’il donne à son ami, en toute connaissance du danger présenté… Un style d’écrivain, assurément. S’il l’avait voulu ! »
« La soupe à la chaussette », de René Barde, est publié chez L’Arganier ; 378 pages ; 19 euros dans toutes les librairies ; ISBN 978-2-912728-70-8.
Légende : René Barde est mort dans la misère en 1963. Il avait côtoyé le peintre Édouard Pignon lui aussi de Marles-les-Mines.
23:34 Publié dans Des écrivains qui vous bousculent | Lien permanent | Commentaires (0)
Une vie d'artiste
23:29 Publié dans Les copains d'abord | Lien permanent | Commentaires (0)
29/01/2009
Enfin une vraie manif de droite....
Vous mes très chers concitoyens, qui comme moi en avez marre de toutes ces manifestations de gauchistes minables, faites comme moi, participez à une manifestation de droite... C'est bien plus drôle... Enfin de vrais slogans qui ne sont pas des tirades empruntées à la prose de pseudos intellectuels stalino-dépressifs... Enfin des gens comme on les aime, pleins de ces valeurs inaltérables du CAC 40... Vive la franche rigolade, Vive le maréchal des logis chef, Viva grand Guignol... Viva carnaval.....
Mes bien chers frères veuillez répéter après moi:
Intermittent, retournes dans ton pays
Intermittents fainéants à plein temps
intermittents, rendez nous notre argent
é chassier trouves-toi un vrai métier
faites des enfants, pas des intermittents
la grossesse a 6 mois
les femmes derrière, les hommes devant
A bas, a bas, le second degré
USA sors nous de ce mauvais pas
Bush, Bush, montre nous la voie
Monsieur Bush, priez pour nous
la parité c'est pour les dégénérés
Chirac président
Monsieur Jean-Jacques Aillagon, tenez bon, s'il vous plaît
Monsieur Raffarin vous nous faites du bien
Raffarin nous voila
Monsieur Pasqua vous m'avez donné la foi
Charles Pasqua reviens les mettre au pas
Mr Nicolas Sarkozy à la culture s'il vous plait
Subvention égal dépense d'argent
PSG fais-nous rêver
Travail, famille, télévision
Remettez le José au frais !
C'est pas les agriculteurs qui nous empêcheront de manger des hamburgers
On aime, on aime les OGM
La culture est une marchandise comme les autres
Alain Delon, rejoins-nous à Chalon , Monsieur Chirac à Aurillac,
Michel Sardou un peu partout
TF1 c'est rudement bien
ARTE c'est trop compliqué
c'est toujours sous titré
avec des films étrangers
ARTE, c'est pas bien, on n'y comprend rien
chacun pour soi, et pas les autres
on est plus, plus de droite que vous
non, non aux manifestations
La droite est adroite, la gauche est gauche
Afrique paye ta dette aux pays occidentaux
Le Bigdil c'est pas si facile
Star Academy c'est pas si mal que ça
restons divisés
les grévistes sont des gens qui ne travaillent pas
les chômeurs sont des gens qui ne travaillent pas
moins de festivals, plus de quinzaines commerciales
Plus de corsos fleuris, moins de festivals de hippies
le Puy du Fou dans toutes les villes
on veut, on veut des sons et lumières
les reconstitutions historiques nous apprennent des choses
Monsieur De Villiers, vous avez de bonnes idées
un vrai statut pour les majorettes
la culture est une marchandise comme les autres
manifestants, vous gênez les commerçants
le FMI ne fait plus crédit
Tf1 sur toutes les chaînes
Mac Donald, dans les cantines
Mickey nous fait rire, et Donald aussi
1 euro, c'est 1 euro
Selliere président
les retraités au boulot
la police protégez nous
la police pas trop loin de nous
Nous sommes tous des américains
les vrais artistes avec nous
on veut des sous, pas des crassous
Les vraies valeurs sont dans nos portefeuilles
Les bonnes actions sont dans nos portefeuilles
CAC 40 CAC 40 OUI OUI
Jean Pierre Gaillard rends-nous l'espoir
Joueur de djembé remontes dans ton cocotier
les cheveux longs c'est pas pour les garçons
les boucles d'oreille ça fait efféminé
les boucles dans le nez c'est pour les bovidés
les rastaquouères au frigidaire
les manouches à la douche
Pas d'allocs pour les dreadlocks
Ma maison mon horizon
A bas les colonnes de Buren
La batucada ne passera pas par moi
La culture ça fait mal à la tête
19:17 | Lien permanent | Commentaires (2)
25/01/2009
Le droit à l'indifférence.....

Métissage : du fait divers de proximité à la "diversité"
par Mouloud Akkouche
Mais il faut raison garder et ne pas croire au Père Noël le 20 janvier. Les américains ont, j’ose espérer, d’abord élu un homme politique avec un programme, pas un mannequin de United Colors of Benetton. Beaucoup de commentateurs oublient l’homme politique. D’ailleurs, la couleur de peau n’a jamais empêché d’être dictateur. Mugabe, Mobutu et Kim Jong-il ne sont pas blancs.
Telle radio décide de consacrer sa journée à la diversité, tel hebdomadaire en fait sa une. Stigmatiser des citoyens à cause de leur appartenance ethnique me semble aussi dangereux que de claironner sans cesse les vertus du métissage. Effectivement, il y a eu des luttes légitimes et importantes pointant les dysfonctionnements de la société française dans ce domaines, mais méfions-nous par trop plein de bonté de ne pas tomber dans l’excès inverse.
A plusieurs reprises, j’ai entendu certains auteurs français -dont des amis- affirmer: "Vaut mieux être membre d’une minorité pour obtenir une bourse littéraire ou un prix." Des réalisateurs râlent car les sujets de société traitant des problèmes de mixité raflent les honneurs dans les festivals.
Ces récrimination d’artistes "blancs" ont sans doute dû augmenter avec les attributions du Goncourt et Renaudot. Imaginez alors un instant les pensées des citoyens ayant moins de recul, des citoyens touchés comme leurs voisins- issus de l’immigration- par la crise. Ils ne possèdent pas une caméra ou un stylo pour exorciser les démons qui peuvent faire basculer tout un chacun, même les plus cultivés.
Zidane, Debouze cachent la forêt de ceux qui pointent au chômage
Au fond, il me semble que ce métissage à tout prix cache quelque chose de plus profond. Une manière de se dédouaner et occulter la casse sociale et culturelle en cours dans ce pays. Un leurre pour ringardiser les luttes de classe. Pendant ce temps, ministre de la Justice issue de l’immigration ou pas, une foule nombreuse continue de fréquenter les soupes populaires loin des échoppes Prada. Les Zidane, Debouze et autres célébrités, cachent la forêt de ceux qui pointent au chômage. Eux incarnent la diversité internationale, les autres le fait divers de proximité.
Tout compte fait, je reviens toujours à cette heureuse formule de Michel Rocard dans les années 80: le droit à l’indifférence. Aujourd’hui, grâce à certaines luttes, il me semble que nous devrions peut-être laisser les histoires d’amour "mixte" se faire et se défaire, les étudiants se battre pour obtenir leurs diplômes, les entrepreneurs entreprendre, les slameurs slamer… comme tous les autres.
Même s’il est nécessaire de continuer de sanctionner tout propos ou acte raciste et antisémite et rester vigilant sur les discriminations. Le droit à l’indifférence offrirait sans doute une bouffée d’oxygène à une population qui rêve de jouir de la même invisibilité que les autres, se fondre dans la foule. La pire des choses qui puisse arriver à un citoyen est que, à cause de ses origines, quelqu’un se retienne de lui jeter à la face "tu n’es qu’un con!". Pensez que les êtres d’origine étrangère sont potentiellement des délinquants ou terroristes est aussi stupide que croire qu’ils sont tous parfaits. Les bons sentiments enferment autant que les préjugés.
Pour clore sur une note optimiste, réjouissons-nous de la décision de Obama de fermer Guantanamo et la nomination de deux diplomates expérimentés pour l’Afghanistan et le Proche-Orient. Des actes qui portent haut les couleurs de l’intelligence. Un président lecteur ne peut pas être mauvais. Jugeons-le désormais sur sa politique.
NDLR: Il est balèze mon pote Mouloud, hein... Il a vraiment le sens de la formule et celui du discours politique. Bientôt si ça se trouve il va devenir le nègre de Finkielkrault....
15:14 Publié dans La vie des bêtes racontée aux enfants | Lien permanent | Commentaires (0)
22/01/2009
Et pendant ce temps là au royaume de France.....

dessin TLEO
LYON (Reuters) - Un rapport rendu public à Lyon met en lumière les tracasseries qui peuvent devenir de vrais obstacles pour les Français d'origine étrangère, même très lointaine, désireux de renouveler leurs papiers d'identité.
L'enquête a été conduite par le Conseil lyonnais pour le respect des droits (CLRD), une instance unique en France fondée il y a vingt ans pour travailler sur les questions de société qui transmet rapports et propositions à la mairie de Lyon.
"Nous alertons les pouvoirs publics sur l'inégalité de traitement des citoyens sur le renouvellement des papiers qui est scandaleuse et choquante. Y a-t-il des Français plus ou moins français que d'autres ?", a demandé Me Alain Jakubowicz, animateur du CLRD lors d'une conférence de presse.
"Bien qu'ils soient Français et qu'ils possèdent déjà une carte nationale d'identité française, on demande à ces personnes de prouver leur nationalité, de produire une nouvelle fois un certificat de nationalité ce qui est tout à fait anormal."
Pour formuler ces exigences, "l'administration se fonde sur une naissance à l'étranger, sur la naissance de parents, de grands-parents ou d'arrières grands-parents à l'étranger ou sur la consonance étrangère du patronyme", dénonce le juriste.
La centaine de témoins ayant raconté leurs mésaventures dignes de Kafka étaient déjà en possession d'une carte nationale d'identité française, certains même d'une carte sécurisée.
"STUPEUR"
Devant les problèmes, plusieurs ont abandonné "par lassitude, ou par révolte et sentiment d'être rejetés", note le rapport de la CLRD, qui rapporte des exemples de fonctionnaires, de militaires voire d'élus mis en difficulté.
Bruno A. est né en 1959 en Algérie et son patronyme a une consonance maghrébine. Jeudi, ce "militaire, fils de militaire et petit-fils de militaire" a raconté qu'on lui avait demandé un justificatif de nationalité pour refaire son passeport.
"Et là, stupeur! La première condition pour servir l'armée française est justement d'être de nationalité française", a-t-il rappelé. Le fonctionnaire qui traitait sa demande lui a répondu avoir "de nouvelles directives à appliquer depuis peu" avant d'ajouter "et de plus votre nom n'est pas d'origine française".
Tout le monde en France est potentiellement concerné par ces problèmes, a estimé Me Jakubowicz.
Le rapport raconte également le cas d'une femme ayant finalement menacé de porter plainte pour fraude électorale pour prouver l'absurdité de ce que l'administration lui demandait.
Née de parents eux-mêmes nés en France mais ayant des noms étrangers, elle avait toujours voté et même été élue conseillère municipale.
"Si je ne suis pas Française, c'est illégal et le maire qui m'avait présentée était donc coupable de fraude en présentant une 'étrangère'", a-t-elle expliqué à le CLRD.
21:49 Publié dans l'ami qui vous veut du bien | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : appartheid, ségrégation, sociologie, témoignage
21/01/2009
De la faisabilité politique....

de Christian Morrisson*
Désinformer par la maîtrise des médias
- "On observe, avec un décalage de 3 à 6 mois, un lien étroit entre l'annonce des mesures de stabilisation et les troubles, les grèves ou les manifestations.
Ce décalage est intéressant, car il prouve que (…) les réactions politiques ont lieu au moment de l'application des mesures plutôt qu'à leur annonce. (…) la plupart des personnes concernées ne sont pas capables d'avoir une idée claire des conséquences de ce programme pour elles, ou pensent qu'il touche surtout les autres". (Page 10-11)
- "Cela suppose une bonne stratégie de communication, (qui est) une arme importante dans le combat politique. Il faut, dès l'arrivée au pouvoir insister, voire en exagérant, sur la gravité des déséquilibres, souligner la responsabilité des prédécesseurs et le rôle des facteurs exogènes défavorables, au lieu de tenir un discours optimiste". (Page 25) "Seule importe l'image que donne le gouvernement et non la portée réelle de ses interventions". (Page 28)
"Il faut ajouter des campagnes dans les medias, voire des actions spectaculaires, pour obtenir le soutien de la population et faire contrepoids à l'opposition". (Page 31)
Manipuler
- "Le gouvernement (…) peut, par exemple, expliquer que, le FMI (Fonds Monétaire International) imposant une baisse de la masse salariale, le seul choix possible est de licencier ou de réduire les salaires et qu'il préfère la seconde solution dans l'intérêt de tous". (Page 29) "Rien n'est plus dangereux politiquement que de prendre des mesures globales pour résoudre un problème macro-économique. Par exemple, si l'on réduit les salaires des fonctionnaires, il faut les baisser dans tel secteur, les bloquer en valeur nominale dans un autre, et même les augmenter dans un secteur clé politiquement. Si l'on diminue
les subventions, il faut couper celles de tels produits mais maintenir en totalité celles pour d'autres produits. Le souci du détail ne connaît pas de limite : si les ménages pauvres consomment seulement du sucre en poudre, on peut augmenter le prix du sucre en morceaux pourvu que l'on garde la subvention au sucre en poudre". (Page 31)
Tromper
- "(Un gouvernement) ne peut plus faire, en principe, de concession dès lorsqu'il a pris des engagements envers le FMI (Fonds Monétaire International) pour bénéficier de son concours. D'ailleurs, une telle décision peut rendre service à un gouvernement car celui-ci peut ensuite répondre aux opposants que l'accord réalisé avec le FMI s'impose à lui, qu'il le veuille ou non". (Page 22)
- "Comme on le voit, pourvu qu'il fasse des concessions stratégiques, un gouvernement peut, en procédant de manière graduelle et par mesures sectorielles(et non globales), réduire les charges salariales de manière considérable. L'essentiel est d'éviter un mouvement de grève générale dans le secteur public qui remettrait en question un objectif essentiel du programme de stabilisation".
* Extraits du "Cahier de politique économique n°13" du Centre de développement de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économique), 94, Rue Chardon-Lagache, 75016, Paris.
Ce texte est à rapprocher du discours qui paraît hallucinant mais qui ne l'ai pas tant, de Eric Woerth....
Stratégie, stratégie, de bas de gamme... La faconde, la rapacité, le mépris, la morgue du dominant ne quelques sortes... Tant que ça dure...
Propos du Ministre de la Fonction publique (sic) rapportés par Charlie-Hebdo, tenus lors d'une réunion de la Fondation Concorde, proche de la majorité actuelle, le mercredi 20 octobre au Café Restaurant Pépita à Paris :
"Les retraités de la fonction publique ne rendent plus de services à la nation. Ces gens-là sont inutiles, mais continuent de peser très lourdement. La pension d'un retraité, c'est presque 75% du coût d'un fonctionnaire présent. Il faudra résoudre ce problème."
"Le grand problème de l'État, c'est la rigidité de sa main-d'oeuvre. Pour faire passer un fonctionnaire du premier au deuxième étage de la place Beauvau, il faut un an. Non pas à cause de l'escalier [rires dans la salle], mais des corps. Il y a 1400 corps. 900 corps vivants, 500 corps morts [rires], comme par exemple l'administration des télécoms. Je vais les remplacer par cinq filières professionnelle qui permettront la mobilité des ressources humaines : éducation, administration générale, économie et finances, sécurité sanitaire et sociale. Si on ne fait pas ça, la réforme de l'État est impossible. Parce que les corps abritent des emplois inutiles."
"A l'heure actuelle, nous sommes un peu méchants avec les fonctionnaires. Leur pouvoir d'achat a perdu 4,5% depuis 2000."
"Comme tous les hommes politiques de droite, j'étais impressionné par l'adversaire. Mais je pense que nous surestimions considérablement cette force de résistance. Ce qui compte en France, c'est la psychologie, débloquer tous ces verrous psychologiques."
"C'est sur l'Éducation nationale que doit peser l'effort principal de réduction des effectifs de la fonction publique. Sur le 1,2 million de fonctionnaires de l'Éducation nationale, 800 000 sont des enseignants. Licencier dans les back office de l'Éducation nationale, c'est facile, on sait comment faire, avec Éric Woerth [secrétaire d'État à la Réforme de l'État] : on prend un cabinet de conseil et on change les process de travail, on supprime quelques missions. Mais pour les enseignants, c'est plus délicat. Il faudra faire un grand audit."
"Le problème que nous avons en France, c'est que les gens sont contents des services publics . L'hôpital fonctionne bien, l'école fonctionne bien, la police fonctionne bien. Alors il faut tenir un discours, expliquer que nous sommes à deux doigts d'une crise majeure - c'est ce que fait très bien Michel Camdessus , mais sans paniquer les gens, car à ce moment-là, ils se recroquevillent comme des tortues."
Il admet dans ses propos que les français sont satisfaits de la qualité du service public rendu par les fonctionnaires, quels qu'ils soient. C'est bien en les fragilisant de l'intérieur (sous effectif, baisse d'investissements etc.) qu'il compte rendre les services publics impopulaires auprès des populations. Une impopularité qui lui servira de prétexte pour les privatisations à venir. Alors que ce sont bien les attaques à l'oeuvre depuis de nombreuses années qui dégradent la qualité des services publics.
07:07 | Lien permanent | Commentaires (0)
11/01/2009
Vic Chesnutt
Pour ne pas désespérer de l’espèce humaine il existe des gens comme Vic Chesnutt qui vous font croire qu’on peut encore repousser les limites quand on est acculé à force de n’avoir plus rien. Il fait exister encore une porte de secours vers laquelle se diriger. Un miracle étant rare dans ce monde autant en profiter immédiatement.
Au carrefour des Cohen, Russel, Guthrie, Buckley, il y a le petit Vic, abandonné dans sa poussette. Méchamment amoché par les fées qui se sont penchées sur le landau.C’est lui qui descendait les marches dans le film du cuirassé Potemkine. Une tête d’allumé de première. Chesnutt va à l’essentiel. Il dépouille comme on le dit d’une eau forte et la teinte de l’empreinte toute en manière noire devient lumière. Un drôle de type à écouter toutes affaires cessantes.
Vous dire que ce type m'a filé la chair de poule, c'est peu... Fort et bon comme un alcool vieux...

Pour commencer vous pouvez vous jeter ça derrière la cravate....
et puis s'il vous reste un doute remettre ça, si vraiment vous êtes d'un autre monde et que vous ne croyez pas ce que je dis
16:16 Publié dans un peu de poésie dans ce monde.... | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chanteur, folk, blues, américain, blanc, handicapé, poésie
10/01/2009
René Barde- Charlotte (2)
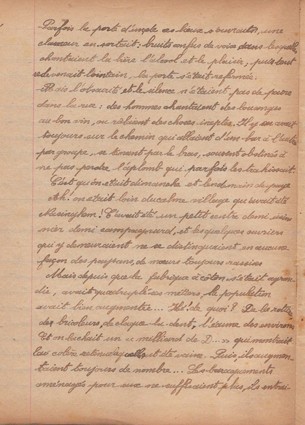
René Barde dans sa mansarde en 1962

Charlotte ( 2 )
Mais l’obscurité et le silence n’allaient pas de paire dans la rue : des hommes y chantaient des louanges au bon vin ou râlaient des choses ineptes. Il y en avait toujours sur le chemin qui allaient d’un bar à l’autre par groupe, se tenant par le bras, souvent obstinés à ne pas perdre l’aplomb qui parfois les trahissait.
C’est qu’on était dimanche et lendemain de paye. Ah ! On était loin du calme village qu’avait été Nasinghem ! C’avait été un petit centre mi-usinier, mi-campagnard et les quelques ouvriers qui y demeuraient ne s’y distinguaient pas des paysans de mœurs toujours rassises.
Mais depuis que la fabrique de coton s’était agrandie, avait quadruplé ses métiers, la population avait bien augmenté… Hé ! de quoi ? De la roture, de bricoleurs, de claque-la-dent, l’écume des environs. Et on lâchait un « milliard de D… » qui montrait la colère retenue, elle eut été vaine. Puis, ils augmentaient toujours de nombre… Les baraquements aménagés pour eux ne suffisant plus, ils entraient dans les maisons comme locataires.
La plupart n’avaient pas de femme – elle est encombrante au nomadisme – et que peut-il se passer quand chaque homme n’a pas sa femme ?… Et de ces gens qui sapaient si fortement les coutumes - aussi vieilles que le clocher qui avait vu naître et fondre bien des générations – plus d’un avait déjà empli son casier judiciaire.
- Oui ! tout a bien changé, les voilà tous amis de nos gars et de nos filles disaient les mères outrées.
Car ceux là n’étaient pas fâchés de ce revirement des habitudes ; les contraintes pesaient aux jeunes du village qui supportaient toute la dureté de la vie d’ouvrier, sans profiter de l’agrément qu’elle leur offrait.
Auparavant on ne savait qu’aller le soir travailler au jardin ou se louer pour quelques heures après l’usine à un fermier qui payait peu. Mais maintenant, le soir, c’était le brin de toilette, la danse, la boisson et la course aux belles. C’était inconciliable avec les penchants traditionnels.
Il y eut bien au début quelques bons frottements entre ceux du pays et les nouveaux venus, à tel point que les gendarmes en patrouille se faisaient, eux aussi, mettre à mal. Tantôt un parti, tantôt l’autre formait des complots pour venger des camarades qui avaient eu à souffrir la rudesse d’un poing sans douceur.
Mais après quelques échauffourées, le nombre étant pour l’envahisseur, il fallut en rabattre ; et tout finit par s’arranger. Attelés au même travail, leurs peines et leurs besoins étant communs, la camaraderie n’eut plus d’autres agents de trouble que les surprises de la vie ordinaire, telles la jalousie pour les belles ou parfois, après boire, la vague envie de montrer que l’on a du sang et des muscles.
Un cafetier eut l’initiative de louer un piano automatique et d’aménager une salle pour les danseurs ; huit jours après dix de ces instruments étaient installés dans le village. Les estaminets ne désemplissaient plus. Une fois la pension payée le reste de la semaine tombait dans la caisse des comptoirs.
Les vieux du village qui avaient l’habitude de s’assembler pour jouer tranquillement aux cartes dans leurs estaminets attitrés en avaient été vite vidés.
Et toujours en librairie La soupe à la chaussette de René Barde aux éditions l'Arganier
18:33 Publié dans Des écrivains qui vous bousculent | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, témoignage, histoire, nord, mines, monde ouvrier
02/01/2009
Bienvenue en 2009
"La faisabilité politique de l'ajustement", de Christian Morrisson*
Quelques conseils des ECONOMISTES de l'OCDE aux POLITIQUES pour casser la résistance sociale à la marchandisation des services publics. Qui nous manipule ? Comment allons-nous être mangés ?
Profiter de la situation
- "Si un gouvernement arrive au pouvoir au moment où les déséquilibres macro-économiques se développent, il bénéficie d'une courte période d'ouverture (4 à 6 mois) pendant laquelle l'opinion publique le soutient et il peut rejeter sur ses prédécesseurs l'impopularité de l'ajustement. Grâce à ce soutien, les corporatismes sont temporairement affaiblis et il peut dresser l'opinion contre ses adversaires. Après ce délai de grâce, c'est fini." (Page 24)
Diviser l'opinion publique
- " (Un gouvernement) doit se ménager le soutien d'une partie de l'opinion, au besoin en pénalisant davantage certains groupes. En ce sens, un programme qui toucherait de façon égale tous les groupes serait plus difficile à appliquer qu'un programme discriminatoire, faisant supporter l'ajustement à certains groupes et épargnant les autres pour qu'ils soutiennent le gouvernement". (page 17)
- " La plupart de ces réformes (structurelles) frappent certains groupes tout en bénéficiant à d'autres, de telle sorte qu'un gouvernement peut toujours s'appuyer sur la coalition des groupes gagnants contre les perdants". (page 18)
Casser les résistances, les corporatismes et les syndicats
- "L'autre obstacle tient au corporatisme, plus il existe de groupes d'intérêt puissants et bien organisés, plus la marge de manœuvre du gouvernement est réduite". (…) toute politique qui affaiblirait ces corporatismes serait souhaitable. (…) cette politique soulèvera des résistances, mais il vaut mieux que le gouvernement livre ce combat dans une conjoncture économique
satisfaisante, qu'en cas de crise, lorsqu'il est affaibli. (Elle) peut prendre
plusieurs formes : garantie d'un service minimum, formation d'un personnel qualifié complémentaire, privatisation ou division en plusieurs entreprises concurrentes, lorsque cela est possible". (Page 23)
- "Un gouvernement qui veut accroître ses marges de manœuvres et rendre plus flexible une société, aurait intérêt à affaiblir d'abord tous les corporatismes ». (Page 24)
- "La grève des enseignants n'est pas (…) une gène pour le gouvernement mais elle est indirectement dangereuse, puisqu'elle libère la jeunesse pour manifester. Ces grèves peuvent donc devenir des épreuves de force difficiles à gérer". (Page 29) "Les grèves comportent un inconvénient sérieux, celui de favoriser les manifestations. Par définition, les grévistes ont le temps de manifester. Surtout les enseignants du secondaire et du supérieur (qui) libèrent une masse incontrôlable de lycéens et d'étudiants pour les manifestations, un phénomène très dangereux". (Page 26)
La suite au prochain post... car suite il y a bien sûr....
17:09 Publié dans La vie des bêtes racontée aux enfants | Lien permanent | Commentaires (0)
22/12/2008
Front de libération du colibri

Si comme moi vous êtes sensible au charme utopique du colibri, faites le savoir autour de vous...
07:51 Publié dans De la poésie au quotidien | Lien permanent | Commentaires (0)
20/12/2008
Cliquez Ici !
Cliquez ici
Une nouvelle de Mouloud Akkouche

« On assiste depuis ce matin à un phénomène incroyable. Les gens se ruent sur les ventilateurs… »
_ Pas moi ! grommela-t-il en éteignant la radio.
La chaleur conjuguée au manque de sommeil, plus le courriel matinal de la banquière « Découvert largement dépassé. Veuillez rappeler d’urgence et ne plus vous servir de votre carte de crédit. », généraient une montée de bile. Et, condamné à rester dedans à cause de la canicule, sa nervosité risquait de croître. A moins que le coup de fil fut positif. Le patron d’une boîte devait l’appeler dans la journée pour proposer un poste deux fois mieux payé que le sien. Surtout ne pas rater l’appel.
Des bourdonnement firent trembler les murs.
_ Pouvait pas choisir un autre jour !
Il pestait contre les ouvriers qui intervenaient sur les canalisations. L’eau coupée jusqu’au soir. Il retourna s’asseoir et enfonça les écouteurs dans ses oreilles. Mais, très vite, il se releva du canapé brûlant et fit les cent pas.
Il écarta deux lames du volet. Personne dans les rues ni sur les terrasses.
Sur le bureau, une montagne de facture non ouvertes et de cartons de recommandés. Les étagères vidées des livres et C.D, tous revendus à très bas prix. Sa collection de B.D aussi.
Tout débuta par un spam ouvert par erreur : la pub d’un casino virtuel sur Internet. Cliquez ici et vous serez riche sans bouger de chez vous ! proposait une blonde avec un décolleté qui colonisait une partie de l’écran. Pourquoi pas, se dit-il sans imaginer où l’entraînerait ce premier clic. Au début, il gagnait beaucoup puis, peu à peu, alternait pertes et gains. Jusqu’au moment où les pertes s’enchaînèrent. Mais il voulut se refaire, empruntant même pour continuer de jouer. Bouffé par les nuits blanches, il ne fichait plus rien au boulot. Déjà deux mois d’ arrêt de maladie, les yeux rivés sur le casino virtuel. Persuadé de finir par toucher le jack pot.
Son mobile sonna.
_ Salut maman.
Il fronça les sourcils.
_ Mais non, je ne te fuis pas. Ecoute, je…
Elle l’interrompit et parla très vite. Il éloigna le téléphone, la voix s’égosillait dans le vide.
_ Ecoute, je…
Que dire ? Il regrettait d’avoir répondu. D’habitude, son numéro s’affichait. Elle laissait des messages qu’il effaçait sans même les écouter. Pas envie de s’étaler.
_ Je suis en déplacement pour mon job. J’ai un max de boulot en ce moment.
Elle ne le croyait pas.
_ Allô… Tu m’entends.
Il sortit sur le palier.
_ Quoi ? Je ne t’entends plus… Je te rappelle plus tard.
Un ouvrier posa un regard interrogateur sur lui avant de reprendre le perçage du mur.
Elle criait au bout du fil.
_ Je ne t’entends plus.
Il rentra et claqua la porte .
La chaleur avait encore augmenté. Il ouvrit le frigo: deux bières et un reste de pizza. Il décapsula une cannette, but une gorgée puis passa la bouteille sur son front.
Impossible de tenir en place. Corps poisseux, plus qu’une boule de sueur et d’impatience. Et ce mobile qui ne sonnait pas ! Il se déshabilla et s’allongea entièrement nu. Le lino le rafraîchit un peu.
Adossé contre le mur, il fixait le mobile posé entre ses jambes. Des heures qu’il attendait. Il n’ a pas que moi, je l’intéresse pas, il appellera plutôt en fin de journée… Toutes les hypothèses circulaient dans sa tête. Plus le temps avançait, plus les pessimistes s’imposaient. Il décida de composer le numéro de son –peut-être – futur patron. « Désolé, il est en rendez-vous extérieur. Je peux prendre un message ? ». Il lui raccrocha au nez. Rendez-vous extérieur, grommela-t-il, et moi je suis coincé ici comme un con !
Bien sûr, il aurait pu demander de l’aide à sa mère. Mais les intérêts avec elle étaient plus lourds que ceux de la banque. Sans compter les conseils en tous genres. Il vida la deuxième bière et s’amusa à faire rouler la cannette sous son pied.
La fin d’après-midi tirait à sa fin. La chaleur n’était pas retombée. Il avait la gorge sèche. L’épicier lui ferait bien crédit pour une bouteille d’eau. Mais dans l’escalier, son mobile ne passait pas ; s’il appelait à ce moment là ?
Il s’allongea sur le dos et ferma les yeux.
Soudain, il se précipita dans la cuisine et arracha tous les casiers du frigo.
_ Y en a marre !
Il se recroquevilla à l’intérieur et ferma la porte, son mobile dans la main.
La dernière parution de Mouloud.

17:04 Publié dans Cherchez pas c'est de l'art..... | Lien permanent | Commentaires (0)
15/12/2008
René Barde
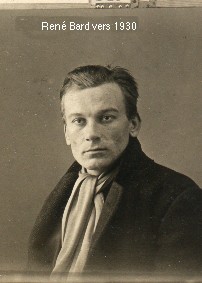
Comment vous dire cette joie, lorsque dans cette valise en carton ouverte devant moi j'ai vu apparaître les manuscrits de René Barde tout jaunis, écris à la plume d'écolier de cette graphie nette, précise, belle... Dessinée avec cette minutie d'écolier appliqué. Une émotion intense en ayant l'impression de découvrir un trésor. De remonter des fonds de la terre, enfouie dans l'or du temps, la matière vivante de la parole. Plusieurs manuscrits, des aphorismes, et un gros pavé de mille pages. Puis ce texte intitulé Charlotte dont j'ai évalué le calibrage à environ cent cinquante mille signes. Un petit roman. Encore inédit, et dont je vous offre, Bernard Collet m'en pardonnera, la première page....
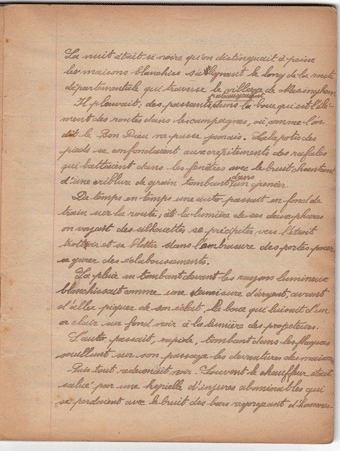
La nuit était si noire qu’on distinguait à peine les maisons blanchies s’alignant le long de la route départementale qui traverse le village de Nasinghem.
Il pleuvait ; des passants pataugeaient dans la boue qui est l’élément des routes dans les campagnes, où comme l’on dit, le Bon Dieu ne passe jamais. Les clapotis des pieds se confondaient aux crépitements des rafales qui battaient dans les fenêtres avec le bruit chantant d’une criblure de grain tombant dans un grenier.
De temps en temps une auto passait à fond de train sur la route ; à la lumière de ses deux phares, on voyait des silhouettes se précipiter vers l’étroit trottoir et se blottir dans l’embrasure des portes pour se garer des éclaboussures.
La pluie en tombant devant les rayons lumineux blanchissait comme une tamisure d’argent, avant d’aller piquer de son éclat la boue qui luisait d’un or clair sur fond noir à la lumière des projecteurs.
L’auto passait, rapide, tombant dans les flaques, souillant sur son passage les devantures des maisons. Puis tout redevenait noir. Souvent le chauffeur était salué par une kyrielle d’injures abominables qui se perdaient avec le bruit des bars regorgeant d’hommes.
22:41 Publié dans Des écrivains qui vous bousculent | Lien permanent | Commentaires (0)
09/12/2008
Quand Pélieu s'amuse encore....
Claude grand farceur devant l'éternel barbu, continue à nous jouer de ses blagues... On a du retard à la parution... et pour cause... quel farceur ce Claude... Je récapitule dans le désordre... mon disque dur qui lâche, les chèques qui reviennent à leur expéditeur, le CD pour l'imprimeur qui s'égare dans la nature... le code barre de la couverture qui n'est pas bon, les fichiers qui arrivent de partout avec des mise en forme tordues impossibles à déverouiller, des images dont on à perdu la trace des auteurs, pas dans le bon poids de fichier... un original envoyé en recommandé qui s'égare... etc.... etc... Sacré Claude tu nous auras beaucoup fait rire... Des coquilles dans l'intro de la Crevaille qu'on a oublié de soumettre à l'auteur tellement préoccupé par tous ces lézards qui apparaissent à chaque instant... A Quel sorcier as tu recours cher Claude...Si je m'en réfère à Cocteau: je plaint les petits anges... La vache! qu'est ce qu'ils doivent prendre...

le code barre de la crevaille

08:43 Publié dans Les copains d'abord | Lien permanent | Commentaires (0)
08/12/2008
Walden ou la vie dans les bois.....

portrait de Henry David Thoreau
Traduction française de Louis Fabulet
Quand j'écrivis les pages suivantes, ou plutôt quand j'en écrivis le principal, je vivais seul dans les bois, à un mille de tout voisinage, dans une maison que j'avais bâtie moi-même, au bord de l'Étang de Walden, à Concord, Massachusetts, et je ne devais ma vie qu'au travail de mes mains. J'habitai là deux ans et deux mois. A présent me voici pour une fois encore de passage dans le monde civilisé.
Je n'imposerais pas de la sorte mes affaires à l'attention du lecteur si mon genre de vie n'avait été, de la part de mes concitoyens, l'objet d'enquêtes fort minutieuses, que d'aucuns diraient impertinentes, mais que, loin de prendre pour telles, je juge, vu les circonstances, très naturelles et tout aussi pertinentes. Les uns ont demandé ce que j'avais à manger; si je ne me sentais pas solitaire; si je n'avais pas peur; etc., etc. D'autres se sont montrés curieux d'apprendre quelle part de mon revenu je consacrais aux oeuvres charitables; et certains, chargés de famille, combien d'enfants pauvres je soutenais. Je prierai donc ceux de mes lecteurs qui ne s'intéressent point à moi particulièrement de me pardonner si j'entreprends de répondre dans ce livre à quelques-unes de ces questions. Dans la plupart des livres il est fait omission du Je, ou première personne; en celui-ci le Je se verra retenu; c'est, au regard de l'égotisme, tout ce qui fait la différence. Nous oublions ordinairement qu'en somme c'est toujours la première personne qui parle. Je ne m'étendrais pas tant sur moi-même s'il était quelqu'un d'autre que je connusse aussi bien. Malheureusement, je me vois réduit à ce thème par la pauvreté de mon savoir. Qui plus est, pour ma part, je revendique de tout écrivain, tôt ou tard, le récit simple et sincère de sa propre vie, et non pas simplement ce qu'il a entendu raconter de la vie des autres hommes; tel le récit que, par exemple, il enverrait aux siens d'un pays lointain; car s'il a mené une vie sincère, ce doit, selon moi, avoir été en un pays lointain. Peut-être ces pages s'adressent-elles plus particulièrement aux étudiants pauvres. Quant au reste de mes lecteurs, ils en prendront telle part qui leur revient. J'espère que nul, en passant l'habit, n'en fera craquer les coutures, car il se peut prouver d'un bon usage pour celui auquel il ira.
L'existence que mènent en général les hommes est une existence de tranquille désespoir. Ce que l'on appelle résignation n'est autre chose que du désespoir confirmé. De la cité désespérée vous passez dans la campagne désespérée, et c'est avec le courage de la loutre et du rat musqué qu'il vous faut vous consoler. Il n'est pas jusqu'à ce qu'on appelle les jeux et divertissements de l'espèce humaine qui ne recouvre un désespoir stéréotypé quoique inconscient. Nul plaisir en eux, car celui-ci vient après le travail. Mais c'est un signe de sagesse que de ne pas faire de choses désespérées.
Si l'on considère ce qui, pour employer les termes du catéchisme, est la fin principale de l'homme, et ce que sont les véritables besoins et moyens de l'existence, il semble que ce soit de préférence à tout autre que les hommes, après mûre réflexion, aient choisi leur mode ordinaire de vivre. Toutefois ils croient honnêtement que nul choix ne leur est laissé. Mais les natures alertes et saines ne perdent pas de vue que le soleil s'est levé clair. Il n'est jamais trop tard pour renoncer à nos préjugés. Nulle façon de penser ou d'agir, si ancienne soit-elle, ne saurait être acceptée sans preuve. Ce que chacun répète en écho ou passe sous silence comme vrai aujourd'hui, peut demain se révéler mensonge, simple fumée de l'opinion, que d'aucuns avaient prise pour le nuage appelé à répandre sur les champs une pluie fertilisante. Ce que les vieilles gens disent que vous ne pouvez faire, vous vous apercevez, en l'essayant, que vous le pouvez fort bien. Aux vieilles gens les vieux gestes, aux nouveaux venus les gestes nouveaux. Les vieilles gens ne savaient peut-être pas suffisamment, jadis, aller chercher du combustible pour faire marcher le feu; les nouveaux venus mettent un peu de bois sec sous un pot, et les voilà emportés autour du globe avec la vitesse des oiseaux, de façon à tuer les vieilles gens, comme on dit. L'âge n'est pas mieux qualifié, à peine l'est-il autant, pour donner des leçons, que la jeunesse, car il n'a pas autant profité qu'il a perdu. On peut à la rigueur se demander si l'homme le plus sage a appris au cours de sa vie quelque chose qui ait une réelle valeur. Pratiquement les vieux n'ont pas de conseil important à donner aux jeunes, tant a été partiale leur propre expérience, tant leur existence a été une triste erreur, pour de particuliers motifs, suivant ce qu'ils doivent croire; et il se peut qu'il leur soit resté quelque foi capable de démentir cette expérience, seulement ils sont moins jeunes qu'ils n'étaient. Voilà une trentaine d'années que j'habite cette planète, et je suis encore à entendre de la bouche de mes aînés le premier mot d'un conseil précieux, sinon sérieux. Ils ne m'ont rien dit, et, probablement, ne peuvent rien me dire à propos. Ici la vie, champ d'expérience de grande étendue, inexploré par moi; mais il ne me sert de rien qu'ils l'aient exploré. Si j'ai fait quelque découverte que je juge de valeur, je suis sûr, à la réflexion, que mes mentors ne m'en ont soufflé mot.
Certain fermier me déclare : « On ne saurait vivre uniquement de végétaux, car ce n'est pas cela qui vous fait des os »; sur quoi le voici qui, religieusement, consacre une partie de sa journée à soutenir sa thèse avec la matière première des os; marchant tout le temps qu'il parle, derrière ses boeufs, qui, grâce à des os faits de végétaux, vont le cahotant, lui et sa lourde charrue, à travers tous les obstacles. Il est des choses réellement nécessaires à la vie dans certains milieux, les plus impuissants et les plus malades, qui, dans d'autres, sont uniquement de luxe, et dans d'autres encore, totalement inconnues.
Il semble à d'aucuns que le territoire de la vie humaine ait été en entier parcouru par leurs prédécesseurs, monts et vaux tout ensemble, et qu'il n'est rien à quoi l'on n'ait pris garde. Suivant Evelyn, « le sage Salomon prescrivit des ordonnances relatives même à la distance des arbres; et les préteurs romains ont déterminé le nombre de fois qu'il est permis, sans violation de propriété, d'aller sur la terre de son voisin ramasser les glands qui y tombent, ainsi que la part qui revient à ce voisin ». Hippocrate a été jusqu'à laisser des instructions sur la façon dont nous devrions nous couper les ongles : c'est-à-dire au niveau des doigts, ni plus courts ni plus longs. Nul doute que la lassitude et l'ennui mêmes qui se flattent d'avoir épuisé toutes les ressources et les joies de la vie soient aussi vieux qu'Adam. Mais on n'a jamais pris les mesures de capacité de l'homme; et on ne saurait, suivant nuls précédents, juger de ce qu'il peut faire, si peu on a tenté. Quels qu'aient été jusqu'ici tes insuccès, « ne pleure pas, mon enfant, car où donc est celui qui te désignera la partie restée inachevée de ton oeuvre? »
***
Biographie en résumé
Écrivain américain. Disciple de Ralph Waldo Emerson, il "fut un non-conformiste résolu. Après avoir vécu seul dans une cabane au bord d'un étang dans les bois, Thoreau publia Walden, récit de cette expérience, dans lequel il prêche la résistance aux diktats de la société organisée. Ses écrits expriment la tendance à l'individualisme fortement enracinée dans l'âme américaine" (Portrait des USA. Chapitre 10." L'Amérique et les arts" (Service d'information du Département d'État américain).
Dans son essai La désobéissance civile ( Civil Desobedience, 1849) Thoreau proclame son hostilité au gouvernement américain, qui tolère l’esclavagisme et mène une guerre de conquête au Mexique. « Pas un instant, je ne saurais reconnaître pour mon gouvernement cette organisation politique qui est aussi le gouvernement de l’esclave. (…) Je pense qu’il n’est pas trop tôt pour les honnêtes gens de se soulever et de passer à la révolte. Ce devoir est d’autant plus impérieux que ce n’est pas notre pays qui est envahi, mais que c’est nous l’envahisseur. » L’essai eut une grande influence sur le Mahatma Gandhi et sur Martin Luther King.
Pour continuer l'aventure avec Henry David Thoreau contemporain Cliquez ici
22:49 Publié dans Petit traité de médecine à l'usage des rustres | Lien permanent | Commentaires (1)
30/11/2008
La Denise est passée à cinq heures...

Michel Malnuit autoportrait
Malnuit a publié de son vivant un certain nombre de textes dont La denise est passée à 5 heures. Mon intention est non seulement de rendre disponible toute l'oeuvre publiée de Malnuit, mais aussi de publier celle qui ne l'a pas encore été...
Pour certains manuscrits dont il a fallu corriger et revoir le texte- passages incompréhensibles écrits sous l'emprise de l'alcool- passages entiers à supprimer qui n'amène rien au lecteur... Ce travail je le fais sous le contrôle de Bédé, alias Françoise Malnuit.
Traduire Malnuit en français sans altérer le substantifique moelle c'est un travail absolument étrange qui se situe à mi chemin de la traduction et du rewriting. C'est de la traduction sans en être...
Du rewriting sans en être... Il suffit parfois simplement d' aérer le texte par des retours à la ligne, mettre des points, là où parfois il n'y a que des virgules qui en saccades finissent par plomber l'appétit du lecteur...
Terribles décision à prendre et à assumer... Cela a été étrange de découvrir la force du texte sous les scories qui l'encombraient... De redécouvrir cet auteur quasi inconnu et d'être persuadé là encore de toucher du doigt une grande oeuvre... Un peu comme celle de René Barde... ces deux là ne se connaissaient pas n'avaient rien en commun et pourtant...
un petit extrait
—Neige alors drue !
— Souaf souafeuse et faim de loup !
— De loup hou-hou,
— De fofifon et, hé hé : de ragoût ragoûtant !...
— Alors... à table !
Et que je te verse. Corbières. Rasades.
— Vin cuit pour celles qui…
— Oh oui bien volontiers merci !
— Santé !
— Conservation !
— Y avait longtemps !...
Nos aises... Taillées dans le fameux gros pain nos aises, taillées dans ce qui reste du pâté…
— A moinsse, qu’on en aye racheté...
Taillées dans les bavettes, des sur-mesure pour chaque une et chaque un. Et les toutous qui tournent et virent, et le fuego qui crépite, et dehors les flocons
— Dis-donque ce coup-ci c’est parti !...
Parti la neige... parti la daube... et les vins lourds, Bordeaux, Vieux Pape...
— Y a...vait pas un... ptit Minervois ?...
— M’inerve pas ac ton Minervois ...
Tournée aller tournée retour, je suis peu pour ces lourds je m’en reviens à ceux qui tachent. Et qu’à se tendre les plates et qu’à se tendre les vides et se remplir les vides et se vider les pleins et s’envoyer tout ça qu’assurément c’est pas dégueu…
— Pas plus haut que le bord merci et si tu veux savoir t’as qu’aller dire à Polbocu qu’il est venu pour lui le temps de le rendre son tablier ah si ah si !...
Et les douces effluves ondulantes me serinent à la serinette l’opulence et le dénuement... la blanche neige symbol... hic ! eee, j’entends « Mazio t’es un inquiet » fin de citation sans date et moult fois réitérée ni vraie ni fausse donc vraie, ou fausse... la solitude la communion... tu parapport à je... me sentais rien qu’un œil, pas voyeur mais voyant... petit peu voyeur quand même.
—Plaisir... de voir c’est boire des yeux !...
De boire...
En me dressant bien haut les antennes hors des gaines et j’avais l’air... ou pas... comme ça...
— Recul approche...
— Et recul et approche...
— Et re... cula... prrroche...
— Loin...
— Pas là...
— Où ça ? ...
— Ailleurs.
— Où ça ?...
— Qui quoi...
Bédé. Ma gauche. La joie... ou l’abrutissement. Jaja. Coucou.
— R’un coup de daube, cette...
— Vindieu !...
Moment... moment un tant soit peu durable un... tant soit peu total... un temps... soit peu qui fut !... rempli comme les estomacs ! Petit délire tant soit peu rien. Rempli de mots. Pas les ceux qui volaient bien sûr, ceux-là... perdus ! tous envolés !... qu’on retrouverait dans les murs... dans le lambris sous les dessins... dans le four à pain qui sert de sac à vin... dans les festons de la nappe blanche à festins... dans le paillon des chaises... dans la boîte à cigares, lesquels itou partent en fumée ! Mots morts sitôt qu’on les a dits, vivants tout juste l’instant des bouches et de ces goûts qui les tapissent, tissage ou modelage, ou sculpture d’air... et l’air qu’a le sculpteur souvent très convaincu pas toujours convaincant, jactant cette drôle d’histoire de bonhomme antérieurement cheval et en voici la preuve mais restez donc assis : ayant perdu un fer il s’en est souvenu précisément où ça... et il l’a retrouvé... Ou celle-ci encore plus bizarre tout autant authentique et qui dit que l’individu ici-présent pour le plaisir commun Couraudon Le Besset... serait, comment douter ? un des, pour pas dire ze ! unique survivant de l’hécatombe du Montségur... « enchanté, verse m’en un »...

photo Bédé
Et je m’allume un clopinet,
— Mmm, pas de doute là-dessus et de loin : j’me préfère le corbières des Corbières à ces velours d’Bordeaux et d’ailleurs qu’on sait même pas d’où j’vous les brade avèque « sans façon » le from des Pyrénées,
— Bien que ça j’aimerais l’aimer c’est pas d’blague
— Tu dis ça
— Mais c’est pas vrai
— Alors goûte-z-y
— ça veut pas »...
Et nia et nia
— Pas insister sinon je pique ma crise je vomis tout j’inonde je vous pleure dans l’assiette je vous renie définitif !...
Et je sais plus tant quoi vous narrer qui soit marrant de ces agapes, qu’ont pourtant bien duré leur couple d’heures à l’aise oh oui ! Sauf ça. Qui nous reviendra à tous à toutes en son temps... chacune... chacun... clair et net. Précis. Incisif. Comme un coup de trique. Comme. Un burin de Rembrandt. La Denise est passée à 5 h. Environ.
Sur le coup j’ai pas fait gaffe en tout cas peu importe sinon, que pour ma part, j’ai dit à ma voisine, Bédé
— Regarde, tu l’as vue ? c’est Denise, la fille à l’Émile...
et je suis sorti pour lui serrer la main bonjour,
— ça va ?
– ça va ...
Et elle a dit aussi :
— Alors ? revenu ? et peut-être aussi « voir les amis ? » et j’ai pu dire
— Oui, quelques jours »...
Alain était près d’elle et il parlaient du vilain temps, et elle avait un seau... fontaine chercher de l’eau oui, de l’eau à la fontaine... Rentré mézigue j’ai repris mon endroit à côté de Bédé
— Tu l’as vue ?
— Oui, pas beaucoup mais j’l’ai vue, oui »...
Parce qu’à Bédé je lui avais dit les deux ou trois choses... qu’elle vivait là avec son père qui l’avait élevée tout seul, sa mère était morte elle était tout bébé... et ça presque incroyable : elle était jamais descendue à Biert au village... toujours restée ici... trois choses à peu près tout. Quasi. Alors. Les questions les problèmes... quasiment le mystère ? mais non. Pas de mystère. Tout clair. Tout net ! Pasque là, ouais... déjà t’à l’heure la sécheresse, rapport à nos agapes... d’agapê qui veut dire amour c’est grec, c’est pas chinois... je pouvais plus. Qu’abréger tout. On est montés. Changer d’endroit et... écouter des musiques et, continuer à causer, fumer, boire se chauffer tout ça. Aux étages. D’où c’est vrai je suis redescendu pour pisser... puis... sur la tôle dressée à moitié à droite de l’entrée j’ai eu l’idée d’écrire au doigt dedans la neige épaisse d’une main « just maried » et « Alain ! ho Alain ! viens voir ! t’as un message !
– Quoi ?
– Un télégramme ! »
Et il a déboulé comme un fou incrédule, j’y ai dit monte là dessus où j’étais, dessus un tas ou la chèvre ou le pétrin qui traîne toujours là à l’envers... il est venu et il a vu et, m’a traité de tous les noms copieux en chipotant d’avoir l’air de se marrer, même ils sont tous radinés voir. On a bien ri. Sinon. Autour et à partir de là je vois que dalle... jusqu’à quand qu’Alain dégringole quatre à quatre on était là-haut... et en bas ça frappe ! Ç’aurait pu être ceux du Ramé ? Plus ou moins attendus vers les pâques rappliqués de leur Nantes, ou bien Rico le peintre... ou l’Émile c’était bien son heure, 7 ou 8 ?... et on bavardait avec Pierre mollo étendu trop bouffé la ceinture relâchée, « Mazio ! descends ! » j’entends, « vite ! »... ah... Isabelle a changé d’œil... elle a dit que c’est l’Émile... Mes godasses...
— Mazio ! t’arrives ? ...
— Et merde, de lacets…
Swann dans les jambes je déboule. Émile, Alain, nerveux les deux, j’ai l’impression,
— Queskia ?
— Denise a disparu... maison fermée de l’intérieur ...
— On y va.
L’Émile déjà là-bas, marmonne, nuit noire, Alain une torche. Rien. Marmonne... et que ça sentirait mauvais... Alain chercher une échelle... était pas aux brebis comme d’habitude tous les soirs... attendu un peu une demi-heure, et alors non y a quelque chose... venu voir, trouvé ça : fermé, c’est du dedans. L’échelle.
— Laissez l’Émile, j’y vais .
Et ça pleut neige gouttes dans les yeux...
— Regardez sur le lit ...
Fouille avec la loupiotte... «
— Y est ?... pas ? »...
— Là-haut
— Oui... y est
Et l’Émile
— Nom de dieu
— Grimpe.
— Attendez !
Déjà haut, près, la torche, Alain donne, passe en bas... son regard !... Là-haut bing ! le carreau badagling ! gling ! réflexe la tête le coude !... et tous les trois l’un après l’autre par la fenêtre et dans la chambre. Denise... sur le lit sur le ventre tête côté. L’Émile est allé tourner le bouton, et
Nom de dieu et va savoir et quelle idée pourquoi ce qui l’a pris
— Qu’est-c... qu’elle a fait ?...
— Qu’est-ce que tu as fait là, dis ! qu’est-ce que tu as fait ? »...
Et Alain et moi on la retourne sur le dos et
— Nom de dieu Mazio...
Il dégage le cou serré «
— Voilà ce qu’elle a fait, voilà !...
Et il sort son inséparable lame, la glisse fébrile mais sûr entre la peau et ce ruban et tchac !... et la Denise elle est bien chaude ! autant que toi ! que moi !...
— Allons, tant que possible, de la méthode...
— Voyons... si le cœur bat.
Je palpe. Et pas le moindre bruit. Retenir ma respiration. Malgré ça j’entends, je sens, que moi, que... dalle ! que... moi ou quoi... ?
Dans mon oreille dessus son sein y avait mon cœur et pas le sien s’il battait j’entendais le mien !... Alors, respiration artificielle. Traction du bras, gauche, droit, une, deux, une, deux, descendre, monter et... je monte descends à califourchon.
— De dieu de merdalors j’aimerais voir ça un peu tiens si t’as fait la conne !
Et han ! et han !... ça marchait pas des mieux. Terrible face à face que je venais d’entamer là. Avec qui ? qui es-tu ? pour nous faire comme ça me faire m’activer s’activer allez ! han !... Je sentais pas très… Je, j’étais pas à l’aise et rien disait sur sa figure si ça pouvait venir,
— Quéchose ?
— Non et non !!!
Redescendre. Entamer bouche-à-bouche. On sera plus en tête-à-tête... je... et... ses yeux mi-clos sur... mi-ouverts que j’ai pas su voir si quoi... Voyons. La bave. Une drôle de bave un peu verte, m’a semblé. Avec la main, j’essuie. Lèvres bleutées légèrement... lesquelles... sur lesquelles... peut-être que jamais... mais les miennes, et pour que ça vive ça nom de dieu,
— Deniiiiiise ! déconne pas !!...
Et qui pouvait me dire où c’est qu’on allait comme ça ? jusqu’où ? combien ? et si c’était utile ? vraiment ?... vraiment ?... Je plaquais bien ma bouche en, d’une main la gauche à deux doigts pouce index lui creusant les deux joues entre les deux mâchoires pour la faire se l’ouvrir et, de l’autre, à deux doigts pareils doigts et main droite je lui bouchais le nez, et l’air c’était le mien que... j’aspirais féroce et je lui donnais tout. Cet air. Que je respire, et qui me sert à quoi ? Qui pouvait tout pour elle. Que j’avais l’impression de sentir refroidir... et une voix, l’Émile :
— Regarde !...
J’ai regardé, très vite levé la tête accommodé mon œil... mais comme quoi tout ça c’était peine perdue. Une étiquette rouge sur un petit flacon minable de rien du tout.
— C’est fini ! c’est fini ! ... l’Émile.
Alain est revenu avec du lait d’abord... qu’est resté sur la table en bas où il a trouvé ce flacon... les filles ensuite , Bédé Isabelle... et Isabelle pour s’occuper d’Émile.
— Et toi Bédé tu viens m’aider.
Appuyer là-dessus les côtes pour sortir l’air que je lui souffle. Pendant ce temps, Alain taille jusqu’aux Jaques chercher la fille Rico que paraîtrait qu’elle est ici et étudiante en médecine à sa cinquième année ! Okay. Alors Bédé mézigue tout ce qu’on sait on croit savoir ! Continuer.
—Dedieu dedieu Denise... l’Émile...
— Isabelle tu t’occupes hein.

photo Bédé
Et mal aux reins bordel j’en peux plus, courber relever courber relever... souffler tout ! fort ! à y laisser pas que mon air ! tout mon être !... et elle est nettement plus froide ! merde... ça fait rien je m’accroche je la gonfle Bédé la dégonfle et la gonfle, la dégonfle, gonfle, dégonfle, et tant que y a de l’espoir y a de la vie la vie la vie... la vie... la mort... ? non pas la mort non... non... la vie !... la vie, même sans espoir même, sans espoir n’est-ce pas Denise... n’est-ce pas Denise... Denise... hé... tu m’entends ?... me sens ?... sens ?... tu sens ?... hé... dis... la vie... ma bouche... tous ses... tous ces baisers ?... à quoi tu joues... tu jou... is ?... au moins ?... ou mairde !...Denise !... sans blague... quoi... ‘niiiiise !!!... salope !... et chuis poli !... Et ... Oui... Tout ça.
Et bien beaucoup plus d’autres choses me suis je pensé avoir ressenti. Terrible. Époustouflant c’est bien le cas : de l’ancien françois « s’esposser » qui veut dire s’essouffler. J’y reviendrai peut-être... ou pas. Comme si... j’ai mal à dire... ma j’ai besoin... cette fille.
Denise. Trente huit ans, qu’avait tout l’air solide, certaine corpulence on dit, ça peut se dire, et vierge ça peut se dire, du moins ça pouvait que se croire... et fille de l’Émile, un chêne !... cette femme donc.
Comment dire ça. Que ça. Me devenait tout l’important c’est ça. Que ça. Qu’une femme peut devenir. Et qu’elle avait pas pu. J’ai parlé de mystère quand y avait rien qu’un drame... vrai. Et si simple et si plein et si brut. Dur comme c’est dur de vivre. Ici. Elle. Etcétéra et quoi ?... Quand ils sont arrivés j’étais sur le point d’abandon... exténué vidé. Flat !... Et de tout ce temps l’Émile ?...

Peinture Michel Malnuit: "Elle est partie" 140 x165 acrylique sur toile, rajout de tissu et de verre
16:06 Publié dans Extraits de romans | Lien permanent | Commentaires (0)
27/11/2008
Pelieu Whas here.....
C'est parti à l'imprimerie... L'ouvrage collectif et La crevaille... Une dizaine de jours de retard seulement sur le planning... Que dalle pour ainsi dire... On fera mieux la prochaine fois c'est sûr... Pélieu c'est qu'un début ... C'est un puits, une mine, l'homme... et avec les moyens contemporains de production c'est aisé de reproduire avec peu de capitaux au départ son oeuvre pour continuer à la faire vivre... Mais ça c'est le petit punk, doctor en litteratur, rien que ça qui s'y colle, j'ai nommé le sieur Delaune...
Le Cap'tain lui il va continuer à faire le secrétaire et à rameuter les foules, et moi à me taper le boulot de mise en page... Bref on change pas une équipe qui gagne à être connu... Pélieu est en de bonnes mains... 9 litres au cent pages... mais c'est du diesel, ça tourne sans à coups...

18:08 | Lien permanent | Commentaires (0)


