02/02/2007
JAZZ, AMOUR, SILENCE & REVES
L'année 2007 commence en Février aux Carnets du Dessert de Lune.
- Il y a du jazz avec un titre dans la collection Pièces Montées :
VISIONS OF MILES - Textes et dessins : YVES BUDIN
54 planches originales (34 quadri) (20 noir et blanc)
Préfaces : MARC MOULIN et JEAN-POL SCHROEDER
Conception graphique et mise en page : PHILIPPE HAULET
72 pages au format 29,5 x 20,5 cm - ISBN : 978-2-930235-75-2
Prix : 24,00 €
- De l'amour, du silence et des rêves avec trois titres dans la collection Pleine Lune :
AMOUREUSE - EVA KAVIAN-
Proses et Poèmes
Couverture couleur et 24 ill. intérieures en noir et blanc : GEORGES VAN HEVEL
76 pages au format 14,8 x 21 cm - ISBN : 978-2-930235-76-9
Prix : 11,50 €
COUPS DE CISEAUX - PERRINE LE QUERREC & STEPHANIE BUTTAY
Texte : Perrine Le Querrec - Couverture couleur et 32 ill. intérieures en noir et blanc : Stéphanie Buttay
Préface : GERARD SENDREY
78 pages au format 14,8 x 21 cm - ISBN : 978-2-930235-77-6
Prix : 12,00 €
ELLIS ISLAND'S DREAMS - MENACHE
Poèmes - Couverture : ROUDNEFF
Présentation : JEAN-LOUIS JACQUIER ROUX
38 pages au format 14,8 x 21 cm - ISBN : 978-2-930235-78-3 - 8,50 €
Ces 4 ouvrages vous sont proposés en souscription jusqu'au 26 février 2007.
Les 100 premiers souscripteurs des 4 titres recevront un dessin inédit d'Yves Budin,
« Jazzman & Hudson Hornet » imprimé sur papier Greentop Naturel, 170 gr. ,
au format 29,7 x 21 cm, numéroté de 1 à 100 et signé par l'auteur.
Pour commander le ou les titres, télécharger le bon de commande des éditions les carnets du dessert de Lune en cliquant dessus le bon_de_commande_2007.doc.pdf
Pour en savoir un peu plus, voyez la suite.
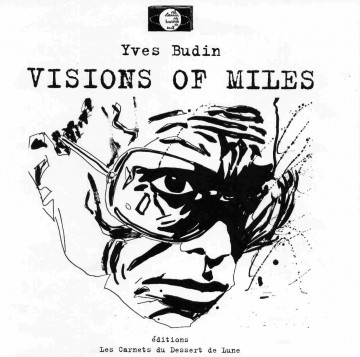
YVES BUDIN - VISIONS OF MILES
(…) Moi, ce que je commence par aimer chez Budin, c'est la texture de son trait. Dès que ça part, ça ne convient déjà plus pour une illustration du petit Larousse illustré : ça vit, ça bouge, ça crie, ça chatouille, ça change d'épaisseur aux endroits inattendus, on se demande (comme avec le dessin de la page 59) si ça va être abstrait ou concret, et puis la tension se résout. Et on accepte, on adhère, on approuve et enfin, on adore.
- Notre époque, boulimique d'images, a fini par les décrier - séquelle de la télé? - dans un rapport d'amour-haine très caractéristique de certains comportements religieux. On finirait par en oublier ce que l'image, si vite et avec si peu de moyens parfois, nous apprend. Comment elle nous fait apercevoir en un instant ce dont de longs discours ne permettent même pas de donner une approximation. Napoléon a dit au moins une chose impérissable à ce sujet.
- Et voilà ce que j'aime chez Budin. Son livre (et son talent) ne nous renseigne à première vue que modérément sur l'art, l'histoire et le pourquoi de Miles Davis. Le minimum est qu'on sache au moins ça sur le Picasso de la musique. Mais sur l'art et la vie du très pictogénique Miles, les dessins de Budin nous offrent peut-être autant d'intuitions et d'informations - même si elles sont d'une nature différente - que les plus incontournables ouvrages de longues écritures qui lui ont été consacrés (notamment les bibles que sont les livres de Ian Carr, de Jack Chambers et de Miles lui-même - son autobiographie -).
MARC MOULIN (extrait de la Pré-face A)
(…) Miles. Et Yves Budin. Budin plays Miles - comme on disait Miles plays Bird, Miles plays Gil Evans ou, la plupart du temps, Miles plays Miles. On disait aussi, de Louis Armstrong, de Lester Young ou de Chet Baker (de Louis, de Lester, de Chet) qu'ils jouaient comme ils chantaient, et retour. De même, le dessin et le texte d'Yves Budin résonnent au même diapason ; celui, écorché et fin de nuit d'un dealer de spleen et de lumière noire : à l'image de Miles finalement. CQFD. Je laisse aux spécialistes de la BD le soin de vanter le trait, l'encrage et le reste. Je dis simplement, pour ma part (et pour la part du bleu - un must pour un spécialiste du black and white maculé de rouge) que ce portrait plein de bruit, de fureur rentrée et de silence débordant, apporte, aux antipodes du merchandising ambiant, un supplément d'âme à la paralittérature milesienne et à la paralittérature jazzique en général. (…)
JEAN-POL SCHROEDER (extrait de la Pré-face B (alternate take)
- L'AUTEUR :
- Né en 1974, dessinateur liégois, autodidacte, régent littéraire (français-histoire), passionné de musiques, de littérature américaine, d'Art en général, c'est par les écrits de Jack Kerouac qu'Yves Budin, s'est spécialisé dans l'illustration de l'univers du jazz. Son graphisme nerveux traduit les envolées de ceux qui sont devenus ses musiciens de prédilection : Miles Davis, Coltrane, Parker, Mingus… Il expose régulièrement dans les festivals jazz et a récemment illustré chez le même éditeur « La quadrature du cercle » de Jean-Christophe Belleveaux « Visions of Miles » est sa première publication. Bio, expos, projets et principaux travaux sur : sundancejazz
--------------------
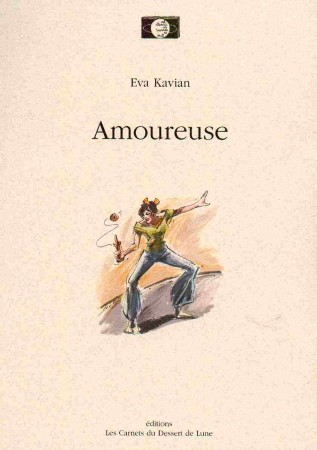
EVA KAVIAN - AMOUREUSE - GEORGES VAN HEVEL
Eva est amoureuse. Il faudrait se dit-elle mettre amour et toujours dans le même poème, mais elle sait que toujours n'existe que pour les framboises écrasées sur les nappes trop blanches alors elle plonge dans la confiture, comme si l'on pouvait se noyer dans un bocal avec l'amour posé au bord. Et l'amour se penche et attrape la cheville déjà sucrée d'Eva mais glisse lui aussi dans les framboises rouges éclaboussant au passage l'entourage qui prend le jus pour du sang. Dans le fond du bocal Eva trouve l'amour accroché à sa cheville et le prend dans ses bras et lui dit pour toujours mon amour, la vie est un poème où l'on ne peut que se noyer. L'amour n'entend rien, avec la confiture dans ses oreilles mais il est bien, dans les bras d'Eva qui pourtant le lâche et lui tourne autour en quelques brasses jusqu'à la ligne sombre entre ses fesses qu'elle trace de sa langue coquine pour laisser une chance à la rime. Avant de sortir du bocal.
- LES AUTEURS:
- Née en 1964 en Belgique, Eva Kavian anime des ateliers d'écriture depuis 1985. Après quelques années de travail en hôpital psychiatrique, une formation psychanalytique et une formation à l'animation d'ateliers d'écriture (Paris, Elisabeth Bing), elle a fondé l'association Aganippé, au sein de laquelle elle anime des ateliers d'écriture, des formations pour animateurs, et organise des rencontres littéraires. L'Académie des Lettres lui a décerné le prix Horlait-Dapsens, en 2004. Elle a reçu le prix Marcel Thiry 2006, pour son dernier roman, « Le rôle de Bart ».
- Georges Van Hevel. Né en 1956. Graphiste et illustrateur, il se tourne d'emblée vers l'affiche et dessine pour le monde de la presse. Il se spécialise dans l'image de marque d'entreprise et le design graphique. Dans les années nonante, il fonde Quidam Studio dont les créations variées n'hésitent pas à intégrer les technologies d'illustration numérique les plus récentes.
--------------------
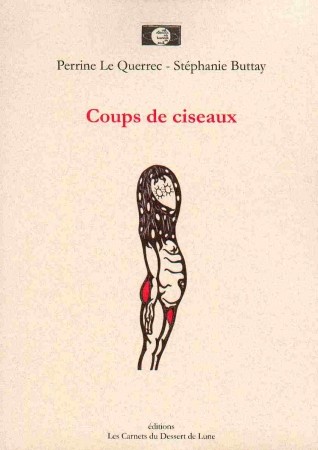
PERRINE LE QUERREC - COUPS DE CISEAUX - STEPHANIE BUTTAY
Elles sont trois femmes fortes autour de Oui-Merci, diversement armées pour ne pas subir l'existence, chacune revendiquant sa condition face à l'héroïne sadique dont elles souffrent toutes à la mesure des émotions provoquées en elles par l'état fragile de leurs sens. Ils sont deux petits mecs faiblards : Le grand géniteur contrit et le poussin anthropophage. L'aîné se répand en concessions fugitives. Et le plus jeune obsessionalise le chant du coq troubadour bas de gamme, à lui tout seul con comme un ballet de ténors dans les solos déchirants de l'impossible jalousie.
Perrine et Stéphanie sont les plus proches parentes de Oui-Merci. Il s'agit d'une trilogie dont le point commun est la souffrance devant le désir d'accomplissement total, au prix du chaos. La destruction de l'autre est une sauvegarde de soi.
Une fable subversive d'utilité pudique ; un paradoxal cri de joie dans toute la détresse du monde réduite à des éclats de style. Femmes, je vous aime !
GERARD SENDREY (extrait de l'avant-propos)
- LES AUTEURS :
- Perrine Le Querrec est née à Paris en 1968. Elle écrit des nouvelles (Fourmilière, Editinter, 2004 et Tu ne liras point par-dessus l'épaule de ton voisin, Éd. Terre de Brume, 2003, adaptée pour le cinéma par Anaïs Vachez). Spécialiste en art contemporain, elle collabore chaque semaine aux magazines culturels en ligne bulbe.com et état-critique.com.
Elle vit et travaille à Paris comme recherchiste-documentaliste indépendante pour de nombreux auteurs et artistes.
- Née en 1968 au bord du Léman, Stéphanie Buttay traversa le lac et découvrit les auteurs de la Collection de l'art brut (Lausanne). Elle commença alors à jeter ses fils et ses lignes sur le papier. En 2005, elle a présenté son travail dans le cadre des Visions et Créations Dissidentes du Musée de la Création Franche (Bègles, Gironde), où elle figure désormais en tant que «créatrice concernée».
--------------------
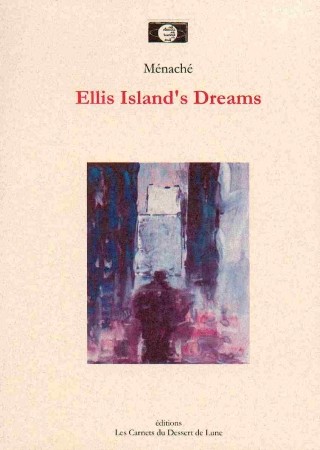
MENACHE - ELLIS ISLAND'S DREAMS - ROUDNEFF
Existe-t-il des pays propices au(x) rêve(s) ? Je n'imagine pas Ménaché s'embarquant pour la terre de l'Oncle Sam, voici bientôt quinze ans, avec semblable question en tête. Il y a longtemps que ce perpétuel exilé dort d'un sommeil trop léger pour succomber aux tentations clinquantes des empires de cocagne. Aux Etats-Unis d'Amérique comme ailleurs, l'espoir vire souvent au cauchemar. La vie cependant s'agrippe à ce quotidien brutal et inhumain « dans une perpétuelle recréation du monde » et c'est précisément là, au cœur de ce no man's land déglingué, que le poète a choisi de mêler sa voix à celle de ses frères de presque silence. Sans un mot plus haut que l'autre, mais avec force, le poème vient cingler le lecteur comme une averse prompte à « faire chanter le feu et le cuivre » en chacune de ses veines.
Jean-Louis Jacquier-Roux (4ème de couverture)
- LES AUTEURS:
-Ménaché est né à Lyon, le 15 juillet 1941. Principales publications : Pavés et Fenêtres, éd. Pierre-Jean Oswald, 1971 ; Fable des matières, éd. du Dé Bleu, 1983 ; Claquemuraille, éd. Fédérop, 1985 ; Ectoplasme à plumes rouges et bonnet de nuit, La Bartavelle éditeur, 1991 ; Célébration de l'œuf, Orage-Lagune-express, 2002 ; Rue Désirée, une saison en enfance, Editions La Passe du Vent, 2004. Une anthologie de ses poèmes a été enregistrée par Alain Carré : Excès de Naissance, éd. Autrement dit, 2004.
- Roudneff. Né en 1933 à Faymoreau (Vendée). Réalise plusieurs livres d'artiste ou illustrés en collaboration avec des poètes, notamment Plier Bagage avec Michel Butor, Michel Dunand, Jean-Pierre Gandebeuf, Jean-Louis Jacquier-Roux, Ménaché, 1997 ; Feuilles de route, avec Jean-Pierre Gandebeuf, 2002 ; Regard sur le silence, avec Jean-Pierre Gandebeuf, Gino Maselli, Ménaché, Philippe Tomasini, 2002.
21:15 Publié dans Les copains d'abord | Lien permanent | Commentaires (0)
La nostalgie, camarade... sur un air de Serge Gainsbourg
Je laissais tourner mon magnéto face à cet homme. A combien de wiskys en étions nous. Je l’ignore. Il admirait Hemingway, st Exupéry et Cendrars. Cet homme d’action ne pouvait en aucun cas être stupide. Notre discussion n’avait porté que sur la littérature jusqu’à présent. Je sentais la chaleur du bourbon me battre les tempes. Et j’écoutais. J’avoue que si je n’avais pas gradé ouvert le magnétophone, je ne me serais pas souvenu ce qu’il m’avait raconté.
-Vous les pacifistes vous me faites rire, vous n’êtes que des imbéciles. Vous crachez dans la soupe mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous devez à l’activité de la guerre. Vous voyez mon cher ami, entre gens civilisés on ne peut pas cracher sur la guerre. Parce que c’est l'activité humaine la plus sérieuse qui soit. Rien n'est plus captivant, ne requiert autant d'énergie. La guerre est à la base de toute société. Toute activité humaine, si elle veut progresser, doit s'inscrire dans cette logique. Il n'y a que chez les primitifs, les sous-développés que la guerre ne sert pas le progrès. Ils se massacrent à coups de machette, s'égorgent au tesson de bouteille, se font gicler la tripe à la serpe. C'est pas du travail… On en parle à peine à la télé… vous le voyez bien vous qui êtes dans les médias que ça n'intéresse personne… Quel gâchis !
Alors qu'une bonne guerre moderne, comme on sait les faire ça maintient un Audimat en haleine pendant six mois, un an. Tous les bonimenteurs y vont de leurs pronostics, sur le déroulement des événements à venir. Les petites gens stockent des vivres, on écoule des tranquillisants. L'Audimat progresse, les pages de pub se vendent plus cher. Cela fait marcher le petit commerce, qui en a bien besoin. C’est merveilleux…
Les guerres des pauvres ne valent pas tripette. Un million d’Africains, ça fait moins de bruit qu’une poignée de bon gros pépères pétris de bonnes manières ou qu’un paquet de yankee réduit en poussières. Les guerres des pauvres sont sales, parce qu’elles sont silencieuses. Quelques explosions par-ci, par-là, quelques rafales de mitraillettes. Rien d'autre. Comment voulez-vous faire peur avec ça ? Comment ces difformes du bide, ces maigrichons couverts de mouches peuvent-ils faire trembler la ménagère? Ils sont trop maigres pour être crédibles. A peine réels. Non ?
Toute notre belle technologie ne leur sert à rien. Pas de radar, pas de contre-mesures électroniques, pas de sous-marins, pas d'avions, ni de chars. Il ne consomment rien, pas de bombes à ailettes, à fragmentation, à souffle, au phosphore, à ondes de choc. Pas d'obus, pas de canon, de jeep, d'half-tracks, de véhicules blindés, d'automitrailleuses, de barges de débarquement, de rations de survie, de casques lourds, de parachutes, de planeurs. Rien de tout ce qui fait notre belle civilisation ne les intéresse. Des cailloux, des couteaux, des arcs, des flèches, voilà de quoi se servent les pauvres, pour s'étriper. Une misère, je vous assure.
Chez nous, au minimum, ça finit par un grand feu d'artifice. Je te rase une ville, tu m’en rases une autre. En beauté, Dresde, Hiroshima, Londres. Nous autres, on ne lésine jamais sur la camelote. Qui plus est, maintenant avec la télévision, il faut mettre le paquet. Que les ponts s'écroulent, que ça pétarade, que ça casse, que ça bastonne, de partout. Beaucoup de bruits et de dégâts, pour peu de morts, finalement. Cent mille, deux cent mille, peut être ? De la rigolade. Pendant ce temps-là, à la machette, un million et demi, sans bruit. Avec, par-dessus, une couche d'épidémies de peste, de choléra, ou tout autre virus inconnu. Plus une bonne vieille famine. On frôle les deux millions en quelques semaines. Personne ne peut prétendre à mieux !

Pour obtenir le même chiffre, dans n'importe quelle guerre qui se respecte, au Vietnam, en 14 ou ailleurs, combien a-t-on utilisé de million de tonne, de napalm, d'agent orange, de gaz moutarde?
Nous, on sait faire durer… Cinq ans, dix, trente, ou deux générations. Pendant ce temps-là, on se hait. Là, en deux mois, plus rien. Ils se zigouillent jusqu’au dernier. Ce n’est pas du travail. Comment voulez-vous après ça, revendre des armes aux survivants pour venger leurs morts ? Ils n’ont aucun sens du commerce. Alors que nos guerres à nous, c’est pas croyable tout ce beau matériel qu'on utilise. Quand j’y pense.
C’est parce que les pauvres ne savent pas se tuer correctement, et qu’ils font ça quasiment avec rien, qu’ils ne peuvent que rester pauvres durablement. Pas étonnant que personne n'en entende parler. Heureusement qu’il reste quelques idiots de médecins français, à cheval sur les principes et arriérés au point de croire encore aux valeurs humaines pour en faire parler. Alors-la ça devient intéressant…
La guerre, c'est trop sérieux pour ne la laisser qu'aux seules mains des intérêts particuliers. Il faut aussi y associer, les publicitaires, les caméras… Le plus de monde possible, je vous dis. Pour vendre du papier il faut de la tripe à chaque repas. Sinon comment les braves gens pourraient se repaître de leur bonheur de vivre dans nos sociétés. Il faut qu’ils puissent mesurer leur joie. Sinon c’est pas du jeu. Il faaut qu’ils aient peur aussi pour qu’on puisse vendre les services de notre police.
Si on les laissait faire, les pauvres se garderaient tout le meilleur pour eux et on n’aurait pas droit à notre show télévisuel.
Même la Rome antique avec ses stades, ses lions, ses gladiateurs, ses esclaves ne pouvait pas en aligner autant de spectateurs. Six milliards d’un seul coup… C’est vraiment joli un puits de pétrole en feu, sur un ciel noir, avec une ambiance de fin du monde. La ménagère de moins de cinquante ans prend une poussée d’adrénaline. Elle court s’acheter des provisions car le pire est à venir. C’est du sérieux, ça... Pas comme ces peigne-culs de pauvres. Pire. Ils font eux-mêmes leurs kalachnikovs, avec des bouts de bois et des tuyaux au fond de leurs gourbis. Il faudrait que la convention de Genève interdise ça. Ils ne devraient avoir le droit de se charcuter qu’avec des vraies armes manufacturées sinon c’est un crime contre l’humanité Sinon à quoi servent tous nos efforts ?
C’est pas le tout de s’étriper, mais dans les règles de l’art, c’est bien plus profitable. Ça donne de l’emploi aux arsenaux. Notre belle industrie qui ne sert plus à rien. Ces saletés de pauvres nous la jouent bégueules et à la déloyale. Nos règlements, nos explosifs, nos tribunaux, nos procès et tout le bastringue ne servent plus à rien. Qu’ils se saignent n’a jamais empêché les mines de diamant de produire, les puits de cracher le pétrole, le pavot de pousser. Le profit est toujours là, malheureusement pas assez juteux. Dans l’échelle de l’économie, on pourrait faire des bénéfices à trois chiffres. C’est à cause de l’incivilité de ces sauvageons qu’on est obligé de se rabattre sur des opérations moins mirobolantes.
Le citoyen honnête en réclame pour ses impôts. On n’a pas le droit de le tromper sur la marchandise. Il faut qu’il ait peur et qu’il soit rassuré par cette noble institution qu’est l’armée. À quoi serviraient toutes ces médailles, ces camions, ces galons, ces défilés, sinon ? Si on n’y prenait pas garde et si on les laissait faire notre belle civilisation serait dangereusement menacée par tous ces primitifs.
07:00 Publié dans La vie des bêtes racontée aux enfants | Lien permanent | Commentaires (0)
20/01/2007
Vendredi Saint, Rouge à lèvre, Sucettes au citron vert
Carl Watson
Pour la seconde fois, ce jour-là, j’étais plongé dans quelque chose que je ne comprenais pas. À l’intérieur, mais sans en faire partie - rien à voir. À la télé, il y avait quantité de pubs pour du savon, des soutiens-gorge, des voitures de sport, des chaînes stéréos, et toutes sortes de trucs qui donnent envie de baiser. Tout ce qu’on voit est censé donner envie de baiser, ou au moins remplacer la baise par le shopping.
Après, ils ont diffusé une émission - un concours de play-back. Apparemment le monde, à l’extérieur, s’était mis au play-back comme à une forme d’expression créative. C’était assez triste, comme situation - emprunter les chants qui célèbrent l’accouplement à la culture de masse. Bon, tant pis. Allons-y. Ça et le reste. Du moment qu’on obtient ce qu’on veut.
Quelqu’un a zappé sur une émission où il y avait des camions aux pneus démesurés qui traversaient le feu, montaient sur des piles de bagnoles qu’ils écrasaient, j’en étais à ma troisième bière, j’ai jeté un coup d’œil autour de moi, et ils avaient tous l’air malades. Et pas seulement malades physiquement, mais dans la tête, aussi. Vous voyez. Les gens me disent qu’il y a trop de colère, en moi. Tant pis.
C’est vrai que je détestais les gens - ça continue, d’ailleurs. Ils ont des tronches graillonneuses et l’haleine chargée. Ils font trop de bruit et leurs halètements sifflants me gênent. Et je vais te dire, si t’as envie d’écouter des respirations sifflantes, des souffles rauques et sonores, c’est ici qu’il faut venir. Même l’horloge ahane comme une vieille bête anémique.
Je regardais l’horloge. Je tuais le temps. Je me disais qu’il fallait que quelque chose meure pour que quelque chose naisse. Je me mettais à philosopher. Il était à peu près trois heures, quand j’ai baissé les yeux et que j’ai vu une goutte de condensation rouler sur le bois brun du bar comme une larme. Et c’était un signe. Au bout du comptoir, un type a ouvert la bouche. À première vue, on aurait qu’il avait du cottage cheese dans la bouche, ou une infection aphteuse. Après, je me suis rendu compte qu’elle était pleine de trucs blancs, comme des vers. J’ai entendu alors un rire violent. Quelque chose a volé à travers la pièce et c’était pas un oiseau de paradis. C’était pas non plus une colombe. C’était petit, dur, brutal et amer. J’ai couru dehors. Il se passait quelque chose, et je ne savais pas quoi.
Le texte de Carl Watson, écrivain américain contemporain, reproduit ci-dessous, est extrait d’un receuil de récits, « Sous l’empire des oiseaux », édité en France par les éditions Vagabonde.
En savoir plus sur Carl Watson
Ecouter un morceau de Johnny Cash
11:10 | Lien permanent | Commentaires (0)
18/01/2007
Le primitivogonopénien
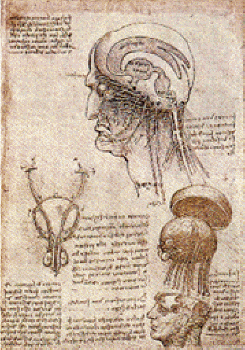
Ainsi appelé il se développe chez le sujet borgne. L’infection se loge dans la cavité orbitale vide et atteint rapidement le cerveau. On a vu chez certains sujets souffrant de cette infection que le cerveau secrète une matière qui dégage une odeur pestilencielle et présente un aspect proche de la soupe de potiron fermentée. Ce virus à tendance à faire voir le monde en noir et blanc au sujet, lequel organise dans la partie de son cerveau encore saine ses relations en deux parties bien distinctes et dispose d’un côté les bons et de l’autre les méchants -représentée par l'inconnu ou toutes différences qui deviennent alors incompréhensibles au sujet .
Le sujet vocifère, éructe et prétend avoir des solutions efficaces pour toutes choses. Il ne supporte que la musique cadencée, la couleur vert-de-gris et les chants simples. On remarque chez le patient une tendance à utiliser plus que chez tout autre sujet la forme du plus que parfais du subjonctif. Nous avons constaté que pour dire il aurait fallu que je le sache, une autres tournure de phrase qui peut donner à croire que l’individu à de l’humour, ce qui n’est pas le cas…
Ce virus sous son aspect terminal pousse le patient à vouloir découper ses voisins à la machette, car ce virus est un dérivé de la branche rwandaise déjà identifiée sur les grands gorilles.
Nous conseillons comme prophylaxie de ne pas fréquenter les patients atteints de cette infection.
La rédaction tient à remercier Léonardo pour le prêt de ses dessins.
Ecouter un morceau de Erik Satie
20:50 Publié dans Petit traité de médecine à l'usage des rustres | Lien permanent | Commentaires (0)
14/01/2007
Le Cervicanévulgus
Ainsi nommé, car il porte sur sa face antérieure une protubérance qui à cette particularité de ressembler à des cornes de cervidés.
Ce patient présente les symptomes suivants: il bave, se replie sur lui et prétend être le dernier des cocus. Dans ses accès de crise que la démence s'apparente à ce qu'on nomme la monoxyde de gamie inférieure.
Ce patient présente la particularité d'avoir eu durant toute sa vie le même trajet pour se rendre d'un point à un autre à heure fixe et cela matin midi et soir, d'avoir entretenu des relations sexuelles normales et non excessivement prolifique avec une patiente femelle de son choix et cela durant toute sa vie.
Pendant ces crises de conscience suraiguë, laps de temps très court où les neurones ne sont pas soumis à la pression hiérarchique, l'homme en général s'arrache les cheveux et se lamente. Puis il maudit le monde entier et se mord forcément les avant-bras. Cette forme avancée se retrouve le plus souvent chez le sujet âgé qui a travaillé toute sa carrière dans l'administration.
Il faut choisir ce moment pour lui asséner un coup de manche de pioche derrière le crâne juste sur le niveau de l'occiput. Pour l'occire n'hésitez à frapper très fort. Un seul coup devrait suffir.
Chez les patients atteints par la forme chronique il faut frapper à plusieurs reprises pour bien s’assurer que mort s'ensuive. Certains confrères n’hésitent pas à utiliser la barre à mine. Ce que je préconise pour être sûr de parvenir à ses fins dès le premier coup si on veut éradiquer cette maladie.
Il faut se débarrasser des pansements, de tout le matériel médical ainsi que du patient dans les bennes prévues à cet effet.
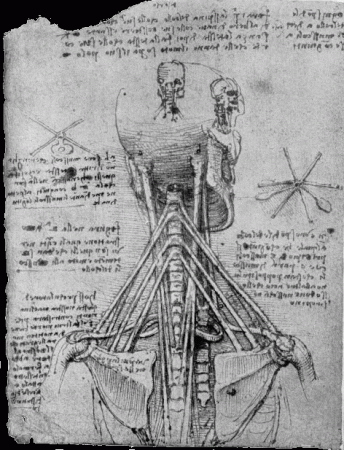
Léonardo a bien voulu me prêter un de ses dessins, qu'il en soit ici remercié....
23:10 Publié dans Petit traité de médecine à l'usage des rustres | Lien permanent | Commentaires (0)
13/01/2007
Les Poétes
Poète, mon ami, c’est un sacré métier, y croire il faut, pour se faire des vers élire le roi. Le floralie courir, le comité des fêtes, l’amicale des versificateurs, à la brosse à reluire recourir pour tenir son rang, faire savoir à qui de droit, autre de travers.
Et tout ça, de bons sentiments dégoulinants
Poète, c’est un sacré métier, y croire il faut, à son enseigne tenir salon, lever le coude, un rayon en connaître, sur la bagatelle,
Les ronds de jambe, les baises mains, pour bénéficier du bon frichti entre Fricotin des lettres. Contre sonnantes,
Quelles bassesses ne serions-nous prêts à commettre ?
Gavons nos panses tant que festoyer gratis on nous laisse, car le buffet des salons est bien la seule occase où la littérature nourrit
L’animal. Est ce hasard si on y décerne en ces heures douces,
Aux premiers de la classe récompenses et bourses.
Le flagorneur y a auditoire, tant qu’on lui verse à boire.
Avec le métier de poète, arrive l’œil torve, la lippe vioque, la répartie garce. Toutes ces canailles capables ânonnent leurs classiques, mais plus guère d’humanité dans leur tirade, que du Socrate, du Platon, du Cicéron. Et si c’est rond mon bon monsieur, ce n’est point carré, voyez-vous !
De tous ces faiseurs d’académies, pas un seul n’est foutu de donner son manteau à la gosse qui étale sa jeunesse perdue
aux regards des passants en grelottant sur le trottoir.
Tous, sont prêts à jouir des attraits de cette fille de joie
qui n’en a plus guère, en experts de bordels enfumés.
C’est bien connu, nos plumitifs travailleurs du chapeau
à trop réfléchir, doivent souvent amener de l’air frais à leurs gonades, afin que leur cerveau ne soit dans la panade.
Une plume dans le fion, un doigt dans l’encre semble être l’apanage de ces gens, à moins que le contraire ce ne soit.
Quand en Décharge un de ces poètes est mené,
La fratrie autour de la carcasse se réunit. Pour héritage,
Ils ne laissent qu’anecdotes sulfureuses parfois.
Lui, gosier en pente, hirsute chevelu, couvert de dettes,
évitait les typographes pour n’y perdre sa mâchoire.
Tel autre sodomite de son état voulait joyeusement
entreprendre le cercle de ses compagnons, untel
des oursins dans les poches jamais ne payait canon.
Ces bourriques à la mort lentement vont, en priant
que d’eux -qui ne furent bon qu’à trousser le vers
et par occasion la chemise,- pitié on prenne.
Fainéants au trois quart, mais tous prêts à l’occase
A monter en selle avec baron et ramassis d’emplumés,
Pour que la gloire inscrive leur nom en marbre.
Qu’ils se rassurent, d’eux, nul ne se souviendra.
Grand bien me fasse qu’ils crèvent, ces vils laquais
Du verbe. De leurs seuls vers, je me nourrirais.
Ceux, qui ne sont devenus pourriture et larves
Ne peuvent plus guère espérer le maroquin du ministre.
Vous ni sales, ni divin, juste laids, disons humains
Laissez moi, rire fort et beaucoup trinquer.
Vos amis qui restent vous ont trouvé si beaux
Si noble ; ces ridicules. Las, mort vous va comme un gant.
Vous n’êtes plus compagnons, car un ami, un vrai
point ainsi ne trahit et ingrat s’en va…
Mon verre du vôtre je détourne et prés d’autres esprits vivants ceux-ci, je vais chercher le bon mot, car trop de peine vous me faites d’avoir déserté le zinc où se retrouvaient les adeptes de la grappe.
Celui qu’en ce jour, au trou on coule, n’aura eu de remords
Que pour la gironde où il aimait aller dans les crus classieux
Goûter les nectars parfumés, petit blanc long en bouche
Rouge bordelais à la cuisse longue, à la charpente ronde,
Telle femme de harem lascive ou fleur de bordel pansue il n’aura eu de cesse, en son gosier assoiffé d’y faire couler la dive liqueur.
Non point je vous maudits, mais de vous vivants j’ai pitié
Car loyer, pitance idem, chaque mois il faut trouver.
Et l’instinct vous porte à vouloir encore tenter quand
impossible est l’issue. Il faut être idiot, confessons-le, mais
contre cela, rien n’y pouvons, car tellement humains en somme vous fûtes que ce dérisoire en devient presque sublime.
Ce foutu métier de poète voyez vous mon ami,
Je ne le souhaiterais pour rien à mon pire ennemi.
13:56 | Lien permanent | Commentaires (2)
10/01/2007
Qu'est ce que la littérature
par Joseph Périgot
Je voulais parler de cette soirée (soirée, c'est peu dire, ça a duré jusqu'à 5 heures du mat) avec une éditrice d'une maison jugée importante... Ça me brûle de donner le nom, parce que, au fond, je n'ai pas grand chose à perdre, et un procès pourrait m'amuser à l'âge où j'arrive, mais la personne en question est une pauvre petite folle, dans le genre hystérique, qui n'a jamais maîtrisé sa vie. Appelons-la Françoise. C'est le prénom de tout le monde, et elle n'est rien de rare. Rien de rare, mais agrégée de lettres (il faut quand même travailler dur pendant au moins un an pour y arriver) et éditrice depuis sa prime jeunesse (le professorat, c'était trop dur) dans cette maison d'édition que je ne citerai pas, inutile d'insister !
Je l'aimais bien, Françoise. J'aime bien les chtarbés, les désespérés, je me sens proche d'eux, sans doute parce que je leur ressemble et que la vie est trop mal faite. Mais ce soir-là, Françoise m'a sérieusement gonflé en prétendant que Malcolm Lowry et Albert Cohen n'étaient pas des écrivains. On peut ne pas aimer un écrivain, mais ériger sans précaution ce sentiment personnel en loi universelle frise la connerie, surtout quand on affiche une qualité d'éditeur. Mais justement, on finit par se prendre au jeu du pouvoir. En langue vulgaire (j'allais dire courante), on ne se sent plus pisser.
Non, mais vous voyez un peu le topo : l'éditrice d'une importante maison d'édition française aurait jeté Malcolm Lowry et Albert Cohen ! Je rêve et c'est un cauchemar ! Mais je suis resté très calme. Je lui ai dit : Françoise, ma petite Françoise, explique-moi, c'est quoi, la littérature pour toi? Elle a réfléchi longuement, parce que l'éditrice d'une maison d'édition importante n'a pas le temps de se poser ces questions théoriques, elle croule sous le travail. Elle a fini par lâcher: foi, imagination et liberté. En abrégé : FIL. Elle était presque fière de sa conclusion qui entrait dans une formule : FIL.
L'écrivain serait animé par la foi. C'est vrai qu'il faut y croire, pour se lancer dans un roman. Des centaines d'heures de boulot et tout le monde s'en fout, pour, au bout du compte, livrer le paquet à une Françoise. Mais ce n'était pas ça. Elle veut croire à un principe esthétique supérieur, Françoise, à quelque chose qui plane au-dessus de nos têtes et qui le soir rentre dans sa caverne. Ni Roland Barthes, ni Maurice Blanchot n'étaient à son programme d'agreg.
Pour écrire, il faudrait de l'imagination... Oui, n'est-ce pas, la réalité quotidienne est pâlotte, répétitive, bornée. Heureusement, l'homme a un organe qui secrète ses propres images et hue Cocotte! le voilà emporté au-delà des limites de la réalité. Ce qu'on appelle: se faire du cinéma. La littérature-évasion.
Enfin – et c'est peut-être le plus important –, le vrai écrivain est un être libre. Il échappe aux déterminismes qui étranglent le commun des mortels. Il fait tout exactement ce qu'il veut, ce petit veinard. A une exception près (enfin, c'est un conseil): il ne doit pas dire merde à son éditrice.
Devant une telle semoule intellectuelle, rance, en plus, je me contenterai de citer Blanchot: "La littérature, actuellement du moins encore, constitue non seulement une expérience propre, mais une expérience fondamentale, mettant tout en cause, y compris elle-même, y compris la dialectique (...) l'art est contestation infinie."
Allez je ne résiste pas au plaisir de vous en donner un deuxième en lecture.
Et Merci bien Joseph...
Une amie écrivain m'a dit...
J'habite la même petite ville de province que mon éditrice. Comme Paris reste un point de passage obligé, aussi bien pour un auteur que pour un éditeur, nous nous retrouvons régulièrement sur le quai de la gare, direction Paris, à attendre le TGV. Ah! ma chérie ! dit l'éditrice, avec un sourire épanoui (malgré l'heure matinale et une marque d'oreiller sur la tempe gauche). Ses auteurs sont une grande famille dont elle serait un peu comme la maman. Une jeune maman, qui a aussi bien d'autres choses à faire, mais qui est toujours là pour distribuer une caresse, remettre une mèche de cheveux en place. Tout ça avec le même sourire épanoui qui donne envie de la gifler. Ce serait une violence incomprise, parce que tout le monde le dit : "Elle est charmante, Catherine." Elle est capable de remuer ciel et terre pour venir en aide à un auteur en détresse. Un auteur important, bien entendu. Qui a de la surface. De la visibilité. Ou au moins lourd de promesses. On a bien le droit de choisir ses amis. Bref, cette femme est d'un commerce agréable et c'est toujours un déchirement quand le TGV entre en gare : bien que nous allions dans la même direction, le moment est venu de nous quitter, car nous n'avons pas le même billet. Le sien coûte 50% plus cher. Dieu merci ! le bar central du TGV favorise le rapprochement entre les VIP et la piétaille. Catherine dit d'une voix enjouée : "On se retrouve au bar, d'accord ?" Au bar, elle paiera les deux cafés. Et même mon croissant.
A l'occasion d'une de ces rencontres ferroviaires, je lui demande : "Tu es contente de ton comptable?" "C'est un type formidable, me dit-elle. Très efficace et très dévoué." J'avais détecté dans mon relevé de droits, une erreur de 3000 €. Rien que ça. De quoi vivre pendant deux mois pour un pauvre auteur. Plusieurs lettres au service de comptabilité étaient restées sans réponse et impossible d'avoir le grand responsable au bout du fil. Deux mois plus tard, j'avais trouvé un chèque de 3000 € dans ma boîte à lettres. Sans aucun mot, ni d'explication ni d'excuse. J'ironise auprès de mon éditrice: "Un type formidable, en effet !" Elle me prend par l'épaule et me dit : "Oh! tu sais, ma chérie, qu'est-ce que c'est que 3000 € pour une boîte comme la nôtre !"
Pour compléter le portrait de cette éditrice qui compte dans le "paysage" éditorial français, mon amie rapporte une dernière anecdote. Toujours sur le quai de la gare. Elle était très déçue par les réactions de la presse à la sortie de son dernier livre – ou plutôt par l'absence de réactions: les journalistes "ne sentaient pas" son bouquin, c'est ce que l'attachée de presse s'entendait dire ! Ils lisent à vue de nez, ces crétins ! Elle vitupérait contre eux devant son éditrice, dénonçant leur manque de culture. L'éditrice l'arrêta et lui dit sans plaisanter : "S'il te plaît, ne soit pas si dure avec les gens qui manquent de culture, c'est mon cas." La culture n'est plus comme la confiture, on ne cherche même pas à l'étaler.
Ça me fait penser à cet autre éditeur, directeur d'une boîte d'édition moyenne, à qui je demande poliment des nouvelles de l'accouchement de sa femme. "Le col du fémur a eu du mal à s'ouvrir", me répond-il. "Elle est tombée sur un os", dis-je. Il n'a pas compris ni cherché à comprendre ma réplique. Le même arrive un matin au bureau et dit à ses collègues: "Vous avez vu ? Ils viennent de sortir une novellisation d'Au nom de la rose."
Pour être coiffeur, il faut passer un brevet. Sans brevet, pas le droit d'ouvrir boutique. Et pour être éditeur, il faut quoi?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C'est Mouloud, vous savez ce drôle de type, petit, frisé, rigolo, sympa, Toulousain de Montreuil, mien ami qui m'a donné le tuyau en me disant d'aller lire sur le blog du monsieur en question: Joseph Périgot . La surprise a été de taille. Tout simplement jubilatoire. J'ai cru y reconnaître, cru seulement, la Françoise en question. C'était pas la Verny non, elle devait avoir plus d'intelligence. Un jour je vous donnerai à lire des lettres de refus de manuscrits. Certaines valent leur prix en cacahuètes. Ces gens là m'ont rendu service. Je le jure, en m'apprenant le détachement. Que Ganesh les prenne en protection.
Aussitôt dit aussitôt fait, je colle un de ses billets sur mon blog et vous invite à aller jeter un oeil sur la plume du Monsieur. Qu'il est agréable de se sentir moins seul...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Et voici le petit dessin hebdo de Ballouhey qu'on retrouve sur son site. En tapant sur Bacase dans la liste à gauche dans la rubrique dessinateur. Vous voyez. Juste là sur la gauche. Merci
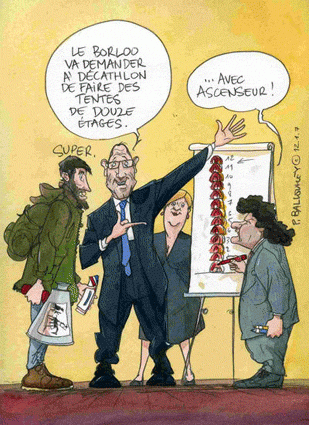
18:25 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (0)
05/01/2007
Les enfants de la balle
Cette année-là, en début de semaine, sans cahiers ni cartables, les cheveux longs et sales, trois bohémiens sont arrivés à l'école. Personne n'avait voulu se mettre à côté d'eux. N'ayant pas de voisin puisque je dissipais tout le monde, j'en avais récupéré un. Les deux autres étaient restés ensemble dans mon dos, près du poêle. Le maître aurait aimé que les grands leur fassent une place, mais ils ne voulaient pas attraper de maladies. Les gosses du cirque connaissaient par cœur tous les animaux du chocolat Poulain. Les tablettes renfermaient une photo surprise d'un animal qu'il fallait coller sur une carte dans un livre. En dehors des ouvrages scolaires je ne possédais que ce livre. Chocolat, mon copain, me l'avait donné en échange d'un lance-pierres taillé dans une vieille chambre à air de bicyclette. Il n'avait jamais vu de fronde si grosse. Il était tout noir. Le premier jour, on refusait de croire que c'était réellement sa couleur. Le maître nous a donné un cours sur les étrangers parce qu’il ne passait pas beaucoup de monde par ici. Les gens qui s'y installaient étaient encore plus rares. Toute la population de ce trou était pâle, ou violette, alors un Noir!
Les trois gosses ne sont restés qu'une semaine. Le dimanche, la place de l'église à la sortie de la messe était nette. Ils avaient enfoncé les piquets du chapiteau dans le goudron. En échange d'un lapin prêt à cuire, il m'ont donné des bons de réduction pour le spectacle. D'autres leur avaient apporté du bois de chauffage qu'ils avaient entassé sous la roulotte, là où leur chien dormait et aboyait à notre approche. D'autres encore avaient échangé des légumes, des œufs, du lait.
Mon voisin de classe causait peu, il avait un accent de Marseille très prononcé et il donnait un numéro d'écuyer. La représentation a eu lieu le vendredi. Depuis le début de la semaine, le village était divisé entre pro et anti-cirque. L'épicière prétendait que c'était un scandale d'avoir laissé les gitans, comme elle les appelait, esquinter le goudron tout neuf avec leurs piquets. Elle se méfiait de ces gens-là qui volent les enfants pour les vendre dans des cirques qui partent à l'étranger. Elle me prévenait que, s'il arrivait malheur, elle tenait la Mère pour responsable de mon destin. Je rêvais de me faire enlever. Je désirais devenir clown ou trapéziste. Le spectacle a eu lieu sans incident. Je m'étais tellement bien débrouillé, que j'ai eu droit à plusieurs coupons de réduction. Même si le Père n'avait pas voulu y aller, il ne pouvait prétendre nous en empêcher. Cet argent, je l'avais gagné. J'ai échangé ma poignée de coupons contre trois places gratuites.
Le lundi, l'école sans mon copain m'a semblé encore plus triste. J'imaginais des endroits fantastiques où la troupe s'était arrêtée.
Ce texte est extrait de: Un enfant de coeur éditions EDDIF
19:45 Publié dans souvenirs d'enfance | Lien permanent | Commentaires (0)
22/12/2006
Du GASTON FLOQUET dans le texte
essayez de remonter.
---
Si vous tombez de haut,
visez plus bas.
---
Si vous tombez de cheval,
évitez que le cheval
vous tombe dessus.
---
Si vous tombez dans l’indigence,
Essuyez-vous.
08:00 Publié dans La pensée du jour | Lien permanent | Commentaires (0)
15/12/2006
Bruits d'humains

Photo: Bénédicte Mercier
15 mai 1975
Barcelone barrio Chino.
Habituellement quand il descendait dans le Barrio Chino il passait la nuit dans une pension familiale où il prenait ses aises. La patronne une grosse femme dont les bourrelets graisseux du fessier débordaient de chaque coté de la chaise en assurait l’accueil. Elle appartenait à la race des déesses mères, sortes de vierges des temps primitifs dont les poignées adipeuses dégoulinaient les unes sur les autres, comme une bougie à moitié consumée dont le suif aurait beaucoup suinté. Elle n’en bougeait guère de sa chaise qui avait fini par sembler devenir un appendice de son gros-cul et elle dormait probablement sur place. Il ne se serait pas aventuré à affirmer le contraire.
La première fois, il avait choisi cet hôtel pour son aspect anonyme. Les suivantes parce que la patronne lui rappelait cette maîtresse maquerelle, dont il avait gardé un souvenir ému. Depuis il avait eu accès à d’autres initiations plus tordues, mais rien ne pouvait effacer le souvenir de la première fois.
La matrone assise sur sa chaise ne comprenait pas la signification du sourire si sympathique qu’il lui adressait, mais il s’en foutait. L’odeur du lieu aussi était identique, un mélange de naphtaline, de livarot, d’encens et de créosote. Il ne manquait que le bidet au milieu du patio.
-Le romantisme ça vous fait crever un homme debout, pensa-t-il en constatant un début d’érection.
Il avait choisi aussi cet hôtel parce qu’il se trouvait prés des Ramblas, et il aimait s’en approcher pour sentir battre le cœur de cette ville. C’est là qu’il rentrait en contact avec son agent. Jamais le même. Parfois il devait attendre plusieurs longues journées, enfermé dans sa chambre.
-Vous dites ?
-Oh, rien. Ce sont des souvenirs qu’on aurait pu avoir en commun c’est tout. Il arrêta là son monologue craignant d’être pris pour un dingue ou de devenir un type vraiment suspect.
Il décida de passer son temps en restant le plus possible enfermé dans cet hôtel. Déambuler dans les bars aurait pu attirer l'attention ou favoriser une malencontreuse rencontre. Trente ans s’étaient écoulées, mais il avait été trop connu ici pour se permettre ce genre de fantaisie et sa tête malgré les années n’avait guère changé. Toujours aussi mat de peau, un visage osseux, une gueule qui les faisait toutes se pâmer de la catin à la bourgeoise. Il avait toujours été étonné qu’on s’intéresse autant à sa sale gueule.
Il était peu probable qu'il verrait son contact pendant ce Week-end pascal et cela lui augurait de longs jours d'ennui.
-L’Espagne est toujours aussi catho… Putain, ça ne changera jamais, ça.
Il régnait une chaleur lourde comme seul il peut en exister à Barcelone, et un taux d’humidité à coller les enveloppes entre-elles. Il aurait juré que s’il avait laissé ses chaussures dans un coin, il les aurait retrouvées couvertes de champignons avant la fin de la semaine. Tout aurait moisi. Les perroquets verts qui voletaient de palmiers en palmiers jactaient autant que des pies. Impossible de fermer l’œil pendant la sieste.
Allongé sur le dos dans l’air irrespirable de sa chambre, il regardait les volutes de ses Fortuna s’envoler au plafond. Il pensa qu’il n’aurait jamais dû arriver si tôt. Mais les correspondances des vols ne lui avait pas permis de partir plus tard. Il ne put s’empêcher de repenser à cette femme. Elle le hantait encore, trente ans après. Des parties de jambes en l’air comme celles-la, il n’en avait jamais revécu de semblables. Il tâta son membre à travers l’étoffe légère de son pantalon et senti une raideur.
-Putain de pays de merde… J’ai le feu au cul et pas moyen d’aller voir une petite femme. Qu’est ce qu’elle a bien pu devenir depuis tout ce temps ?
Lorsqu'il avait quitté le pays, plongé dans l'obscure dictature du généralissime, elle travaillait pour les renseignements de la police et exerçait aussi son métier à domicile, source inépuisable d'informations.
Elle avait probablement bien mal tourné et, couverte de bijoux elle devait régner sur tous les bordels de la ville, et toucher de l’argent de tous ses bourgeois qui voulaient encore s’accorder un coït dominical entre hostie et billet de loterie. Il lui savait gré de l'avoir tiré du pétrin quand il avait été si recherché par la police. Elle l’avait hébergé sans rien lui demandé d’autre que de la baiser et tant d’années avaient passé...
Bravant l’interdiction qu’il s’était fixé et taraudé par la curiosité il pensa rendre visite à cette vieille amie à qui il devait d’être encore en vie.
Le heurtoir de la lourde porte n'était plus en place, un digicode l'avait remplacé. C'est à ce genre de détail, que l'on s'aperçoit qu'un pays change. Il attendit que quelqu'un rentre et s'engouffra à sa suite, la femme le regarda avec suspicion, comme pour prévenir les questions il amorça la discussion.
-"Je vais chez madame Esmeralda au troisième!"
La dame le regarda interloqué et lui répondit:
-Je crois que vous faites erreur monsieur. Il n'y a personne de ce nom ici!
-Mais, si, voyons, une cinquantaine un peu forte, elle habite au troisième!
-Impossible
-Pourquoi donc,
-C'est nous qui y habitons!
-Depuis longtemps?
-Une dizaine d'années!
-Je suis à la recherche de cette dame, sa fille qui vit en Argentine est décédée. Peut-être pourrez-vous m’aider à la retrouver!
La dame parue très embarrassée. Elle réfléchit un instant avant de répondre.
-Ecoutez, venez à la maison, quelques instants, mon mari inspecteur de police, vous renseignera.
A la photo du caudillo dans le couloir; au crucifix au-dessus de la porte du salon, il savait que la moindre information qui pourrait lui être transmise ne lui serait qu'après un méticuleux interrogatoire.
-Je suis le père de son gendre, nous vivions en Argentine. Nous n'avons plus de nouvelles d'elle depuis si longtemps!
Le flic paraissait terriblement embarrassé.
-C'est que, Madame est décédée depuis si longtemps que, l'appartement a été réquisitionné par décret et l'argent des loyers placé chez notaire!
C'était donc ça le nœud du problème.
-Vous avez l'adresse du maître?.
Ils se jetèrent des regards inquiets, les deux du petit couple.
-Je ne pense pas que vous le trouverez à son cabinet aujourd'hui. Comme tout le monde, il a déserté Barcelone pour le Week-end pascal.
Par tout le monde, il entendait certainement les gens de sa caste. Les autres continuaient à vaquer à leurs occupations quotidiennes.
-Ce n'est pas grave, j'ai le temps!
-D'ailleurs ma femme et moi allions quitter la maison!
Rien ne semblait pourtant l'indiquer, ni panier à pique-nique, ni valise dans le couloir. Sentant le regard inquisiteur, il précisa.
-Nous aimons nous rendre à l'hôtel!
-Bien sûr on y est tellement plus à l'aise, leur dit t-il, comme pour les réconforter et estomper le soupçon qu'il sentit dans le regard de l’homme.
Il le photographia de mémoire. Oui, c’était bien lui. Ce ne pouvait être que lui. Cette cicatrice sur la joue gauche… Obtenue lors d’un combat au sabre à l’école de police… Oui, pas de doute à avoir…
Il plia le papier et le glissa dans son portefeuille. Il se rendit à l'adresse. A son niveau une voiture s'arrêta, trois types en descendirent deux l'alpaguèrent et le troisième le poussa sur le siége arrière où deux autres sbires l'entourèrent.
-Alors garçon, on est en visite au pays?
Il ne pu les reconnaître. Mais leurs voix, il s'en souvenait… Il les entendait à travers la serviette mouillée qu'on lui avait mis sur le visage et sur laquelle on versait de l'eau. Il s’était juré qu’un jour ces enfants de putains et leur chef, allait payer pour toutes ces souffrances quand il se réveilla le dos trempé de sueur. Tremblant de peur. Maintenant il savait qu’il ne reviendrait plus jamais sereinement à Barcelone. Il attendit son contact, claquemuré dans son hôtel, son billet de train en poche.
Il souleva l'oreiller et retira de dessous son parabellum, il enleva le cran de sécurité et recompta les diamants. Il s'assura qu'on ne le suivait pas et ne retourna pas de suite à l'hôtel. Dans la poche de son pantalon, il tâtait les pierres à travers le tissus.
-Encore heureux que j'ai pris mon calibre, pensa-t-il. En tout cas je ne construirais pas un château en Espagne.!
Dans son travail, on ne mélangeait pas les affaires et les sentiments, et il venait de faillir à cette règle.
Les pales du ventilateur découpaient l'air au plafond. Allongé sur le dos, il fuma un paquet de Ducados. Il pensait qu’il n'aurait pas dû essayer de renouer le contact avec Esmeralda. Sa libido lui avait joué un sale tour. Elle avait dû l’aimer vraiment pour prendre autant de risques et le protéger aussi longtemps. Mais elle détestait ces types du renseignement et leur méthode. Elle avait fini par tomber comme tant d’autres.
En refermant la porte il pensa que ce nouveau modèle de silencieux pour son P38 était d'une redoutable efficacité. Il a allumé sa cigarette en se jurant que ce serait la dernière. Depuis le temps qu’il s'était promis d'arrêter de fumer et qu’il avait sans cesse reporté sa décision. Il savait bien qu'il se mentait. Malgré les risques encourus pour sa santé, il continuait. N'ayant jamais put résister à la tentation, il avait accepté cette faiblesse comme toutes les autres. On s'habitue à tout, avec un peu de résignation. Il pensait vite, par à coups. Des images se superposaient sur des ralentis. Tout revenait comme une aigreur, après un repas trop lourd. La vie est difficile à digérer. Il savait bien qu'il n'avait pas choisi d'arrêter de fumer, cela il l'avait compris, probablement c'était la seule chose qu'il avait accepté. Il lui semblait faire ce geste pour la dernière fois comme lorsqu'il avait tourné la clef dans la serrure de sa chambre en interrogeant son chek list. Tout était parfaitement en ordre, comme il l'avait prévu. Il ne lui restait plus qu'à laisser la clef en bas, avant de se rendre à l'aéroport...
Il se revoyait sur le tarmac de kinchassa avec son bagage à main. Il était un autre, barbe rasée, cheveux coupés très courts. Il se sentait léger dans ce costume. Bien qu'il sache qu’en Argentine ce soit l'hiver, il s'en fichait. L’escale prévue était à Barcelone. Il ne savait pas qui serait son contact. Il ne l’avait jamais vu ne le reverrait jamais. Il recevait un coup de téléphone, il se rendait à un autre hôtel, de grande classe celui-là. Il attendait encore, puis recevait un autre coup de téléphone. On lui apportait l’argent, il laissait les diamants et il retournait à son hôtel.
Les liasses de coupure dans sa mallette, il héla un taxi, mais avant de se rendre à la gare, il demanda au chauffeur de faire un léger détour. Il lui laissa un billet et lui demanda de l’attendre. Sa valise à la main, il s'engouffra dans le porche à la suite de la jeune fille. Il sonna au troisième étage. Quand le couple apparu dans l'encadrement du couloir, ils s'affaissèrent l’un après l’autre, dans un bruit mat.
- De la part d’une amie, dit-il!
Et il referma la porte.
19:45 Publié dans Extraits de romans | Lien permanent | Commentaires (0)
12/12/2006
du 11 septembre 1973..... à la postérité.....

19:49 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (0)
11/12/2006
Malnuit, vous avez dit Malnuit...
Quand dans sa vie on a eu la chance de cotoyer de tels personnages, aprés tous les autres vous semblent mornes, fades, sans réelle envergure.
Les autres, ils ne brûlent pas la chandelle par les deux bouts, ils s'économisent.
Ils vont lentement et sûrement, mais pour aller où?
Tous ceux qui l'ont cconnu se souviennent de ses crises de folie quand il avait trop bu. Sa carcasse n'encaissait pas beaucoup non plus. Il ne croulait jamais sous la table et ne buvait que de la bière.
Jamais de vin, breuvage trop puissant pour son humble constitution.
Cet espèce d'ange avait les ailes engluées dans un quotidien cruel qui n'était pas fait pour lui.
Bref, sans jouer les anciens combattants, je reste persuadé du style de l'écrivain Malnuit, comme si celui de peintre ne lui avait pas suffit à mi-chemin entre celui d'un Bukowski, d'une Duras, d'un Céline, d'un Djian.
Un peu tous ceux-là à la fois, mais tellement lui, forcément lui...
Ce texte: Stop sur papier jauni, jamais publié, jamais présenté non plus à un éditeur, écrit pour le plaisir, comme beaucoup d'autres textes; c'est BALLOUHEY dit Bacaze, le filochard de l'expédition qui m'a scanné les pages du manuscrit...
En voici quelques pages pour vous mettre l'eau à la bouche...
Un jour, je vais me remettre à l'édition et ce sera lui mon premier et ancien auteur publié...
Et il y en a bien d'autres que j'aimerai republier, Morin, Longchamp, Amina Saïd , Baglin...
Le temps passe trop vite....
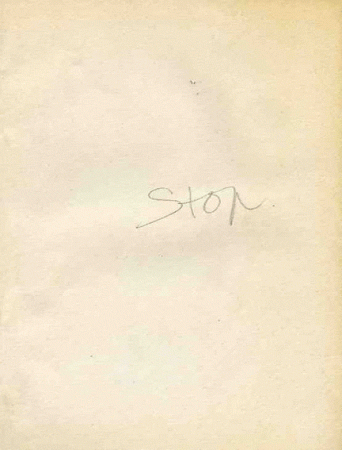
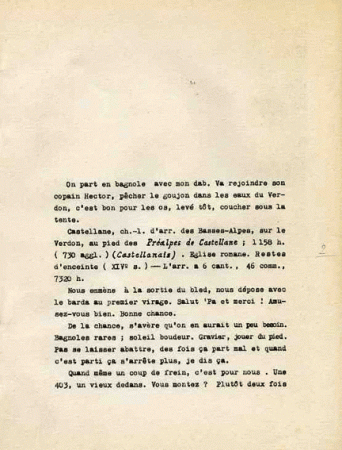
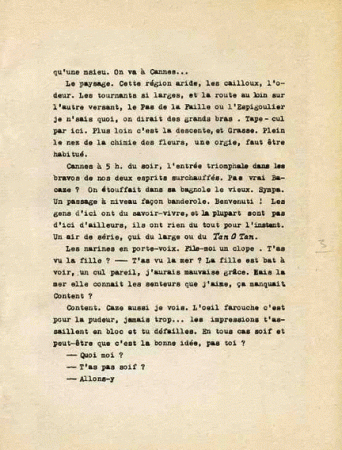
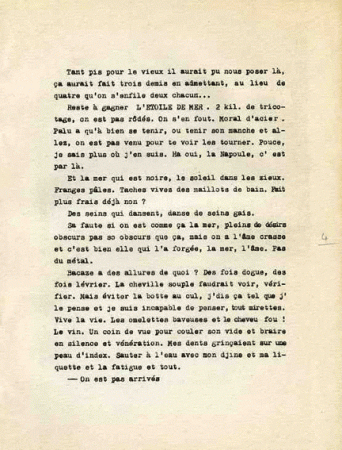
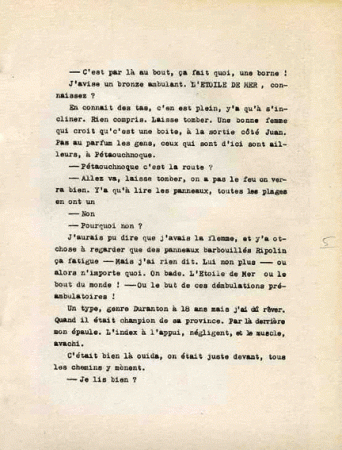
17:20 Publié dans Extraits de romans | Lien permanent | Commentaires (0)
06/12/2006
Le dernier vol
par MOULOUD AKKOUCHE
Petits repères bibliographiques
Mouloud Akkouche habite la région de Toulouse.
Il a déjà publié
Causse toujours - édition Baleine - 1997
Avis déchéance - édition Gallimard-Série Noire - 1998
Les Ardoises de la mémoire - édition Gallimard-Série Noire- 1999
Sur la route de Bauliac - édition Baleine - 2000
Cayenne, mon tombeau - éditions Flammarion - 2002
Il est auteur dramatique mais aussi scénariste.
Il écrit depuis 1998 de nombreuses pièces radiophoniques pour France Inter, France Culture… et élabore des scénarii pour le cinéma : (L'Extra ; Qu'est-ce que tu deviens? ; L'amour rend Flou).
Il écrit également des nouvelles publiées dans : Brèves ; Le Sabord ; L'Autre Journal ; Libération ; Drunk ; Encres vagabondes, collectif Fleuve Noir, Nouvel Obs…. et des Textes pour des Catalogues d'art contemporain.
Gérad Gautier est naturaliste.
Il habite la baie du mont St Michel.
Il n'a rien publié en dehors de ses travaux scientifiques.
Vous pouvez retrouver sur ce blog l'article le concernant.
"Juste quelqu'un de bien"
Si vous désirez entrer en contact avec lui pour ses photos,
laissez lui un message sur ce blog.
La série présentée ici concerne les Fous de bassan.
- Tu veux vraiment le faire ?
Elle se retourna et esquissa un sourire.
- Oui.
- C’est de la folie.
- Je ne changerai pas d’avis.
Elle secoua la tête et ajouta :
- Même seule, je le ferai.
Puis elle reprit sa position. Plusieurs semaines qu’elle restait immobile, recroquevillée, l’œil scrutant l’horizon. Mais ce jour là, elle était beaucoup moins tendue. Sans doute grâce au départ prévu le lendemain. Elle avait fini par le convaincre. Mais il appréhendait ce voyage.
Un voyage sans retour.
Pourtant ils avaient parcouru des milliers de kms ensemble. Elle aimait partir, revenir, partir… Infatigable. Elle n’arrivait pas à tenir très longtemps en place. Toujours impatiente de s’envoler pour n’importe quelle destination.
Cette fois, ils partiraient avant les autres. Et sans les prévenir. Elle ne voulait pas de leur présence. Il aurait préféré partir avec eux. Bourlinguer en groupe était plus agréable et plus rassurant. Surtout avec une voyageuse gravement malade.
- Bon je vais faire des courses.
A son retour, elle dormait. Il déposa son repas près d’elle et l’observa. Elle avait maigri, ses joues de plus en plus creusées. Sa respiration, haletante, emplissait l’air. Mais le sommeil semblait l’apaiser, comme une liberté provisoire.
La maladie lui était tombée dessus d’un coup. En quelques jours, elle eut des problèmes pour se déplacer, le moindre mouvement la faisait souffrir. Elle chutait fréquemment. Elle, très volubile et enjouée, s’enferma dans un profond mutisme. A la moindre contrariété, elle se défendait bec et ongles. Plus personne ne pouvait l’approcher, à part lui. Deux ou trois fois, elle était redevenue gaie. Et lui convaincu qu’elle s’en sortirait. Mais les répits furent de courte durée.
Souvent, paupières closes, elle murmurait : « Emmène-moi là-bas. Je veux y retourner ». La première fois, il avait refusé fermement. Tous les autres étaient d’accord avec lui : elle ne pouvait accomplir un si long trajet. Une folie dans son état. Elle s’était mise en rogne comme jamais auparavant, ne lui adressant plus la parole. Et elle avait décidé de ne plus se nourrir.
Et une nuit, elle n’était pas rentrée. Rongé d’inquiétude, il avait écumé tous les lieux où il pensait la trouver. Sans résultats. Le cœur gros, il avait fixé le ciel… Puis il avait tourné des heures durant avant de la découvrir à l’aube : sur le pont d’une autoroute. Il avait eu le ventre noué. Incapable du moindre geste.
- Rentre avec moi.
Sans se retourner, elle avait murmuré :
- Autant en finir maintenant.
Elle tremblait.
-…
Il avait retenu de justesse une parole réconfortante. A quoi bon ? Elle ne désirait qu’une chose. Une chose enfouie au plus profond de son être.
Et à l’horizon.
- D’accord, on part demain.

Photo: Gérard Gautier
Le jour se levait à peine lorsqu’ils atterrirent. De nombreuses odeurs mêlées flottaient dans l’air. Elle sourit, heureuse de cet instant braconné à la douleur. Ils gagnèrent leur pied à terre, le même à chaque halte dans cette ville.
Il ne tarda pas à s’endormir. Si longtemps qu’elle ne l’avait regardé dormir… Des années qu’ils vivaient côte à côte. Pourtant beaucoup avaient parié que leur couple ne tiendrait pas la route : trop différents. Pas du même coin, ni du même milieu. Mais, contre vents et marées, ils avaient résisté. Leurs gosses volaient de leurs propres ailes, sous d’autres cieux. Et eux deux continuaient leur chemin ensemble.
Malgré la fatigue, elle n’avait pas envie de dormir. Elle sortit sur l’espèce d’avancée.
- Tu vas où ? Faut pas te fatiguer.
- Ne t’inquiète pas, je n’use que mes yeux.
- Tu devrais essayer de te reposer.
- Je me sens bien aujourd’hui.
Rassuré, il se rendormit.
La lumière du soleil, très forte, lui fit plisser les yeux. Elle inclina la tête et contempla la grande place. Voitures, camions, taxis et mulets circulaient sans ordre apparent. Un flic, sifflet à la bouche, faisait de grands gestes. Derrière leurs étals, les vendeurs de jus d’oranges pressées hélaient chaque passant. Un singe sur l’épaule, un ado se précipita sur deux touristes sortant d’un taxi.
Elle poussa un soupir. D’habitude, elle sillonnait la ville, quartier par quartier. Désormais, elle ne pouvait quitter son poste d’observation. Trop épuisée pour bouger.
Les virées à l’océan lui manquaient plus que le reste. En très peu de temps, ils passaient de la folie urbaine au calme de l’océan. Au lever du jour, ils traînaient sur les remparts du village fortifié puis descendaient vers les plages désertes. Et à l’heure de la criée, ils allaient manger au milieu d’une cohue piaillant. Repas inoubliables face aux flots…
- Tu te souviens ?
Elle poussa un nouveau soupir.
- Je ne peux plus faire que ça.
Il promena son regard sur la ville puis, peu à peu, le laissa couler loin, très loin derrière les montagnes.
- Tu peux y aller.
- Non, je…
Un crissement de pneus l’interrompit.
- Tu n’es pas obligé de rester avec moi.
- Arrête. J’ai pas envie d’y aller.
- Je te connais.
-…
- Je sens bien que tu as très envie d’aller à la criée. Vas-y… Je ne t’en voudrais pas.
Il fit la moue.
- Tu sais bien que je m’en fous. D’ailleurs, j’aime pas ce qu’on mange là-bas.
Menteur, faillit-elle répondre. Il adorait le poisson. Elle eut soudain la gorge serrée à l’idée que, un jour, il se retrouverait là-bas avec une autre. Au même endroit, à la même heure. Jamais elle n’avait ressenti auparavant un sentiment de jalousie.
- Tu veux faire quoi alors aujourd’hui ?
Il eut un silence.
- Ce que tu veux, répondit-il.
- J’aimerais bien…
Elle ferma les paupières.
A son réveil, elle mit un long moment à se rappeler où elle se trouvais. Avait-elle dormi une heure ou une semaine ? Son cou avait encore gonflé.
- Tu es là ?
Pas de réponse.
- Tu es là ? insista-t-elle d’une voix moins faible.
Toujours rien.
Etait-il sorti ? Il ne la quittait jamais quand elle s’endormait, la prévenant de chacun de ses déplacements. Elle fit quelques pas et s’arrêta.
Il se lavait en chantonnant. À part un léger embonpoint, il n’avait pas beaucoup changé. Si longtemps qu’elle n’avait senti son corps sur le mien…
Quand il croisa son regard, il se renfrogna comme un gosse pris en faute.
- Excuse-moi. J’arrive.
- Ne te presse pas.
- Faut qu’on décide de notre prochaine étape.
- Je voulais te dire…
Elle baissa les yeux.
- Quoi ?
Elle laissa passer un instant.
- Continue de chanter.

Photo: Gérard Gautier
Au-dessus de l’océan, il se tourna vers elle. « Comment te sens-tu ? ». Elle ne l’entendit pas, absorbée par l’immense nappe bleue. Une étrange lueur dans le regard.
- Tu m’entends ?
Ses yeux semblaient vouloir sortir de leurs orbites. On dirait qu’elle a le vertige, s’inquiéta-t-il. Mais il balaya aussitôt cette impression stupide. « Je suis si contente de survoler l’océan » lui avait-elle confié avant le départ.
- J’ai mal aux oreilles.
Elle était exténuée. Jamais, depuis le début de sa maladie, elle n’avait eu de telles difficultés à respirer, les traits aussi tirés. Et autant envie de décrocher.
- On va bientôt arriver.
- J’ai froid.
Elle se plia en deux, le souffle coupé.
- Ne parle plus.
Sa poitrine se leva et s’abaissa plusieurs fois. Peu à peu, sa respiration retrouva son rythme. Un rythme imposé par le mal qui la rongeait.
- C’est mon dernier vol.
Elle ferma les paupières. Il paniqua et la secoua : elle rouvrit les yeux.
- On est pas loin.
- J’en peux plus.
- Encore un effort.
Et pendant le reste du vol, il n’arrêta pas de lui parler pour la tenir éveillée. Fallait qu’elle tienne au moins jusqu’à l’autre rive. Elle rêvait tant d’y revenir…
- Je vais tout lâcher.
- Accroche-toi.
Ils atterrirent vers midi.
- J’ai réussi finalement à le traverser vivante, sourit-elle avec une imperceptible fierté.
- On va dormir où ?
- Comme d’habitude.
- J’espère qu’il y aura de la place.
Leur point de chute habituel était entouré d’une palissade. Plusieurs pelleteuses déblayaient le sol. Un camion-benne vide entra, croisant un autre chargé de terre. Une centaine de mètres en contrebas, une grue tournoyait au-dessus d’un immeuble en construction. Cette colline, ponctuée de pins et de vieilles bâtisses, deviendrait un complexe hôtelier. Plus pour eux.
Gorge nouée, elle regardait leur nid douillet de printemps rasé à jamais.
- Quel gâchis, grommela-t-elle.
Il l’entraîna plus loin.
- Tu m’attends-là, je reviens.
Après une bonne heure de recherche, il réussit à trouver un endroit pour dormir. Mais moins confortable. Elle se fichait du confort, seule la vue l’intéressait.
- J’ai un p’tit creux.
Il sourit.
- Moi un gros. Je vais chercher à manger.
- Non.
- Tu veux que je reste avec toi ?
- Je viens.
Ils gagnèrent le bord de l’eau. Le soleil cognait fort. Elle était trempée de sueur.
- Ca te va ici ?
- Je préfère en haut.
Il avançait très lentement pour ne pas l’obliger à accélérer. Mais elle s’en rendit compte. Deux fois, elle piqua une colère. Et il dût se résigner à la laisser derrière.
- Ici, ça a l’air bien.
Installés à l’ombre, ils mangèrent du poisson. Elle se força à avaler quelques bouchées, pour lui faire plaisir. Chaque geste, même grignoter ou boire, lui coûtait. Elle bougeait le moins possible, tout entière concentrée dans son regard.
La plage se remplit très vite malgré le vent qui s’était levé d’un seul coup. Des cris de gamins se mêlaient au bourdonnement des voitures longeant la côte. Une dizaine de surfeurs s’échinaient à apprivoiser les vagues.
- Je n’ai pas peur de mourir.
- Mais tu…
Elle le remercia d’un regard de lui éviter sa tirade faussement optimiste.
- Maintenant que je le sais, ça…
Elle déglutit et ajouta :
- Si j’ai peur.
Puis elle se plongea dans le silence. Il essaya de relancer la conversation. En vain. Elle se contentait de répondre par de petits hochements de tête.
- Si tu veux, je peux continuer toute seule.
- Dis-pas n’importe quoi.
Avait-elle perçu son agacement ? Il s’en voulait de ne pas s’être contenu.
- Tu n’en as pas marre de me traîner comme un boulet ?
Il ne répondit pas.
- Quel est l’endroit que tu as préféré de tous nos voyages ?
Sa question le prit de cours.
- Ben, je… J’en sais rien, moi. Mais pourquoi tu me poses cette question ?
- Je me demande s’il vaut mieux mourir dans un lieu qu’on préfère ou… Ou n’importe où.
- Tu crois que les autres sont partis eux aussi ?
- Ils te manquent ?
Il hésita avant de lâcher :
- Un peu.
- Moi pas du tout… J’en avais plus qu’ assez de leurs regards bourrés de pitié.
- Ils t’aimaient… ils t’aiment beaucoup.
- Tu peux employer le passé ; je ne les verrai plus. Et au fond, je m’en contrefous. J’avais rien à leur dire et eux n’ont plus d’ailleurs. Je les vomis ces cons.
Et elle se mit à les insulter, un par un, comme s’ils se trouvaient en face d’elle.
- Calme toi.
- Toujours ça de moins dans mes bagages, ricana-t-elle à bout de souffle.
Elle grelottait.
- Tu veux rentrer ?
- Non, pas tout de suite.
- Tu devrais te mettre à l’abri du vent.
Ils se déplacèrent de trois-quatre mètres. Elle ferma les paupières et laissa choir sa tête. J’espère qu’elle va dormir, espéra-t-il. Mais elle rouvrit les yeux.
- Ramène-moi.

Photo: Gérard Gautier
Elle pestait contre la pluie qui coulait depuis leur arrivée dans la région. Impossible de contempler le paysage. Derrière le rideau opaque tombé du ciel, une impressionnante forêt de pins s’étendait sur des dizaines de kms. Seule un chemin cahoteux la traversait. Rares ceux qui s’aventuraient aussi loin.
Il n’avait pas envie de s’y arrêter. Elle avait insisté. Elle voulait tant retrouver ce silence. Un silence unique.
Il rentra tard, le corps entièrement trempé.
- Quel merdier. Je t’ai pas trouvé grand chose à manger.
- T’occupe pas de mon estomac s’il te plait.
Il encaissa sans ciller.
- Bon, je vais me sécher
Elle le regarda avec un sentiment de culpabilité. Des semaines qu’il supportait ses caprices. Quelle patience ! Mais parfois il devait espérer que ça finisse au plus vite.
Elle aussi.
La pluie s’arrêta en fin de journée.
- On sort.
- Si tu veux.
Une agréable odeur exhalait de la terre humide. Elle s’engagea sur le sentier en pente très glissant. Il avançait à côté d’elle, prêt à la rattraper.
- T’inquiète pas, je tiens encore un peu sur mes pattes.
Les rives de l’étang étaient boueuses. Pas d’autres traces que les leurs.
Et celles du silence.
- Nous, on a eu de la chance quand même..
- La chance de quoi ?
Fatiguée par la promenade, elle s’arrêta et aspira une grande goulée d’air.
- On est bien ici.
Un clapotis dans l’eau brisa le silence.
- De quelle chance parlais-tu ?
Elle reprit la marche.
- … De se trouver ici. Regarde autour de nous… C’est magnifique. Ce silence, je ne m’en lasse pas.
- Ouais, souffla-t-il, mais je sais pas si ce sera pareil pour nos gosses. J’ai vraiment l’impression que tout ça ne va pas tarder à disparaître.
- Toujours aussi pessimiste.
- Non, réaliste.
Il ramassa une brindille.
- Tu exagères.
- C’est la triste vérité. Tout se dégrade. Bientôt plus personne ne trouvera à becqueter. Cette planète est de plus en plus en mauvais état. Tu te rappelles ce qu’on a vu hier au bord de la rivière… Des carcasses de bagnoles.
Il souffla et continua :
- La nourriture devient dégueulasse. Et maintenant, dans certains endroits, on peut plus dormir tant l’air est irrespirable. Les océans et les fleuves, je t’en parle pas… Ils sont devenus pires que des égouts. J’ai plus du tout envie de pêcher dedans tellement ça me dégoûte
- C’est pas comme ça partout.
- Bien sûr que si. Même dans les lieux les plus reculés, soi-disant protégés. Plus rien n’arrêtera la progression des 4X4 et des braconniers.
- Qu’est-ce qu’on peut faire ?
- J’en sais rien mais il faut le faire. Et vite. Si on veut pas perdre tout ça.
- Moi je crois que c’est foutu.
Il se crispa.
- Pourquoi ?
- On y peut rien.
- Si !
Il sentit la colère monter en lui. Ce genre de sujet lui tenait très à cœur.
- Calme-toi.
Il balança les brindilles.
- C’est toi qui part perdante.
Un silence gênant succéda.
- Pourquoi tu t’énerves ?
Gêné, il bredouilla :
- Je suis désolé de t’emmerder avec tout ça. C’est vraiment pas le moment.
Il fixa le sol.
- J’ai froid, réchauffe-moi.
- Je vais réussir cette fois.
Malgré son acharnement, elle n’arrivait pas à tenir debout. Déjà plusieurs fois qu’elle avançait, deux ou trois pas, trébuchait et s’affalait.
Il l’aida encore à se relever.
- Faut que tu te reposes.
- Non, refusa-t-elle d’une voix éraillée, je ne veux pas rester ici. Emmène-moi ailleurs.
Lui aussi n’avait pas envie de rester. Mais, son état ayant empiré, elle ne pouvait continuer le voyage. Et ils avaient dû s’arrêter près d’une zone industrielle.
Perchés au dernière étage, ils suivaient la ronde des voitures sur le périphérique. L’autre côté donnait sur un parc. Des joggeurs couraient chaque matin autour de l’étang.
- Dès que tu iras mieux, on repartira.
- Ça fait déjà trois jours que nous sommes là. Je ne veux pas mourir ici.
- Je sais, je sais.
- Tu ne peux pas me faire ça.
- Viens, on va rentrer.
Elle lui montra les barres d’immeubles.
- Je ne veux pas que tu me laisses ici. Je veux mourir en regardant. l’horizon.
- On va repartir…
Ses yeux humides le suppliaient.
- Essayons encore.
- Avance lentement.
- Lâche-moi, je vais y arriver…
Grimaçant de douleur, elle fit un pas, puis deux autres… et s’effondra sur la pelouse.
- Je vais te remonter là-haut, tu seras mieux.
- Je n’en peux plus.
Il se pencha.
- Tu as besoin de dormir.
- Oui c’est vrai, bafouilla-t-elle. J’ai… J’ai besoin de…
Et son regard se vida.
Toute la nuit, il la veilla. Le silence ponctué de ses sanglots et des bruits de la ville.
Il finit par s’endormir contre elle.
Au matin, des pas le firent sursauter. Plusieurs camionnettes et des motos étaient garées devant l’entrée du parc. Deux hommes vêtus comme des cosmonautes se dirigeaient vers lui. Le plus gros portait un sac plastique.
Il essaya de les empêcher de passer. « Dégage sale bestiole ! » aboya le gros en lui filant un coup de pied. Il l’évita de justesse et se mit à voleter autour d’eux.
Accroupi, l’autre homme ramassa le cadavre. Soudain, il lui fondit dessus et referma son bec sur la main. L’homme tenta de se libérer. Il serra encore plus fort, déchirant la combinaison.
Le gros l’aspergea avec une bombe paralysante. Il lâcha prise, battit des ailes et s’affala
- Le salaud, y m’a bouffé la main. Je vais le…
- Laisse tomber, on a pas le temps.
Ils la balancèrent dans le sac.
- Tu crois que c’te cigogne a vraiment la grippe aviaire ?
- On verra bien.
Il entrouvrit les yeux et les vit s’éloigner.
Précédés de deux motards sirènes hurlantes, la camionnette roulait très vite. Encore étourdi, il suivait leur véhicule. Il volait le plus bas possible pour ne pas les perdre de vue. Trois autres motos avec des caméramans fermaient le convoi.
La camionnette franchit le portail de l’Ecole Vétérinaire et s’engouffra dans un souterrain.
Il se posa sur le toit de l’un des trois immeubles de verre. Puis, peu après, il fit le tour de toutes les façades, examinant chaque salle. Aucune trace d’elle. Résigné, il s’apprêta à abandonner quand une porte s’ouvrit au huitième étage.
Ils l’allongèrent sur une table de labo. Deux écrans d’ordinateurs clignotaient sur les côtés. Une dizaine d’hommes et femmes, masques sur le nez et gantés, s’agglutinèrent autour d’elle. Ils parlèrent longuement. Puis tous se turent et s’immobilisèrent. Sauf un qui se pencha sur elle, un scalpel à la main…
Fou de douleur, il cogna son bec contre la vitre.
Un an plus tard, il s’arrêta manger au bord de l’océan : à l’heure de la criée.
Elle lui souriait.
Copyright: Mouloud Akkouche

Photo: Gérard Gautier
08:50 Publié dans carnets de voyages | Lien permanent | Commentaires (0)
03/12/2006
MALNUIT à Fleur de Peau
Ce texte Fleur de Peau de Michel Malnuit a été publié par le passé aux éditions Ressacs. Je vous en redonne aujourd'hui le début.
Faudra ressaisir toute l'oeuvre de Malnuit, cela prendra du temps, de l'énergie. plus de 5000 pages pour le journal sans compter tous les romans, publiés et les inéditss, comme: Corbu's book, Fromage de tête, Totem.
C'est qu'il était prolixe le Sapiens... Autant pour la peintuure...
Ausssi sans attendre je vous donne dés à présent des extraits de Fleur de Peau...
Tu te moquais des enfants. Un petit garçon était là, flanqué d’une nounou aride et visiblement idiote. Tu prédis qu’il ne vivrait pas longtemps, qu’il mourrait bientôt. Et je riais. Chaque passant avait droit à tes injures. Tu n’épargnais personne. Et je riais. À ton tour tu te ridiculisais d’un mot. Et je riais.
Une idée cherchait un mot où se couler, mais aucune en convenait. Tu disais n’importe quoi, et au bon moment, un mot particulier suscitait une idée, que tu développais. Ainsi tu éloignais les silences. Peut-être y avait-il une raison à cela, je ne sais trop laquelle.
Je ne peux pas me défendre d’un sentiment morbide. Et m’en accuser le prolonge. Tant pis pour moi, je ne tiens pas assez à me taire… J’ai bien le droit de croire que je te parle encore, que nous pouvons encore nous moquer des gens. Tu ne m’as rien ôté.
Je ne suis pas résolue à n’attendre plus rien de toi. Tu ne m’offrais rien, mais j’ai beaucoup reçu. C’est ainsi. Les rares élans qui savaient t’échapper ne m’étaient pas destinés, non plus qu’à personne. Tu les disais gratuits, " comme ça ". Insolent. Ne rien donner, jamais. N’obliger personne. Oh je n’ai pas d’amertume. Celui qui donne un peu m’assoiffe. Mais tu ne me donnais pas, que pouvait-on attendre ? Je me perds en mots creux ( un terme à toi, non ?)

Gouache de Malnuit Format 80 x 120 cm
16:05 Publié dans Extraits de romans | Lien permanent | Commentaires (0)
28/11/2006
Cambodge, je me souviens

Je vous en donne quelques passages.
« Aujourd’hui, nous nous sommes réveillées à trois heures du matin pour aller travailler. Deux heures de marche pour aller à la rizière, et toute la matinée à patauger dans cette boue infecte, répugnante… Ma vie a complètement changé ; comme tous les autres ici, je suis jeune, à peine dix ans, fragile. J’ai encore besoin de tout ; de l’école pour apprendre, de bons repas pour grandir, et simplement d’un peu d’affection… Rien de tout cela ne nous est offert, rien d’autre à attendre que le travail jour et nuit. Je ne sais ni lire, ni écrire. Je me sens aveugle, perdue dans une nuit sans fin. Sortirais-je un jour de cette vie inhumaine ?
Après avoir pris un mauvais repas, j’ai vomi, puis je me suis endormie. Cette horreur de nourriture, pas même bonne pour les cochons, a fini par me rendre malade. Et avec le travail si dur, la fatigue s’est accumulée…
Est-ce que j’échapperai à la mort dans ces maudites rizières ? »
Pour ceux qui ont vu le film « La Déchirure »
Nous quittons aujourd’hui le village de Som-Lauth. Nous sommes plus nombreux maintenant. En préparant mes affaires, j’entends des cris et des hurlements à travers les murs de bambou que j’essaye d’écarter pour voir ce qui se passe. Il y a des dizaines de prisonniers, tous maigres, en train de supplier les soldats de ne pas leur faire de mal. Ils sont enchaînés, sans doute depuis longtemps, et ce jour là, c’est le jour de l’exécution. Je tremble comme une feuille. Un soldat tient un couteau taché de sang. Je ne sais pas s’il m’a vue en train d’observer la scène, car pendant un moment j’ai fermé les yeux en serrant les dents. J’ai beaucoup de pitié pour ces prisonniers innocents. Ils sont grands,maigres, ils ont les yeux cernés. Je ne sais pas depuis combien de temps on les as privé de nourriture. En ouvrant les yeux, je ne vois plus le tueur. Il est derrière moi
-Tu peux venir voir de plus près, si tu veux.
Je sursaute, je fais une grimace en voyant son couteau plein de sang.
-N’aies pas peur ! Viens voir ! me dit encore le sauvage. Je secoue la tête. Impossible de faire quoi que ce soit. J’ai très peur qu’il m’assassine à mon tour. Maman n’est pas là, elle est allée à la cuisine demander un peu de provisions. Kim, Sam et Visal sont avec elle. Je ne sais que faire. Je reste là, et je pleure pour ces hommes prisonniers que je ne connaissais même pas. Quant au jeune soldat, il n’a pas l’air du tout d’un assassin. Il est jeune et beau garçon. Il ne dit plus rien quand il me voit pleurer. Il retourne à son devoir et fait déshabiller trois prisonniers pour les envoyer en enfer…
Je n’oublierai jamais ce massacre. C’est la pire chose que j’aie jamais vue. J’ai des douleurs qui me lancent dans les veines. J’ai très mal, et pourtant on ne m’a rien fait. Mais pourquoi ai-je si mal ?
La fuite et l’arrivée en Thaïlande.
« Pourrons nous, une fois en Thaïlande être en sécurité ? J’aimerais pouvoir le croire, mais j’ai peur que ce ne soit pas le cas. Ce que j’attends c’est la paix, je me dis qu’à partir de maintenant, à la seconde même où je respire ce parfum précieux et mystérieux que j’ai cherché toute ma vie, mon cœur est soulagé de tous els dangers de l’existence. Malgré la fatigue et la fièvre qui envahit tout mon corps, je suis heureuse.
-Est-ce qu’on peut continuer ? nous demande oncle Chao après une petite pause.
Tout le monde fait signe que oui, et se met debout pour partir. Mais à ce moment précis, le monde change de couleur. Six Khmers rouges armés jusqu’aux dents sortent de la forêt et braquent leurs canons sur nous. Ils avancent sur nous en silence, prêts à tirer si nous bougeons. Ils sont armés de M79 et d’AK47 chinois. Le chef nous demande à voix basse :
-Où allez-vous comme ça ?
Nous tremblons. Personne n’ose briser le silence. Nous restons immobiles, encerclés par les six fantômes Khmers rouges qui nous fixent avec mépris. Le désespoir a ouvert ses portes sur nous. Tout le contraire de ce que j’avais espéré… Le chef Khmers rouge sort son pistolet et caresse la joue de tante Soeun avec son arme…
Oncle Chao est rouge de colère, mais il ne peut rien faire. C’est maman qui prend la parole :
J’ai une fille qui est gravement malade, elle aa besoin de se faire soigner…
-Venez avec nous ! lui répond le Khmer rouge. Nous avons tout ce Qu’il faut à Beau-Pailin. Un grand hôpital, des médecins et des infirmiers très doués… »
« …A ce moment précis, un autre groupe de soldats surgit de nulle part. nous sommes encerclés, aucune chance d’avancer… mais bizarrement, les Khmers rouges se retirent dans la forêt et les autres militaires nous appellent :
« Mani, mani ! », ce qui signifie : Venez, venez !
de grandes lumières d’espoir brillent dans les yeux de l’oncle Chao. Un sourire de vraie joie se dessine sur ses lèvres. Il articule seulement :
-Venez, nous sommes sauvés !
nous les suivons. Les Khmers rouges ont disparu sans bruit. Nous approchons de nos amis inconnus. Derrière nous, aucun coup de feu. Oncle Chao dit que ce sont des soldats thaïlandais et qu’ils vont prendre soin de nous… Je leur souris. L’un d’eux vient vers moi ;
-Tu as mal à la tête ? me demande-t-il en cambodgien.
Maman lui explique que je suis malade et que je n’arrête pas de délirer . il me prend alors par la taille et m’aide à marcher vers la liberté…
Il émane de ce petit bout de femme une volonté à ébranler n’importe quelle certitude et un instinct de survie monumental. On ne larmoie pas sur soi-même en ces circonstances, sinon on est déjà est mort. La morale n’existe plus, c’est l’instinct à l’état brut, lui seul dicte ce qu’il faut faire. Sur le moment on ne sait pas pourquoi on a choisi cette voie plutôt que l’autre. Au résultat, ils se rendent compte qu’ils sont encore de ce monde parce que c’était le seul choix possible. Comment ont-ils fait ? Ils l’ignorent mais ils l’ont fait.
Il ne faut que quelques heures à Méas pour vous donner l’impression que vous l’avez toujours connu. Nous sommes plusieurs à avoir constaté cette sensation à son contact. Merci Méas...
Prix 15 euros
ISBN 2-914-581-15-7
22:15 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (0)
27/11/2006
Ironie du sort
Le Ballouhey dit "Bacase" c'est le même sur la photo que dans l'article "Malnuit c'est le contraire de bonjour" mais 4O balais après... Toujours aussi rigolo... Un peu seul quand même sans l'autre zigotto de Michel Malnuit dit "Mazio"... Drôle de zozio aussi...

Malnuit ça l'aurait bien fait rigoler une rue à son nom...
Les drôles ont oublié la date du décés... Vous noterez l'humour local... Peintre local... à balais ou à Ballouhey? aurait ajouté Pierre Dac... De la moelle ils n'en manquent pas ... Faut dire que tomber sur un manche pareil c'est un os....
Justement le grand Pierre ballouhey dit Bacase nous a envoyé son petit crobard de la semaine...
ça vous apprendra a venir sur le blog de ressacs...
Au fait si vous trouvez une définition pour ressacs... Réseau d'Exfiltrés Soviétiques... C'est pas mal comme début mais me manque la suite... Si vous avez des idées...

14:30 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (0)
20/11/2006
Ballouhey dit Bacase...
Pour l'heure voila un dessin de Pierre Ballouey dit Bacase qu'on retrouve sur son site et qui vient de publier au Editions l'Arganier un recueil de dessins forts cochons, ma foi...
"Rêves de Cochons"
(le livre)
chez L'Arganier
22 x 22 cm, 72 pages, 16 €.
ISBN 2-912728-50-9
70 dessins beaux, cons et anti-cons.
Prix Anti-Mal-Bouffe à Saint Just le Martel
dans toutes les librairies
et sur Amazon.fr, Alapage.fr et Fnac.fr
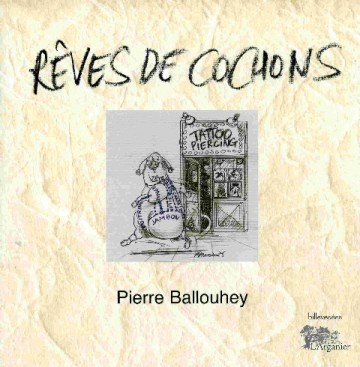
par ailleurs sur son site vous retrouverez tous ses crobards et petits dessins...

11:10 Publié dans Les copains d'abord | Lien permanent | Commentaires (0)
17/11/2006
Poétes vos papiers...

photo: Bénédicte Mercier, carnaval de Pau
Mes papiers ont toujours intrigué l'administration qui n’a jamais cessé de me regarder de travers. Peut-être que je ne conviens pas. Je n’ai jamais rien demandé et ce n'est pas moi qui les ai imprimés, ces papiers….
Pourtant l'administration m'a obligé à avoir une carte. Avant, quand je présentais le bout de papier qui me servait de carte d’identité d’apatride, c'était déjà pareil, on me regardait de travers. À force d'être suspecté, on finit par se penser en suspect. Rien de défini, mais une appréhension persistante.
En passant au poste-frontière, je me voyais déjà au fond d'un bagne, charcuté par des experts en aveux. La trouille ne se raisonne pas. On passe du blanc au verdâtre, les joues s'affaissent, les yeux se creusent, deviennent vitreux. L'air manque. On pense que rien, plus jamais, ne sera comme avant. L'adrénaline, pistonne en jets continus au fond des veines. Même en s’arrangeant pour paraître calme, on ne le reste pas. Les sbires au trois quarts bourreaux ont reniflé quelque chose de louche. Ils subodorent un avion détourné, un navire coulé, une ambassade plastiquée, un général dessoudé.
Vous avez la tête de l'emploi, vous en êtes convaincus. Les cerbères de la sécurité deviennent nerveux. La contagion gagne la fourmilière. Les gâchettes sensibles ont flairé le gros poisson. L'avancement plane dans l'air. C’est tout simplement votre nom… Un homonyme pas sympathique du tout… À ce rythme, vos abattis ne valent plus grand-chose. La bavure n'est pas loin. Un siècle, d'un seul coup, vous tombe sur les épaules. Et vous vous emmêlez les pédales dans les explications. À force d'être suspecté, vous finissez par vous persuader d'être un type dangereux.

photo: Bénédicte Mercier, carnaval de Pau
18:35 Publié dans carnets de voyages | Lien permanent | Commentaires (0)
16/11/2006
En vallée de Soulor
La journée n'était pas au beau fixe, quelques nuages de-ci de-là passaient, mais rien n'interdisait une sortie en montagne. Un pull et un K-way pour tout équipement. On savait que la course ne serait pas longue et on ne s'était pas chargé. Pour une randonnée, une bonne paire de chaussures suffit. Quand on a enfilé les vêtements de promenade il a trépigné d'impatience, sauté en tous sens et s'est mis à aboyer. Heureux à l'idée de courir sur les prairies de ses ancêtres.
Flanqué du chien, un énorme patou, on s'était attaqué à la ballade en pensant ramasser quelques myrtilles. Il en restait encore après le passage des touristes, dans des coins reculés. On a mis le peigne à baies dans le sac à dos. La chaleur est descendue dès que les nuages ont caché le soleil. Au loin résonnaient les clochettes des vaches, des moutons. Des chevaux aussi paissaient en liberté dans cette estive totalement déserte et mystérieuse. Au milieu de l'immense prairie, quelques cahutes servaient à traire les animaux sur place avant la tombée de la nuit. Les bergers redescendaient au village distant d'une dizaine de kilomètres, les coffres de leurs deux chevaux chargés de bidons de lait. On a continué à grimper. On n'aurait aucun mal à revenir, même si le brouillard s'épaississait encore. Il nous suffisait pour cela de suivre la pente naturelle et l’on retournerait à notre point de départ. Une silhouette furtive de renard est passée non loin. Le chien s'est élancé à sa poursuite. On l'a entendu gueuler après le goupil qui l'a distancé. Il a couru comme un dératé croyant qu'il pourrait le rattraper. Ce chien m'apparaissait chaque jour plus idiot. On ne s'est pas inquiété de lui, sachant bien que cet imbécile retrouverait son chemin. Continuant le nôtre, on est arrivé sur le plateau couvert de myrtilles protégé du pillage des touristes. Le gisement était quasiment intact. À chaque coup de peigne, on en ramenait une poignée. En moins d'une heure, on en a récolté plusieurs kilos.
-Le chien n'est pas de retour!
-Il nous attendra près de la route, s'il s'est perdu, ai-je dit à Lola.
Le brouillard était devenu trop dense pour qu'on envisage sérieusement de s'aventurer plus dans cette Balade. On a continué à cueillir profitant de l'aubaine. Quand on s'est décidé à partir, glacé par le brouillard, le chien n'avait toujours pas donné signe de vie. On l'a sifflé en vain. Puis on a décidé de le laisser tomber et de retourner à la voiture. La température descendait rapidement. Le brouillard emmaillotait tout d'une humeur blanchâtre. Des gouttes d'eau se formaient sur les toiles d'araignées. On ne reconnaissait plus aucun des points de repère.
-Par quel chemin, on est venu, j'ai demandé à Lola?
-Par là!
-Tu es sûr?
-Je pense!
-Où est le pierrier?
-Je ne le vois plus!
La vision s'était réduite à quelques mètres. On s'était laissé prendre de vitesse et piéger en néophyte. Je jetais un oeil à ma montre. Il nous restait une bonne paire d'heure avant la nuit. Je ne me suis pas inquiété outre mesure. On a avancé précautionneusement pour ne pas dévaler en contrebas. S'engager dans le bois nous donnait l'assurance de se perdre.
-Nous, ne sommes pas passé dans les arbres, lui ai-je fait remarquer!
J'ai enfilé mon pull de réserve, et j'ai tendu le sien à Lola. Des touffes de fougères, des myrtilles, mais pas le moindre son de clochettes.
-Je ne sais plus comment sortir de ce foutoir!
-Si au moins on entendait les vaches!
-Ouais on pourrait passer la nuit prés d'elle, on aurait du lait et de la chaleur, ai-je dit pour détendre l'atmosphère.
Un épais silence répondait à l'angoisse de plus en plus palpable.
-Mais où est parti ce connard de clebs?
On s'époumonait à hurler son nom. Face à ce mur blanc compact un écho atténué nous renvoyait désespérément au vide. Il ne fallait pas s'aventurer mais rester sur place. Risquer de se perdre était stupide. Je posais mon sac et j'ai tenté de réfléchir
-Ce n'est pas la période des grands froids, on ne risque rien!
-Si on passe la nuit sous la pluie, ça ne sera pas la première fois a répliqué Lola!
-En plus on ne peut pas faire du feu, je n'ai pas d'allumettes!
Me revenait en mémoire la technique apprise chez les scouts pour démarrer un feu avec des brindilles mortes. Mais pas la peine d'y penser un instant de plus.
-D'abord garder son calme...
Il nous a semblé apercevoir un point plus blanc que le brouillard, puis une tache noire et des oreilles marron. Ce crétin battait de la queue. Nul doute, il était revenu nous chercher. Il avait compris que quelque chose ne tournait pas rond. Il a aboyé, nous a léché les mains puis a marché devant. Il se retournait souvent pour vérifier qu'on le suivait bien. À cet instant, il m'est apparu d'une intelligence extraordinaire. Joyeux de se sentir utile il se trémoussait. Il nous attendait. On lui faisait entièrement confiance. On n'avait guère le choix. On a entendu à nouveau les clochettes bien qu'on ne distinguait rien dans la brume. On était sur la bonne voie. Il la connaissait la nature, bien mieux que quiconque. J'ai compris pourquoi les bergers s'aidaient dans leur tâche de ces gouffres à bouffe. On a buté sur la voiture aussi blanche que le reste du ciel.
-Bon dieu! Ce taré de chien n’est pas si débile!
Il n'a pas voulu monter dans le coffre et a couru devant la voiture pour nous montrer la route. On était vraiment heureux de l'avoir rencontré au fond d'une étable, ce clébard.

15:30 Publié dans carnets de voyages | Lien permanent | Commentaires (0)
15/11/2006
Pyrénées
Les autochtones de ces contrées sont des aristocrates de l'existence ayant conscience de leurs privilèges. Ils n'ignorent pas que d'autres s'entassent dans des cages de béton et ne respirent que du pot d'échappement à longueur d'année. Ils les voient débarquer l'été venir s'empiffrer d'oxygène. Si les indigènes mettent les pieds en ville, ils s'enfuient dès que possible. Pour eux le nord commence au-delà des gaves. Ils regardent vers le sud pour prédire la météo, un peu à l'est et à l'ouest sur la ligne de la Méditerranée à l'Atlantique. En Deçà ce ne sont que contrées étrangères. Pays du calme, du paisible carillon des vaches, du souffle du vent dans les arbres, des aboiements de chiens. Parfois le bruit d'une tronçonneuse rompt cette harmonie.

13:05 | Lien permanent | Commentaires (0)
08/11/2006
Une petite toile d'Anto

12:28 Publié dans Les copains d'abord | Lien permanent | Commentaires (0)
07/11/2006
Miettes de Ghetto
Par MOULOUD AKKOUCHE
Mouloud, que j'ai connu à Toulouse et recroisé au hasard des pérégrinations fait partie de ces gens qu'on à l'impression d'avoir toujours eu comme ami. Tout en simplicité est en rire contagieux.

Pour Alain Rey qui connaît la valeur des mots.
À la mémoire de Coluche qui n’avait rien promis... et continue de distribuer des millions de repas.
Récemment sur le petit écran, Éric Orsenna, académicien, vantait les mérites des textos et MSN très en vogue chez les jeunes. L’écrivain démontrait avec brio et bonhomie l’apport non négligeable de ce nouveau langage. Puis son raisonnement fut relayé et étayé par l’auteur tout aussi intéressant d’un dictionnaire d’argot. Diams, chanteuse rap parmi les invités, écoutait avec une grande attention cet échange fructueux entre érudits. Un régal pour les téléspectateurs. Diams, visiblement amusée, était sensible à cet éloge du mot-issage. Comment ne pas acquiescer à l’évolution de la langue française ? Éric Orsenna, pour illustrer son argument linguistique, dragua gentiment la rappeuse avec les mots des jeunes des cités et d’ailleurs. Un jeu de séduction plutôt marrant. Pas courant de voir un membre de l’Académie sympathique et vert même sans sa panoplie...
Mais aurait-il eu le même comportement avec la fille d’un de ses collègues du Quai Conti ou une jeune chanteuse d’opéra ? Se lâche-t-il autant aux réceptions du Conseil d’État ? Ses enfants communiquent-ils uniquement avec des textos et MSN truffés de fautes d’orthographe ? Et n’écoutent-ils que du rap ou de la techno ? Cette scène de télé en apparence banale révélait cette posture récurrente à l’égard des jeunes de banlieue : une fausse empathie teintée d’irrespect. Jean-Louis Borloo, ministre d’État, pratique souvent la démagogie du parler « djeune ». Rien à voir avec Éric Orsenna plutôt animé de bons sentiments... En tout cas, l’attitude de l’académicien primesautier me fit penser, toutes proportions gardées, aux éructations indignes d’un ministre de l’Intérieur lors de ses descentes en banlieue. Pourquoi cette étrange mise en parallèle ? À cause de leurs comportements et propos qu’ils ne se seraient pas autorisés dans leur univers très policé : milieu feutré avec plan de table et conversation calibrée. Et tous deux soucieux de la bonne éducation de leur progéniture, attentifs à l’orthographe et aux leçons de solfège. L’un menaçait de karchériser une cité entière tandis que l’autre, beaucoup plus ouvert, affichait un sourire affable dans une émission culturelle. Mais chacun, dans des registres opposés, ne laissant in fine aux jeunes des quartiers « sensibles » que les miettes du gâteau. Chacun son ghetto et les dictionnaires seront bien gardés...
Et aujourd’hui encore, à quelques mois d’un important scrutin, les habitants des banlieues redeviennent les figurants d’une mise en scène politicienne : intermittents réquisitionnés aux services d’ambitions étalées de Voici à TF1. Ségolène Royal propose de geler les prestations familiales des plus démunis et, pendant ce temps, même si ce n’est évidemment pas à mettre sur le même niveau, Nicolas Sarkozy traque les gosses sans papiers dans les écoles primaires pour les expulser. Chacun maniant tour à tour carotte et bâton devant les caméras, un numéro de surenchère pour apparaître plus intransigeant que son adversaire. Plus sécuritaire. Tactique et jeux d’ego classiques pour la quête du pouvoir... Un jeu où des millions de gens sont pris en étau par la gauche cafard et la droite nerf de boeuf exhibant sa caution éphémère : un rappeur à bonnet blanc et sans cervelle. Coincés entre une démagauche people, une droite Flash-Ball et quelques jeunes cons aux pieds de leurs immeubles, ces millions de citoyens n’ont même plus le droit de vivre dans des départements comme les autres mais dans le 9-3 ou 9-5. Quel commentateur a situé l’affaire Clearstream dans le 7-5 ?
Que dire de constructif sur les banlieues ? Tant d’encre a coulé et coulera encore sur ce sujet. Que rajouter à ce flot ? Fonds de commerce électoral, ces barres HLM sont absorbées et recyclées au gré des faits divers par la machine médiatique avant de retomber dans l’oubli. Et de redevenir des coquilles de béton échouées le plus loin possible des centres-villes, coquilles ouvertes juste pour nourrir les JT. Que sont réellement ces banlieues ? Difficile de répondre à cette question. Ce terme recouvre tellement d’éléments disparates. Dans le centre de Paris, les habitants ne sont pas tous identiques ; parmi eux se trouve la même proportion de gens sympathiques et d’abrutis qu’à Bobigny et sur tout le reste de la planète. Mais personne ne pensera à coller tous les Parisiens dans le même panier. Alors qu’on occultera les individualités de l’autre côté des périfs et rocades. Pour ne conserver que les images des jeunes cagoulés brisant des pare-brise. Images plus simples à véhiculer.
À l’heure où j’écris ces lignes, les RG annoncent une probable « nouvelle flambée des banlieues ». Et plus d’exploits de Zidane pour anesthésier... À qui peut profiter une France en flammes ? Qui réussira à tirer profit de ce grand incendie programmé ?
Nicolas Sarkozy, très habile, parle sans rien dire mais s’adresse à chacun. Et partout.
Pas un jour sans qu’il n’intervienne ou fasse monter au créneau l’un de ses lieutenants. Sur tous les fronts... Surtout national.
Un catalogue de promesses sous le bras, il slalome allégrement de la dame patronnesse du 7e arrondissement qui tremble pour les stock-options de son époux, au érémiste au fin fond du Lot, en passant par le banlieusard à la bagnole cramée. Il joue sur du velours : qui n’a pas une raison valable de se plaindre de son existence à un moment ou un autre ? Fort de cette certitude, le patron de l’UMP peut promettre que le soleil se lèvera plusieurs fois par jour et le bonheur régnera de Barbès à Tarascon. L’ancien avocat a bien appris les leçons de Pasqua, son mentor, qui clamait : « Les promesses n’engagent que ceux qui y croient. » Chaque tape sur l’épaule ne lui coûte que les frais de déplacement, réglés par le contribuable. Même les beaux quartiers se rallient à son panache de furet populiste. Lorgnent-ils d’hypothétiques places ? Aveuglés par l’opportunisme, ils en oublient que les mauvais mélanges causent immanquablement gueule de bois et crise de foie. Si Nicolas Sarkozy gagne en avril prochain, Marianne risque de rester longtemps à genoux au-dessus de la cuvette des chiottes...
Et les banlieues sous pression lui servent tour à tour de paillasson et de marchepied pour l’Élysée. Son intérêt n’est pas du tout de régler les tourments réels des grands ensembles. Au contraire. Chaque voiture brûlée lui rapporte plus de voix qu’une campagne publicitaire. Et les émeutiers, ses meilleurs agents électoraux, roulent pour lui. Pourquoi n’emploierait-il pas ces jeunes bénévoles pressés de passer à la télé ? Enfoncées dans la précarité, des familles entières de l’Hexagone, certaines à bout de nerf aux premières loges du désastre, finissent par lui tomber dans les bras ou dans ceux des barbus. Triste alternative. Surtout pour ceux qui, comme moi, sont athées et encartés dans aucun parti...
Un an après la mort de Zyed et Bouna dans un transformateur EDF et les émeutes qui suivirent, rien n’a vraiment changé sur le fond. Les saisons et les caméras passent, les difficultés restent ancrées. J’ai l’impression de me répéter, répéter ce qui s’écrit et se dit depuis des années. Une bouillie indigeste des mêmes maux toujours au menu. Et, bien à l’abri derrière mon écran, je me sens impuissant et donneur de leçons. Peut-être juste bon à alimenter le brouillard déjà épais au-dessus des banlieues ?
Que faire ?
Quand on m’a proposé d’écrire sur ce sujet, j’ai hésité car je ne vis plus en banlieue depuis cinq ans. Mais une partie de ma famille y réside encore et beaucoup d’amis. Chaque fois que je monte à Montreuil, ma ville natale, je me rends compte que le fossé se creuse entre les diverses populations. La mixité sociale de plus en plus compliquée à maintenir. Nombreux gosses de « bobos » (souvent militants Verts et ardents défenseurs des sans-papiers) et de « nouveaux prolos » ne fréquentent pas les mêmes écoles. Mais quels parents auraient envie d’envoyer leurs gamins dans un collège cumulant les handicaps ? Et les récentes propositions de Ségolène Royal pour l’abrogation de la carte scolaire ne feront qu’accentuer ce déficit. Sans dédouaner certains jeunes, responsables d’incivilités dans les établissements scolaires, je ne crois pas que les enfants Hollande ressentiront un jour une profonde humiliation face aux institutions. Ni mes gosses d’ailleurs. Mais force est de constater que l’école est de plus en plus taillée sur mesure pour une minorité. Même si quelques-uns parmi la majorité réussiront à trouver un vêtement en solde... « Si tu es sage dans ton bahut de banlieue, tu pourras entrer à Henri-IV. Sinon deviens champion du monde de foot, comique, rappeur... Leader... ou dealer. Ou vigile. » Petit message à la candidate socialiste qui refuse d’avoir « peur du peuple » : les prestations familiales remplissent aussi un frigo ou règlent une note de chauffage en hiver. Les allocs ne sont pas de l’argent de poche, surtout quand les poches sont trouées.
Depuis une vingtaine d’années, les banlieues sont autant de petits volcans qui se réveillent séparément ou, pour la première fois en novembre 2005 : ensemble. Comme une fatalité. Pourtant, ici et là, des mains anonymes (Jean Acamas et son Chiffon rouge...) continuent inlassablement de tisser et retisser du lien social, réparant les dégâts de la nuit avant d’attaquer la journée. Loin des dorures de la République et des effets d’annonce. En réalité, ces émeutes de l’automne dernier dépassent les frontières des banlieues ; elles sont le reflet d’une société abandonnée en grande partie aux publicitaires et financiers adeptes du court terme. Et sans morale : un mot pas très tendance. Dans toutes les corporations (idem pour la culture), le critère essentiel est la rentabilité ; de nombreux cadres et employés finissent par commettre des incivilités invisibles pour ne pas se faire virer. Mais qui n’a jamais fait des concessions et eu des lâchetés ? Voilà pourquoi chacun, moi compris, ne doit se complaire dans la victimisation et se défausser exclusivement sur la société génératrice de tous les maux. Pareil pour chaque jeune qui ne peut s’exonérer de sa part de responsabilité individuelle. Surtout quand il crame un bus à Marseille ou ailleurs.
Tous ces constats établis : quelles solutions efficaces pour enrayer cette spirale infernale ? Comment agir face à ce gâchis, cette autodestruction d’une partie de la jeunesse ? Critiquer ceux qui fournissent les briquets en haut lieu ne suffit pas... Quoi qu’il en soit, les auteurs, artistes en général, ne sont que des questionneurs du monde. Place maintenant à ceux qui doivent apporter des réponses concrètes : les responsables politiques. Pas ceux axés uniquement sur leurs intérêts, mais des citoyens n'oubliant pas en cours de mandat qu’ils ont été élus par et pour des citoyens. Citoyens usés par les promesses non tenues. Et de plus en plus sceptiques sur le rôle de la politique.
Aujourd’hui, le temps n’a plus le temps.
Et les élections approchent. De gauche ou de droite, nanti ou au RMI, rappelez-vous avant de glisser votre bulletin dans l’urne que le vrai ennemi de la démocratie n’est pas le jeune de banlieue. Ni l’insoumise de cité et le sans-papiers. Ni un écrivain condamné à la cavale...
Et surtout n’oubliez pas au second tour de l’élection du prochain(e) président(e) de la République que les mots Liberté, Égalité, Fraternité peuvent aussi s’effacer au Karcher.
Ce texte a été publié dans l’Humanité du 2 novembre 2006.
Mouloud Akkouche vient de publier
Rue des absents, Atelier In 8 In Octavo.

21:40 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (0)
06/11/2006
Vient de paraître
Le Quellec
vient encore
de sévir
aux éditions
du Jasmin

Maryvonne amie de longue date, a déjà illustré des articles de ce blog.
Pour rentrer en contact avec son éditeur et découvrir son travail :éditions du jasmin
15:30 Publié dans Les copains d'abord | Lien permanent | Commentaires (0)
25/10/2006
La preuve par le neuf

Collage: Maryvonne Le quellec
Pour retrouver le travail de Maryvonne Le Quellec
Les groupes éditoriaux semblent être devenus des géants aux pieds d’argile, comme s’ils s’étaient embourbés dans des structures de plus en plus lourdes les rendant incapables de raisonner autrement qu’à coups de best seller.
Là, où des petits éditeurs s’estiment s’en sortir royalement avec mille ou deux mille exemplaires vendus sur trois ou quatre ans, l’éditeur classique aura l’impression de sombrer dans le ridicule s’il tire à moins de deux mille, même s’il sait qu’il ne vendra que cinq cent exemplaires. La sacro-sainte mise en place et la philosphie du marketting et des ouvrages en pile est passé par là.
Là, où une colonne de mulets sur un sentier de montagne se faufile haut la main et tiens tête à une armée, classique en y infligeant de lourdes pertes, les colonnes de blindés et les pilonnages intensifs ne servent à rien. Chaque petit éditeur épouse l’aspérité du terrain et s’adapte dans sa niche de résistance. La légèreté semble être la taille idéale pour survivre en milieu hostile. Si des généraux pestes contre la montagne et les périodes économiques escarpées, c’est parce qu’ils ne savent pas faire la guerrilla. Ce sont marins de beau temps qui roulent bien seuls sur l’autoroute de leur raison. Voir l'édition sans éditeurs
Pourquoi ce savoir faire des petits éditeurs ne peut-il pas être repris par des structures plus importantes? C’est ce feu sacré retrouvé dans les yeux de ces apôtres qui fait toute la différence. Il semble qu’aucun de ces apôtre ne peut fonctionner dans le girond d’une marketting manager. Ces putschistes des temps modernes. Pourtant ils tâtent, pèsent le pour et le contre, recomptent… Plus rien ne va comme ils l’avaient prévu. Bien que dans leurs plans tout semblait clair. L’auteur malmené, les contrats renégociés, le travail délocalisé... Malgré cela, impossible d’arrêter l’hémorragie.
Pourquoi les micros éditeurs se mettent à pulluler ?
C’est grâce un seuil de rentabilité très bas…
Car la technique est passée par là entre-temps. Il existe des machines à impression numériques qui produisent une qualité qui s’approche d’un tirage imprimé par un procédé offset. Bien sûr le produit ne peut pas recevoir une couture classique, mais éventuellement une couture à la japonaise comme celle que font les éditions Moundarren.
L’avantage dans ce procédé révolutionnaire qui n’est en fait, -en grossissant un peu le trait-, qu’un photocopieur qui a énormément progressé, réside dans la possibilité d’impression sans stock. Ce qui n’est pas négligeable.
Zéro stock : pas ou peu d’immobilisation de capital, zéro ou guère de risque financier, délai de fabrication très court… Rien que du flux tendu, un stock tampon minimal -au cas où- de cinquante ou cent exemplaires au maximum. C’est bien suffisant pour notre futur Beckett. Qu’il se contente de trouver ses deux cent lecteurs et on vendra ses deux cent exemplaires à l’année… Et le tour est joué.
Pain béni pour le petit éditeur, il n’est plus jamais en rupture de stock, il continue à exploiter le titre au goutte à goutte. En poésie, ce n’est pas négligeable, en théâtre non plus. Et pour nos premiers romans ? A quoi donc cela sert-il d’imprimer deux ou trois mille exemplaires, quand cinq cent suffisent ?
La gestion de production pour des flux plus importants est parfaitement maîtrisée et le parc machine est capable de produire très rapidement des quantités importantes (Goncourt) en limitant la prise de risques financière. La machine Cameron se cale à partir de deux mille exemplaires et produit tranquillement ses cinq mille exemplaires finis à l’heure. Il suffit seulement d’imprimer des couvertures d’avance.
Trois quart d’heure de calage, deux heures de roulage et vous obtenez vos dix mille exemplaires sur palette… Si vous avez bien prévu votre planning vous aurez juste le temps d’aller casser la croûte au bistrot pendant qu’on vous remplira la camionnette d’exemplaires tous chauds… Une blague, dites-vous ? Que nenni… C’est là tout l’argument de vente de cette machine que j’ai vu et revu en production… Réactivité, efficacité, les deux mamelles pour perdurer sur ce marché.
Alors pourquoi ne pourrions-nous pas faire dans la dentelle, alors que nous savons si bien faire dans la cavalerie…

Laissons-là, les problèmes d’industriels, le petit éditeur n’est pas de cette famille industrieuse-là, mais de celle de l’artisan même s’il travaille maintenant avec des outils très puissants.
L’impression numérique est l’avenir du petit éditeur…
En quelques années, un micro éditeur peut se constituer un catalogue avec un apport financier ridicule, ce qui relève littéralement de l’hérésie. L’édition s’est démocratisée grâce à la technologie.
Quid des ventes ?
Si le E book qui fut en son temps célébré comme un outil totalement révolutionnaire a fait long feu, par contre l’Internet et la vente par correspondance, qui n’en est qu’à ses débuts ont évoluées.
L’éditeur peut vendre sur la toile, soit en passant par le biais d’une librairie qui travaille aussi par correspondance, soit router lui-même ses ouvrages. Rien ne lui interdit. Des librairies virtuelles se constituent. La part de marché qu’elles représentent est certainement infinitésimale. Mais comment va évoluer le marché de la vente par correspondance dans l’avenir ? Déjà quatre à cinq pour cent en si peu de temps, alors que les libraires et les éditeurs classiques croulent sous les flux de retour… Quel sera le comportement des lecteurs futurs… Se contenteront-ils des ouvrages proposés en librairie ou curieux iront-ils dénicher ces auteurs inconnus qui peuvent être produit en passant sous le rideau de fer de la pure raison économique par des apôtres du livre dans le regard desquels brûle la flamme de la passion ?
Article à consulter: mort aux petits éditeurs
A méditer : l’éditeur Robert Morel pensait que chez un bon éditeur on pouvait acheter les yeux fermés.
09:30 Publié dans Analyses | Lien permanent | Commentaires (0)
24/10/2006
De la prétention littéraire.
Parlons argent puisque ça fâche…
Le livre va mal… Faillite d’un éditeur, départ à la retraite d’un libraire, absorption de marques par des groupes, coups tordus dans la profession, le livre va mal. Le livre va semble-t-il, mal, très mal.
Ce paysage, -bien que mal-en-point- est paradoxalement en bien meilleur état qu’à New York, puisqu’à Paris il reste dix fois plus de librairies… Et tout cela est à mettre au bénéfice de notre éternel jeune ministre, Jack Lang. Je le précise, à effet, pour les moins de vingt cinq ans qui n’étaient pas encore de ce monde en 1981.
Revenant d’une réunion professionnelle, qui si elle avait le mérite d’être publique n’en était pas moins à cercle restreint, semblait avoir des airs de conspiration dans un sous-sol parisien. J’avais, excusez du peu, l’impression de revivre une expérience qui remontait à vingt-cinq ans en arrière, lorsque dans des discussions sans fins, dans un village haut perché des Pyrénées orientales, nous rejouions la résistance et que Marcevol se déclinaient dans des discussions interminables où les joutes oratoires fleuraient bon l’empoignade.
L’idée de l’époque, qui depuis à fait du chemin, c’est que la culture appartient à tous. Qu’il n’en existe pas une seule qui serait dominante que l’on doit se laisser imposer, mais des milliers et que toutes sont aussi respectables. Et qu’il faut désacraliser l’acte de création pour le mettre à la portée de tous. Qu’en aucun cas la culture est une marchandise qui appartient à un groupe économique aussi puissant soit-il, mais le ciment de toutes sociétés humaines. Que l’accès aux cultures et aux savoirs est à la base de l’émancipation qui permet de transgresser le déterminisme social. Que tout le monde peut écrire et publier son livre, car tout le monde à quelque chose à transmettre aux autres. Même si souvent c’est maladroit, mal écrit, même si « la chose finale » est mal fagotée, même si le texte est de guingois, qu’importe ! Que le seul témoignage d’un poilu avait même valeur que tous les ouvrages répertoriés dans le corpus de cette période. Que le récit d’un survivant de la shoah comportait dans le texte toute la douleur du monde depuis sa création. Il nous semblait que la force qui animait la démarche était bien plus intéressante que le résultat de la démarche. Tout un état d’esprit d’une époque… Sympathique au demeurant et qui laisse une nostalgie incroyable, car du haut de nos vingt ans nous pensions que tout était encore possible et nous voulions refaire le monde. Au résultat, c’est plutôt lui qui nous à méchamment refait. Il faut bien perdre ses illusions. Mieux vaut tard, que ne pas en avoir du tout eu .
Les éditeurs de l’époque étaient moins bien armés pour l’activité économique que pour la joute oratoire. Mémorables les prises de bec d’une Martine Delort, les engueulades d’un Xavier D’arthuys, les positions d’un Carité. S’il en est resté certains dont les livres ont depuis marqué le paysage éditorial, Castor astral, Atelier du gué, Brémond, d’aucun comme S’éditions sont restés moribonds ; d’autres sont tout simplement passés aux oubliettes, Chiendent, et Ressacs pour votre serviteur et pour ne citer qu’eux.
Les années avant dix-neuf cent quatre-vingt et un, étaient marquées de cette fin imminente et catastrophique annoncée pour l’édition et le livre en France… Et la loi Lang est arrivée… Vingt-cinq ans de sursis. Des secteurs qui tournent le feu de l’enfer, BD, Jeunesse. La poésie qui était en total collapsus, revigorée. Même si elle n’a pas retrouvée sa vitalité d’antan et ses tirages hugoliens.
Six cent romans à chaque rentrée littéraire. Et il paraît que le livre va mal. Tiens donc ? À moins qu’il aille mal de cette boursouflure. Serait-ce à cause de ce fameux marketing, auquel je comprends toujours couic.

Dans ce sous-sol de l’immeuble parisien étaient-là des éditeurs de la mouvance des litteratures pirates, certains jeunes et d’autres un peu moins, mais tous fauchés et tous atteints de cette fièvre des apôtres du livre que j’ai toujours connu chez tous, comme si la vie dépendait des productions…
La question du jour était : comment trouver une appellation pour ces livres, qui si parfois ils n’en sont guère aux yeux des libraires, en sont encore moins à ceux des diffuseurs, bien que le marché existe auprès d’un public initié. Livres d’art et d’essai ; comme il existe un cinéma de la même appellation.
Il semble que les limites de la loi Lang soient atteintes et qu’à nouveau, le livre soit malmené par le marché parce que les libraires ne peuvent plus faire leur travail convenablement sous ce flot incessant de nouveautés. Parce que ce sont les libraires les seuls garants de la biodiversité culturelle qui sont atteints par un mal qui ronge leurs magasins. Ils s’écroulent littéralement sous les flux des livres. Et ils ont l’impression de servir de trésorerie aux groupes éditoriaux de plus en plus axés sur le marketting et de moins en moins sur la pertinence des contenus, comme l’analyse Dominique Autié.
Si les chiffres de vente s’effondrent, sous l’effet de masse le marché, lui, se maintien en chiffre d’affaires. Mais avec combien de fois plus de titres qu’avant ? Cherchez donc l’erreur. Cela veut dire qu’on vend moins d’exemplaires tout en vendant plus de titres différents… Si vous ne comprenez pas, c’est normal… C’est du marketting.
Le livre est bien le seul produit alimentaire qui n’en soit pas un… Car s’il nourrit l’esprit et c’est à ce titre qu’il bénéficie de la même TVA qu’un kilo de nouille, son commerce, n’en est pas vraiment un.
La ratification du traité sur le commerce des biens culturels l’attestant… La culture est un bien commun à mettre au même rang de progrès social que la déclaration des droits de l’homme. N’en déplaise à nos cousins d’outre océan.
La preuve la plus étonnante de ce non commerce se trouve dans le fait que le livre est le seul produit qui s’il n’est pas vendu est retourné à son producteur. Imaginons un pécheur de limandes : si celui-ci ne trouve pas acquéreur pour sa marchandise, voilà notre brave homme obligé de reprendre ses cageots et de remettre tout ça à l’eau. Hérésie de comparer gens instruits avec le quidam bourru hirsute et iodé. Point tant, il me semble.
18:05 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (0)
19/10/2006
ANTO journal d'octobre
L'ami Anto qui tient son journal de peintre…
En fait profiter en exclusivité les lecteurs de Ressacs...
Les esquisses d’octobre
Écris au jour le jour Avec des avec et des sens.
Je parcours sur les photos de mes petits boulots
Des commentaires qui asticotent mon vécu… Le plaisir d’y sentir les épreuves et le rythme créatif en noir et blanc.
C’est Lundi et il fait un soleil radieux…Belle journée pour peindre et dessiner en camaïeu de gris.
Photos et autres balivernes argumentent ma journée…

Tiens voilà les dessins en boîte sur l'ordi.
Technicien et pas des moindres nous devons prendre des précautions pour l’avenir, avoir trace de nos images.
Je prends du temps pour archiver le nouveau boulot pour l'expo prochaine,
dont je t'ai parlé toute à l'heure. Celle de novembre à Akwaaba.
Voilà le premier est plus réussi, enfin à mon sens...
Arpente la complexité d'avoir des enfants dans l'ébauche, le
naturel d'un trait, souvenir blanc de jouissance...

Mon ami, le plaisir est grand de te le montrer en premier sur ton ordi. Il est classé
dans la "Sans idées autour du ventre"… C’est en cours mais l’idée me plaît. L’art me fait manger. Alors…
Tiens en voici un autre... C'est le travail de ces derniers temps sur un dessin la ville continue à me hanter... Beau temps aujourd'hui...? Les ennuis sont passés... Pour combien de temps...
La télé, elle est cassée. Chouette ... VivE l'imagination!...

Divagation sur papier autour "d’eux"… Très peu de couleurs...
La gamme des gris emprisonne les strates d'un paysage d'hiver où le coeur y est planté.
Nous sommes mardi 17 octobre et le temps va changer. Cette après midi… Le gris
Voici les deux derniers boulot du jour…
L’envie de continuer la série « sang idées avec du ventre » est intact et pense l’exposer en novembre…

Le petit baigneur ou la main tendre...
Le lundi, 16 oct 2006, à 16:45 Europe/Paris, Didier Simon a écrit :
Attention,
Le bien être te porte à la famille, espèce de géniteur fou !! écrivait Didier
Et oui...
Prolixe en bonheur...
Gris noir et surtout blanc...
Mon journal a repris vie… Je continue…

Les montres peuvent s’en retourner.
Le contre-la-montre, j'en n’ai rien à faire... Le temps à l'envers pour un carnet débuté en juillet sous la chaleur d'un été en questionnement.
Et tant pis pour le tour de France... Le mondial a primé.
Au fur et à mesure, le temps passe, les réussites aussi... Allez, attendons les escargots… C’est pour bientôt...

L’attente…
Dans les grands blancs d'une attente.
Gertrude s'assoit sur son passé le temps d'une petite pause.
La noire d'une pensée, comme le noir d'un sol... La terre en colère.
L'avenir déterminé par l'envie d'un moment tranquille...
L’agitation pour préserver les fumées du temps.

Baignade
A Rome ou ailleurs sous la chaleur, le couple se rafraîchit à la tombée de nuit.
La baignoire est leur mer et le jeu de sa main évoque en elle;
l'offrande d'un câlin
sur ses petits seins.
Risque et progrès… Tout un programme
Estienne… le jeudi 23 à 11heures… J’y parlerai
C’est décidé. Faut bien semer des graines d’art dans les métiers d’art… C’est mercredi….

Chamaille
La faim pousse quelques fois le ventre vers un jeu de mains.
La mère protège le chérubin et le ciel réclame l’amour sans retour.
Mercredi, Saïd a appelé…
Me rappelle L’Enfant de cœur notre première collaboration…
Espèce de Chacal…-« Puant »… a t-il ajouté… Un soir.
Nous, les mots ont les peints en noir.
Je lui envoie ses quelque images sans être gris.
Pascal est passé…
Fred a téléphoné
Solange ne travaille pas.
Et moi j’attend l’idée suivante.
Jeudi : on verra bien…
16:15 Publié dans Les copains d'abord | Lien permanent | Commentaires (0)
18/10/2006
De la prétention littéraire

Idiot j’étais, je le confesse, -la jeunesse n’étant pas l’apanage de la discrétion ni du discernement- en concourrant à tous les prix de la Navarre persuadé qu’un bedonnant ratiboisé de la touffe reconnaîtrait mon talent, et que le jury unanime me consacrerait par-delà le département… Idiot triple, plus truffé de certitudes qu’un blockhaus de mines. Atteint d’une vision prophétique, j’étais sûr qu’on allait consacrer mon talent, voir mon génie et je m’accrochais à ça comme un naufragé à sa bouée de sauvetage. Je demande clémence à mes juges pour qu’ils m’accordent les circonstances atténuantes, le quotidien d’ouvrier imprimeur était loin d’être folichon. Ceci expliquant cela.
Á combien de concours ai-je participé ? À tous absolument. J’ai envoyé des manuscrits à Rodez au prix Artaud*, à Lyon au Kowalski, à st Quentin en Yvelines au Snyder*, même à Lourdes au Max Pol Foucher* croyant encore au miracle. Partout il doit encore traîner pour les forcenés de la recherche de mes manuscrits sur des étagères poussiéreuses. De quoi faire une thèse pas moins sur l’obsession d’un auteur ayant été à l’origine de l’assassinat verbal de jurys entiers.
Ce n’est que bien plus tard que je compris après avoir maintes fois pesté contre ces idiots, ces bornés abrutis non éclairés à la science de la ligne mélodique, que pour être élu il fallait produire une écriture consensuelle, non pas un ramassis de vociférations outrancières juste bonnes à effrayer le bourgeois bien pensant. Ce n’étaient point des gens de ma caste qui me jugeaient mais des ennemis. En rentrant dans leur jeu, je me comportais comme un traître désireux de se faire adouber par des vieilles badernes boursouflées de certitudes. Combien de lettres d’insultes ai-je envoyé à ces gens? Je n’ose savoir. J’évite encore de croiser certains membres de jury sur les salons, toujours tellement couvert de honte, je suis aujourd’hui encore. Á l’époque, je m’en foutais de passer pour un voyou. Et je levais ma chope à l’audace de la jeune garde qui allait cul par-dessus tête faire gicler ce ramassis de timorés de bonbonnières. Je n’ai jamais réclamé leur pardon, et préfère encore le romantisme d’une balle en plein front de ma révolte adolescente.
Je n’avais rien à attendre d’eux et pourtant j’attendais. Rageant et pestant tout en ne remettant pas en cause l’utilité de mon geste. M’inventer un prix littéraire à moi, taillé sur mesure, décerné par mon jury fait d’autres plumitifs. Impossible. Tous l’auraient voulu…
Depuis j’ai appris à m’en foutre. Je ne participe plus à rien et j’entasse mes manuscrits de poésie dans mon tiroir. Pour le cas où je devienne à la mode sur mes derniers jours quand je ne pourrais plus voyager, alors que l’argent coulera à flots.
Heureusement qu’il me reste un éditeur pour la prose, qui est ce qu’il est, ni pire, ni meilleur -bourrique à ses heures-, il ne m’en veut pas de ne guère vendre. Tant qu’il rentre dans ses finances, il continue à me publier et je suis bien trop content qu’il me publie. Je ne cherche plus la gloire, et lui ne rechigne pas le bougre, entre ses faillites, à m’accepter encore un texte. Oh, il ne m’en donne pas cher non, mais il l’imprime à mille exemplaires. Et il les vend à sa vitesse, en deux ou trois ans. Que demander de mieux ? Je me contente de ce peu, qui est déjà beaucoup.
Et tout ça, sans même un articulet dans la presse. Pour sa défense, il n’envoie même plus un seul exemplaire à un journaliste en service de presse. Il ne va pas inutilement gâcher des exemplaires. Ça ne sert à rien de contacter des gens qui sont aussi critiques littéraires que danseur étoile à l’opéra de pékin. Pourquoi voulez-vous que ces gens parlent d’un petit éditeur qui ne les as pas publiés, qui ne les fréquente pas, qui n’a pas de pognon à dépenser dans des raouts mondains et qui préfère s’acoquiner avec des grattes papiers inconnus.
Et si par miracle, il m’arrive de rencontrer un lecteur qui me parle avec de la sincérité dans la voix, -tant pis s’il ment- d’un de mes manuscrits, je suis tout prêt à le croire. S’il s’étonne que je ne sois pas publié chez un grand éditeur. Je lui réponds qu’il n’y a pas de risques puisque je ne leur envoie plus rien. Fatigué de ces lettres qui se terminent toujours par une réponse négative.
08:30 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (2)
10/10/2006
De la prétention littéraire.

Écrire c’est bien, mais qu’est donc l’écriture sans lecteur ?
Un passe-temps sympathique, une thérapie à peine suffisante pour les plus méchamment atteints, une manie comme une autre, pas pire ni mieux que du tricot ou de l’onanisme. Ca tient chaud, c’est agréable et confortable et ça permet de passer le temps. Guère de prétention, pas moins d’exigence. Aucun souci du lecteur, ce voyeur prêt à savourer un épanchement intempestif, une tournure de phrase par trop osée.
C’est bien souvent ce qu’on finit par se dire, à quoi sert tout ce cirque. Noircir son clavier avec ses mains pleines de doigts, puis aller courir les antichambres comme si sa survie en dépendait. Faut être un peu toqué, non ? Alors qu’on peut débloguer en direct, et faire du trapèze sans filet. Enfin un peu de sensationnel pour une infâme carcasse. Allez zou, tout le monde en piste… On va s’amuser.
Le niveau d’exigence de la rédaction du texte augmentant en fonction de sa destination. Et comme la publication relève quasiment de l’œuvre à part entière. On n’imagine pas à quel point le moteur est complexe. La facilité d’accès à la lecture de ses textes est bien le pire danger qui guette l’écrivant. Parce que c’est le lecteur qui fait l’auteur, et l’auteur est le pire ennemi de l’écrivant.
Le parcours du combattant pour publier n’empêche en rien nombre de textes ne méritant point la publication de se retrouver sur l’étalage de nos bonnes vieilles librairies, de plus en plus âgées.
La première question qui vient à l’esprit de tout honnête homme étant celle-ci: la staracadémisation est-elle la cause de la pauvreté de telles publications ?
En d’autres termes : pourrait-on imposer pareilles âneries à un esprit sain ?
Certes il aura au préalable fallu, rendre perméable et malléable le cortex de nos contemporains pour y faire rentrer le contenu des émissions littéraires qui vantent les mérites de pareils brouets.
On pourra d’ailleurs remarquer au passage que le mot émission contient déjà la nocivité du propos. Une émission de gaz, et les sirènes retentissent. Malheureusement il n’existe pas une côte d’alerte pour les émissions cathodiques. Pourtant arriverons-nous un jour à quantifier la somme des dégâts que cela provoque ?
Qui retrouve-t-on lors de ces émissions ? Un bec à foin, un bon gros gigolo de service, un micheton allumé, une génisse extra-conjugale, et vas-y de la tirade à te faire pondre un dindon.
On peut donc observer le phénomène suivant : par un principe de mécanique inverse, plus l’émission cathodique à été forte, plus les dégâts collatéraux sont intenses et plus le niveau d’exigence littéraire des textes qui se retrouvent à l’étal des marchands de papiers noircis voient leur qualité décroître. Tout ça me laisse bien glaçon mon brave monsieur.
Les chiffres de vente annoncés feraient pâlir Beckett, lui qui à ses débuts arrivait péniblement à ses deux cent exemplaires par an de En attendant Godot… Imaginez le topo au jour de notre époque. Il y aurait long feu que le père Lindon et sa pseudo œuvre aurait méchamment été prié de prendre la porte et que feu le sieur Samuel aurait été remercié par les actionnaires pour n’avoir pas atteint le bénéfice à deux chiffres tant escompté par le fond de pension américano marxiste à tendance Groucho
Confondant produit et œuvre pérenne, chiffre de vente et qualité. Confusions largement entretenues par les sirènes du système pour que perdure l’illusion. Car il faut que la mécanique continue à cracher du profit.
Quant au lecteur, il guette l’animal le nouveau cru comme un pinardier la fermentation de son jus. Il en veut pour son pognon si durement gagné. Qu’il se rassure… L’éditeur est là pour lui donner la belle illusion qu’il est capable de lire un titre sérieux en lui dopant le volume rien qu’en lui gonflant la tranche. Le bouffant, comme son nom l’indique, ça vous donne tout de suite de l’épaisseur à un méchant cahier. Le même ouvrage sur bible, aucun quidam ne voudrait le payer le dixième du prix annoncé, pourtant, foutre dieu, c’est bien la même quantité de signes qui se trouve à l’intérieur. Un Harry Potter corps douze interligné treize sur un quatre-vingt-dix grammes en bouffant avec une main de deux, ça vous donne l’équivalent d’un papier en cent vingt grammes. Notez que le bible est en vingt huit gramme avec une main en dessous de l’unité, vous commencez à comprendre la supercherie… C’est trois quarts du vent dans la cellulose noircie que s’achète au prix fort notre benêt. Alors qu’un titre Pléiades des siècles ça vous dur et ça en contient du texte, bien plus que toutes ces foutaises.
Quid alors de la culture dans ces conditions ? On peut l’espérer longtemps le prochain Beckett… En attendant faudra se farcir du Cohelo, se rincer au Lévy, se dilater au Harry, se péter la fantaisie avec Amélie, se frotter d’aise au Angot, se soulager au Houellebecq. Foutre dieu, quelle belle perspective. Rien que du pur jus de littérature de premier choix. Pas étonnant qu’après ça, en banlieue, on ait envie de mordre… Si c’est là tout l’avenir intellectuel qui les attend, ils font bien de foutre le feu aux facultés qu’ils n’ont plus… Ils ne perdent pas grand-chose et s’amusent pendant ce temps-là.
Le chiffre d’affaires ne doit pas choir, aussi le maintient-on artificiellement par une pléthore de titres nouveaux. Qu’importe alors si les trois quarts du stock repartent dans la chaîne sous forme de cellulose recyclée. Tant que les machines ne s’arrêtent pas…
A un moment donné il faut bien que quelqu’un trinque… Mais qui pressurer dans ce foutoir ?
Il y a un gugusse qui encaisse pas mal dans cette affaire, et c’est sur lui que devra s’abattre la compression pour maintenir les centres de profit avec le même ratio.
Ce n’est pas l’imprimeur : les coûts d’impression sont maintenus en déflation depuis plusieurs années. Chez l’éditeur : baisse de l’exigence de la qualité des images, de la relecture, compression de personnel, ambiance de négrier et salaires au ras des pâquerettes avec dépression nerveuses à tire-larigot, suicides, tabagisme, cancers et sièges éjectables à tous les coins de rue.
Continuons à chercher l’erreur. L’auteur, bon sang mais c’est bien sûr, c’est lui le bougre qui coûte cher. Bien sûr, de bien sûr. Il n’a pas besoin d’argent pour vivre puisqu’il produit en dehors de ses heures par hobby ou par prétention. Ratiboisées à sa part congrue l’avance sur recette. Quand un écrivain encaisse en tout et pour tout un chèque de mille euros à la signature du contrat il faut savoir raison garder, et pas tout dépenser en une soirée au lupanar du coin. Remplir le bas de laine pour se payer du toner et des ramettes de papier. Parce que ça finit par coûter cher un tel vice. Et les envois postaux malheureux y avez-vous pensé ?
Bien sûr il ne faut pas envisager renouveler son traitement de texte avec pareils émoluments. L’abbé Pierre vous aidera bien avec du matériel déclassé. Certains de ses compagnons sont doués en réparation. Anciens informaticiens qui ont failli sur leur parcours, pour cause d’out sourcing, comme disent les actionnaires aux ratios belliqueux.
Le libraire aussi, le petit malin, il file profile bas et il collabore de mieux en mieux ne devenant plus qu’une grosse caisse de résonance du prêt à mâcher. Les résistants sont rares, timides et n’usent pas du fiel qui leur serait salutaire. le diffuseur
Mais l’auteur, c’est la fiente, la pire des chienlits, le mac à sa poulette. Le lichou à mémère… Charly la fiotte. L’enclume. La bourrique qui s’entête ni queue a l’ego boursouflé. La belle chose que voilà, l’ego. Vite sortir la brosse à reluire pour le haut du crâne. Comme c’est beau l’ego. Comme ça brille.
Celui qui dix ans auparavant, avec vous partageait, café noir et passes d’armes langagières à fines lames grivoises, hé bien l’ami c’est fini, tout ça. Le ministre lui a remis son hochet au garçon. Le voilà avec sa quincaillerie, son prix sous le bras, ses entrées au palais rue de Valois. Un sourire à peine esquissé, alors qu’avant c’était la virée assurée chez madame Andrée, pour tâter les nouvelles. Il a resserré son jabot. L’engeance. Jamais homme de cette qualité n’a fricoté en bistroquet enfumé, avec barbot de basse caste. L’enflure, le minet, le bon compagnon plumitif qui en a laissé son duvet sous la couette. Le voilà emplumé, tout poudré, roulant en carrosse. Qu’elle est loin la saucisse frite de la fête de l’huma dans son estomac. A le voir dans son costume tout noir, chemise de même couleur largement ouverte, portant chaussures vernies, jamais l’homme par le passé n’a fréquenté la piétaille. Il fricote maintenant en haut lieu. L’auteur, bientôt ministre à ce régime traîne déjà sur les plateaux du fumigène cathodique.
Pas l’humble écrivain qui doute de son travail, mais l’auteur, la petite fumure qui rampe au fond de chaque plumitif. L’auteur au fion boursouflé par son tout à l’ego. La crapule à chaque instant prête au coup d’état à museler le bec à l’artisan qui baratte sa moisson de mots jusqu’à ce qu’il en sorte un clairet buvable. Ce n’est pas simple de dire ce qui n’est pas encore perçu. Ce qui n’est qu’ébauche du monde, petite voix fluette dans tout ce foutoir. Alors quand on tend le micro à l’auteur croyez-moi il le prend et il y va de sa fiente de neurones… Et vas-y du réchauffement de la banquise, du match de foot, de la politique des banlieues. Il finit même ministre l’auteur quand il marche dans la combine. Il n’a qu’à dire Amen. On a besoin de ses lumières en haut lieu. Il accourt l’homme. Il est pas regardant du tout. Oh non, la soupe est bonne alors pourquoi s’en priver.
ET UN PETIT DESSIN DE L'AMI GABS, UN!!!!!

07:25 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (0)


