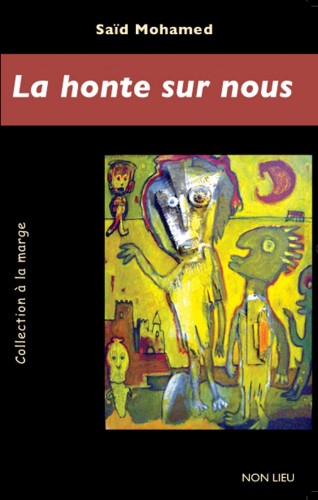04/10/2012
L'éponge des mots
A paraitre à la fin du mois d'octobre aux éditions les carnets du dessert de lune...
C'est en belgique, à Bruxelles... Et pour inventer un nom pareil pour une maison d'éditions, qui d'autre qu'un habitant de la belgique, pays ô combien surréaliste, pouvait le faire... La couverture est le fruit d'une rencontre improbable entre un poisson rouge et une pomme dans un aquarium... La rencontre s'est faite entre l'objectif (Canon powershot) de Bénédicte Mercier et cette image insolite dans un restaurant sur le front de mer à Pondichéry en 2003...
09:01 | Lien permanent | Commentaires (0)
07/07/2012
Un gars du poitou... Michel Boutet.
Un jour il faudra que je vous raconte comment j'ai connu cet individu... Il y a fort longtemps de cela...
C'était en 1971, c'est dire... J'étais encore mioche et lui chantait déjà. Pas comme maintenant. Pas aussi bien. Le bon vin avec le temps ça gagne, c'est bien connu. Je tortillais déjà des vers sur le papier. ça m'a pris jeune aussi ça. Quarante ans que je le connais ce gars là. C'est une paie quand on y pense. Faut pas trop y penser. Il méne son bout de chemin sans casser de guitare sur scène. Il trousse la rime, des fois elle rime à rien aussi, ça arrive, sa rime.
Donc si vous savez pas quoi faire un de ces soirs et qu'il passe pas loin de chez vous allez donc le voir puis l'écouter. Dites lui que c'est moi qui vous a envoyé... ça lui plaira.
Il est comme tous ceux que je recommande, un bon gars. Et pas comme on dit un "bénet" pour parler poli. Non un bon gars, comme on dit du bon pain... Un bon gars au fond et dessus aussi.
Le vernis il n'est pas là forcément où l'on croit qu'il est, et la croûte non plus elle est pas là où elle devrait être.
Dans le bon pain tout a été fait à la main, des fois il est un peu trop cuit dans le grand four en briques. Mais ça fait rien s'il est pas comme de la baguette du dimanche, lui quand on le mange, ce pain-là, il tient au corps. Parce que le boulanger y a mis tout son savoir faire.
En attendant mettez vous ça dans les oreilles, c'est ma préférée, comme dirait Léo... Un vrai petit chef d'oeuvre, simple, pas un mot de trop, de la musique bien rythmée qui mène sur son dos la chansonette qui trotte longtemps après dans la tête... C'st la petite musique des mots
Pour en connaître un peu plus sur le bonhomme: http://michel-boutet.com/
13:48 | Lien permanent | Commentaires (0)
21/05/2012
On the road.....
Kerouac au bout du rouleau
par Michel BITZER
Alors que l’adaptation du roman culte de Jack Kerouac sort le 23 mai sur les écrans, le Musée des lettres et manuscrits présente le rouleau original sur lequel le chef de file de la Beat generation écrivit Sur la route en 1951.
J’ai rencontré Neal pour la première fois peu après la mort de mon père… » Suivent 125 000 mots dactylographiés d’un seul jet sur une machine à écrire Underwood, du 2 au 22 avril 1951. Aucun retour à la ligne. Un seul et unique paragraphe sur un rouleau long de 36 mètres et façonné à l’aide de papier à dessin appartenant à son ami Bill Cannastra, décédé tragiquement quelques mois plus tôt. The scroll. L’original de Sur la route de Jack Kerouac, tel qu’il a resurgi au début des années 2000 avant d’être adjugé pour 2,2 millions de dollars à Jim Irsay, amateur de rock et propriétaire de l’équipe de football américain des Colts d’Indianapolis.
« Il manque la fin, environ trois mètres qui furent mâchonnés par Potchky, le chien de Lucien Carr qui était un de ses copains. Kerouac l’a réécrite par la suite », explique Estelle Gaudry, devant le si précieux rouleau qui trône dans une vitrine longue de 9 mètres. La pièce maîtresse de l’exposition Sur la route de Jack Kerouac, l’épopée de l’écrit à l’écran, qui accompagne la sortie dans les salles obscures (lire ci-contre) de l’adaptation du roman culte du chef de file de la Beat generation.
« MK2, qui produit le film de Walter Salles, était à la recherche d’un lieu pour exposer ce tapuscrit pas comme les autres. Le Musée des lettres et manuscrits a finalement été choisi et nous en sommes évidemment ravis », jubile la commissaire de l’exposition, en posant un regard attendri sur le fameux rouleau. « Nous avons voulu parler de l’homme, de sa culture, et de l’importance que la poésie américaine et la littérature européenne ont exercée sur lui. » William Blake, Mark Twain, Jack London, Henry David Thoreau, mais aussi Rimbaud, Genet, Céline, Proust, Balzac, Tolstoï, ou Dostoïevski, que Jack Kerouac – il descendait d’une famille canadienne française dont les ancêtres bretons avaient traversé l’océan l’Atlantique au XVIII e siècle –, dévora durant sa jeunesse.
Né à Lowell (Massachusetts) en 1922, il aurait pu connaître un destin à l’américaine, après avoir été admis à la prestigieuse université de Columbia grâce au talent qu’il manifestait sur les terrains de football américain. Mais une vilaine fracture du tibia ruinera ses espoirs. En attendant, Kerouac fréquente les clubs de jazz new-yorkais où se produisent Count Basie, Charlie Parker ou Dizzy Gillespie. Il s’engage ensuite dans la marine (marchande puis de guerre) le temps de quelques contrats. Puis il croise le chemin de William Burroughs, Allen Ginsberg et surtout Neal Cassady, un beau gosse qui adore sillonner les Etats-Unis à bord de voitures rutilantes. L’appel de la route ne va guère tarder.
En juillet 1947, Jack Kerouac quitte Lowell pour Chicago, puis Des Moines, Denver, San Francisco et Los Angeles, avant de revenir à New York à l’automne. Les mois suivants, il multiplie les virées frénétiques sur la côte Est avec Neal Cassady, avant d’effectuer deux nouvelles traversées du pays en 1949 et une expédition au Mexique en 1950. Durant ces voyages, Kerouac noircit de notes des dizaines de petits carnets noirs, où il puisera la matière de Sur la route. Car après la publication de The town and the city en 1950, Kerouac ne pense plus qu’à ce livre.
« J’ai un roman en tête, auquel je n’arrête pas de penser, qui parlerait de deux gars qui font de l’auto-stop jusqu’en Californie à la recherche de quelque chose qu’ils ne trouvent pas vraiment, qui se perdent en chemin et qui retournent d’où ils viennent à la recherche de quelque chose d’autre », écrit-il dans son journal. Au fil des mois, il a déjà esquissé plusieurs versions, mais elles ne le satisfont pas. « Tu sais ce que je vais faire ? Je vais me dégoter un rouleau de papier d’imprimerie, le mettre dans la machine à écrire, et tout écrire aussi vite que je peux, exactement comme ça s’est passé, d’un coup, au diable les constructions bidons – je verrai ça après », confie-t-il à John Clellon Holmes, un de ses proches qui sera le premier à utiliser le terme Beat generation dans son roman Go paru en 1952.
Le 2 avril 1951, Jack Kerouac entame donc son marathon de "prose spontanée". Trois semaines plus tard, il met un point final à « l’énorme roman dostoïevskien » écrit « sous l’emprise du café », pas des shoots de benzédrine dont Kerouac était familier. Mais il lui faudra attendre jusqu’en 1957 la publication de Sur la route chez Viking Press dans une version largement remaniée. Ainsi les identités des personnages ont été brouillées – lui devient Sal Paradise et Neal Cassady Dean Moriarty –, des passages entiers raccourcis, des scènes édulcorées…
Cela n’empêchera pas le succès immédiat de Sur la route, devenu le roman culte d’une génération. « Je pense qu’il parle toujours aux jeunes. Quand vous avez 15 ans, vous lisez Kerouac et vous tracez la route ! Ce livre donne envie de faire son sac à dos et de partir à la découverte de soi », estime Estelle Gaudry. En faisant peut-être un crochet par Lowell où repose Jack Kerouac, mort en 1969 après une vie d’errance ponctuée par l’alcool, la drogue… et une vingtaine d’ouvrages qui constituent la légende de cet ange maudit.
Sur la route de Jack Kerouac,
l’épopée de l’écrit à l’écran :
exposition jusqu’au 19 août
au Musée des lettres et manuscrits, 222, bd Saint-Germain, 75007 Paris.
NDLR: Hey le vieux Charley, t'en pense quoi de tout ça ?

Neal Cassady and friends, outside Charles Plymell's 1403 Gough Street house, San Francisco, where Allen had met Peter 9 years earlier when Robert LaVigne lived there. According to Plymell, the other people in the photo were a "Hollywood filmmaker & cronies who came to Gough St. to visit. That was [Neal's] Plymouth he had driven to NYC and back to see Kerouac. I had to go to Motor Vehicle to license it with him when he got back because it was unregistered." c. Allen Ginsberg Estate.
21:44 | Lien permanent | Commentaires (1)
18/05/2012
Passage des Indes...
Une critique de Mustapha Harzoune sur Passages des Indes
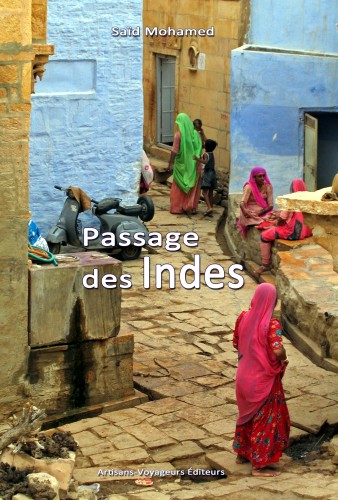
"Alors ne raconte que ce que tu vois, pas ce que tu penses. En Inde, tu penses mal. Tu crois savoir et tu ne sais rien, tu crois deviner et il n’y a rien à comprendre. Il faut accepter les choses telles qu’elles sont". Voilà le conseil d’une certaine sœur Dolorès qui a derrière elle quelques décennies indiennes et la responsabilité d’un orphelinat du côté de Pondichéry. Elle s’adresse au narrateur, fraîchement débarqué dans la péninsule et qui s’est toqué de tout noter de son séjour.
L’Inde offre, ad libitum, de quoi titiller les babas, les bobos, les dévots et les cagots. Entre le sous-continent indien et l’Europe, c’est le grand écart culturel, de quoi se provoquer quelques élongations à l’encéphale et ruptures de jugeote. Le grand écart ou plutôt les grands "écarts" des cultures pour emprunter au sinologue François Jullien. Il s’agit alors de décentrer le regard, de se mieux connaître à travers la culture (et les mots) de l’autre, de mesurer les singularités ou les manques de chacun. L’Inde façon Saïd Mohamed c’est plutôt la version Jullien que l’exotisme consumériste, capable de tout attraper et de ne rien retenir. En goguette de l’autre côté de la planète, Saïd Mohamed se montre disponible à l’autre, mais sans compromissions. Il écoute, échange, s’imprègne même sans pour autant disparaître et se renier. Les transformations adviennent sur l’existant, "au gré" (encore Jullien), ou presque, car le premier choc est rude.
Qu’il évoque les grands thèmes (la mort, la souffrance, le sacré, le temps…) ou la banalité du quotidien, il le fait sans enjoliver, sans rajouter une dose de mystère ou de mysticisme, brut de décoffrage. Pour le coup, le parpaillot est bien au diapason de la dévote Dolorès.
Le bonhomme est coutumier du fait. Depuis 1997, il a écrit pas moins de cinq romans où à travers son parcours il raconte l’histoire de ses contemporains. De l’autofiction "extravertie" pour reprendre le terme de l’universitaire américaine Laura Reeck. Autrement dit, il n’écrit pas pour se gratter le nombril mais pour dire ce qu’il en est de notre monde - et sans salamalecs ! C’est tout son charme et son talent. Encore faut-il aimer le vitriol…
Alors, quand à l’occasion d’une mutation professionnelle, il pose ses valises du côté de Pondichéry, c’est sûr ! son regard verra et sa plume dira des choses différentes de ce que l’on peut trouver dans bien des guides ou des récits pour touriste goguenard et attrape-tout. Lui, au moins, vous sort des sentiers battus, des tralalas, des visites obligées et des scènes convenues.
L’Inde ça commence mal ! Dès la sortie de l’aéroport, le narrateur s’étonne de voir "des quidams accroupis" et "rachitiques" qui "répandent le contenu de leurs entrailles" à même les trottoirs pour le bonheur "de petits cochons noirs" qui "finiront à leur tour dans l’estomac des chrétiens autochtones". Les corbeaux envahissant sont nourris par les croyants hindous qui voient en eux des "augures de bonnes nouvelles" : "Croire que cette valetaille aux manières et à la défroque de loubard annonce la bonne nouvelle, prouve la crédulité des humains". Sans appel.
Et le nouveau venu de déplorer la fringale insatiable des moustiques, les dangers de l’eau et la saleté qui suinte de partout, les rues bruyantes et grouillantes, transformées en ménagerie pour vaches, cochons, poules, canards, coqs, buffles, pigeons, singes, les remugles de sueurs, de déjections humaines et animales, le parfum des curry omniprésent… Mais au moins avec ce voyageur-narrateur on croise des familles d’intouchables, on côtoie mendiants et lépreux, on passe un moment dans une salle de cinéma, film Bollywood garanti : romantisme dégoulinant et sensualité bien trop suggestive à l’écran pour une jeunesse à la libido bridée. On se retrouve au cœur d’un mariage où le Blanc fait figure de porte-bonheur. Au marché aux poissons, les femmes vendent leur camelote à même le sol. L’orphelinat de sœur Dolorès ne manque ni de surprises ni d’enseignements. Ajoutez un petit tour aux urgences ou dans un commissariat… Tout cela ne manque pas de surprendre ou d’étonner comme ces scènes rapportées dans les gares, les trains ou les bus qui "non contents de rouler à tombeaux grands ouverts sur des chaussées défoncées, se tirent la bourre".
Monsieur Mohamed, citoyen français, découvre l’exil, "ressentant ce que peut ressentir un étranger dont la civilisation d’origine est à l’opposé de celle dans laquelle il se trouve parachuté. (…) Plus rien n’a de sens". "Tout le vernis s’effrite, tombe. Rien ne résiste à ce maelström". "La raison, le cartésianisme, il est urgent d’en faire un paquet juste bon pour la déchetterie. Ça, c’était l’autre civilisation, cela n’a plus cours en ces lieux." Les expatriés eux font de la résistance. Déjà égratignés du côté de Shanghai par Stéphane Fière (Double bonheur, Métaillé 2011) ici, ils sont ramenés à leur centre d’intérêt quasi exclusif : "le niveau des revenus détermine le statut, selon le cas vous êtes expatrié ou émigré".
Il faut de la persévérance et de la disponibilité pour "inventer de nouveaux repères", se rendre compte qu’"ici tout est possible". Que "ça fonctionne malgré le foutoir." Mais il faut du temps pour cela et éviter le "syndrome indien", ne pas "être trop confiant", "éviter de baisser la garde". "Ici, on est simplement différent. On vous regarde comme un être différent." Même la peur peut s’apprivoiser et devenir "un jeu qui fait la différence entre ce pays où le danger n’a pas été banni de l’existence et le quotidien lissé de l’Europe où les êtres vivent avec la peur vissée au fondement. La peur du lendemain, la peur du chef, la peur de leur ombre, la peur de la vie. Ils tremblent sur la mise en scène de la peur en fond d’écran cathodique où beuglent les sirènes affolées de la police, des ambulances, des pompiers. (…) Ici, on sait qu’on vit chichement, alors on crève humblement."
Ce Passage par les Indes, "c’est un déplacement de soi vers soi, un glissement, un élargissement des valeurs, comme si l’on ouvrait une nouvelle paire d’yeux restés clos jusqu’alors." Comme dit Mohamed Dib : "L’exil nous fait moins étranger au monde". Et à soi.
Mustapha Harzoune
Saïd Mohamed, Passage des Indes, Artisans-Voyageurs Éditeurs, 2012, 132 pages, 14 €
20:37 | Lien permanent | Commentaires (0)
17/05/2012
à vous de voir....
10:18 | Lien permanent | Commentaires (0)
07/05/2012
Vous avez dit picaresque...
picaresque
adjectif
(espagnol picaresco, de pícaro, vaurien)
Cet article fait partie du DOSSIER consacré aux genres et registres littéraires. Se dit d'œuvres littéraires dont le héros traverse toute une série d'aventures qui sont pour lui l'occasion de contester l'ordre social établi. (Née en Espagne au milieu du XVIe s., la littérature picaresque, qui s'inscrit en réaction contre les pastorales et les raffinements du gongorisme, alors en vogue – à l'époque de l'empire des Habsbourg – est la satire et comme la réplique cynique et désinvolte du roman de chevalerie.)
Se dit d'œuvres littéraires dont le héros traverse toute une série d'aventures qui sont pour lui l'occasion de contester l'ordre social établi. (Née en Espagne au milieu du XVIe s., la littérature picaresque, qui s'inscrit en réaction contre les pastorales et les raffinements du gongorisme, alors en vogue – à l'époque de l'empire des Habsbourg – est la satire et comme la réplique cynique et désinvolte du roman de chevalerie.)
Définition
Dans le seul domaine espagnol, les romans picaresques présentent quelques caractères communs : autobiographie (souvent fictive) d'un personnage d'origine humble – le pícaro – que ses aventures et ses métiers successifs entraînent à se frotter aux diverses classes sociales.
Le pícaro est un « antihéros », un vagabond sans illusions et sans scrupules, un marginal qui, poussé par la faim, cherche à se faire une place dans la société et emploie tous les moyens pour subsister (ruse, fourberie, vol). Le genre picaresque se signale par l'absence de sentiments élevés, en particulier l'amour, une narration teintée d'humour et de dérision, mais aussi une certaine complaisance dans la scatologie. Il a donné plusieurs chefs-d'œuvre en Espagne et, jusqu'au XVIIIe s., dans toute l'Europe.
Petite histoire du roman picaresque
Une expression populaire
La première manifestation picaresque est le Lazarillo de Tormes (1553) [les Aventures de Lazarillo de Tormes], œuvre anonyme attribuée à tort à Hurtado de Mendoza et qui exprime remarquablement l'esprit populaire castillan. Création originale, l'œuvre donne au genre sa physionomie propre : récit autobiographique doublé d'une satire impitoyable des diverses conditions sociales. Certains lui ont trouvé des antécédents et se sont plu à citer le Livre du bon amour (1343), de Juan Ruiz (vers 1285-1350), le Romancero et le roman dialogué de la Célestine, de Fernando de Rojas. Cependant, le genre échappe à toute tradition littéraire : il exprime spontanément le désarroi d'une société déjà en proie à la décomposition et où l'homme réel, harcelé par la misère et indifférent aux prouesses, aux extases, à l'amour idéal, fait entendre le cri brutal de sa mauvaise fortune.
Ainsi la matière du roman picaresque est-elle fournie par un perpétuel vagabondage du héros aux prises avec d'inlassables péripéties, condamné à lutter au jour le jour et contraint de subsister en passant de maître en maître. Ici l'ingéniosité de l'invention suscite d'impressionnants tableaux.
L'épanouissement du genre en Espagne
Le genre connaît son plein épanouissement au début du XVIIe s. avec le Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán (1547-1614), dont la publication connaît une vogue immense et qui mêle au récit de savoureuses digressions (réflexions morales, fables en prose, anecdotes et contes) dans l'esprit de la Contre-Réforme. Construit suivant une succession d'épisodes quasi indépendants, le roman picaresque se fractionne en fonction du parcours géographique, du passage par différents maîtres ou maris, du jeu des récits insérés.
Le genre est également brillamment illustré par le Buscón (1626) de Francisco de Quevedo, chef-d'œuvre dans la plus pure tradition du genre. Grâce à une puissance singulière dans le maniement de la satire et dans la déformation caricaturale, l'auteur dénonce une société qui a atteint les points extrêmes de la décadence morale. Sa langue dynamique, étonnamment vigoureuse, transpose le réalisme picaresque sur le plan de la plus authentique création. En dépit du macabre, de l'étrange, du grotesque, du baroque, Quevedo parvient à retrouver un sens rare de l'humain.
L'appellation « picaresque » caractérise un genre aux multiples variations. En effet, le bref Lazarillo de Tormes est bien différent du long Guzmán de Alfarache. La Pícara Justina de Francisco López de Úbeda (qui, le premier, met en scène une pícara) n'a que peu à voir avec le Buscón, suite de tableaux féroces sans lien solide. Vicente Espinel publie la Vie de l'écuyer Marcos de Obregón. (1618). L'auteur renonce à la simple représentation de la réalité dans sa vision pratique et utilitaire ; il cède au plaisir de raconter les aventureuses histoires de son héros. La Fouine de Séville d'Alonso de Castillo Solórzano a pour héroïne une femme qui ne recule devant rien pour faire son chemin. Quant au Marcos de Obregon de Vicente Espinel (1618), le héros en est un personnage de condition plus relevée, et raisonneur, qui narre des anecdotes auxquelles il n'est pas toujours mêlé lui-même. Chacune de ces œuvres exprime l'idéologie de son temps. Le genre est également représenté avec les œuvres de Salas Barbadillo (la Narquoise Justine, le Coureur de nuit), de Francisco Santos et surtout de Vélez de Guevara, dont le Diable boiteuxinspira Lesage. La Vie d'Estebanille González est considérée comme la dernière en date des œuvres du genre.
Le picaresque hors des frontières espagnoles
Le roman picaresque s'étend hors du domaine espagnol et enregistre les mutations historiques, économiques et socioculturelles essentielles (Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, Simplicius Simplicissimus ; Lesage, le Gil Blas de Santillane). Il peut aussi être utilisé à des fins philosophiques (Diderot, Jacques le Fataliste et son maître) ou idéologiques (Marivaux, le Paysan parvenu, 1735 ; Henry Fielding, Histoire de Tom Jones, enfant trouvé). De nombreux autres romanciers français ont subi l'influence du roman picaresque espagnol, notamment Charles Sorel (Francion) et Paul Scarron (le Roman comique).
Par le caractère extrême de son réalisme, le picaresque anglais prend pour objet l'évocation des bas-fonds (déjà illustrée par Thomas Nashe dans le Voyageur malchanceux) et est particulièrement adapté à la notation du manichéisme moral (Tobias George Smollett, les Aventures de Roderick Random, 1748).
Au XXe s., Louis-Ferdinand Céline, dont toute l'œuvre est marquée par les personnages « picaresques » ainsi que par le jaillissement narratif et l'œuvre au registre torrentiel de Günter Grass, le Tambour, présentent les mêmes caractères que le roman picaresque espagnol.
18:58 | Lien permanent | Commentaires (0)
03/05/2012
Les caractéristiques du genre picaresque
A une époque où les oeuvres de fiction sont peuplées de personnages fantastiques ou héroïques (roman byzantin, roman de chevalerie, roman mauresque,...), le Lazarillo de Tormes, publié en 1554, prend le contre-pied des productions narratives de son temps, donnant naissance à un genre nouveau. Un narrateur, qui est à la fois protagoniste de l'histoire qu'il raconte, s'attache à décrire "sus fortunas y adversidades". Sa narration est émaillée de thèmes récurrents qui constitueront le noyau dur du roman picaresque: la faim, la représentation de certains types sociaux (le noble, le curé, etc.) ou la transgression des valeurs sociales de l'époque. Quarante-cinq ans séparent le Lazarillo de Tormes (1554) duGuzmán de Alfarache (1599), "ouvrage de fondation", comme l'a qualifié M. Molho, qui pose les caractéristiques essentielles du genre picaresque.
Le roman picaresque est, en premier lieu, le récit d'un anti-héros. Le pícaro est un gueux de basse extraction sociale, né de parents ouvertement marginaux ou délinquants. Son but est de changer de condition, de s'élever dans l'échelle sociale; à cette fin, il n'hésite pas à recourir aux subterfuges les plus astucieux, à la fraude et à la tromperie pour tenter d'échapper à la faim, ou à tout le moins, à la pauvreté. Il vit de menus expédients et se consacre à toutes sortes d'activités marginales, toujours liées à l'argent. Tour à tour mendiant, portefaix, valet, voleur, voire dans le meilleur des cas, financier, c'est-à-dire escroc pour les esprits de l'époque, il incarne le rejet des valeurs sociales. Dans une société où le profit est synonyme d'usure et le négoce d'activité douteuse, le pícaro reflète une mentalité hostile au mercantilisme. Au déshonneur de ses origines s'ajoute l'ignominie du personnage, prêt à tous les subterfuges pour trouver sa quotidienne pitance.
Reprenant le modèle épistolaire, le roman picaresque se présente, par ailleurs, comme un récit autobiographique dont la lecture est dictée par les événements. Lazare écrit pour rendre compte d'une sombre affaire qui l'occupe ("el caso"), celle des liaisons amoureuses de son épouse avec leur protecteur, l'archiprêtre de San Salvador, qui les a mariés. Guzmán, quant à lui, revient sur son existence du fond des galères où l'ont conduit sa vie dissolue et ses méfaits. Raconté à la première personne, le récit picaresque s'ouvre invariablement sur le récit des origines, où le gueux prend soin de décliner sa généalogie. Sa naissance et son enfance sont aux antipodes de celles du chevalier ou du héros (le personnage est fils de manant, de prostituée, de voleur, de nouveau-chrétien, etc.) et son récit égrène et revient sur les événements les plus significatifs de sa vie. À la fois narrateur et protagoniste, le pícaro raconte son passé depuis un présent d'où il écrit pour se justifier ou amener le lecteur à juger son existence. Le moule épistolaire qui régit l'architecture du roman picaresque s'inspire des lettres de confession, écrites par les religieux, et des autobiographies de personnages illustres et de soldats, désireux de laisser un témoignage de leurs aventures à la postérité. À la croisée de l'aveu, du récit de contrition et du récit exemplaire, le récit du pícaro, sous ses dehors facétieux, demeure empreint d'une forte teneur moralisante.
Le caractère moralisateur, en effet, est indissociable du genre picaresque. À l'instar des livres de contes médiévaux et des sermons où l'exemplum illustre un comportement censurable, le roman picaresque apparaît comme une succession d'épisodes qui conduisent le gueux vers la déchéance. Dès le prologue, Lazare de Tormes fustige les valeurs sociales de son temps: pour lui, l'honneur qui incite l'homme à se dépasser n'est que vaine gloire, au même titre que l'aumône sans la charité ou le sacerdoce sans la vertu. Opportuniste et dénué de scrupules, Lazare entend ne pas sacrifier sa condition et sa situation chèrement acquises, même si cela doit l'obliger à fermer les yeux sur l'inconstance de son épouse. Dans le Guzmán, le propos moralisateur se fait beaucoup plus explicite, à travers les nombreuses digressions morales et religieuses qui ponctuent le récit. En se remémorant son existence, le narrateur, condamné aux galères, découvre, au même titre que Lazare, que la morale de l'honneur n'est qu'un paravent, un masque sous lequel on peut voler ou mentir. Plus que ses origines infâmes, c'est le libre-arbitre qui fait du pícaro l'acteur de sa propre déchéance, en créant une tension entre le déterminisme et la liberté de l'individu. Le récit prend ainsi des allures de théologie, de parabole du cheminement de l'homme, soumis à la liberté de choisir la voie du bien ou du mal. Le roman picaresque devient l'illustration d'un comportement aberrant au regard des règles et des normes de la société. L'aspiration du pícaro à se hisser dans l'échelle sociale est toujours couronnée par un échec retentissant, ce qui l'oblige à aller tenter sa chance ailleurs, donnant ainsi au livre un caractère itinérant et ouvert. C'est le constat d'échec qui pousse Pablos, le héros duBuscón de Quevedo, à quitter l'Espagne pour les Indes, tout en sachant que sa tentative est d'avance vouée à l'échec, car, comme il est dit dans le dernier chapitre, «jamais ne s'améliore le sort de celui qui change uniquement de lieu et non pas de vie et d'habitudes».
Le livre est, enfin, une satire de la société. L'oeuvre se distingue, en général, de la production écrite au XVIe siècle par le souci de rendre compte des aspects les plus sordides du monde, sur le mode comique et burlesque. Il ne s'agit pas de dénoncer la vie sociale mais d'esthétiser cette réalité afin qu'elle serve de cadre à une satire féroce de la société. Le subjectivisme radical d'un narrateur-personnage qui revient sur ses tribulations rend le roman vraisemblable. Tout au long du récit, la focalisation et le point de vue constants contribuent, en large part, à donner toute sa cohérence à l'oeuvre, malgré les divers emprunts au folklore.
Sur le plan diégétique, l'évocation du monde des bas-fonds, certes esthétisé, constitue le point d'ancrage pour le développement du roman. S'agit-il, toutefois, d'une critique de cette même réalité? Plus qu'une volonté de changer un état de chose, il faut voir derrière les piques mordantes envers les principaux états de la société et derrière ces flèches anticléricales, les traces d'un esprit populaire, viscéralement frondeur et ironique, davantage redevable au burlesque qu'à la critique de la réalité sociale du temps. En se mettant au service des différents représentants de la société de l'époque, le gueux porte un regard sans complaisance sur ses maîtres, issus des principaux ordres de la société d'Ancien Régime. Aussi les corps sociaux sont-ils satirisés dans leurs diverses composantes.
En revenant constamment sur la problématique de l'honneur et de son rapport à l'argent, le roman touche aux « tourments intimes de certaines couches de privilégiés » (M. Bataillon). Témoin privilégié de la comédie sociale, le misérable gueux découvre combien ses maîtres donnent l'exemple de ce qu'ils ne sont guère et assiste, du fond de sa misère, au triomphe de l'hypocrisie et du mensonge, parés des oripeaux de la vertu.
00:04 | Lien permanent | Commentaires (0)
29/04/2012
Bientôt sur les étals...
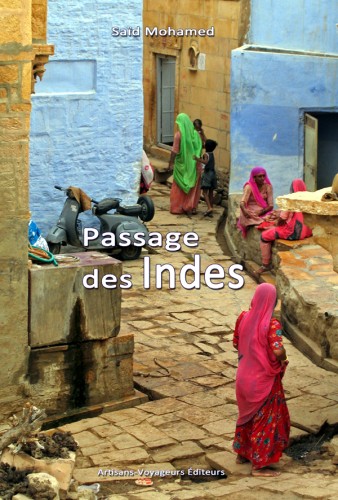
22:18 | Lien permanent | Commentaires (0)
20/04/2012
La mémoire et la mer....
09:56 | Lien permanent | Commentaires (0)
31/03/2012
Soularue, en haut du pavé...

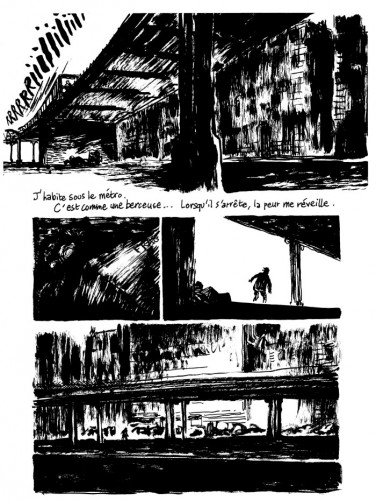
Quoiqu’en ai pu dire les grands-pères d’aujourd’hui, sous la rue il n’y a pas et n’a jamais eu la plage.
Soularue..... c’est son nom...
Et avec un nom pareil on est déjà plus proche du caniveau en haut du pavé donc. CQFD.
Son trait est noir, parce que, Soularue c’est noir, noir et noir. Son trait vous file la chair de poule. D’ailleurs, est-ce un trait ce coup de pinceau qui se vautre sur le papier. Cela fait un paquet d’années que le soleil et tout le fatras des clichés du vainqueur ont quitté la surface de sa feuille. Avec un peu d’imagination, on devine même qu’il ne les a jamais dessiné. Ses paysages sont des bretelles d’autoroute des cheminés qui fument, des banlieues qui suintent la misère, le No Futur, la mort lente, le smicard à perpétuité et les mômes born to loose ou Toulouse, allez savoir.
Le sien de héros s’appelle Moïse -un nom aussi à coucher dehors avec un billet de logement-, abandonné dans un carton sous une bretelle d’autoroute est ramassé par des manouches - ça commence comme une histoire connue - lesquels s’empressent de refiler le lardon à un couple de bolcho stalino dépressif… Que du reluisant … le daron s’évertue à l’appeler Maurice en hommage à Thorez. Décidément le quiproquo est de taille. Et ce Moïse là n’a d’autre issue pour échapper à son destin que de ne pas y échapper. Paria instruit, sa révolte le conduira vers un fasciste musulman.
Dans cet univers là, l’amour possible avec cette môme de banlieue sans papiers qui se promène entre voies de chemin de fer et lignes à haute tension ne peut mener à rien. Sauf à un camp de rétention et une reconduite à la frontière qui fait basculer Moïse dans un futur de terroriste potentiel, avec un aller simple pour l’Afgahnistan…

Il reste maintenant à Soularue à écrire la suite de l’histoire de Moïse…
Le gamin paumé va se retrouver à Peshawar vendu par les pachtounes et sera ensuite transféré à Guantanamo où sous les tortures sexuelles il avouera l’assassinat de Kennedy et celui de Marylin…
On l’attend au coin de la rue, Stéphane, pour qu’il nous refile encore des sueurs noires… ( titre de son précédent album)
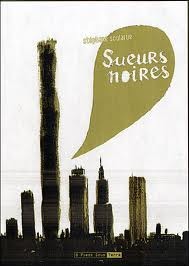
L'histoire récente vient probablement d'écrire la suite de Moïse et voler un bon scénario à Soularue... Car décidément la réalité a plus d'imagination que la plus noire de toutes les imaginations et Soularue avec son trait noir de noir en a pourtant un paquet d'imaginations...
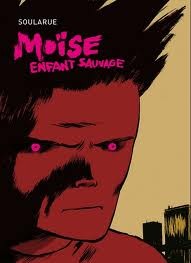
14:01 | Lien permanent | Commentaires (0)
27/03/2012
Patrick Auzier, l'homme du feu.
Au pays du rêve de Patrick Auzier...

Il me reste des bribes de ces fêtes très étranges auxquelles j’ai assisté. Les musiciens qui soufflaient dans des saxophones portaient des masques de carnaval et des perruques dorées dont les boucles se répandaient sur les épaules, alors que d'autres étaient affublés de chignons et de loups de satin noir. Certains, torses nus et le visage bariolé de peintures zoulous frappaient des tambours. La procession était suivie par une foule en transe qui dansait et chantait. Cela sentait la poudre noire, la transpiration et le rut. Les corps étaient prêts au coït et l'âme à l'ivresse. Comme dans une fête primitive, la foule scandait un hymne festif autant qu'une prière païenne. La procession s'enfonçait dans les bois pour rendre hommage aux esprits de la terre. Des humanoïdes, mi-chair, mi-éponge qui avaient commencé à prendre la couleur de l'écorce et du lichen étaient accrochés aux arbres. Comme si ces types arrivaient d'une autre planète et avaient échappé à une giclée de neutrons en pleine poire en se cachant au fond d'une galerie désaffectée. Après y être restés des générations entières sans avoir jamais vu le jour, ils auraient, lors de leur première sortie, tenté d'escalader les arbres et se seraient brûlés à la lumière. Tétanisés, statufiés par la photosynthèse qui se serait déclenché à cause des mutations des corps déshabitués à la lumière. Ces corps semblaient avoir stoppé leur évolution à mi chemin entre le chou-fleur et le rosbif.
La sarabande, qui s'avançait dans le sentier, s'est arrêtée aux pieds de grands chênes. Une troupe de percussionnistes avait confectionné des trampolines avec des chambres à air de camions et de voitures. Attachés à des élastiques, tendus depuis le faîte de l'arbre, les acrobates sautaient le long d'un xylophone géant en tubes de bambou qui partait depuis le sol rejoignait les premières branches d'un chêne séculaire. Enfermés dans des cages de bambou, en haut des arbres, des violonistes jouaient une symphonie. Dissimulés dans les fougères, des feux de Bengale illuminaient cette fête. Des officiants aux déguisement de forbans portaient des flambeaux et des fusées rouges et jetaient des ribambelles de pétards au milieu de la foule qui se déhanchait sur un hymne endiablé. Combien de jours et de nuits a duré cette étrange fête? Je n’en sais rien.
Mais j’ai souvenir qu’une autre nuit la fête a eu lieu dans un château désaffecté. Au milieu d’un énorme nuage de fumée, dans la grande cour entourée de murailles, les explosions retentissaient. Les traînées versicolores des fusées retombaient en mèches folles, sifflaient dans tous les sens, assourdissantes. Secouaient la terre, remuaient le ciel et faisaient tout trembler. Observant la trajectoire aux départs des missiles, les musiciens de jazz étaient prêts à se jeter à terre, ou à s'abriter derrière leur pupitre en cas de besoin. Des bouts de carton enflammés retombaient à l'intérieur de l'enceinte ce qui provoquait des cris, des mouvements de foule. On n'y voyait pas à trois mètres, aussi, c'est la tête levée au ciel que chacun guettait les retombées enflammées. Les explosions redoublaient et le rythme ne mollissait pas. Les filles dansaient et suaient dans cette nuit moite et électrique.
Une autre nuit encore, l'embrasement a eu lieu sur un plan d'eau. Les musiciens avaient pris place dans des barques, et des violonistes ainsi qu’un saxophoniste jouaient doucement, un air très mélancolique sur le rythme de la cascade, dans le sous-bois illuminé par des feux de Bengale, dissimulés parmi les fougères. Les silhouettes énigmatiques étendaient leurs ombres sur l'eau dont le reflet s'étirait en ondoyant. A la surface du lac comme des sortes de génies malfaisants, des fusées hors bords sifflant et pétaradant couraient en tous sens.
Francis Marmande, Le Monde, 21 août 1999
La Compagnie Lubat se signale par son rapport aux mots, aux poètes, au rap, à la langue, au scat, à la tchatche, à l’invention syllabique. Au milieu, Auzier est le silence essentiel. Il s’est révélé comme l’homme du feu. Commençant par des installations pyrotechniques de facture classique, puis compliquant.
Au début, on a cru de ses feux qu’ils étaient une fantaisie de la Compagnie, une drôlerie pimentée de dérision, le détournement d’une réjouissance populaire. Et puis il a fallu se rendre à l’évidence. Les feux d’Auzier de plus en plus ingénieux, donnant un spectacle de plus en plus simple, par le fait, sont la clef de l’invention ; Le lien entre enfance et artistes, musique et rêve. Quand Auzier embrase un château, une forêt, un lac, c’est d’une autre manière. L’autre pyrotechnie. Il a travaillé le
rythme, le tempo, les commandes électriques, les emplacements inédits, les déclenchements inattendus, les fils qui courent sur la foule avec les vecteurs de comète, les bouquets de flammes que l’on contemple au-dessous, les synchronies instrumentales…
Dans la forêt, sa Nuit des Soli-Sauvages donne lieu à une création saisissante. Portal et Shepp bien ensemble, dans les fontaines blanches. Des murs, des gerbes et des fusées qui jaillissent du fond de l’eau du lac. Comme un symbole de la Compagnie, Auzier n’a cessé de perfectionner l’art qu’il a inventé. Chemin faisant, en vingt-deux ans d’apprentissage autodidacte, il fabrique ses pièces et s’est donné une technique au trombone : vingt-deux ans d’études en public, dont onze pour trouver l’embouchure.
Après quoi il conclut trois heures de Soli-Sauvages et d’invention pyrotechnique, seul devant un Niagara de flammes, commande les gerbes par le son, au trombone incroyablement maîtrisé, puis dans un coin, fond en larmes. « Prendre toujours les mêmes », comme regrettent les notables avant d’en reprendre un, c’est la forme pyrotechnique de la fidélité active.
20:49 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (2)
25/03/2012
La vie d'artiste...
21:06 | Lien permanent | Commentaires (0)
Noël aux tisons, Pâques à New York....
18:15 | Lien permanent | Commentaires (0)
22/03/2012
La prose du Transibérien (à écouter)
Texte dit par Vicky Messica

En ce temps-là, j'étais en mon adolescence
J'avais à peine seize ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance
J'étais à 16.000 lieues du lieu de ma naissance
J'étais à Moscou dans la ville des mille et trois clochers et des sept gares
Et je n'avais pas assez des sept gares et des mille et trois tours
Car mon adolescence était si ardente et si folle
Que mon coeur tour à tour brûlait comme le temple d'Ephèse ou comme la Place Rouge de Moscou quand le soleil se couche.
Et mes yeux éclairaient des voies anciennes.
Et j'étais déjà si mauvais poète
Que je ne savais pas aller jusqu'au bout.
Le Kremlin était comme un immense gâteau tartare croustillé d'or,
Avec les grandes amandes des cathédrales, toutes blanches
Et l'or mielleux des cloches...
Un vieux moine me lisait la légende de Novgorode
J'avais soif
Et je déchiffrais des caractères cunéiformes
Puis, tout à coup, les pigeons du Saint-Esprit s'envolaient sur la place
Et mes mains s'envolaient aussi avec des bruissements d'albatros
Et ceci, c'était les dernières réminiscences
Du dernier jour
Du tout dernier voyage
Et de la mer.
Pourtant, j'étais fort mauvais poète.
Je ne savais pas aller jusqu'au bout.
J'avais faim
Et tous les jours et toutes les femmes dans les cafés et tous les verres
J'aurais voulu les boire et les casser
Et toutes les vitrines et toutes les rues
Et toutes les maisons et toutes les vies
Et toutes les roues des fiacres qui tournaient en tourbillon sur les mauvais pavés
J'aurais voulu les plonger dans une fournaise de glaive
Et j'aurais voulu broyer tous les os
Et arracher toutes les langues
Et liquéfier tous ces grands corps étranges et nus sous les vêtements qui m'affolent...
Je pressentais la venue du grand Christ rouge de la révolution russe...
Et le soleil était une mauvaise plaie
Qui s'ouvrait comme un brasier
En ce temps-là j'étais en mon adolescence
J'avais à peine seize ans et je ne me souvenais déjà plus de ma naissance
J'étais à Moscou où je voulais me nourrir de flammes
Et je n'avais pas assez des tours et des gares que constellaient mes yeux
En Sibérie tonnait le canon, c'était la guerre
La faim le froid la peste et le choléra
Et les eaux limoneuses de l'Amour charriaient des millions de charognes
Dans toutes les gares je voyais partir tous les dernier trains
Personne ne pouvait plus partir car on ne délivrait plus de billets
Et les soldats qui s'en allaient auraient bien voulu rester...
Un vieux moine me chantait la légende de Novgorode. […]
Or, un vendredi matin, ce fut enfin mon tour
On était en décembre
Et je partis moi aussi pour accompagner le voyageur en bijouterie qui se rendait à Kharbine
Nous avions deux coupés dans l'express et 34 coffres de joailleries de Pforzheim
De la camelote allemande "Made in Germany"
Il m'avait habillé de neuf et en montant dans le train j'avais perdu un bouton
- Je m'en souviens, je m'en souviens, j'y ai souvent pensé depuis -
Je couchais sur les coffres et j'étais tout heureux de pouvoir jouer avec le browning nickelé qu'il m'avait aussi donné
J'étais très heureux, insouciant
Je croyais jouer au brigand
Nous avions volé le trésor de Golconde
Et nous allions, grâce au Transsibérien, le cacher de l'autre côté du monde
Je devais le défendre contre les voleurs de l'Oural qui avaient attaqué les saltimbanques de Jules Verne
Contre les khoungouzes, les boxers de la Chine
Et les enragés petits mongols du Grand-Lama
Alibaba et les quarante voleurs
Et les fidèles du terrible Vieux de la montagne
Et surtout contre les plus modernes
Les rats d'hôtels
Et les spécialistes des express internationaux.
Et pourtant, et pourtant
J'étais triste comme un enfant
Les rythmes du train
La "moelle chemin-de-fer" des psychiatres américains
Le bruit des portes des voix des essieux grinçant sur les rails congelés
Le ferlin d'or de mon avenir
Mon browning le piano et les jurons des joueurs de cartes dans le compartiment d'à côté
L'épatante présence de Jeanne
L'homme aux lunettes bleues qui se promenait nerveusement dans le couloir et me regardait en passant
Froissis de femmes
Et le sifflement de la vapeur
Et le bruit éternel des roues en folie dans les ornières du ciel
Les vitres sont givrées
Pas de nature!
Et derrière, les plaines sibériennes le ciel bas et les grands ombres des taciturnes qui montent et qui descendent
Je suis couché dans un plaid
Bariolé
Comme ma vie
Et ma vie ne me tient pas plus chaud que ce châle écossais
Et l'Europe toute entière aperçue au coupe-vent d'un express à toute vapeur
N'est pas plus riche que ma vie
Ma pauvre vie
Ce châle
Effiloché sur des coffres remplis d'or
Avec lesquels je roule
Que je rêve
Que je fume
Et la seule flamme de l'univers
Est une pauvre pensée...
20:58 | Lien permanent | Commentaires (0)
21/03/2012
Koi ki di wiki sur le roman picaresque?
Le roman picaresque (de l'espagnol pícaro, «misérable», «futé») est un genre littéraire né en Espagne au xvie siècle et qui a connu sa plus florissante époque dans ce pays.
Un roman picaresque se compose d'un récit sur le mode autobiographique de l’histoire de héros miséreux, généralement des jeunes gens vivant en marge de la société et à ses dépens. Au cours d’aventures souvent extravagantes supposées plus pittoresques et surtout plus variées que celles des honnêtes gens, qui sont autant de prétextes à présenter des tableaux de la vie vulgaire et des scènes de mœurs, le héros entre en contact avec toutes les couches de la société.

Le roman picaresque se rattache directement à des modèles beaucoup plus anciens. Dans l’Antiquité gréco-latine, le roman avait déjà les mêmes caractères. L’Âne d’or d’Apulée, qui en est l’exemple le plus célèbre, est fait lui aussi d’une extrême variété d’épisodes, souvent reliés entre eux par des liens légers ou arbitraires. Le personnage principal traverse une série d’aventures, qu’aucune existence humaine n’aurait pu connaître dans la réalité ; et il s’y ajoute encore plus d’un récit gratuitement introduit par un personnage épisodique. L’œuvre d’Apulée continuait, elle-même, la tradition des « fables milésiennes », fables qu’elle se contentait parfois de recoudre entre elles de même que les grands poèmes homériques semblent bien avoir recousu entre eux des chants épiques de l’âge antérieur. Ce genre d’œuvres trouvaient leur raison d’être profonde et durable, dans un effort de l’art littéraire pour s’égaler à la diversité de la vie, diversité qu’aucun des autres genres n’était à même d’embrasser.
Le roman picaresque est généralement porté par une vision critique des mœurs de l’époque. Mais les éléments sociaux ou moraux sont bientôt doublés par l’élément esthétique du roman picaresque dont la structure très libre permet à l’auteur d’introduire à chaque instant de nouveaux épisodes, sans les faire sortir de ce qui précède. Ce manque de logique et de nécessité interne dans le développement finit par distinguer le roman picaresque.
À la différence des autres genres littéraires comme la tragédie, la comédie, le discours ou l’histoire qui s’astreignaient tous à des lois précises de développement, de construction, et parfois même n’hésitaient pas à faire violence à la réalité pour la soumettre à l’harmonie de l’art, le roman fonctionnait sans règles. Toute peinture de la société, pour être un peu vaste et foisonnante, devait échapper aux règles habituelles, et trop étroites, de la composition afin de pouvoir représenter l’infinie diversité de la vie et du monde social.
Six caractéristiques constitutives distinguent le roman picaresque :
Le protagoniste est un pícaro de rang social très bas ou qui descend de parents sans honneur ou ouvertement marginaux ou délinquants. Le profil d’antihéros du pícaro constitue un contrepoint à l’idéal chevaleresque. Vivant en marge des codes d’honneur propres aux classes dominantes de la société de son époque, son plus grand bien est sa liberté. Aspirant également à améliorer sa condition sociale, le pícaro a recours à la ruse et à des procédés illégitimes comme la tromperie et l’escroquerie
Structure de fausse autobiographie : le roman picaresque est narré à la première personne comme si le protagoniste racontait ses propres aventures, à commencer par sa généalogie, contrairement à ce qu’est censé faire un chevalier. Le pícaro apparaît dans le roman dans une double perspective : comme auteur et comme acteur. Comme auteur, il se situe dans un temps présent qu’il évalue à l’aune de son passé de protagoniste et il raconte une action dont il connaît le dénouement à l’avance
Déterminisme : bien que le pícaro tente d’améliorer sa condition sociale, il échoue toujours et restera toujours pícaro, c’est pourquoi la structure du roman picaresque est toujours ouverte. Les aventures racontées pourraient se poursuivre indéfiniment car l’histoire n’est pas capable d’évolution susceptible de la transformer.
Idéologie moralisante et pessimiste : chaque roman picaresque en viendrait à être un grand cas exemplaire de conduite aberrante systématiquement punie. Le picaresque est très influencé par la rhétoriquesacrée de l’époque, fondée dans beaucoup de cas, sur la prédicationd’exemples relatant la conduite dévoyée d’un individu qui finit soit par être puni soit par se repentir.
Intention satirique et structure itinérante : la structure itinérante du roman picaresque meut le protagoniste dans chacune des strates de la société. L’entrée du protagoniste au service d’un élément représentatif de chacune de ces couches constitue un nouveau prétexte de critique de celles-ci. Le pícaro assiste ainsi, en spectateur privilégié, à l’hypocrisie incarnée par chacun des puissants nantis qu’il critique à partir de sa condition de déshérité puisqu’il ne s’érige pas en modèle de conduite.
Réalisme, y compris naturalisme dans la description de certains des aspects les moins plaisants de la réalité qui, jamais idéalisée, est au contraire présentée comme une moquerie ou une désillusion.
Le picaresque s’est également exporté en France avec, par exemple, l’Histoire de Gil Blas de Santillane de Lesage qui est, en quelque sorte, le dernier chef-d’œuvre du roman picaresque. Ce genre littéraire a eu une postérité, car il en subsiste des traces jusque dans leBildungsroman allemand comme le Wilhelm Meister de Goethe.
On peut aussi voir l'influence de sa philosophie dans de nombreux westerns, où un homme du peuple, souvent un petit malfrat au grand coeur, se dresse contre l'autorité établie pour redresser des torts.

20:53 | Lien permanent | Commentaires (0)
Bunker Roy
Bunker Roy, un entrepreneur social au service du développement rural.
L’Inde, 2ème pays au monde avec plus d'un milliard d’habitants compte 700 000 villages sur un territoire équivalent à 6 fois la France. La situation économique y est très souvent fragile, la moindre saison sèche ou récolte difficile venant accroître l’exode rural déjà considérable. Comment un de ces villages, peuplé de seulement 800 habitants devient un des modèles de développement durable pour tous les autres pays du Sud ; visité, reconnu et admiré par des personnalités comme le président de la Fondation Ford, le président de la Banque Mondiale ou le Prince de Galles ? C’est pour répondre à cette question que nous avons rencontré Bunker Roy, le fondateur du « Barefoot College » de Tilonia.
Fils d’une des familles les plus influentes du Bengale (la région de Calcutta), Bunker a suivi l'une des meilleures éducations du système indien. Il a usé ses shorts sur les mêmes bancs que Rajiv Gandhi (le fils d’Indira et lui aussi ancien Premier Ministre assassiné) et que les héritiers du plus grand empire industriel du sous-continent : les fils Tata. De cette éducation stricte et élitiste, il garde le souvenir de professeurs « on ne peut plus snob » leur présentant le mirage de l’Inde moderne du XXIe siècle en lieu et place du « Bhârat », l’Inde rurale*.
Programmé pour devenir un grand diplomate, un fin politicien ou un puissant bureaucrate, Bunker suit une scolarité exemplaire. Pendant son temps libre, il se consacre à sa passion, le squash, et remporte même pendant 4 années d’affilée le Championnat National.
Le tournant de sa vie se produit en 1966, lorsque par curiosité, il va visiter un village du Bihâr. Cette année-là, ce petit Etat rural, frontalier du Népal, connaît une des pires famines de son histoire. Faute de mousson, les greniers à céréales sont entièrement vides et l’aide internationale permet difficilement à chaque personne de disposer d’une chapati par jour, une mince galette de farine de blé, base de l’alimentation indienne.
Le choc est terrible pour ce jeune privilégié. Rien dans son parcours personnel ne l’avait préparé à voir cette réalité poignante : des dizaines de milliers de personnes périssent faute de nourriture et ceux qui restent sont condamnés à errer chaque jour à la recherche d’une maigre pitance. C’est décidé, du haut de ses 19 ans, Bunker prend une décision qui va changer sa vie : il veut vivre dans l’Inde rurale et se mettre au service des paysans les plus pauvres.
Sans avoir aucune notion concrète de ce qu’il veut entreprendre et de la manière dont il doit opérer, il décide d’aller vivre dans un des villages du district d’Ajmer, dans le Rajasthan. C’est là, qu’humblement, il passe 5 ans de sa vie. Travaillant comme un forcené, il creuse, nettoie et fait exploser des charges afin de construire des puits. Au contact des villageois de souche, il acquiert la certitude que les connaissances et les compétences pratiques des villageois sont suffisantes pour assurer leur développement.
A 25 ans, un collègue l’invite à passer quelques jours à Tilonia. Cette visite sera le second tournant de son existence. Il remarque un grand sanatorium à l’abandon au beau milieu du village et décide d’engager les démarches pour l’acquérir. Légué par le gouvernement au modeste prix de 1 roupie, il en fera en 3 décennies le centre du « Barefoot College ».
Construit sur des préceptes de Gandhi, celui-ci s’articule autour de 5 grandes idées : la participation de chacun à la vie du village, l’égalité homme-femme, l’éducation pratique et non théorique, la nécessité de ne pas gâcher les ressources et la technologie par et pour ses habitants.
Résultat après presque trente ans d’efforts. Toute l’électricité du village provient de panneaux solaires, 90 écoles de nuits ont été créées pour dispenser un savoir pratique aux enfants qui gardent leurs troupeaux le jour. Un groupe de 300 femmes se réunit chaque semaine pour débattre et influencer leurs conditions de vie et un ingénieux système de récupération de l’eau de pluie alimente irrigation, douches et toilettes de tous les villageois. Dernière trouvaille mais pas des moindre, un parlement des enfants est élu tous les 3 ans pour influencer la vie du village et des écoles !!
Le plus remarquable de ces 30 années de développement est que ce sont les villageois eux-mêmes qui ont eu les idées, les ont financées (partiellement) et les ont appliquées à leur rythme et ceci sans aucune aide extérieure. Bunker ne se considère que comme un support et passe désormais la majeure partie de son temps à promouvoir ce modèle aux quatre coins de l'Inde et, depuis peu, de la Planète.
Persuadé qu'il faut beaucoup plus investir sur les individus que sur les projets pour réaliser un développement durable des villages indiens, il espère convaincre les sceptiques et faire de nombreux adeptes. En voilà 2 de plus !!
* "Bhârat" signifie Inde en Hindi.
Texte extrait du site le tour du monde en 80 hommes
18:06 | Lien permanent | Commentaires (0)
18/01/2012
A votre bon Albert Marcoeur m'sieur-dames....
Il serait tout à fait intéressant de calculer et d’évaluer les mètres-cubes de matière grise que l’on utilise afin de trouver une formule originale pour présenter ses voeux. Tous les ans, c’est pareil. C’est un clin d’oeil à l’actualité (à bas la morosité, bonne année ! Le moral des Français est au plus bas. Après le bas, le haut. Bonne année !), deux ou trois rimes avec l’année qui vient de démarrer (flouze, blues, partouze, niouz, douCe…), un aphorisme encourageant (« Ce n’est pas parce qu’il y a de l’espoir que l’on est joyeux, mais c’est parce que l’on sera joyeux qu’il y aura de l’espoir ! »), une question existentielle (Que ferons-nous germer cette année ?). Et presque toujours, des formulations qui ont nécessité des heures de gamberge. Encore une à l’instant : « Un maximum de bonheur au milieu des serpentins imaginaires et des langues de belle-mère hypothétiques. » Vous imaginez un peu ce qu’on pourrait faire avec toute cette matière grise en mouvement.
J’espère de tout coeur que vous avez fêté cette nouvelle année dans les règles de l’art.
Moi j’ai réveillonné en solitaire à Noël et en équipe au jour de l’an.
Habité par cette manie de ne jamais faire comme tout le monde, j’ai voulu passer le réveillon de Noël tout seul. Réveillonner sans tra-la-la, sans trompette, sans penser une seule seconde que c’est un jour, enfin une nuit, où tout le monde doit être rassemblé pour partager, où personne ne doit être laissé sur le bord du chemin. Oublier toutes ces simagrées et réveillonner dans son coin, loin de tout, loin de rien.
J’avais acheté chez Madame Chargueros, bouchère-charcutière à Venarey-lès-Laumes, une rouelle de porc qu’après avoir fait revenir sur les quatre côtés, je fis cuire avec cinq petites pommes de terre coupées en quatre, trois tomates pelées coupées en deux. Sel, piment d’Espelette et deux feuilles de laurier. En entrée, une tranche de pâté en croûte entourée de lamelles de cornichons sur une assiette à dessert. J’allumai une bougie et fis péter une bouteille de Chablis de Noël Pourantru et José Rodrigues, viticulteurs à Lignorelles (89800). J’avais essayé de repousser le début du repas en prolongeant l’apéritif, le Chablis était succulent et j’avais vidé un demi-sachet de pistaches en un temps record. Lorsque je décidai de mordre dans mon pâté en croûte, l’horloge affichait vingt et une heures trente. J’ouvris une boîte de sardines à l’huile d’olive de la conserverie de La Belle Îloise et épluchai une échalote que je coupai en fines particules. Je raclai cinq torsades de beurre salé avec un couteau sans dents. Le tout écrasé avec une fourchette dans une jatte, le plus mélangé et unicolorisé que je pus. Je fis griller du pain, y étalai mon beurre de sardines et me versai un verre de Chablis. Le moment fut délicieux et je le retins par tous les moyens.
Je découpai ma longe de porc encore toute fumante avec toute la précaution du monde pour ne pas éclabousser et en foutre partout, mais aussi afin d’éviter l’accident qui eût entaché la cérémonie. Vingt deux heures trente, j’avais presque rattrapé mon avance. J’aperçus au-dessus du halo de la bougie ma mère fourrant ses dattes avec de la pâte d’amandes et mon père préparant sa farce à escargots. Je mis ça sur le dos de l’alcool mais je savais bien que dans ces moments-là, les souvenirs débarquent avec perte et fracas et ou on s’attarde, ou on tourne la page.
La rouelle était tendre et rôtie comme il faut. J’ai écrasé mes patates dans le jus et les tomates. J’eus le réflexe de me servir un autre verre de Chablis mais le voyant encore raisonnablement rempli, je remballai mes clarinettes. Le niveau sonore de "Sleepytime Gorilla Museum" montait, comme pour annoncer un numéro de cascade dangereux, l’arrivée des rois mages au milieu d’une tempête de sable ou quelque chose comme ça.
J’avais sorti la cancoillotte, qu’elle soit à la température de la pièce. Je fis griller du pain à nouveau, mais rassis celui-ci. Avec la cancoillotte, le pain rassis grillé, c’est mieux, alors que je conseillerais le pain frais grillé pour le beurre de sardines. Un peu de beurre salé sur le pain grillé tiède, la cancoillotte que l’on étale en toute liberté et le verre vide que l’on remplit. Mais de quoi aurais-je le culot de me plaindre ?!
Mon fromage terminé, j’allumai une cigarette. Minuit pile. Je me dirigeai par acquis de conscience vers la cheminée, mon verre à la main..
Il me vint à l’esprit tous ces gens qui, au lendemain des fêtes, rapportent les jouets au magasin parce que ceux-ci ne marchent pas. Pour que ça marche, c’est très simple, il faut mettre des piles et les piles, on oublie souvent qu’elles ne sont pas fournies avec ! Vous imaginez la distribution des jouets à minuit :
« - Papa, ça marche pas !
- Fais voir ! »
Je mis un autre album sur la platine. Pour le dessert "Deerhoof" fut un compagnon idéal.
Pain d’épices, noix de Saint-Thibault et chocolat caramel poire. Il est indispensable de toujours avoir dans la bouche la même quantité des trois matières. C’est pour cette raison qu’il faut décortiquer ses noix avant, découper ses tranches de pain d’épices en quatre. Le chocolat se casse facilement, on coupera donc les crans au fur et à mesure. La bouchée idéale comprend un quart de tranche de pain d’épices, trois cuisses de noix et un demi-cran de chocolat compte-tenu qu’il y a deux crans de chocolat dans une rangée de tablette. Pour accompagner ces sucreries, j’ai dû abandonner le Chablis et opter pour une petite absinthe. Réalisant que la musique s’était arrêtée, j’en dégustai une autre religieusement dans le silence.
J’eus un peu de mal à empiler les bûches dans la chaudière pour la nuit. J’y parvins toutefois, sûrement guidé par cette puissance surnaturelle dont on vient justement de fêter la naissance.
Quand Jésus est né, sa mère ne s’est pas fait chier, elle l’a tout de suite foutu à la crèche !
Label Frères a passé 2011 entre les gouttes, essayant malgré tout de tenir le cap. Nous avons toujours été là, croisant le fer bec et ongles afin de conserver la tête hors de l’eau. Seulement c’était en 2011 et nous savons que 2012 ne ressemblera pas à 2011. Pour plein de raisons, vous m’avez compris mais aussi parce que nous avons décidé d’aménager et d’actualiser notre site, d’y ajouter des documents, d’améliorer les repères et la navigation entre les pages. Nous avons en outre changé de système de paiement en ligne. Nous avons quitté la Caisse d’Épargne et son système de paiement sécurisé SPPlus de plus en plus compliqué et indiscret, ne faisant aucune différence entre l’achat du Château de Versailles et celui d’un Carambar. Nous avons opté pour le système Paypal. qui, pour l’instant nous satisfait totalement .
Le quatuor Béla est venu passer quelques jours à La Bergerie cet été et m’a proposé de monter un spectacle qui réunirait des titres de "Travaux pratiques", des arrangements de Frédéric Aurier sur des titres plus anciens et quatre nouvelles pièces. Création à l’Atelier du Plateau (75018) les 26 et 27 mai 2012 à 17H00.
La jauge étant limitée, il serait raisonnable, je pense, de prendre ses précautions.
Frédéric Aurier, Julien Dieudegard : violons, voix
Julian Boutin : violon alto, voix
Luc Dedreuil : violoncelle, voix
Albert Marcoeur : percussions, voix
Excellent début d’année et comme diraient certains, ne lâchez rien ! C’est marrant, j’aurais plutôt envie de dire : lâchez tout !
Albert marcœur, le 11 janvier 2012
08:40 | Lien permanent | Commentaires (0)
03/01/2012
Mieux vaut être riche et en bonne santé....
19:39 | Lien permanent | Commentaires (0)
28/12/2011
Bonne blague à la mal bouffe....
Le bonheur est dans l'assiette...
Pendant plusieurs années, la Bolivie a résisté à l'implantation du géant du fast-food américain jusqu'au jour où les responsables de la chaîne de restaurants ont compris que dans cette partie du monde, la bataille était perdue.
Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Pendant 5 ans, de 1997 à 2022, Mc Donalds a fait l'impossible afin de s'adapter aux goûts du consommateur bolivien et ce, au risque de devoir mettre à mal son image internationale. Par exemple, en Bolivie, Mc Donalds a incorporé à ses menus la "llajwa", sauce piquante datant de bien avant la Conquète espagnole, à base de piments rocoto et de tomates que les boliviens ajoutent à tous leurs plats. Mc Donalds a même été jusqu'à accompagner les repas des clients de mélodies folkloriques des plus traditionnelles.
Tous ses efforts se sont révélés inutiles. Après de faibles recettes, l'entreprise nord-américaine a décidé de fermer ses huit restaurants installés dans les trois principales villes du pays, La Paz, Cochabamba et Santa Cruz. Situation inédite à laquelle Mc Donalds n'avait jamais été confronté en aucun point du globe.
La question qui se pose est pourquoi les consommateurs boliviens ont fait la moue aux préparations de Mc Donalds alors que sur le reste de la planète on se les dispute. Pourquoi l'"empanada", plat typique bolivien a-t-il réussi à détroner le célèbre hamburger ? Un documentaire intitulé "Pourquoi Mc Donalds a-t-il fait faillite en Bolivie ?" tente de répondre à ces interrogations. Ce film comprend des interviews de cuisiniers, historiens, nutritionnistes et sociologues ainsi que du responsable de la chaîne de restaurants en Bolivie, Roberto Udler. Chacun des intervenants aboutit en quelque sorte à la même conclusion : la raison du refus des boliviens ne réside pas dans la saveur du produit en lui-même, saveur qui est identique aux autres pays, mais plutôt dans la mentalité des consommateurs boliviens. En effet, les experts pensent que l'explication est à rechercher du côté de l'attachement des boliviens non seulement aux produits de la terre sinon à une mentalité qui continue à donner une place importante aux plats cuisinés à feu doux pendant de longues heures.
18:57 | Lien permanent | Commentaires (3)
15/11/2011
Des coqs, des coquilles et des coquillages.....
Gallimard : le dernier Goncourt corrigé par la communauté pirate [MAJx3]
Vaut-il mieux pirater des ebooks que de les acheter légalement si l’on veut un fichier de qualité ? Malheureusement, le mauvais travail de certains éditeurs risque de donner raison à ceux qui ont cette pratique. On connaissait le très bon travail de certains teams de pirates sur la qualité de leurs fichiers EPUB (ou Mobipocket) et sur les corrections effectuées avant la mise en ligne. Visiblement, la pratique n’est pas la même chez Gallimard qui vend un fichier rempli de coquilles. Et pas n’importe quel livre : le dernier Goncourt, L’art français de la guerre d’Alexis Jenni.
Un des plus importants réseaux d’ebooks piratés a publié sur Twitter une courte sélection des erreurs typographiques ou des fautes trouvées dans le fichier EPUB commercial. La liste n’est pas longue, mais laisse penser qu’il n’y a pas eu de véritable travail de relecture sur le fichier numérique mis en vente. Surtout lorsque l’EPUB coûte 16,80 € sur la FNAC et le Mobipocket chez Amazon
!
À quoi peut-on imputer ces erreurs ? Visiblement, il s’agit de coquilles de numérisation : les « ç » qui deviennent des « c », les « é » qui se transforment en « e », les points qui apparaissent après des mots en milieu de phrase, etc. Cela relève la méthode de production utilisée par Gallimard : un PDF qui passe par un système d’OCR (ce qui était une boutade n’a pas été pris comme tel visiblement…). Autant dire, une pratique que l’on pensait disparue pour les dernières nouveautés des grandes maisons. Espérons que la maison centenaire va rapidement rectifier son fichier et proposer une mise à jour à ses clients (un processus simple à mettre en oeuvre sur l’iBookstore et le Kindle Store).
L’influence des teams pirates est indéniable, surtout dans un marché encore embryonnaire. Face à une offre de contenu encore limitée et parfois de piètre qualité (nous ne manquerons pas de revenir sur cette question), l’offre illégale est souvent de bien meilleure qualité. Les teams d’ebooks sont-elles les corsaires de l’édition numérique ? Verra-t-on émerger des éditions revues et corrigées par les lecteurs, tant les éditeurs semblent s’affranchir de certaines étapes essentielles du travail éditorial ?
Une fois de plus, la présence de DRM ne protège pas les fichiers de leur diffusion illégale. Nous ne ferons que répéter que ces mesures de protection sont vaines et que l’abandon de tels dispositifs sera bénéfique au développement du marché. Supprimer les DRM, c’est rendre les ebooks hackables, transportables sur n’importe quelle plateforme et libres de permettre à l’utilisateur de le lire selon son propre usage de lecture numérique (application et niveau de partage). Et puis, cela permettra aux lecteurs de corriger les coquilles…
MAJ : Suite aux commentaires sur Twitter et aux mails de certains lecteurs, il semble que cette dizaine de coquilles soit aussi présente… dans la version papier ! En tout cas, elles sont bien présentes dans l’EPUB commercial. Pour la version Mobipocket, dont la qualité de mise en page n’est idéale (mais la faute est à partager avec le moteur de lecture Kindle assez capricieux et rustique), nous n’avons pas encore pu vérifier les similitudes. En effet, l’ebook n’est pas encore « indexé » pour notre reader. La technologie…
MAJ 2 : Péniblement, la recherche plein texte du Kindle se met à fonctionner mais l’ebook n’est pas encore totalement indexé. Pour l’instant, les coquilles sont aussi présentes ce qui n’est pas étonnant sachant que le fichier source est un EPUB converti par Amazon (à moins que Gallimard travaille ses Mobipocket mais vu la qualité du fichier, cela serait étonnant) avec KindleGen.
MAJ 3 : Compte tenu de l’évolution de cette histoire, il est nécessaire de faire un point sur les derniers éléments révélés sur le web ou les réseaux sociaux.
Tout d’abord, un point sur les faits : ce qui n’était que quelques coquilles dans une version numérique a vite pris de l’ampleur puisque ces erreurs se sont aussi révélées être présentes dans la version papier (dans leur grande majorité, même si l’absence de recherche plein texte sur un livre papier ne facilite pas la chasse aux coquilles
). Logique donc que l’erreur ait été répliquée dans les différentes déclinaisons du texte. Moins logique qu’elle soit passée au travers du filtre d’un éditeur comme Gallimard.
L’objet de ce billet était de relever, non sans un certain amusement, que les pirates, pourchassés par les grandes maisons, ne sont pas si inutiles à l’écosystème du livre numérique. Si l’on a relevé ici des coquilles, il aurait bien plus à dire de la qualité des fichiers numériques commerciaux. En cela, le dernier Goncourt n’échappe pas à la règle. On ne peut même pas appeler la table des matières dans la version vendue sur le Kindle Store ! Un comble pour un fichier commercial…
Les moins complaisants s’amuseront aussi de révéler que les dernières assises du numérique du SNE avait justement pour sujet la fabrication de fichiers, notamment en EPUB 3. Avant de passer à la version 3, pourquoi ne pas essayer de faire des fichiers EPUB et Mobipocket corrects ?
La conception de fichiers numériques, EPUB et Mobipocket, est un véritable enjeu économique et pointer du doigt ces négligences n’est pas sans risque. À une époque où ses prestations sont constamment externalisées, le risque de défaillance augmente. Gallimard n’est pas le seul éditeur à proposer des fichiers dont la qualité laisse à désirer ou à oublier de corriger certaines erreurs. Une bonne partie des éditeurs commerciaux (« 100% numérique » ou traditionnels) est logée à la même enseigne.
Nous ne manquerons donc pas de revenir sur ce sujet, images à l’appui, pour démontrer que les ebooks commerciaux sont d’un niveau très inégal, en terme de qualité et d’ergonomie. Comme dit dans l’article d’origine, je pense que le développement du marché du livre numérique doit se faire avant tout sur la qualité des textes commercialisés pour faciliter l’émergence d’usages de lecture numérique et limiter l’essor du piratage. Affaire à suivre.
21:41 | Lien permanent | Commentaires (0)
12/11/2011
Poésie du général
09:24 | Lien permanent | Commentaires (0)
09/11/2011
Nous avançons comme des somnambules vers la catastrophe
Entretien Edgar Morin :

Illustration empruntée à Maggie Taylor
Pourquoi la vitesse est-elle à ce point ancrée dans le fonctionnement de notre société ?
La vitesse fait partie du grand mythe du progrès, qui anime la civilisation occidentale depuis le XVIIIe et le XIXe siècle. L’idée sous-jacente, c’est que nous allons grâce à lui vers un avenir toujours meilleur. Plus vite nous allons vers cet avenir meilleur, et mieux c’est, naturellement. C’est dans cette optique que se sont multipliées les communications, aussi bien économiques que sociales, et toutes sortes de techniques qui ont permis de créer des transports rapides. Je pense notamment à la machine à vapeur, qui n’a pas été inventée pour des motivations de vitesse mais pour servir l’industrie des chemins de fer, lesquels sont eux-mêmes devenus de plus en plus rapides. Tout cela est corrélatif par le fait de la multiplication des activités et rend les gens de plus en plus pressés. Nous sommes dans une époque où la chronologie s’est imposée.
Cela est-il donc si nouveau ?
Dans les temps anciens, vous vous donniez rendez-vous quand le soleil se trouvait au zénith. Au Brésil, dans des villes comme Belém, encore aujourd’hui, on se retrouve « après la pluie ». Dans ces schémas, vos relations s’établissent selon un rythme temporel scandé par le soleil. Mais la montre-bracelet, par exemple, a fait qu’un temps abstrait s’est substitué au temps naturel. Et le système de compétition et de concurrence – qui est celui de notre économie marchande et capitaliste – fait que pour la concurrence, la meilleure performance est celle qui permet la plus grande rapidité. La compétition s’est donc transformée en compétitivité, ce qui est une perversion de la concurrence.
Cette quête de vitesse n’est-elle pas une illusion ?
En quelque sorte si. On ne se rend pas compte – alors même que nous pensons faire les choses rapidement – que nous sommes intoxiqués par le moyen de transport lui-même qui se prétend rapide. L’utilisation de moyens de transport toujours plus performants, au lieu d’accélérer notre temps de déplacement, finit – notamment à cause des embouteillages – . par nous faire perdre du temps ! Comme le disait déjà Ivan Illich (philosophe autrichien né en 1926 et mort en 2002, ndlr) :« La voiture nous ralentit beaucoup. » Même les gens, immobilisés dans leur automobile, écoutent la radio et ont le sentiment d’utiliser malgré tout le temps de façon utile. Idem pour la compétition de l’information. On se rue désormais sur la radio ou la télé pour ne pas attendre la parution des journaux. Toutes ces multiples vitesses s’inscrivent dans une grande accélération du temps, celui de la mondialisation. Et tout cela nous conduit sans doute vers des catastrophes.
Le progrès et le rythme auquel nous le construisons nous détruit-il nécessairement ?
Le développement techno-économique accélère tous les processus de production de biens et de richesses, qui eux-mêmes accélèrent la dégradation de la biosphère et la pollution généralisée. Les armes nucléaires se multiplient et on demande aux techniciens de faire toujours plus vite. Tout cela, effectivement, ne va pas dans le sens d’un épanouissement individuel et collectif !
Pourquoi cherchons-nous systématiquement une utilité au temps qui passe ?
Prenez l’exemple du déjeuner. Le temps signifie convivialité et qualité. Aujourd’hui, l’idée de vitesse fait que dès qu’on a fini son assiette, on appelle un garçon qui se dépêche pour débarrasser et la remplacer. Si vous vous emmerdez avec votre voisin, vous aurez tendance à vouloir abréger ce temps. C’est le sens du mouvement slow food dont est née l’idée de « slow life », de « slow time » et même de « slow science ». Un mot là-dessus. Je vois que la tendance des jeunes chercheurs, dès qu’ils ont un domaine, même très spécialisé, de travail, consiste pour eux à se dépêcher pour obtenir des résultats et publier un « grand » article dans une « grande » revue scientifique internationale, pour que personne d’autre ne publie avant eux. Cet esprit se développe au détriment de la réflexion et de la pensée. Notre temps rapide est donc un temps antiréflexif. Et ce n’est pas un hasard si fleurissent dans notre pays un certain nombre d’institutions spécialisées qui prônent le temps de méditation. Le yoguisme, par exemple, est une façon d’interrompre le temps rapide et d’obtenir un temps tranquille de méditation. On échappe de la sorte à la chronométrie. Les vacances, elles aussi, permettent de reconquérir son temps naturel et ce temps de la paresse. L’ouvrage de Paul Lafargue Le droit à la paresse(qui date de 1880, ndlr) reste plus actuel que jamais car ne rien faire signifie temps mort, perte de temps, temps non-rentable.
Pourquoi ?
Nous sommes prisonniers de l’idée de rentabilité, de productivité et de compétitivité. Ces idées se sont exaspérées avec la concurrence mondialisée, dans les entreprises, puis répandues ailleurs. Idem dans le monde scolaire et universitaire ! La relation entre le maître et l’élève nécessite un rapport beaucoup plus personnel que les seules notions de rendement et de résultats. En outre, le calcul accélère tout cela. Nous vivons un temps où il est privilégié pour tout. Aussi bien pour tout connaître que pour tout maîtriser. Les sondages qui anticipent d’un an les élections participent du même phénomène. On en arrive à les confondre avec l’annonce du résultat. On tente ainsi de supprimer l’effet de surprise toujours possible.
A qui la faute ? Au capitalisme ? A la science ?
Nous sommes pris dans un processus hallucinant dans lequel le capitalisme, les échanges, la science sont entraînés dans ce rythme. On ne peut rendre coupable un seul homme. Faut-il accuser le seul Newton d’avoir inventé la machine à vapeur ? Non. Le capitalisme est essentiellement responsable, effectivement. Par son fondement qui consiste à rechercher le profit. Par son moteur qui consiste à tenter, par la concurrence, de devancer son adversaire. Par la soif incessante de « nouveau » qu’il promeut grâce à la publicité… Quelle est cette société qui produit des objets de plus en plus vite obsolètes ? Cette société de consommation qui organise la fabrication de frigos ou de machines à laver non pas à la durée de vie infinie, mais qui se détraquent au bout de huit ans ? Le mythe du nouveau, vous le voyez bien – et ce, même pour des lessives – vise à toujours inciter à la consommation. Le capitalisme, par sa loi naturelle – la concurrence –, pousse ainsi à l’accélération permanente, et par sa pression consommationniste, à toujours se procurer de nouveaux produits qui contribuent eux aussi à ce processus.
On le voit à travers de multiples mouvements dans le monde, ce capitalisme est questionné. Notamment dans sa dimension financière…
Nous sommes entrés dans une crise profonde sans savoir ce qui va en sortir. Des forces de résistance se manifestent effectivement. L’économie sociale et solidaire en est une. Elle incarne une façon de lutter contre cette pression. Si on observe une poussée vers l’agriculture biologique avec des petites et moyennes exploitations et un retour à l’agriculture fermière, c’est parce qu’une grande partie de l’opinion commence à comprendre que les poulets et les porcs industrialisés sont frelatés et dénaturent les sols et la nappe phréatique. Une quête vers les produits artisanaux, les Amap (Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne, ndlr), indique que nous souhaitons échapper aux grandes surfaces qui, elles-mêmes, exercent une pression du prix minimum sur le producteur et tentent de répercuter un prix maximum sur le consommateur. Le commerce équitable tente, lui aussi, de court-circuiter les intermédiaires prédateurs. Certes, le capitalisme triomphe dans certaines parties du monde, mais une autre frange voit naître des réactions qui ne viennent pas seulement des nouvelles formes de production (coopératives, exploitations bio), mais de l’union consciente des consommateurs. C’est à mes yeux une force inemployée et faible car encore dispersée. Si cette force prend conscience des produits de qualité et des produits nuisibles, superficiels, une force de pression incroyable se mettra en place et permettra d’influer sur la production.
Les politiques et leurs partis ne semblent pas prendre conscience de ces forces émergentes. Ils ne manquent pourtant pas d’intelligence d’analyse…
Mais vous partez de l’hypothèse que ces hommes et femmes politiques ont déjà fait cette analyse. Or, vous avez des esprits limités par certaines obsessions, certaines structures.
Par obsession, vous entendez croissance ?
Oui ! Ils ne savent même pas que la croissance – à supposer qu’elle revienne un jour dans les pays que l’on dit développés – ne dépassera pas 2 % ! Ce n’est donc pas cette croissance-là qui parviendra à résoudre la question de l’emploi ! La croissance que l’on souhaite rapide et forte est une croissance dans la compétition. Elle amène les entreprises à mettre des machines à la place des hommes et donc à liquider les gens et à les aliéner encore davantage. Il me semble donc terrifiant de voir que des socialistes puissent défendre et promettre plus de croissance. Ils n’ont pas encore fait l’effort de réfléchir et d’aller vers de nouvelles pensées.
Décélération signifierait décroissance ?
Ce qui est important, c’est de savoir ce qui doit croître et ce qui doit décroître. Il est évident que les villes non polluantes, les énergies renouvelables et les grands travaux collectifs salutaires doivent croître. La pensée binaire, c’est une erreur. C’est la même chose pour mondialiser et démondialiser : il faut poursuivre la mondialisation dans ce qu’elle créé de solidarités entre les peuples et envers la planète, mais il faut la condamner quand elle crée ou apporte non pas des zones de prospérité mais de la corruption ou de l’inégalité. Je milite pour une vision complexe des choses.
La vitesse en soi n’est donc pas à blâmer ?
Voilà. Si je prends mon vélo pour aller à la pharmacie et que je tente d’y parvenir avant que celle-ci ne ferme, je vais pédaler le plus vite possible. La vitesse est quelque chose que nous devons et pouvons utiliser quand le besoin se fait sentir. Le vrai problème, c’est de réussir le ralentissement général de nos activités. Reprendre du temps, naturel, biologique, au temps artificiel, chronologique et réussir à résister. Vous avez raison de dire que ce qui est vitesse et accélération est un processus de civilisation extrêmement complexe, dans lequel techniques, capitalisme, science, économie ont leur part. Toutes ces forces conjuguées nous poussent à accélérer sans que nous n’ayons aucun contrôle sur elles. Car notre grande tragédie, c’est que l’humanité est emportée dans une course accélérée, sans aucun pilote à bord. Il n’y a ni contrôle, ni régulation. L’économie elle-même n’est pas régulée. Le Fonds monétaire international n’est pas en ce sens un véritable système de régulation.
Le politique n’est-il pas tout de même censé « prendre le temps de la réflexion » ?
On a souvent le sentiment que par sa précipitation à agir, à s’exprimer, il en vient à œuvrer sans nos enfants, voire contre eux… Vous savez, les politiques sont embarqués dans cette course à la vitesse. J’ai lu une thèse récemment sur les cabinets ministériels. Parfois, sur les bureaux des conseillers, on trouvait des notes et des dossiers qualifiés de « U » pour « urgent ». Puis sont apparus les « TU » pour « très urgent » puis les « TTU ». Les cabinets ministériels sont désormais envahis, dépassés. Le drame de cette vitesse, c’est qu’elle annule et tue dans l’œuf la pensée politique. La classe politique n’a fait aucun investissement intellectuel pour anticiper, affronter l’avenir. C’est ce que j’ai tenté de faire dans mes livres comme Introduction à une politique de l’homme, La voie, Terre-patrie… L’avenir est incertain, il faut essayer de naviguer, trouver une voie, une perspective. Il y a toujours eu, dans l’Histoire, des ambitions personnelles. Mais elles étaient liées à des idées. De Gaulle avait sans doute une ambition, mais il avait une grande idée. Churchill avait de l’ambition au service d’une grande idée, qui consistait à vouloir sauver l’Angleterre du désastre. Désormais, il n’y a plus de grandes idées, mais de très grandes ambitions avec des petits bonshommes ou des petites bonnes femmes.
Michel Rocard déplorait il y a peu pour « Terra eco » la disparition de la vision à long terme…
Il a raison, mais il a tort. Un vrai politique ne se positionne pas dans l’immédiat mais dans l’essentiel. A force d’oublier l’essentiel pour l’urgence, on finit par oublier l’urgence de l’essentiel. Ce que Michel Rocard appelle le « long terme », je l’intitule « problème de fond », « question vitale ». Penser qu’il faut une politique planétaire pour la sauvegarde de la biosphère – avec un pouvoir de décision qui répartisse les responsabilités car on ne peut donner les mêmes responsabilités à des pays riches et à des pays pauvres –, c’est une politique essentielle à long terme. Mais ce long terme doit être suffisamment rapide car la menace elle-même se rapproche.
Le président de la République Nicolas Sarkozy n’incarne-t-il pas l’immédiateté et la présence médiatique permanente ?
Il symbolise une agitation dans l’immédiateté. Il passe à des immédiatetés successives. Après l’immédiateté, qui consiste à accueillir le despote libyen Kadhafi car il a du pétrole, succède l’autre immédiateté, où il faut détruire Kadhafi sans pour autant oublier le pétrole… En ce sens, Sarkozy n’est pas différent des autres responsables politiques, mais son caractère versatile et capricieux en font quelqu’un de très singulier pour ne pas dire un peu bizarre.
Edgar Morin, vous avez 90 ans. L’état de perpétuelle urgence de nos sociétés vous rend-il pessimiste ?
Cette absence de vision m’oblige à rester sur la brèche. Il y a une continuité dans la discontinuité. Je suis passé de l’époque de la Résistance où j’étais jeune, où il y avait un ennemi, un occupant et un danger mortel, à d’autres formes de résistances qui ne portaient pas, elles, de danger de mort, mais celui de rester incompris, calomnié ou bafoué. Après avoir été communiste de guerre et après avoir combattu l’Allemagne nazie avec de grands espoirs, j’ai vu que ces espoirs étaient trompeurs et j’ai rompu avec ce totalitarisme-là, devenu ennemi de l’humanité. J’ai combattu cela et résisté. J’ai ensuite – naturellement – défendu l’indépendance du Vietnam ou de l’Algérie, quand il s’agissait de liquider un passé colonial. Cela me semblait si logique après avoir lutté pour la propre indépendance de la France, mise en péril par le nazisme. Au bout du compte, nous sommes toujours pris dans des nécessités de résister.
Et aujourd’hui ?
Aujourd’hui, je me rends compte que nous sommes sous la menace de deux barbaries associées. Humaine tout d’abord, qui vient du fond de l’histoire et qui n’a jamais été liquidée : le camp américain de Guantánamo ou l’expulsion d’enfants et de parents que l’on sépare, ça se passe aujourd’hui ! Cette barbarie-là est fondée sur le mépris humain. Et puis la seconde, froide et glacée, fondée sur le calcul et le profit. Ces deux barbaries sont alliées et nous sommes contraints de résister sur ces deux fronts. Alors, je continue avec les mêmes aspirations et révoltes que celles de mon adolescence, avec cette conscience d’avoir perdu des illusions qui pouvaient m’animer quand, en 1931, j’avais dix ans.
La combinaison de ces deux barbaries nous mettrait en danger mortel…
Oui, car ces guerres peuvent à tout instant se développer dans le fanatisme. Le pouvoir de destruction des armes nucléaires est immense et celui de la dégradation de la biosphère pour toute l’humanité est vertigineux. Nous allons, par cette combinaison, vers des cataclysmes. Toutefois, le probable, le pire, n’est jamais certain à mes yeux, car il suffit parfois de quelques événements pour que l’évidence se retourne. Des femmes et des hommes peuvent-ils aussi avoir ce pouvoir ?
Malheureusement, dans notre époque, le système empêche les esprits de percer. Quand l’Angleterre était menacée à mort, un homme marginal a été porté au pouvoir, qui se nommait Churchill. Quand la France était menacée, ce fut De Gaulle. Pendant la Révolution, de très nombreuses personnes, qui n’avaient aucune formation militaire, sont parvenues à devenir des généraux formidables, comme Hoche ou Bonaparte ; des avocaillons comme Robespierre, de grands tribuns. Des grandes époques de crise épouvantable suscitent des hommes capables de porter la résistance. Nous ne sommes pas encore assez conscients du péril. Nous n’avons pas encore compris que nous allons vers la catastrophe et nous avançons à toute allure comme des somnambules.
Le philosophe Jean-Pierre Dupuy estime que de la catastrophe naît la solution. Partagez-vous son analyse ?
Il n’est pas assez dialectique. Il nous dit que la catastrophe est inévitable mais qu’elle constitue la seule façon de savoir qu’on pourrait l’éviter. Moi je dis : la catastrophe est probable, mais il y a l’improbabilité. J’entends par « probable », que pour nous observateurs, dans le temps où nous sommes et dans les lieux où nous sommes, avec les meilleures informations disponibles, nous voyons que le cours des choses nous emmène à toute vitesse vers les catastrophes. Or, nous savons que c’est toujours l’improbable qui a surgi et qui a « fait » la transformation. Bouddha était improbable, Jésus était improbable, Mahomet, la science moderne avec Descartes, Pierre Gassendi, Francis Bacon ou Galilée était improbables, le socialisme avec Marx ou Proudhon était improbable, le capitalisme était improbable au Moyen-Age… Regardez Athènes. Cinq siècles avant notre ère, vous avez une petite cité grecque qui fait face à un empire gigantesque, la Perse. Et à deux reprises – bien que détruite la seconde fois – Athènes parvient à chasser ces Perses grâce au coup de génie du stratège Thémistocle, à Salamine. Grâce à cette improbabilité incroyable est née la démocratie, qui a pu féconder toute l’histoire future, puis la philosophie. Alors, si vous voulez, je peux aller aux mêmes conclusions que Jean-Pierre Dupuy, mais ma façon d’y aller est tout à fait différente. Car aujourd’hui existent des forces de résistance qui sont dispersées, qui sont nichées dans la société civile et qui ne se connaissent pas les unes les autres. Mais je crois au jour où ces forces se rassembleront, en faisceaux. Tout commence par une déviance, qui se transforme en tendance, qui devient une force historique. Nous n’en sommes pas encore là, certes, mais c’est possible.
Il est donc possible de rassembler ces forces, d’engager la grande métamorphose, de l’individu puis de la société ?
Ce que j’appelle la métamorphose, c’est le terme d’un processus dans lequel de multiples réformes, dans tous les domaines, commencent en même temps.
Nous sommes déjà dans un processus de réformes…
Non, non. Pas ces pseudo-réformes. Je parle de réformes profondes de vie, de civilisation, de société, d’économie. Ces réformes-là devront se mettre en marche simultanément et être intersolidaires.
Vous appelez cette démarche « le bien-vivre ». L’expression semble faible au regard de l’ambition que vous lui conférez.
L’idéal de la société occidentale – « bien-être » – s’est dégradé en des choses purement matérielles, de confort et de propriété d’objet. Et bien que ce mot « bien-être » soit très beau, il fallait trouver autre chose. Et quand le président de l’Equateur Rafael Correa a trouvé cette formule de « bien-vivre », reprise ensuite par Evo Morales (le président bolivien, ndlr), elle signifiait un épanouissement humain, non seulement au sein de la société mais aussi de la nature. L’expression « bien vivir » est sans doute plus forte en espagnol qu’en français. Le terme est « actif » dans la langue de Cervantès et passif dans celle de Molière. Mais cette idée est ce qui se rapporte le mieux à la qualité de la vie, à ce que j’appelle la poésie de la vie, l’amour, l’affection, la communion et la joie et donc au qualitatif, que l’on doit opposer au primat du quantitatif et de l’accumulation. Le bien-vivre, la qualité et la poésie de la vie, y compris dans son rythme, sont des choses qui doivent – ensemble – nous guider. C’est pour l’humanité une si belle finalité. Cela implique aussi et simultanément de juguler des choses comme la spéculation internationale… Si l’on ne parvient pas à se sauver de ces pieuvres qui nous menacent et dont la force s’accentue, s’accélère, il n’y aura pas de bien-vivre. —
20:40 | Lien permanent | Commentaires (0)
31/10/2011
Nouvelle édition...
Diffusé en France par Vilo.
Avec toujours l'ami Anto aux pinceaux pour la quatrième fois sur une couverture..
Le travail d'Anto est en lien sur ce blog dans la rubrique peintres.
Hugo Marsan.
Ce deuxième roman vibre d’une belle et saine acuité. Le quotidien est décrit avec lucidité et parfois cruauté, mais l’amour des mots, le chant des phrases, la jouissance du conteur transfigurent une réalité sordide en beau récit d’initiation. L’écriture pour qui écoute son miracle ne transforme pas les injustices sociales mais permet de survivre dans le respect de soi-même.
Le Monde des Livres
Saïd Mohamed va au cœur de la délinquance, du sordide, de la difficulté d’être le fils d’un immigré marocain alcoolique et d’une française pauvre au verbe cru. Roman autobiographique, fiction réaliste, c’est avec poésie et humour que l’auteur écrit ce parcours étonnant d’un jeune rebelle, brinquebalé de foyers en galères, qui survit grâce à un amour immodéré des mots et un sens aigu du beau. Il touche du doigt les paradoxes qui font la vie décousue de marginaux, plus ou moins touchants, et enfermés dans leurs carcans sociaux. Sans complaisance, avec une fluidité narrative exceptionnelle, il captive le lecteur avec une histoire cruelle parfois, mais pleine d’espoir.
Sud Ouest Dimanche
La honte hante les gens de peu, les moins que rien, dès le plus jeune âge. Le héros de Saïd Mohamed enfant de la DASS, pensionnaire de foyers, hôte éphémère de familles d’accueil avait un destin tracé : " Le berceau était entouré de mauvaises fées et le diagnostic sévère. " Un jour, il découvre les livres grâce à une prof de français baba-cool et la littérature va changer sa vie. Le narrateur exercera divers métiers sans sombrer dans la délinquance prétendument inscrite dans ses gènes. Il lit, il écrit des poèmes que parfois il déclame dans des groupes d’amis de rencontre. On ne le rejette pas, non on l’écoute, on boit ses mots, on l’applaudit. La Honte sur nous raconte l’itinéraire d’un gosse qui a su saisir la perche qu’on lui a tendue. La seconde partie du livre amène à la délivrance. Il quitte son métier d’imprimeur pour partir sur la route jusqu’au Maroc à la recherche de son père. Ces pages de la rencontre avec l’ancien soldat perdu de la guerre, puis ouvrier silicosé en France sont les plus émouvantes du livre. Le narrateur cherche à recoller les morceaux des premières années de sa vie, à bétonner le socle de son enfance. Il pourra alors retourner dans sa Normandie natale, la conscience apaisée.
L'humanité
Kenza Alaoui.
Lassé de passer d’un métier à un autre et de changer constamment de situation le narrateur décide de tout laisser derrière lui et de partir à la recherche de lui-même. Il part au Maroc retrouver son père. Le voyage le transforme. Au bout du chemin il ne trouve aucune satisfaction, sauf le soulagement. La Honte sur nous est le récit d’un voyage initiatique qui promène le narrateur dans les méandres d’une vie marquée du sceau du sordide. La mauvaise herbe qu’il était a fait pousser au fond de lui, comme par miracle, un talent précoce de poète.
La Gazette du Maroc
Salim Jay
L’appétit de vivre et l’appétit de raconter vont de pair chez Saïd Mohamed. Il écrit comme on trépigne, donne à percevoir tous les protagonistes de hasard mis en bouquet sur le chemin, de la France vers le Maroc, qui remettra face à face le père enfin en son village natal et le fils abandonné qui n’a rien oublié et ne sait pas ne pas respecter les siens. C’est la belle leçon de La Honte sur nous que cette incapacité à avoir honte de soi ou des siens. Saïd Mohamed sait rendre compte de la réalité apparemment la plus triviale sans l’arrogance d’un donneur de leçons. La Honte sur nous a parfois des accents déchirants et recèle des épisodes drôlatiques. Un récit qui ne démérite pas de l’existence. Tonique en somme.
Revue Quantara, Institut du Monde Arabe
Mustapha Harzoune
Sans concession aucune, Saïd Mohamed décrit les milieux par où il est passé, le sort des laissés-pour-compte, les boulots de misère, la délinquance des uns, l’alcoolisme des autres, la solitude d’une humanité abandonnée à elle-même par une société indifférente, folle," la folie de cette grande mécanique qui broie les hommes et les rend si misérables". Avec le même réalisme, la même brutalité, il rapporte l’histoire, la sordide et terrible histoire familiale. Pas de pleurnicherie ici. Les choses sont ce qu’elles sont et il faudra bien faire avec. La Honte sur nous est une autobiographie écrite à vif. Un témoignage sans tricherie mais sans concession sur cette part honteuse d’elle-même de la société française.
Revue Hommes et Migration
14:50 | Lien permanent | Commentaires (0)
29/10/2011
Festival des Artisans voyageurs
Un événement à ne rater sous aucun prétexte. Le niveau de qualité de la programmation ne se démentit pas... Trois jours de découvertes de partage d'émotions... Un festival porté à bout de bras par Arthur avec le soutien de la municipalité de Pellouailles Les Vignes.

Festival Artisans Voyageurs
17, 18, 19, 20 novembre 2011
à Pellouailles-les-Vignes (10 km d'Angers 49)
Abed AZRIE, compositeur et chanteur : notre invité d'honneur
- Réalisations audiovisuelles,
conférences avec les réalisateurs - Expositions
- Musique
- Salon du livre, dédicaces des auteurs
- Concours de carnet de voyage
- Salon de thé sous la yourte, repas exotiques...
10:01 | Lien permanent | Commentaires (0)
28/10/2011
Sebran d'Argent

Un jour alors que je me promenais dans le quartier st Paul j'ai vu un photographe qui vendait des tirages de ses photos d'Inde. Il avait inventé un appareil photo, une chambre en bois avec lequel il voyage en Asie et il prenait des clichés avec des films négatifs au format 20 x 30 cm. Ces films il les as récupérés dans les stocks de l'armée rouge. Ces négatifs servaient aux avions espions pour prendre des clichés depuis une altitude de 10 000 mètres. Cela donne un piqué extraordinaire à ses photos... Il tirait des planche contact avec ces négatifs qu'il vendait sur le trottoir. C'est là que je lui ai acheté un de ses tirages... Imaginez des planches contacts avec des négatifs de cette taille. Totalement bluffant.

Pour voir son travail il vous suffit d'aller sur le lien que j'ai mis sur ce blog. Il y a chez ce photographe une puissante ambiance totalement onirique qui reflète ce que j'ai perçu de l'Inde...
Pour le plaisir voici déjà quelques clichés qui étaient en vente à la galerie Verdeau...




21:15 | Lien permanent | Commentaires (30)
07/10/2011
à l'automne les salons sont à l'appel.....

08:15 | Lien permanent | Commentaires (0)
06/10/2011
Writerly Identities in beur fiction and beyond de Laura Reeck par Mustapha Harzoune

A chacun, elle consacre un chapitre. Elle ne se contente pas d’y analyser les œuvres des uns et des autres mais se livre également à des mises en perspectives théoriques, sociales et biographiques. Elle illustre ainsi, avec rigueur et conviction, la fameuse opinion qui veut que la littérature en dise plus sur nos sociétés et sur leur devenir que nombre de doctes traités, lourdement lestés de statistiques. A l’ère du chiffre-roi, les poètes ne seraient pas tout à fait morts…
L’auteure détrousse les écrits d’Azouz Begag, Farida Belghoul, Leïla Sebbar, Saïd Mohamed, Rachid Djaïdani et Mohamed Razane. Un autre écrivain traverse à plusieurs reprises le livre, sans qu’un chapitre lui soit pour autant dédié : Mounsi. Le choix, personnel, pourrait être discuté, mais l’éventail présenté offre plusieurs intérêts. Il est constitué d’hommes et de femmes appartenant à trois générations. Certaines personnalités ne rechignent pas à occuper le devant de la scène quand d’autres choisissent volontairement de s’en retirer. Les acteurs de la politique y côtoient des intellectuels engagés dans le débat public. Certains acceptent de jouer le jeu médiatique pour se faire entendre quand d’autres refusent, en actes et par écrit, de faire la danse du ventre. Tous ont à voir avec l’Algérie, sauf un esseulé qui laisse s’exhaler quelques fragrances franco-marocaines. Socialement, ils sont issus des bidonvilles, des cités, de la DDASS ou de ces armoires franco-algériennes, riches en secrets et non-dits. Tous mettent en avant la littérature et l’universalité de leurs propos. Le style et la langue avant tout ! Ils écrivent une "littérature engagée", un engagement qualifié d’"extraverti" pour Begag ou d’"introverti" pour Belghoul, une "autofiction extravertie" pour Said Mohammed, une "littérature au miroir" pour Rezane ou une littérature "tout court" pour Djaïdjani. Le premier livre présenté est paru en 1986 et le dernier en 2007 ; ce large spectre littéraire permet de rendre compte des évolutions, des formes et des objets de ces engagements.
Laura Reeck dissèque "ses" auteurs, convoque tour à tour Fanon, Camus et le concept d’absurde, Ralph Ellison et les notions de visibilité et d’invisibilité, le Tout-Monde d’Edouard Glissant, le philosophe Kwame Anthony Appiah, Michel Serres, Michel De Certeau, Salman Rushdie ou Le Clezio.
Elle replace les œuvres dans le contexte sociohistorique. Elle part des rodéos de Venissieux en 1980 en passant par la Marche de 1983 et Convergences 84 pour arriver aux émeutes de 2005. C’est dire si, en matière d’identité, ce n’est pas seulement celle de quelques "gratte-papier" qui intéresse l’universitaire nord américaine mais bien les identités en devenir des populations issues de l’immigration ("postcoloniales" ou "minorités ethniques" selon son vocabulaire) et les chambardements induits au sein de la société française. Comme l’écrivait récemment Amin Maalouf, "l’intimité d’un peuple c’est sa littérature" (Le Dérèglement du monde, Le Livre de poche, 2010). Avec ces écrivains - français ! - on plonge au plus profond des entrailles et de l’âme française.
Des revendications politiques de la Marche de 1983 à la violence des années 2005, la même blessure taraude ces Français un peu trop à part : comment faire entendre qu’ils sont partie prenante de l’histoire et du devenir national, qu’ils partagent les valeurs héritées des Lumières et de la Grande Révolution et qu’il constituent une clef du futur de (et pour) leurs concitoyens ? Le titre du manifeste Qui fait la France ? résume à merveille cette double disposition vieille maintenant de plus de trente ans : ils "kiffent" la France et participe de son dynamisme.
Laura Reeck dissèque justement les processus de métissages - ce qu’en bonne américaine elle nomme le "multiculturalisme" de la société - qui traversent les romans de ces auteurs et, au-delà, les populations dont ils sont issus. La société française se métisse. Et ce n’est pas simple ! Ce processus est difficile et douloureux. Pour les intéressés d’abord qui en subissent les premiers et rudes coups. Mais aussi, ce que montre ce livre en creux et peut-être même involontairement, pour la société dans son ensemble. On peut adopter telle ou telle grille de lecture - échec et tromperie du modèle d’intégration (A. Begag), reproduction de la société coloniale (F. Belghoul ou L. Sebbar) ghettoïsation en périphérie (R. Djaïdjani ou M. Razane), injustices sociales (S. Mohamed) - la question qui est au centre du propos de Laura Reeck porte sur la capacité de la société française à se réinventer, à se régénérer dans le monde du XXIe siècle devenu le "Tout-Monde". La France sera-t-elle capable de repenser les liens entre l’ici et l’ailleurs, le local et le monde, ses parties et le tout, l’horizontalité des relations et la verticalité des dominations, l’écoute et donc la disponibilité à l’autre qui est aussi le tout proche, l’échange comme cheminement et non comme volonté de convaincre, la question des langues et des cultures débarquées clandestinement avec ses populations venues d’ailleurs, l’écoute des autres voix du monde dont ils sont (un peu) les ambassadeurs et qui expriment l’essence des jours présents et la lumière des prochaines aubes ? Pourra-t-elle concevoir des identités "déterritorialisées" et l’irruption d’un "Je" autonome et complexe ?
Bien sûr, la question sociale est au cœur des évolutions attendues. Ce n’est pas une nouveauté : la priorité (l’urgence) exige une prise de conscience et une volonté politique en faveur notamment des populations reléguées aux périphéries des grandes villes. Du travail, de l’éducation, des conditions de vie décentes... De l’espoir et du rêve aussi ! Si, comme le disent ces auteurs, la violence – celle de la sphère publique mais aussi celle des sphères privées et même intimes - renferme des causes sociales, il n’en reste pas moins que cette prise de conscience politique (pré)suppose un bouleversement culturel. Que le "centre" se décentre, qu’il change de logiciel et voyage vers d’autres imaginaires pour écouter, autrement plus sérieusement que le spectacle du cirque médiatique, ce que ces écrivains ont à dire d’eux-mêmes ; et de tous. Alors, peut-être que oui, la parole des poètes ne sera pas galvaudée.
Mustapha Harzoune
Laura Reeck, Writerly identities. In Beur fiction and Beyond, Lexington Books, USA, 2011, 191 pages.
19:47 | Lien permanent | Commentaires (0)
02/10/2011
Verdi contre Berlusconi
L’Italie fêtait le 150ème anniversaire de sa création et à cette occasion fut donnée, à l’opéra de Rome, une représentation de l’opéra le plus symbolique de cette unification : Nabucco de Giuseppe Verdi, dirigé par Riccardo Muti.
Nabucco de Verdi est une œuvre autant musicale que politique : elle évoque l'épisode de l'esclavage des juifs à Babylone, et le fameux chant « Va pensiero » est celui du Chœur des esclaves opprimés. En Italie, ce chant est le symbole de la quête de liberté du peuple, qui dans les années 1840 - époque où l'opéra fut écrit - était opprimé par l'empire des Habsbourg, et qui se battit jusqu'à la création de l’Italie unifiée.
Avant la représentation, Gianni Alemanno, le maire de Rome, est monté sur scène pour prononcer un discours dénonçant les coupes dans le budget de la culture du gouvernement. Et ce, alors qu’Alemanno est un membre du parti au pouvoir et un ancien ministre de Berlusconi.
Cette intervention politique, dans un moment culturel des plus symboliques pour l’Italie, allait produire un effet inattendu, d’autant plus que Sylvio Berlusconi en personne assistait à la représentation…
Repris par le Times, Riccardo Muti, le chef d'orchestre, raconte ce qui fut une véritable soirée de révolution : « Au tout début, il y a eu une grande ovation dans le public. Puis nous avons commencé l’opéra. Il se déroula très bien, mais lorsque nous en sommes arrivés au fameux chant Va Pensiero, j’ai immédiatement senti que l’atmosphère devenait tendue dans le public. Il y a des choses que vous ne pouvez pas décrire, mais que vous sentez. Auparavant, c’est le silence du public qui régnait. Mais au moment où les gens ont réalisé que le Va Pensiero allait démarrer, le silence s’est rempli d’une véritable ferveur. On pouvait sentir la réaction viscérale du public à la lamentation des esclaves qui chantent : « Oh ma patrie, si belle et perdue ! ».
Alors que le Chœur arrivait à sa fin, dans le public certains s’écriaient déjà : « Bis ! » Le public commençait à crier « Vive l’Italie ! » et « Vive Verdi ! » Des gens du poulailler (places tout en haut de l’opéra) commencèrent à jeter des papiers remplis de messages patriotiques – certains demandant « Muti, sénateur à vie ».
Bien qu’il l’eut déjà fait une seule fois à La Scala de Milan en 1986, Muti hésita à accorder le « bis » pour le Va pensiero.
Pour lui, un opéra doit aller du début à la fin. « Je ne voulais pas faire simplement jouer un bis. Il fallait qu’il y ait une intention particulière. », raconte-t-il.
Mais le public avait déjà réveillé son sentiment patriotique. Dans un geste théâtral, le chef d’orchestre s’est alors retourné sur son podium, faisant face à la fois au public et à M. Berlusconi, et voilà ce qui s'est produit :
[Après que les appels pour un "bis" du "Va Pensiero" se soient tus, on entend dans le public : "Longue vie à l'Italie !"]
Le chef d'orchestre Riccardo Muti : Oui, je suis d'accord avec ça, "Longue vie à l'Italie" mais...
[applaudissements]
Muti : Je n'ai plus 30 ans et j'ai vécu ma vie, mais en tant qu'Italien qui a beaucoup parcouru le monde, j'ai honte de ce qui se passe dans mon pays. Donc j'acquiesce à votre demande de bis pour le "Va Pensiero" à nouveau. Ce n'est pas seulement pour la joie patriotique que je ressens, mais parce que ce soir, alors que je dirigeais le Choeur qui chantait "O mon pays, beau et perdu", j'ai pensé que si nous continuons ainsi, nous allons tuer la culture sur laquelle l'histoire de l'Italie est bâtie. Auquel cas, nous, notre patrie, serait vraiment "belle et perdue".
[Applaudissements à tout rompre, y compris des artistes sur scène]
Muti : Depuis que règne par ici un "climat italien", moi, Muti, je me suis tu depuis de trop longues années. Je voudrais maintenant... nous devrions donner du sens à ce chant ; comme nous sommes dans notre Maison, le théatre de la capitale, et avec un Choeur qui a chanté magnifiquement, et qui est accompagné magnifiquement, si vous le voulez bien, je vous propose de vous joindre à nous pour chanter tous ensemble.
C’est alors qu’il invita le public à chanter avec le Chœur des esclaves. « J’ai vu des groupes de gens se lever. Tout l’opéra de Rome s’est levé. Et le Chœur s’est lui aussi levé. Ce fut un moment magique dans l’opéra. »
« Ce soir-là fut non seulement une représentation du Nabucco, mais également une déclaration du théâtre de la capitale à l’attention des politiciens.»
20:14 Publié dans Cherchez pas c'est de l'art..... | Lien permanent | Commentaires (0)
21/10/2010
Le Fou Rire de la Joconde...
Deux critiques à propos du livre "Le fou rire de la Joconde" d'Alain Germoz, paru aux Carnets du Dessert de Lune, dans la collection Pleine Lune.
Alain GERMOZ, Le fou rire de la Joconde,
Editions Les Carnets du Dessert de Lune, 2010, 73 p., 13 €. ISBN 978 2 930235 99 8
Vitrine à fantasmes
Le sourire de la Joconde est-il un leurre? Ses ambiguïtés souvent évoquées offrent en tout cas à Alain Germoz l'occasion de contestations majeures autant sur l'art en soi que sur les comportements humains qu'il suscite. Sous-titrée « variations sur un thème trop (mé)connu », cette mosaïque rassemble, dans un mélange des genres, une gerbe de réflexions et de dialogues moissonnés au long des années à travers le prisme de cette vitrine à phantasmes signée Vinci. Textes tout en intelligence, en irrévérence et en rouerie, qui soumettent cet ectoplasme de la nommée Mona Lisa à tous les traitements possibles (des plus gratifiants aux plus mortifiants), à toutes les interrogations et à tous les regards posés sur un pli de bouche passible de refléter le catalogue de nos grimaces et de nos contradictions. Saccage magistral des certitudes hautaines, des idées toutes faites, des engouements grégaires et de l'imposture d'icônes en toc du monde de l'art, mais mené avec l'élégance d'un jeu d'esprit qui pourrait, le cas échéant, s'apparenter au fameux sourire. Si toutefois celui-ci cache bien un fou rire réprimé, face aux conjectures mêmes qu'il suscite, ou exprime le doute fondamental et créatif qui anime en toutes circonstances et à tout propos, un auteur dont la liberté de pensée constitue le seul credo.
© Ghislain Cotton in Le Carnet et les instants
Comment qualifier un des derniers écrivains francophones de Flandre, homme de la plus grande liberté de ton et de la plus grande rigueur de langue, Alain Germoz. Est-ce un surréaliste, un dadaïste, un ancien ou un moderne ? Je me refuse à le classer dans un petit ou grand casier de ce genre. Son dernier live prouve une fois encore qu’il peut se contenter d’être lui-même, avec sa fantaisie et son énorme culture. Le fou rire de la Joconde est cependant, malgré son humour et sa belle méchanceté, tout autre chose qu’une potache. A preuve s’il en fallait le chapitre « Point à la ligne » véritable cours sur l’Art (il tient à la majuscule) qu’il définit comme la « potion magique librement consentie. » Le reste de ce petit livre digne des « propos des buveurs » de Rabelais se permet toutes les insolences et même pire, s’amusant à désacraliser le tableau de Léonard en jouant de toutes les ressources de la bonne blague, y compris une réjouissante grossièreté à l’occasion. Décidément ce fils de l’étonnant Roger Avermaet (encore un oublié ou gommé) n’a rien perdu à près de nonante ans de la faconde estudiantine. Comme les précédents, cet opus a aussi conservé le souci de ne jamais écrire (ou dessiner, voir ses scromphales) n’importe quoi, comme c’est la mode aujourd’hui dans les milieux dits intellectuels où croupissent des écrivains surtout préoccupés de subventions et d’une retraite confortable et si possible académique.
© Paul Van Melle, in Inédit Nouveau
Si vous souhaitez commander ce livre envoyez un mail à dessertdelune@skynet.be. Un exemplaire de la version complète du dessert "Le caribou mal équarri" d'Alain Germoz vous sera offert avec votre commande.
09:19 | Lien permanent | Commentaires (1)
Le Fou Rire de la Joconde...
Deux critiques à propos du livre "Le fou rire de la Joconde" d'Alain Germoz, paru aux Carnets du Dessert de Lune, dans la collection Pleine Lune.
Alain GERMOZ, Le fou rire de la Joconde,
Editions Les Carnets du Dessert de Lune, 2010, 73 p., 13 €. ISBN 978 2 930235 99 8
Vitrine à fantasmes
Le sourire de la Joconde est-il un leurre? Ses ambiguïtés souvent évoquées offrent en tout cas à Alain Germoz l'occasion de contestations majeures autant sur l'art en soi que sur les comportements humains qu'il suscite. Sous-titrée « variations sur un thème trop (mé)connu », cette mosaïque rassemble, dans un mélange des genres, une gerbe de réflexions et de dialogues moissonnés au long des années à travers le prisme de cette vitrine à phantasmes signée Vinci. Textes tout en intelligence, en irrévérence et en rouerie, qui soumettent cet ectoplasme de la nommée Mona Lisa à tous les traitements possibles (des plus gratifiants aux plus mortifiants), à toutes les interrogations et à tous les regards posés sur un pli de bouche passible de refléter le catalogue de nos grimaces et de nos contradictions. Saccage magistral des certitudes hautaines, des idées toutes faites, des engouements grégaires et de l'imposture d'icônes en toc du monde de l'art, mais mené avec l'élégance d'un jeu d'esprit qui pourrait, le cas échéant, s'apparenter au fameux sourire. Si toutefois celui-ci cache bien un fou rire réprimé, face aux conjectures mêmes qu'il suscite, ou exprime le doute fondamental et créatif qui anime en toutes circonstances et à tout propos, un auteur dont la liberté de pensée constitue le seul credo.
© Ghislain Cotton in Le Carnet et les instants
Comment qualifier un des derniers écrivains francophones de Flandre, homme de la plus grande liberté de ton et de la plus grande rigueur de langue, Alain Germoz. Est-ce un surréaliste, un dadaïste, un ancien ou un moderne ? Je me refuse à le classer dans un petit ou grand casier de ce genre. Son dernier live prouve une fois encore qu’il peut se contenter d’être lui-même, avec sa fantaisie et son énorme culture. Le fou rire de la Joconde est cependant, malgré son humour et sa belle méchanceté, tout autre chose qu’une potache. A preuve s’il en fallait le chapitre « Point à la ligne » véritable cours sur l’Art (il tient à la majuscule) qu’il définit comme la « potion magique librement consentie. » Le reste de ce petit livre digne des « propos des buveurs » de Rabelais se permet toutes les insolences et même pire, s’amusant à désacraliser le tableau de Léonard en jouant de toutes les ressources de la bonne blague, y compris une réjouissante grossièreté à l’occasion. Décidément ce fils de l’étonnant Roger Avermaet (encore un oublié ou gommé) n’a rien perdu à près de nonante ans de la faconde estudiantine. Comme les précédents, cet opus a aussi conservé le souci de ne jamais écrire (ou dessiner, voir ses scromphales) n’importe quoi, comme c’est la mode aujourd’hui dans les milieux dits intellectuels où croupissent des écrivains surtout préoccupés de subventions et d’une retraite confortable et si possible académique.
© Paul Van Melle, in Inédit Nouveau
Si vous souhaitez commander ce livre envoyez un mail à dessertdelune@skynet.be. Un exemplaire de la version complète du dessert "Le caribou mal équarri" d'Alain Germoz vous sera offert avec votre commande.
09:18 | Lien permanent | Commentaires (0)