25/05/2009
Du grain à Mouloud
Egalité républicaine : un Mc Do, une Sciences-po
Par Mouloud Akkouche
De passage à Paris, j'ai vécu une dizaine de jours dans un studio du VIIe arrondissement. Riverain éphémère, je me suis promené dans le quartier. En passant devant le collège Stanislas, les lycée Montaigne et Henri-IV, Sciences-Po, j'ai regardé ces jeunes gens en me disant : celui-ci sera juge, l'autre avocat, éditeur, cinéaste, journaliste, militant de l'ultragauche…
Cette belle jeunesse -plutôt uniforme- sous le soleil parisien était sympathique. Très joyeuse. Leur apparente désinvolture me fit penser à celle de mes gosses et à ceux de mes amis. Choisir sa vie est quand même le plus beau cadeau que nous puissions offrir à notre progéniture. Et je suis intimement persuadé que beaucoup de parents sont habités par ce rêve.
A Montreuil, un mélange de surface
Une demi-heure après, je me retrouvais à Montreuil : ma ville natale. A la sortie du métro, cette commune prisée par les agents immobiliers pour ses lofts offre un semblant de métissage social. Je dis semblant car un grand nombre d'enfants de bobos ne fréquente pas les écoles communales de leur secteur ; plutôt celles des villes plus nanties comme Saint-Mandé et Vincennes ou des établissements du type Montessori ou Decroly. Mais, quoi qu'on puisse penser, le centre-ville bénéficie d'un véritable foisonnement culturel ou le coude du plombier côtoie celui de l'artiste peintre. Comme disait Antoine Blondin : avec deux Whiskies, il fait beau partout. Et les différences fondent au moins jusqu'à la fermeture du bar….
Poussé par un irrépressible accès de nostalgie, je décidais de grimper dans le Haut-Montreuil -si haut que les habitants n'auront pas le droit comme les autres au Vélib. Ce quartier pas desservi par le métro où je fus écolier semblait étrangement détaché du reste de la ville, du pays. Comme dans les écoles des VIe et VIIe arrondissement de la capitale, les élèves se ressemblaient tous : uniformes eux aussi. Certes pas le même genre d'uniformité. Différents de beaucoup de jeunes montreuillois deux kilomètres plus bas, et à des années lumière du collège Stanislas. Un seul point commun à tous ces jeunes : leurs âges. Et l'énergie.
Que dire ? Que penser ? Le sujet ayant tellement été traité qu'il en devient presque vidé de sens, juste du grain à moudre pour les sociologues. Pourtant, debout devant mon collège, je ne pus m'empêcher de penser à la putain de difficulté de se frayer un chemin à travers ce labyrinthe de misère pour choisir sa vie. Juste autorisé à choisir sa survie. Comment continuer de croire que ces gosses appartiennent à la même trinité républicaine : liberté, égalité, fraternité. Dans certains quartiers, elle pourrait être rebaptisée : loyers impayés, électricité coupée, fin de droits.
Exporter Paris en banlieue ?
De retour à Paris, je passais en pleine nuit boulevard Saint-Germain. Près de la rue Saint-Guillaume, je me remémorais l'initiative du patron de Sciences-Po : proposer à des enfants issus de banlieue « défavorisées » un cursus scolaire dans son prestigieux établissement. Une espèce de Mercato de la matière grise dans les périphéries. Même si je trouve son initiative totalement inopérante, force est de lui reconnaître le mérite de la proposition. Contrairement à lui, je n'ai pas la moindre amorce de solutions : juste des interrogations. Et beaucoup de contradictions.
Mais tout de même étrange que ce responsable, sans doute très cultivé et humaniste, n'ait pas pensé à franchiser Sciences-Po dans ces contrées lointaines de France… A croire qu'il est persuadé que tout est foutu d'avance et, contraint et forcé par une dérive inévitable du système scolaire, accorde à quelques-uns la possibilité de quitter le navire pendant le naufrage. Et laisse les autres -moins compétitifs- se noyer. Pourquoi pas offrir au moins les mêmes chances éducatives à tous et sur tout le territoire ? Un Mc Do, une Siences-Po ? Bref, des jeunes séparés par quelques stations de métro « évoluent » dans le même pays, pas dans le même monde. Et on voudrait qu'ils sachent tous se tenir dans le monde.
La nuit suivante, accompagné d'un copain d'enfance aujourd'hui sans papiers, nous nous sommes arrêtés à « l'Old Navy », un bar de nuit. Sirotant une mousse, nous évoquions cette période où, descendus des hauteurs de Montreuil, nous nous accordions des haltes dans ce bistrot pour parler de littérature et peinture, avant de retourner à pieds ou en bus de nuit chez nos parents. Belle époque où les mains ne s'accrochaient pas sur les poitrines mais se serraient…
Dans les beaux quartiers, la force (de l'ordre) tranquille
Puis, après avoir essoré ensemble le passé, ce copain décida de me raccompagner dans mon antre provisoire. Près d'un ministère, son visage se crispa. Habitué aux nombreux contrôles d'identités à Montreuil où il réside toujours, il voulait s'échapper par la première rue à droite. Pourtant très proches et complices depuis longtemps (le premier à me faire lire Rilke), l'un et l'autre constations d'un seul coup que la ville lumière, si souvent arpentée et aimée à la folie, n'était plus du tout la même pour nous deux. Chacun d'un côté d'une frontière administrative, séparés par l'absence d'un rectangle de plastique dans sa poche.
Pour éviter d'attirer l'attention de la maréchaussée, nous restâmes sur le même trottoir de la rue de Babylone en devisant de poésie… comme avant Hortefeux et Besson. Occupés à monter la garde dans leur véhicule, les flics, après un bref regard sur les deux passants, continuèrent eux aussi leur conversation. Plus loin, il me sourit et lâcha : « Moralité : vaut mieux être sans-papiers dans les beaux quartiers. »
Mais aussi écolier.
texte publié pour la première fois par Rue 89
Ndlr: l'ami Mouloud m'a signalé son texte et c'est parce que je le trouve bien écrit et surtout témoignant parfaitement de la trajectoire de deux copains qui furent proches et qui sont maintenant séparés par une barrière administrative infranchissable que j'ai décidé de le repasser...
19:00 Publié dans De la poésie au quotidien | Lien permanent | Commentaires (0)
22/12/2008
Front de libération du colibri

Si comme moi vous êtes sensible au charme utopique du colibri, faites le savoir autour de vous...
07:51 Publié dans De la poésie au quotidien | Lien permanent | Commentaires (0)
16/11/2008
la petite renarde rusée....

Résumé
A propos de l’œuvre La Petite Renarde rusée est inspirée à Janácek par une série de bandes dessinées parues dans un quotidien de Brno, le Livode noviny. Comme le rédacteur en chef de ce journal dispose d’espace, il persuade Rudolf Tesnohlidek de rédiger des textes susceptibles d’accompagner une série de caricatures découvertes à Prague, exploitant le thème de la chasse. C’est ainsi qu’en 1920, parait en livraisons régulières La Petite Renarde à l’oreille fine, qui suscite immédiatement l’enthousiasme de Janácek. Cette œuvre ne saurait se prêter à une approche strictement rationnelle ou analytique.
Elle n’est pas le produit de la rencontre de deux grands génies dramatiques (tel Verdi et Schiller, ou Mozart et Beaumarchais), mais simplement le fruit de la lecture régulière d’un quotidien. Cette œuvre provient de l’intérêt d’un compositeur qui aspirait à « chanter la majesté des montagnes, la douceur de la pluie tiède, le froid cuisant des glaces, les fleurs des champs et les étendues enneigées […] le chant d’amour des oiseaux et les cris perçants des rapaces […] et le bourdonnement assourdissant des milliers d’insectes … »
Les animaux ne sont que mouvement. Et ce n’est que grâce au mouvement, grâce à la musique, que l’on peut capter quelque chose de l’esprit de la forêt. Cet opéra constitue donc un véritable défi, en matière de scénographie notamment. Il requiert de la part des animaux une danse, un chant, animés de toute la sauvagerie, la violence mais aussi de tout l’humour dont ils sont capables.
L’œuvre à l’Opéra national de Paris On a longtemps considéré qu’il était impossible de mettre en scène cet opéra où se côtoient des hommes et des animaux ; d’ailleurs, de nombreuses tentatives ont échoué. Mais en 1956, au Komische Oper de Berlin, les intentions de Janácek se sont trouvées pleinement réalisées dans la production merveilleuse de Walter Felsenstein qui a su associer d’une façon étonnante le réalisme et la musicalité. La représentation à Paris de ce spectacle, un an après sa création à Berlin, fut une révélation pour ceux qui ont pu y assister et l’œuvre fut donnée plus de 120 fois dans les quatre années qui ont suivi, sans rien perdre de la qualité étonnante des premières représentations. La Petite Renarde rusée entre enfin au répertoire de l’Opéra national de Paris pour la saison 2008-2009 dans une mise en scène d’André Engel, sous la direction de Dennis Russell Davies.
ARGUMENT ACTE I Dans la forêt, l’été, des animaux et des insectes vaquent tranquillement à leurs occupations. Un Blaireau fume une pipe ; une Libellule bleue danse avec grâce… L’arrivée du Garde-chasse trouble ce petit monde : le Garde, fatigué, choisit un coin pour s’allonger et faire sa sieste. A peine est-il endormi que le ballet des habitants reprend de plus belle. Le Grillon et la Sauterelle font un petit concert. Une Grenouille essaie d’attraper un Moustique, sous l’œil intéressé d’une Renarde. Mais la Grenouille fait un bond malencontreux et se retrouve sur le nez du Garde, qu’elle réveille. Celui-ci, en ouvrant les yeux, aperçoit la jolie Renarde. Il réussit finalement à l’attraper et rentre chez lui, la Renarde sous le bras. La Libellule bleue pleure son amie perdue. A l’automne, dans la cour de la maison du Garde-chasse, la femme du Garde verse un peu de lait dans une soucoupe pour le Chien et la Renarde qu’elle et son mari veulent élever pour leur fils. Mais la Renarde est triste. Le Chien essaie de lui expliquer qu’il faut se résigner, avant de lui faire des avances pressantes, qu’elle repousse. Il lui faut ensuite subir les agaceries du fils du Garde qui, avec un de ses camarades, vient la taquiner. Elle essaie de mordre les enfants ; la réaction ne se fait pas attendre : le Garde l’attache et la pauvre Renarde reste seule. La nuit tombe alors, la Renarde s’endort et rêve bientôt qu’elle se transforme en une belle jeune fille… Mais quand le jour se lève, elle est toujours Renarde. La femme du Garde, levée à l’aube, jette un peu de nourriture aux poules qui caquettent fièrement. Mais la Renarde attire alors leur attention en entamant une grande diatribe révolutionnaire, prêchant pour une nouvelle conception du monde qui ne devrait plus être dominé par les hommes et les coqs. Les poules demeurent insensibles à cet appel à la révolte et la Renarde, écœurée, se creuse une tombe et déclare qu’elle préfère s’enterrer vivante… Les poules s’approchent alors, et la Renarde bondit et les égorge les unes après les autres. La femme du Garde-chasse a beau sortir de la ferme en criant, le mal est fait. Néanmoins, la Renarde a compris ce qu’elle risque : elle brise son attache et s’enfuit vers la forêt.
ACTE II Revenue dans la forêt, la Renarde, sous l’œil amusé des autres animaux, se moque du Blaireau. Excédé, il quitte son terrier dont prend alors possession la Renarde. Pendant ce temps, à l’auberge du village, le Garde-chasse joue aux cartes avec l’Instituteur en compagnie du Curé. Le Garde se moque de l’Instituteur en raillant la maladresse avec laquelle il fait la cour à sa bien-aimée. Mais celui-ci lui évoque les « exploits » de la Renarde enfuie. Le Curé, lui, se divertit fort avec une citation latine qu’il estime bien à propos. La boisson échauffe toutes les têtes. L’Aubergiste conseille au Curé de quitter l’auberge pour éviter le scandale et promet de raconter un jour en détails l’histoire de la Renarde. Mais le Garde se fâche et quitte l’auberge de méchante humeur. Dans le bois, la nuit, l’Instituteur, ivre, avance en chancelant et en s’apitoyant sur lui-même et sur ses faiblesses. La Renarde passe sa tête derrière une fleur de tournesol et l’Instituteur, comme illuminé, croit voir la gitane Terinka, une de ses anciennes amours. S’élançant vers ce mirage, il trébuche et se retrouve à terre. Le Curé, qui emprunte la route à son tour, aperçoit la Renarde et la confond aussi avec Terinka qu’il a également aimée quand il était étudiant, à tel point même qu’on l’a accusé, injustement, d’avoir été responsable de la grossesse de la jeune fille. Mais l’arrivée du Garde met un terme aux réflexions du Curé, qui tombe dans les bras de l’Instituteur. Les deux hommes sont effrayés par le Garde et craignent qu’il ne leur tire dessus. Le Garde a beau grommeler que c’est seulement sur la Renarde qui se faufile dans les bois qu’il tire, les deux hommes ne sont guère rassurés. La Renarde rencontre un Renard, très beau, et lui raconte l’histoire, arrangée, de sa vie. Le Renard offre à sa belle un lapin qu’il a tué. Les renards s’embrassent et filent le parfait amour. Quand la Renarde emmène son Renard dans la tanière, les commérages vont bon train parmi les animaux de la forêt. Peu après, la Renarde annonce au Renard qu’elle va être mère. On envoie quérir un prêtre, le Pivert, qui marie les amants et toute la forêt applaudit ces noces.
ACTE III C’est l’automne. La forêt est tranquille. Harašta, avec son panier de colporteur sur le dos, s’y avance dans l’intention de braconner. Il avise justement un lièvre mort, tué par un renard et s’apprête à le ramasser, quand il se retrouve nez à nez avec le Garde. Celui-ci le salue ironiquement : aime-t-il sa vie solitaire ? Harašta lui fait savoir qu’il se méprend, puisqu’il va épouser Terinka. Le Garde est comme foudroyé à l’annonce de cette nouvelle. Il pose simplement un piège à renard près du lièvre mort et s’éloigne, abattu. Les enfants de la Renarde dansent joyeusement autour de ce piège posé maladroitement, sous les regards de leurs parents. Mais retentit au loin le chant de Harašta. Tout le monde décampe – sauf la Renarde qui s’amuse à attirer l’attention du braconnier en boitant et dansant avec entrain, jusqu’à ce qu’il trébuche et s’arrache la peau du nez. Alors qu’il se relève, il voit les renards faire « patte basse » sur les poulets de son panier. Il se précipite sur son fusil, tire au hasard et tue la Renarde. Dans le jardin de l’auberge, le Garde boit une bière avec l’Instituteur et lui raconte que la tanière des renards est abandonnée et qu’il n’arrivera jamais à se procurer le manchon promis à sa femme. L’Instituteur rappelle avec émotion que Terinka doit se marier aujourd’hui. La femme de l’aubergiste déplore que ce soit Terinka qui hérite du manchon. Il y a de la mélancolie dans l’air. Le Garde sent le poids des ans et décide de rentrer chez lui, par la forêt. Dans la clairière où il avait attrapé la Renarde, le Garde s’attarde un peu, le cœur plein de nostalgie. Il songe à l’éternel recommencement de la vie dans la forêt. Allongé sur le sol, s’enfonçant dans sa rêverie, il s’endort pendant que tous les animaux s’approchent – jusqu’à ce qu’il se réveille et aperçoive, à la place de la Renarde d’autrefois, une toute petite renarde. Il essaie de l’attraper en se promettant de l’élever mieux que sa mère, mais sa main se referme sur une grenouille. La boucle est bouclée. Le Garde, songeur, laisse glisser son fusil par terre.

La Petite Renarde rusée en version intégrale sur WWW.OPERADEPARIS.FR
en cliquant ici
00:52 Publié dans De la poésie au quotidien | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, opéra, spectacle, culture
05/09/2008
René Barde
Aux dernières nouvelles l'ouvrage La soupe à la chaussettede René barde sera disponible en librairie dans une semaine ou deux au plus...

Mon travail? le destin, la providence en décideront: l'arbre ne vend pas ses fruits.

Il faut que je vous raconte cette histoire...
dont voici le contenu:
Monsieur,
Je viens de terminer la lecture du texte de René Barde.
J’en sors bouleversé, de ce bouleversement que seuls procurent les grands textes. Barde appartient à ce peuple des anges de la nuit qui dans l’apprentissage de la douleur de vivre frottent leurs âmes à la noirceur de l’existence, et malgré cela une immense clarté se dégage de leur oeuvre. Je pense à des poètes contemporains malheureusement disparus trop jeunes, comme Thierry Metz, bien plus qu’à Christian Bobin...
J’ai lu crayon à la main prêt à couper dans le texte à la moindre imperfection. Hormis quelques coquilles de frappe ça et là, aucune fausse note ne vient nuire à la symphonie du texte, depuis les descriptions naturalistes de la ferme d’un cruel réalisme jusqu’aux fureurs de ses crises mystiques, aucune phrase n’est en trop, à peine s'il ne faut pas changer une seule virgule à ce texte...
Quelle immense leçon de ténèbres et de soleil brûlant. Pas de faire valoir, pas de flagornerie, aucun branle de l’âme du lecteur, aucune grandiloquence jusque dans la description de sa misère choisie. Il plonge sans cesse dans les gouffres de douleur qu’il creuse avec enchantement au fond de lui-même.
Dire que j’ai été dérouté par ce manuscrit de Barde est peu. Je n’ai pu m’empêcher de penser au bouleversement salutaire que m’avait alors provoqué, jeune adulte, le style de « Voyage au bout de la nuit »... Et aussi la lecture d’Antonin Artaud. Ce mysticisme ouvre sur des paysages intérieurs si immenses.
Le titre qui me vient en tête immédiatement c’est : « On charriait le foin le matin où je suis né »... qui semble être l’événement majeur d’une catastrophe annoncée. La vie...
Il me faudra le relire deux, trois, quatre, fois plus sûrement pour accepter la lumière de ce corps noir, en déceler les nuances, en capter les fulgurances.
Voila en quelques phrases le ressenti de cette lecture.
Est ce l’ange ou le démon qui nous touche à ce point à travers la force de son style. Comment un homme a-t-il pu écrire ainsi et passer aussi inaperçu. Question d’époque ? De destin forcé ?
Non seulement j’ai aimé ce texte, mais j’aimerai en lire d’autres de lui. Car je suis prêt à publier l’auteur de cette oeuvre d’une telle sauvagerie
.../...
Puis revenu à Paris, j'ai téléphoné à Bernard Collet. J'ai donné le manuscrit à lire à Nicolas Grondin qui lui, n'a pas été convaincu lors d'un premier survol du texte. Devant mon insistance, et me faisant aussi un peu confiance, il m'envoya un mail pour s'excuser d'avoir été si peu attentif et mis ce texte en écho aux Mémoires d'un paysan bas breton de Jean Marie Déguignet 1834-1905.
Le manuscrit va paraître en septembre aux éditions l'Arganier dans la collection "La belle ouvrage".
D'ici là patientez un peu. Belle revanche pour le misérable par conviction qu'était René Barde.
Beau témoignage d'amitié fidèle, par delà les quarante cinq années écoulées depuis sa mort.
Et voici la préface par Bernard Collet de La soupe à la chaussette titre retenu pour la commercialisation de l'ouvrage.
Jamais il ne m’a donné à lire le moindre de ses écrits. Ce n’est qu’après sa mort que je les ai découverts, un énorme manuscrit maintes fois remanié, trois cahiers de proverbes, des notes innombrables jetées jour après jour d’une écriture serrée sur toutes sortes de bouts de papier, et puis cette autobiographie à laquelle je savais qu’il travaillait. Il disait qu’elle serait nécessaire à ceux qui viendraient à lire son livre, pour en resituer la genèse et le développement. En fait c’est une œuvre à elle seule où se déroule la trajectoire insolite d’une aventure humaine : de sa rude enfance où, dans la violence de son milieu, il développe le respect de la vie et étend silencieusement en lui des espaces de recueillement et de spiritualité, du jeune paysan, qui au hasard des amitiés, et des rencontres s’instruit quelque peu, de l’ouvrier d’occasion, compagnon de marginaux et de déclassés, qui commence à écrire dans le Paris de l’entre-deux-guerres.
Il fréquente également le milieu fantasque des peintres que lui fait connaître son ami d’enfance Édouard Pignon. Une amitié fertile et ombrageuse le liera au peintre italien Orazio Orazi. La rugosité de ses écrits d’autodidacte et ses convictions farouches lui valent l’attention de Romain Rolland, Marcel Martinet, Gabriel Marcel ou Léon Chestov. Il poursuivra une longue et opiniâtre quête d’absolu jusqu’à sa mort au prix du dénuement, de la souffrance physique, de l’angoisse spirituelle. C’est l’histoire de ce lent dépouillement, que d’autres appelleront descente aux enfers, que relate ce livre. Lorsque je l’ai connu, à la fin de cette odyssée son regard intériorisé posait encore sur le monde et la vie des lueurs farouches, mais pouvait aussi s’embuer de larmes devant un brin d’herbe ou un regard d’enfant. Son corps épuisé où résistait encore un peu la vie, devenait comme transparent. N’était-il pas un ange dans sa mansarde sous les toits ? Seul, terrassé par la vie qu’il s’était imposée, c’est par un souffle de victoire que s’achève son récit : « …c’est sans crainte que je vois le présent approcher l’autre rive. Oui, vraiment, j’ai gagné la partie. »
Depuis longtemps René Barde ne cherchait plus à publier : « Mon travail ? Le destin, la providence en décidera, l’arbre ne vend pas ses fruits » disait-il et c’est à moi, comme à une corbeille d’osier sur le fleuve qu’il confiera ses écrits par testament… Voici plus de 4O ans qu’il s’est éteint dans mes bras un jour d’hiver 1963. La corbeille n’a pas sombré, et le destin a placé Saïd Mohamed sur son errance. Qu’il soit remercié de « sortir au jour » cette vie sombre et ardente, celle de mon ami René.
Photo Bernard Collet "1961"

René Barde et le jeune Bernard Collet
08:41 Publié dans De la poésie au quotidien | Lien permanent | Commentaires (4)
14/12/2007
Preuves à l'appui...

Ai reçu ce mail qui m'a beaucoup fait rire...
Y a pas de raisons que je sois le seul à en profiter...
Aujourd'hui cette petite fille a 379 ans et elle est atteinte d'une hypertrophie des testicules et d'une fièvre affreuse de la grande thyroïde contractée lors d'un viol par un cerf en période de brame en forêt de Ramonville, à proximité d'une marre souillée par des déchets de matière fécale venue des égoûts du Chemin de Pécette.
De plus, lors d'un séjour au Zimbabwe, elle s'est fait bouffer une jambe par un ours blanc africain, espèce extrêmement rare qui a la particularité de sodomiser ensuite ses victimes.
Alors renvoyez s'il vous plaît ce message à tout votre entourage ! Et cela vous portera chance.
La preuve : En 1912, un jeune Irlandais fit suivre ce message par SMS. Dans la semaine, il se vit offrir une place pour la croisière inaugurale du plus prestigieux transatlantique britannique (titinac ou un truc de ce genre) direction New York. Lors de ce voyage il découvrit l'amour, les sorbets, et les bienfaits de la natation.
Ne gardez pas ce message sur votre ordinateur plus de 16 minutes sans quoi le mal sera porté sur vous à jamais.
La preuve : Il y a un peu plus de 2000 ans, un homme reçut ce message sur son ordinateur portable. Comme sa batterie était vide et qu'il ne pouvait pas la recharger vu qu'il n'y avait pas encore d'électricité à cette époque, il fut crucifié avec des clous rouillés et on lui mit sur la tête une casquette épineuse.
Ça fait tout de même réfléchir.
Alors n'hésitez plus ! Renvoyez ce message à tous vos amis. Cela leur portera chance :
Chaque fois qu'ils iront aux toilettes, il y aura du papier.
Chaque fois qu'ils achèteront des knackis à la volaille, y'aura 20 euro cents de réduction immédiate à la caisse.
Chaque fois qu'ils mangeront des moules, il n'y aura pas de petits crabes dedans (sauf pour ceux qui aiment bien).
Céline Dion deviendra aphone à vie.
Si vous le faites, en plus, vous recevrez prochainement un bon de réduction de 15 % valable dans tout le catalogue des 3 Cuisses (surtout à la page 69) et moi, je recevrai un bon de cuissage.
Ce message a fait le tour du monde 759 874 236 587 fois, ne brisez pas la chaîne !
Pour Thérèse, pour vous, pour moi, pour tous vos amis, ne brisez pas cette chaîne. Merci..."
16:30 Publié dans De la poésie au quotidien | Lien permanent | Commentaires (0)
25/11/2007
Au nom du Fleuve
par Arnaud Cabanne

En écoutant cet album, comment ne pas penser à Ali Farka Touré ? En rencontrant l’homme, comment ne pas sentir les enseignements du musicien malien le plus connu au monde ?
Après une trentaine d’années passées à jouer ensemble, ils semblaient s’être éloignés l’un de l’autre, mais Afel Bocoum, en ouvrant son album avec une chanson en hommage à son oncle, rappelle avec clarté et humilité la lignée dans laquelle il s’inscrit. Ce sont "les messagers du fl euve", Alkibar (le nom de son groupe). Ils doivent enseigner et réunir. "Dans mon pays nous sommes alphabétisés à 30% seulement.
Nos gens au nord ne lisent pas les journaux, ils n’écoutent pas de radio, ils ne suivent pas de réunion c’est donc à partir de la musique qu’il faut travailler pour transmettre des messages. C’est ça qu’ils ont envie d’écouter. Il faut véhiculer les messages à travers la musique et que les gens se trouvent à l’aise", explique simplement l’ingénieur agronome de la petite ville de Niafunké. L’héritage musical est clair, l’héritage humain l’est aussi, "il ne faut pas se tromper, le Malien aime écouter ce que l’autre dit et c’est pour ça que nous faisons de la musique pour essayer d’organiser la société". Farka était maire de leur ville, Afel, lui, travaille toujours à son bon fonctionnement.
Les comparaisons sont encore nombreuses, Afel Bocoum peut facilement s’effacer derrière les multiples images du talentueux mais très encombrant maire de Niafunké.
Le musicien vaut beaucoup plus et c’est peut-être pour cela qu’il a mis autant de temps à sortir ce nouvel opus sur un nouveau label, "Moi, j’ai besoin de peu pour être moi-même, pour vivre mais World Circuit a besoin de beaucoup". D’abord produit par la maison de disque World Circuit (Buena Vista Social Club, Oumou Sangaré, Orchestra Baobab et, bien sûr, l’oncle Ali…), il s’est fi nalement tourné vers le label belge — à taille nettement plus humaine — Contre Jour, sur les conseils du guitariste Habib Koité. Depuis quelque temps, ils se côtoyaient régulièrement pour une aventure qui a aussi beaucoup apporté à Afel, Desert Blues. Ce spectacle réunit trois ethnies importantes du Mali sur la même scène. Afel le Sonrhaï, Habib le Bambara et Tartit, un groupe de femmes nomades tamasheq, "On se connaît largement aujourd’hui, du fond du coeur. C’est surtout ça quej’ai pu trouver dans ce groupe. C’est ce qui manque au Mali. Nous, nous avons toujours prôné l’union. On ne connaît pas les guerres, on ne connaît pas la haine. Tout le monde est cousin, cousine, frère et soeur, il n’y a pas de différence. J’en suis très fier."
Fier, il peut aussi l’être de Niger, un album qui s’adresse aux Maliens mais qui, par l’universalité de ses thèmes et par la beauté de ses musiques, peut toucher le monde entier. "Sans ce fleuve, on ne parlerait jamais de Niafunké. Mon inspiration vient de ce fleuve Niger qui, malheureusement, s’ensable jours après jours. C’est un danger mortel. Pourtant, les gens n’en sont pas convaincus. Ils ne mesurent pas l’importance du danger, je saisis donc l’occasion pour leur parler de ce fl euve." Une musique et un cri pour sauver la vie de sa région, qu’il a paisiblement enregistrés au studio Yeelen de Bamako, "J’ai cherché à faire des choses nouvelles mais tout en restant dans ma nature, dans ma musique originale." La nouveauté se trouve avant tout dans le son, toujours épaulé par son groupe Alkibar, par le violon traditionnel (njarka) et la guitare monocorde (njurkle), c’est la présence d’Habib Koité — un nom qui commence à devenir familier — qui donne un nouveau souffle aux arrangements.
En croisant leurs talents, leurs cultures et leurs connaissances les deux musiciens illustrent parfaitement le discours d’Afel Bocoum, "Je fais la carte musicale du Mali. Que je chante en bambara, en tamasheq ou en peul, l’essentiel, c’est de parvenir à mon objectif qui est de me faire écouter, de me faire comprendre."
Pour écouter Afel Bocoum cliquez ICI
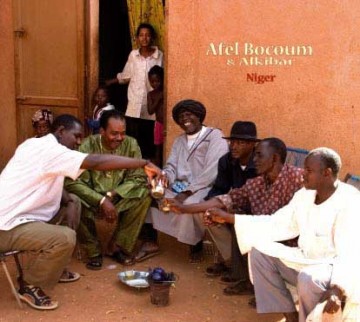
15:35 Publié dans De la poésie au quotidien | Lien permanent | Commentaires (0)
27/10/2007
Aconcha

Aconcha est née à la Havane le 14 février 1946, dans une famille sino-africaine. Dès sa naissance, son oncle Tata, babalao ou “sorcier” dans le culte de la Santeria, décèle en elle une digne représentante de sa lignée et lui insuffle peu à peu son savoir. Mais, à la Révolution, le changement radical de la société cubaine interrompt les aspirations profonde de l’adolescente. Son père, fervent et sincère communiste, lui transmet sa fièvre révolutionnaire et, en 1965, elle obtient un poste à l’ambassade de Cuba à Paris. En mai 1968, elle quitte ces fonctions et opte résolument pour un retour vers ses rêves d’enfance en laissant libre cours à l’énergie créatrice qui l’habite.


Toujours sous l’infuence magique de la Santeria, cette autodidacte se lance dans le milieu artistique et, bientôt, s’exprime à la fois comme peintre, dessinateur, sculpteur, styliste ; elle chante : à travers son CD “Noche Cubana” elle rend hommage au bolero.
Elle vit et travaille au coeur de la forêt dans le parc du Verdon en France. Elle peint pour se protéger, pour exister tout simplement.


Les tableaux et les sculptures d'Aconcha nous parlent de l'abondance, de la fécondité de l'esprit, de l'imagination à travers des femmes, innombrables. Elles sont au centre de toutes les facettes de sa création. Elle les habille de textile, de quartz, de plume, de terre, de coquillage, de papier et puis les tubes de peinture acryliques, les pigments, les pastels secs, les encres, les crayons leurs donnent la lumière, la vie. Leur visage est tantôt solaire, tantôt lunaire, partout obsessionnel.Toute son ouvre est un chant à l'amour,un cantique à la nature et à la femme.


21:05 Publié dans De la poésie au quotidien | Lien permanent | Commentaires (0)
14/09/2007
la vie aux indes (5)

Photo: Bénédicte Mercier
Sa pile de dossiers posée à coté de lui, le fonctionnaire l’ignorait. Avec une lenteur inimitable, il souleva chacun des feuillets, les lus et appliqua son tampon sans produire de bruit. Le ventilateur pour ne pas éparpiller les dossiers ou pour garder l’allure de sérénité qui se dégageait du lieu tournait très lentement aussi. Punaisé au mur ; un portrait de Ganesh badigeonné de taches safran. Des toiles d’araignées s’y accrochaient ainsi qu’à chaque angle de la pièce. Aucun mobilier neuf, des meubles et des chaises en bois aux accoudoirs absents. Le sol était gris, les murs gris bleu passé. Pas de carreaux aux fenêtres, seulement des grilles.
Dans cette absence de mouvement son attention a été attiré par un tout petit insecte qui marchait sur le col de chemise du fonctionnaire. Il l’observait avec une telle insistance que cela incita le rond de cuir à regarder. Un pou s’y déplaçait lentement. L’homme le vit aussi, le pris entre ses doigts et l’écrasa entre ses ongles noirs sans autre façon.
08:55 Publié dans De la poésie au quotidien | Lien permanent | Commentaires (0)
10/09/2007
Liberté j'écris ton nom

Photo Bénédicte Mercier
Dans le chant des townships ou la samba des favelas
Sur le visage ravagé des sans abris aux stigmates de Christ
Sur la peau des sans noms, des sans papiers
De ceux qui attendent et n’auront jamais rien
Sur le dos trempé des migrants noyés
Dans le détroit de Gibraltar
Au fond des gamelles de la faim
Sur les chèques en blanc et la peau des os
Sur l’effigie des billets de banques
J’écris ton nom :Liberté
Extrait de Chardons bleus.... Textes à paraïtre....
16:20 Publié dans De la poésie au quotidien | Lien permanent | Commentaires (0)
01/09/2007
Les Crobards de Malnuit
par Méze Malnuit

Photo Bénédicte Mercier
Heureux les affamés qui ont bouffé au Chaix car il n’y boufferont plus !
Dégueulasse mais pas cher. À midi c’était la flopée, et les coudes dans les côtes, et les haleines et les odeurs et la fumée et la couenne grillée, et les émanations plus ou moins audibles d’origine pas douteuse ; pot-pourri, art total, cour des miracles, messe rabelaisienne, symphonie fantastique pour mandibules en chaleur et grelots coincés et fourchettes à trois dents et à quatre dents, bouillon de culture et bouillon gras, synopsis crado-ubuesque, syzygie des sans-qualités, des sans-familles et des sans pécule, syndicat des sans intérêts, symbiose du bozart sans le sous et du sous smicard sous le signe de l’omelette baveuse et dans la reconnaissance du ventre, foire aux tics, kermesse du bœuf, mode, en morceaux, aux carottes, aux lentilles, au jus, à l’eskimo, à la mau-mau, à la mauritanienne et à la dauphinoise, mais surtout à la Chaixière qu’on appelait ça (recette : vous prenez les abats inutilisables de l’animal, vous les découpez en cubes anodins et vous faites bouillir deux jours durant dans une sauce vitrioleuse à la salive de syphilitique allongée de colle à bois ayant pour rôle d’intervenir au moment où l’esprit de corps menace de manquer au tout). Pendant que j’y suis, quelques autres spécialités de la maison : le chou farci, l’omelette aux fines herbes, l’omelette au jambon, l’omelette aux champignons, les tomates farcies, le gratin dauphinois, la salade niçoise etc. j’y renonce car sorti du chou farci, du bœuf aux carottes, de la verte, de l’omelette fines herbes et du fromage blanc, il fallait passer commande la veille et le Chaix ignorait la formule, non mais sans blague, qu’est-ce que vous croyez !
La Chaixière, une maîtresse femme s’il en fut, même si depuis l’exode elle avait oublié ce que c’est qu’être femme. Mais soyons juste : quand y’avait plus de bouillon et qu’elle montait sur la table pour rectifier le tableau noir, le génie du sexe, et bien malgré elle, révélait une grâce oubliée derrière les rotules, pas de la meilleure, ô non, mais une grâce, un reflet, un rien, là, à la saignée, à côté de la grosse veine bleue et méandreuse comme un affluent du Doubs. J’en connais qui jouaient aux fléchettes dans ce qui avait été sa paire de fesses, qui n’était plus bien sûr que larges crêpes retombées. Elle tournait pas souvent le dos à l’adversaire la vieille carne ; les dix secondes que durait la pirouette c’était feu à volonté ; les vieux vicelards se retrouvaient à la primaire…
— Tu le fais exprès de mettre ta fourchette sous mes pieds ? Attends un peu que je t’savonne.
Le pauvre bougre se ratatinait comme une figue sèche :
— C’est pas vrai, c’est pas moi
— Quoi tu rouspètes ? Allez et t’avises pas de rev’nir demain !
Mais dès qu’elle avait atterri sur le plancher des vaches la sanction passait au panier, à moins que l’autre ait une tête qui lui revenait pas – ce qui arrivait l’un dans l’autre une fois par jour.
Des copains se sont ainsi faits jeter et n’ont jamais osé y remettre les pieds, au Chaix, preuve que c’était des délicats et qu’ils s’étaient trompés d’adresse (exemple : un ancien qui se sentait béni parce qu’il seyait à côté du chef-cochon – c’était le cartel d’esbroufe chargé de contrarier notre mastication par sa présence intimidatoire
– La vieille : « On t’a versé un pot de peinture sur la tête ? Ça fait plus yéyé p’t’être ?
— Dommage que j’soye pas ta mère, tu l’aurais ta fessée. Non mais qu’est-ce que c’est qu’ces allures, tu crois que j’te reconnais pas pac’que t’as changé la couleur du poil ? C’est pas l’Moulin Rouge ici, allez, finis ta portion et que j’te r’voie pas avant d’êt’ passé au dégraissage ! » Le gars ne revint jamais au Chaix.
Quant aux calottes, si la vieille en menaçait un ou deux, je ne lui ai jamais vu en mettre une. Sauf à moi. C’était mon lot, mon privilège, personnel et exclusif. La première m’échut un soir au neuvième coup de 9 h. Sèche, précise, du plat de la main sur l’occiput. Le lendemain ou le surlendemain, quand elle remit ça, c’était déjà routine. Pour sûr, j’ai senti plus d’une fois que ces taloches portaient un message : c’était sa façon à la vieille de dire qu’elle nous aimait bien. Découvrir qu’elle pouvait calotter le client fut pour elle une révélation – à moins que ce ne fut mon crâne, puisque je dérouillais pour les autres ; comme qui dirait un vrai coup de foudre qu’elle eut pour lui, mon crâne, au point qu’elle n’en voulait pas d’autre, rapport au moule sans doute ! Car s’il s’agissait d’essuyer ses paluches il y avait des têtes frisées autrement adéquates ! Quand les fontaines de l’actualité étaient par trop arides pour qu’on se marre à leurs dépens, va pour la fourchette qu’on laissait tomber : simultanée la calotte, et j’avalais mon pain de travers – mais il est écrit que l’homme ne vivra pas que de pain, il lui faut l’occasion de rire, et peu importe le voltage, va pour la java des tripes et le tango des cordes vocales ! Le rire vaut de loin tous les bicarbonates et la cuisine à l’eau de source et la diète et la sauce tartare ; il épate les boyaux et resserre les selles ; riez un bon coup entre chaque bouchée et je vous fais bouffer n’importe quoi, de la soupe aux pneus et du gratin de chapeaux, et du confit de papier Canson et de la salade de parapluies et de la compote de ça-du-nez, n’importe quoi je vous dis… C’est bien pourquoi le Père a trahi son Fils et lui a préféré Rabelais : grâce à icelui il est descendu de son nuage, et les dignes et fades chrétiens peuvent toujours l’y chercher – Il est au Chaix, incognito. Au commencement était le Chaix, les Voies de Dieu sont impénétrables.
Le fils pourtant devait s’en douter. Il prenait ses repas dans son coin, à une table réservée à lui et à sa concubine, la première table au fond de la salle près des fourneaux. Depuis le début j’avais senti quelque chose, le type voulait faire anonyme mais n’y avait pas réussi tout à fait : un air flottait sur lui, facilement repérable bien que diffus, un air qui passait pour noble au regard moins perspicace mais je sais que c’était un air-de-sainteté. Le type avait vieilli, certes : on ne redescend pas parmi les hommes le cœur léger, le visage accusait quelques rides, le cheveu était gris ; mais malgré ça la tête était fière, c’était plus fort que lui sans doute, le menton était relevé, pointu comme la proue d’un brise-glace. Mais c’était les yeux surtout, des yeux d’aigle, habitués au ciel, habités de ciel, des yeux pleins d’espace, un regard de cristal surmonté d’un front gothique, un microcosme de la voûte céleste. Il entrait sans faire de bruit, il se glissait plutôt à l’intérieur. Quand il refermait la porte derrière lui son cœur se fendait en deux. Il posait son écharpe au clou, ouvrait son long manteau, et gagnait sa table à grands pas silencieux. Il saluait discrètement la patronne – il n’y manquait jamais – puis s’asseyait. Il attendait Marie-Mariole. La longue attente immobile, pleine de terreur et de prières. Peut-être dévisageait-il chacun des bougres ici présents, avec son œil du dedans ? Peut-être dévisageait-il chacun personnellement, lui fouillant le cœur et les reins ? Peut-être savait-il avant moi que je vendrais la mèche ?
Il cherchait son Père. Il savait qu’il était là, ou qu’il n’allait pas tarder. C’était peut-être lui, l’homme au béret basque, celui qui s’endormait systématiquement après deux cuillerées de soupe (tous les soirs le même bouillon de pâtes – des petites pâtes en forme d’étoiles ou d’amandes ou les lettres de l’alphabet)… La concubine faisait son entrée, pimpante, fringante, sautillant sur ses talons à ressorts ; elle rejoignait son homme en ligne droite, esquivant d’une hanche experte les angles meurtriers des tables. Ses lèvres peintes affichaient le bonheur. Sa trajectoire en balle de ping-pong faisait effraction dans la clientèle ruminante, les mâchoires s’immobilisaient et ne reprenaient l’exercice qu’une fois la femme assise. C’est alors qu’il souriait – et ce sourire chassait la fumée des cigarettes et des fourneaux, bleuissait l’atmosphère par absorption. Le vieux dormait sous son béret basque, la tête dangereusement inclinée, et la patronne lui criait dans l’oreille :
— Alors, pas encore finie cette soupe ?
C’était comme un clou enfoncé d’un coup sec dans la tempe.
— Ooooooh j’dors mêm’pas !!
Deux minutes s’écoulaient et les ronflements recommençaient sous le béret basque.
— Alors, pas encore finie…
— Ooooh j’dors mêm’pas !!
Deux minutes. Ronflements…
— Alors… !
— Oooooh j’dors mêm’pas !!
… Ronflements…
— Alors !!!
— Oooooh j’dors mêm’pas !!…
Il l’avait 1000 fois vouée au diable, elle l’avait 1000 fois réveillé :
— Alors !
— Oooooh !
— Alors !
— Oooooh !
— Alors ! Alors ! Alors !
— Oooooooooooooh !!!
Moi, Dieu, serai intraitable moi, moi, suis pas venu dans c’bouic pour me laisser distraire par une vieille harpie moi, je dors, est-ce que je suis Dieu oui ou non ? oui da j’le suis, et en tant que tel je dors et c’est pas cette charogne qui m’empêch m’emp m’em rrrrrrr
— Alors !!
— Ooooooooooooooooooooooooo… !
Pendant ce temps l’Autre tenait sagement l’écheveau et Marie-Mariole lui tricotait des écharpes – les yeux dans les yeux et les orteils dans les deltas.
Pendant que la vieille souillarde essayait d’extorquer à Dieu son pardon sous prétexte de lui faire manger sa soupe comme un petit garçon bien sage, Jésus goûtait au péché par dessous la table, le front toujours pur et l’œil céleste.
— Un chou farci un !
Pendant ce temps la terre tournait tant bien que mal sur son axe tordu et la race humaine continuait piano piano son évolution en ingurgitant du chou farci.
— Une finezerbe une !
Pendant ce temps y’avait plus de finezerbe et fallait voir à manger ce qu’y avait.
— Une omelette nature alors
— Une nature une !
— Moi aussi
— Et une qui font deux !
— Moi aussi m’dame
— Non mais vous vous foutez d’moi ?… Combien de nature ?
— Une pour moi
— Une pour moi
— Une pour moi
— Bon alors ça fait trois. T’es sûr que t’en veux pas une toi ? Trois nature trois !!
Pendant ce temps, la nuit allongeait ses grandes pattes noires sur le mur d’en face et sur la rue Millet et sur la ville tout entière et le sommeil poussait du coude les travailleurs éreintés et les rêveurs désespérés une fois de plus par la monotonie de cette saleté de vie.
Pendant ce temps, Nanou rangeait sa poussette rouillée dans l’encoignure de la porte et rentrait en bougonnant :
— Pas chaud jourd’hui, salut, pas chaud brrr...
Frottant ses mains l’une contre l’autre, elle gagnait sa place habituelle auprès du poêle à charbon auquel elle tournait le dos.
— Pas encore allumé c’bon dieu d’machin, pff !
(On l’appelait Nanou parce qu’elle lui ressemblait l’âge en plus ; une cinquantaine tassée, mais fonce-dedans, bien qu’un peu rabotée, et bougonneuse, et pas bégueule, tout ça sur un fond de pâte feuilletée).
— Qu’est-ce tu prends ?
— Potage
— T’as raison ça réchauffe
La patronne était de bon poil ; alors nouzôtres, on restait jusqu’à la fermeture, parce qu’on avait rien de mieux à faire ; la pendule égrenait les secondes qui coulaient sur le mur jauni et le jaunissaient plus encore, et par moment une planche craquait dans le plancher du balcon – le balcon où Calamity Jane avait fait ses gammes – c’était avant qu’elle connaisse Lucky – Elle forgea son nom en mordant la rambarde dès qu’elle fut en âge, tombant ses dents de lait l’une après l’autre au fur et à mesure qu’elles perçaient. C’est là aussi qu’elle contracta un dégoût farouche pour la gent masculine, à cause de Billy the Kid, de 4 ans plus vieux qu’elle.
À l’époque les chambrettes existaient – on s’en servait d’étendage à linge – mais c’est un peu plus tard qu’on leur adjoignit de petites portes individuelles… Ces petites portes me fascinaient. Tous les jours remontaient à la surface de mon esprit de petites questions pertinentes ; et si je ne l’avais pas eu si agile, l’esprit, et le nez aussi large, je n’aurais rien connu de leur histoire…
C’est le soir, pendant la demi-heure qui précédait la fermeture que ça suintait ; il suffisait alors de se vider les méninges par une torsion progressive, ce jusqu’à liquidation de toutes préoccupations étrangères ; alors, la tête vide et le ventre plein, on pouvait interroger les choses : le haut plafond, les murs pisseux, le bois des tables, des bancs et du balcon, et le passe-plats – qui en avait vu passer d’autres – et la caverne du cuistot – c’était le patron soi-même. C’était déveine ou atrophie cérébrale si la question ne trouvait pas la réponse.
Un soir que j’étais seul à table, j’éprouvai quelque chose de bizarre, un sentiment comme qui dirait insulaire et ondulatoire ; j’en compris le sens douze minutes après, en allumant ma clope : le Chaix avait quelque chose à voir avec l’énigme de l’Atlantide, à moins que ce ne fut avec l’arche de Noé.
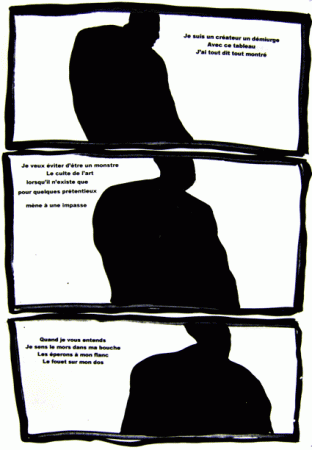
les illlustrations sont de Yves Budin qui vient de publier aux carnets du dessert de lune Visions of Miles
17:45 Publié dans De la poésie au quotidien | Lien permanent | Commentaires (0)
19/07/2007
Les Crobards de Malnuit (2)

L'illustration est de Yves Budin qui vient de publier aux carnets du dessert de lune Visions of Miles
Mèze Malnuit
- Je t’emmène au Falstaff
- C’est quoi ?
- Un bistrot tu verras. Rien d’extraordinaire mais on est tranquille, c’est un peu fermé.
C’était juste à deux pas , au début d’une petite rue grimpante.
En effet, on était assis douillettement à gauche de l’entrée. Je me souviens que c’était assez chaleureux, comme le décor – ou plutôt je voyais le décor à travers la discussion et il y avait une chaleur amicale qu’il n’avait pas forcément -. On buvait des alcools pleureurs – c’est à dire que les verres pleuraient, sans doute d’avoir trouvé l’âme sœur... C’est merveilleux deux âmes sœurs qui se rencontrent. Si je me sentais bavard je pondrais bien quelques pages là-dessus, peut-être même sur un alcool content aux larmes du verre où on l’a mis. – au bout d’un moment j’aperçois – merde c’est pas vrai, mais si c’est bien lui – et alors – t’occupe pas c’est rien – c’est vite dit ! – chuis pas sûr de bien voir, je dois être un peu rond – t’excuse pas, accouche –
Beckett, j’te l’donne en mille !
Ça te fait peut-être rien mais moi ça me... j’en suis gaga...
Chaf comprenait quedale, tout d’un coup j’étais blême, ou rose, et les tempes me battaient comme des peaux de zèbre. Un effort intense pour ne pas exulter, mais vraiment – Peut-être même que ça ne se voyait pas tellement, je ne sais pas pourquoi, je voulais garder ça secret. Je ne pouvais pas oublier Chaf, je n’avais pas le droit, et en même temps je ne devais pas me priver. De quoi ? De l’occasion qui se présentait ?
Est-ce que j’osais aller vers lui ? Non... Faire quoi... Pourtant j’y étais projeté, aspiré, un appel d’air formidable qui me décollait du siège où je n’étais plus pour personne sans en bouger d’un poil. Cloué, figé, et muet, tout en continuant de parler pour dire à Chaf que c’était Beckett qui est là-bas ce vieux tout gris et sec comme une trique là-bas au fond, tu le vois ?
Je lui expliquais que c’était un type extraordinaire, peut-être le plus grand écrivain vivant, oui y a pas de doute, incontestablement bordel, un type sensationnel, un mort vivant, au sens qu’il est au plus près du point limite où la vie a encore le dessus, la preuve l’homme existe bel et bien il est là devant nos yeux – point à partir duquel toute vie cesse et on se décompose, en témoigner encore, à ce point-là écrire, c’est phénoménal, inconcevable, affolant...
Je ne sais pas ce que je dirais, peu de choses en fait, mais intérieurement j’étais bouleversé et les mots me venaient en masse, tels qu’ils sortaient de la bouche d’ombre, ce trou sans lèvres qu’on a dans l’esprit... qui est l’esprit ? c’était même pas des mots c’était de la sensation pure, fallait à tout prix que ça cesse sinon je ne répondais plus de rien...
J’exagère ? Je me le demande honnêtement...
Bien sûr il ne s’est rien passé ; je suis resté là et j’ai vu.
La vieille l’appelait « ce vieux Sam ». Le vieux opinait souvent de la tête. Et lui, Beckett, il se la prenait à deux mains la tête, et la pétrissait comme glaise, la malaxait, doigts à moitié repliés pour que les ongles grattent grattent grattent grattent cette écorce emmerdante le crâne, ce récipient fêlé, CE TROU qui veut passer pour autre chose il y tient, à se demander pourquoi vraiment je ne fais que ça depuis deux mille ans, me gratter la tête, creuser ce trou, je crois savoir mais je n’ose pas dire, pourquoi, alors j’écris, c’est pour ça que j’écris, et – tiens je n’ai pas fini mon verre
Pour la prose c’était mon chouchou, je parle d’un maître à écrire.
Kierkegaard m’impressionnait terrible... Un type fabuleux. Mais un esprit, pas un modèle.
Beckett et Michaux.
Mais je ne veux pas laisser entendre qu’écrire c’était une activité séparée ! C’était une façon de faire, ou d’être, comme boire des pots, causer, faire l’amour. Une façon de faire l’amour. Une autre façon de penser, de dire aussi, et de voir le soleil se lever, monter, puis décliner, la nuit descendre et s’installer, jusqu’à ce que le soleil se lève... Une façon de vivre, sans que ça soit autrement estimable.
Beckett se servait des cailloux (Molloy) et autres babioles pour y coller plus fort, à la vie ; la vie impossible ; l’esprit écrabouillé par la pesanteur de l’absence (quelle absence ?) ; le vide et les tonnes, à supporter jour après jour ; on se décompose, on croule, on fait du sable, du sable d’os...
(J’avais torché Ou bien Ou bien quand j’ai eu cette série d’angines. J’avais gratté mon premier texte en prose, ça se voulait un bouquin, 200 pages, 17 jours d’écriture en pyjama, un bon souvenir). (Mais non, j’étais encore au bahut, puisqu’un prof l’avait su, celui qui nous lisait Michaux, Le grand combat, en postillonnant sur les premiers rangs – Il avait dit « Bravo, mais un bouquin ne signifie pas grand chose, c’est au deuxième que tout commence » - Je l’avais revu une fois dans le train que je prenais pour aller aux Arts, et on avait parlé du Château de Kafka. Postillonnait toujours autant, et cette fois j’étais à portée, hou là !)
y a toutes les choses à dire : afin qu’on les oublie ! Je traîne avec moi une ménagerie d’étrangers qu’un temps chacun j’ai pris pour mon reflet : peintres, auteurs et poètes, hommes de pratiques et d’idéal, et d’autres : personnes connues, sans œuvres que leur comportement, leurs phrases aussi, et toujours des passions, plus ou moins admirables, plus faciles qu’admirables, et finalement encombrantes. Un tas de merde.
Je sens qu’on écrit pour faire le vide, et on l’atteint rarement. Prédestination ?...Beckett écrit pour trouver l’os sous la barbaque, le sel au cœur de la matière. L’âme ?... Une grande brasserie de rien – comme si rien était quelque chose de vivant, plus vivant que tout le reste et comme auteur de ce reste...
Je m’entends penser que j’aimerais dire ce qui se passe (voulais dire se pense) sans aucun souci de la suite. Du pied, le mien, qui fait du pied au pied de la table où je suis assis pour écrire, pour fermer les yeux au décor (toujours le traverser, bêtise. Et illusion) on fait le symbole facile d’une inépuisable et épuisante solitude (Et pourtant j’écris à quelqu’un. On n’est jamais seul).
Je pensais que « mon visage, mon vrai visage, est celui que tu vois quand je ne suis pas là ».
Et la petite qui me disait : « Mèze, si je peux parler 5 minutes avec toi, je boufferai un champ de luzerne, après ». j’ai pris ma verge entre les dents et je l’ai avalée. C’est trop simple.
09:15 Publié dans De la poésie au quotidien | Lien permanent | Commentaires (0)
15/07/2007
Ici Même (4)
Les peintures sont de Dorothy Napangardi pour retrouver son travail Cliquez ici

Gitane, regarde au creux de la main,
La valse des volutes bleues où se joue le destin
Et prédis-moi, des tempêtes, des soifs de rocs
En attendant des horizons nouveaux, au bout du quai.
J'ai cherché le vent en essayant de garder le cap,
Le sexe tendu en direction des néons somnambules.
Dans ce marigot où la nuit donne ses concerts
De sirènes faméliques, ses bagarres entre ivrognes.
Dans les éléments contraires, sur ce radeau,
Certains sont devenus fous, d'autres ont péri,
Quelques-uns ont survécu, aucun n'a prétendu y être
Lorsque est revenu l’apaisement.
Cigarette pour survivre au romantisme des visages
Avides de ces presque rien inventés pour continuer.
Cernés par l'existence trop lourde et la faim de vivre,
où l’on se consume sans remords aucun.

Depuis l'âge de la nuit nous venions ici.
Sur les pierres tendres, des noms, des formes.
Dans un coin, l’empreinte des corps.
A même le sol s'y retrouvaient les amants.
Terre luisante dûe à la sueur et aux frottements des peaux
Au plaisir marqué par la semence qui a coulé sur le sol.
Dans cette grotte, nous avons découvert
L’émotion pure des corps emmêlés et sans l'avoir su,
Compris que nous n'appartiendrons plus à ce monde.
Sans retour possible plus rien ne fait peur.
Des plaisirs, des liens secrets,
Là où les autres enfants jouaient.
Te savoir vivante sans la souillure du possible me suffit.
J'imagine ces instants couronnés d'étoiles et de parfums.
Dans nos festins imperturbables, vivons apaisés
Quand l'amour s'éteint, atteint par tant de heurts.
Malgré confusion et silence,
Pareil à un poisson rouge dans un bocal
Hissons avec légèreté le drapeau de l’ignorance
Puisque les savoirs ne se laissent pas apprivoiser.
Glissons dans cette peau, d'un bout à l'autre du monde,
Avec l’empreinte d'éternité des vieux vêtements.
Nos morts veillent ensemble pour nous donner sens.
Retournés dans leurs croyances ils inventent l'inconnu.
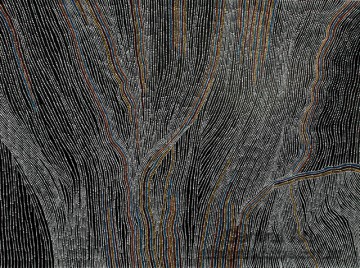
Bouleverser l'enchevêtrement des poutres par une métaphore du rien.
Vivre d'arrogance et avoir comme secours au passé, la désobéissance et un grain amer de café.
Nostalgie de ces années d'enfance incroyable, de voyages dans le possible.
Comment entrevoir la nudité des pénitents sans le romantisme du danger et les bourrelets violets des cicatrices sous les doigts.
La laideur épuise autant que la légèreté.
Traverser des ports, aimer les fleurs, le chant des oiseaux, saluer des poissons rouges.
Rien n'est moins fier que le lierre des anges sur les arbres.
Un matin d'été un cargo glisse au milieu des champs parmi les vaches noires et blanches.
Des quidams ébahis applaudissent un cortège qui glisse sur l'asphalte toutes sirènes affolées.

Un basque qui joue de la musique aborigène
Si vous avez le goût pour les choses étranges, comme un mélange de flamenco/musique aborigène, voila une bonne adresse.
Quand je l'ai entendu jouer sa musique, face à l'océan sur le port de San Sébastian, j'ai tout de suite pensé à Gaston Lagaffe. Je ne sais pas pourquoi....
NIKOLA IBAN seul ou avec son groupe Samar le morceau Cuatro a déguster seul ou accompagné le morceau Maroko assez étonnant aussi. du ragga/reggae/aborigène c'est pas mal non plus à condition d'être totalement iconoclaste. Et pour ceux qui doutent encore, le petit dernier pour la route Totem
Si vous désirez vous procurer son CD: Cliquez ici
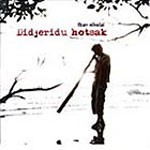
17:05 Publié dans De la poésie au quotidien | Lien permanent | Commentaires (0)
21/06/2007
ICI MÊME (3)

Photo Bénédicte Mercier
On avance sur une ligne, une route sans destination, une sente recouverte de taillis épineux
Départs, retrouvailles, souvenirs, charpente de l'univers sont le catéchisme de la souffrance.
Demander un répit et le droit de guetter sans être inquiété.
Strip-tease de sentiments qui mijotent sous les rêves dans une recette inédite.
La douleur nous réunit plus sûrement que la joie.
D'elle nous retenons la silhouette honteuse qui demeure.
Comment apprécier l'insolence des moineaux et convaincre l'ombre du bien fondé de la lumière
Survivre aux ratages de l'existence et à cette nostalgie qui éreinte.
Mains tendues en attente du miracle
L'offrande du silence se reconnaît à la trajectoire d'une étoile filante.
Les univers qui s'entrechoquent scintillent dans le contre-
jour et opposent la violence du verbe, à celle de vivre privé de mots.
Prendre le feuillet pour éloigner les démons de l'inquiétude.
Je n'ai pas cru à l'image volée de l'aube, ni dilué le vin à l'usure du fruit pour trouver le rythme du blues et le passage du nord au sud
La nostalgie a comme contraintes, des pans d'oubli, des livres inachevés et au jour le jour le reniement salvateur comme tracé d'épure.
La soif conseille à la poussière de sourire à l'ivresse et la sirène sortie des eaux d’apprendre à nager pour perdurer dans les rêves.
Ce texte vient d'être publié, avec 25 autres, aux éditions la Tarabuste dans l'anthologie de la revue Triages.
Les éditions la Tarabuste seront au marché de la poésie place Saint Sulpice. Pour en savoir plus sur le marché de la poésie Cliquez ICI
21:00 Publié dans De la poésie au quotidien | Lien permanent | Commentaires (1)
19/06/2007
ICI MÊME (2)

Sentinelle... Anto 2005
Blaise, ce qui à ton époque semblait épique, l'exotisme des paysages verts et l'eau qui ruisselle du kilimandjaro, les parfum bleus de soleil, les volutes de viandes cuites au brasier dans la brume, la litanie bienveillante des boogies, le youlements des femmes guatémaltèques, la lumière en peau de mosaïque des figuiers, tout est devenu une verrue.
L'insulte nous a cueilli au coeur de la joie. Déplumé l'oiseau aux sept couleurs. Sidaïque l'oncle Jo des Amériques. La petit Jeanne s'injecte de l'héroïne.
Comme des orphelins, efflanqués nous ne croyons plus en rien. Nous avons tant vu de désastres, de boue ruisseler des montagnes, de louves pleines les flancs ronds, de vagabonds pointer sur la carte du ciel une étoile rouge. De marins condamnés à errer d'îles en îles convaincus des plaies d'Egypte essuyer de la main des tempêtes sans vent, étrangement ballotté entre l'histoire d'un monde aux urgences de grisaille et l'impatience de vivre.
Nous avons tout subi, l'outrage, la félonie, les malversations et la fièvre des morsures. Il faudrait retourner d'autres terres, creuser de nouveaux sillons, chercher des mots pour dire la simplicité.
S'avancer sur la pointe des pieds et offrir aux ratages de l'existence la croyance du silence. Aller dans la profondeur pour trouver la sève, privés de la joie des sens dans notre réclusion.
A trop voir l'inféconde tristesse des lendemains, le goudron collé aux chevaux de bois comment inventer le quotidien et consumer d'immédiat nos recoins d'insolite.
De tous ces égarements aucun n'est fiable. Nous ne pouvons ignorer ces malédictions. Sur le berceau veille une dame belle et rieuse malgré les rides, avec une voix râpée de Gauloise Verte ou, de Disque Bleu ces marques de cigarettes disparues depuis, Abreuvée de lune camomille au bar des petites heures, elle aime la peau de chagrin et la monnaie de singe qui réclame sa part de miracles.
Nous qui avons trop festoyé et trop bu, poupées désarticulées nous tentons d'apprivoiser le manque avec fierté en prenant le parti d'en rire.
Nous avons peur de nous perdre et de nommer la salvatrice folie. Tu vois tout a vraiment changé
Ce texte vient d'être publié, avec 25 autres, aux éditions la Tarabuste dans l'anthologie de la revue Triages.
Les éditions la Tarabuste seront au marché de la poésie place Saint Sulpice. Pour en savoir plus sur le marché de la poésie Cliquez ICI

08:10 Publié dans De la poésie au quotidien | Lien permanent | Commentaires (0)
12/06/2007
Des bleus à l'âme

06:08 Publié dans De la poésie au quotidien | Lien permanent | Commentaires (0)
30/05/2007
ICI MÊME
Ces textes sont extraits de ICI MÊME
à paraître aux éditions Tarabuste dans l'anthologie annuelle
Les photos sont de Misha GORDIN
L'imparfait rend compte des défaites.
C'est le moindre jeu du destin...
Tout ce qui a été ressenti l’a été avec force.
Mystère de la vie perverti par les dommages
Des joies sans suites, nous retiennent
Avec de simples éclats de voix
Au fond d'un bouge où s'estompent les rêves.
J'aurais tout connu, des générosités obséquieuses
Aux hommes enterrés sans sépulture.
La pitié, le salpétre, le juste achévement,
le souffle de la couleur qui vibre à l'infini.
Loin de vous, j'ai fui, pour survivre.
Mais je ne comprends toujours pas les notes
Des mélodies savantes qui sous mon chapeau.
Déroulent leurs sons. Est ce bien normal?

J'ai repris à mon compte les croyances,
Les rires contagieux, les perles convaincues d'orage.
Avec pour toute innocence, des chagrins
qui brûlent entre les façades cruelles.
Je n'ai pas fui ces montagnes.
Mais comment revenir sans bagage vaniteux
Dans le territoire de l'enfance qui vacille.
Lorsque chaque instant est compté.
Scénario pour les corps sans pitié
D'une humanité que tout réduit à l’ordure.
Dire l'instant émerveillé, devient insolence
Aux hommes obscurcis par trop de misère.
Echapper à la foule des regards convergents.
Se divertir de miracles au compte de la fugue.
Calme lumière.

Rien ne laisse tranquille ni l'apparent calme,
Ni la paisible rivière.
L'hiver a sa part de jours éreintés de grenaille.
Etrange sensation de monotonie
Qui effleure à la surface plate du ciel de mercure.
Dans l'eau deux soleils, un de lune, l'autre de terre.
Ils s'observent, s'attirent, se repoussent.
Frères jumeaux.
A chacun revient sa part.
Inventaire sans miracle de l'adolescence anéantie
Par le manque de soleil.
Des affamés j'ai gardé les vertus de l'illumination,
Les tenailles du silence et la tyrannie de l'aube.
L'avantage d'être aussi lointain permet de convenir du factice.
Les jours ressemblent de plus en plus à des mois
Et la plaine n'offre pas de vue à l'aigle.
Sous sa pelisse la terre nue s'ennuie
De ses ramures fatiguées de l'hiver.

La musique douce envahie les recoins où poser ses pas.
Tapis d'images dans lesquelles se reconnaître, les lumières incendient par-delà les monts.
Il faut se perdre dans la confusion ou la trajectoire d’un clandestin au fond d'un contenair.
Pointe d'orgueil, ces cicatrices dissimulées au regard.
En ce temps là j'écrivais des poèmes reflets de la tourmente, obscurs et cruels, durs à lire, moins à écrire.
Ils parlaient des compagnons de nostalgie adolescente
dont les âmes mortes ne sauraient réveiller les corps.
Ils ont oublié l'essentiel, mais trouvé le repos.
Aimer les hommes malgré la démence
Qui les rend si lointain à tout.
Le malheur ne touche pas les animaux.
Calmer les vents de terre par des instants fragiles,
des offices de tendresse, des regards, des phrases parfois.
Muscles sous la peau.
Pour retrouver le monde fantastique de Misha Gordin Cliquez ici
21:05 Publié dans De la poésie au quotidien | Lien permanent | Commentaires (2)
25/05/2007
DEUX ANS D’ABSENCE
Par Mouloud Akkouche

photo Bénédicte Mercier
-Dépêche-toi! râla une brune aux cheveux très courts. Qu’est-ce qui t’arrive ?
Essoufflée, Monique pesta contre les embouteillages du périf et rajusta sa veste d’hôtesse de l’air.
Un quart d’heure plus tard, le commandant de bord annonça le départ pour New York.
Avec les autres hôtesses et stewards, Monique commença la distribution de sourires et de recommandations aux voyageurs. Une lumière brillait dans son regard. Elle était heureuse d’avoir repris le boulot 17 jours auparavant. Après une très grave dépression, elle était restée plusieurs mois en arrêt de maladie. Contrairement à l’avis de son médecin, elle avait décidé de reprendre son poste. A peine sa tenue de travail revêtue, elle s’était à nouveau senti rassurée, au sein d’une famille, et retrouva rapidement le goût de vivre. Persuadée d’être sortie complètement de sa nuit, elle avait abandonné sur-le-champ les antidépresseurs et les séances chez son psy. Excepté avec une hôtesse d’une autre compagnie, Monique ne parlait pas beaucoup d’elle, ses collègues ne connaissaient pas grand chose de sa vie privée.
-Je reviens Karine, dit Monique à la chef de cabine.
Dans les toilettes réservées au personnel, elle fouilla dans son sac et sortit une photo. Ses mains se mirent à trembloter. Les yeux sur le cliché, elle murmura plusieurs fois: << Fabrice, faut vraiment que tu me dises pourquoi… >>. La lumière disparut de son regard. Elle grimaça et rangea la photo.
Comme des centaines de fois, elle enfila le gilet de sauvetage puis, joignant les gestes à la parole, expliqua au passager les consignes de sécurité. Le seul moment qu’elle n’aimait pas du tout, elle se trouvait ridicule.
L’avion avait décollé depuis une demi-heure lorsqu’elle ouvrit la porte de la cabine de pilotage.
Jean-Marc, le commandant de bord, la salua d’un hochement de tête. C’était un type d’une quarantaine d’années plutôt agréable qui, cependant après quelques verres à l’hôtel, voulait souvent s’envoyer en l’air avec des hôtesses. Il avait aussi tenté sa chance avec elle… Face à une ancienne championne de boxe française, le dragueur avait compris qu’il valait mieux garer ses couilles.
- Jean-Marc?
Il se tourna vers elle.
- Qu’est-ce que tu veux ?
Elle braqua l’ arme sur sa nuque.
- Si tu m’écoutes, tout ira bien.
- Mais tu es folle ?
Le co-pilote ouvrit des yeux ronds.
- J’ai collé trois bombes dans les chiottes. Si tu passes pas ce message à la tour de contrôle, je fais tout sauter.
- Mais qu’est-ce qui…
- Ta gueule et lis !
Il entra en contact avec la tour de contrôle:
- Ici, le commandant de bord du vol AH 567, je dois faire une déclaration urgente. Me recevez-vous tour de contrôle ?
- 5 sur 5.
- Je….
- Nous vous recevons, vous pouvez parler.
Le papier dans les mains, il débuta sa lecture d’une voix tremblotante :
- Ceci est un message de Monique Bertin… Je suis hôtesse de l’air sur le vol AH 567 en direction de New York et… et je viens de prendre en otage cet avion. J’ai installé plusieurs explosifs. Ma demande est simple : je veux que vous contactiez mon mari Paul Bertin pour qu’il s’explique en direct avec moi… Je veux savoir pourquoi il m’a quittée. Je veux savoir. Quand je l’aurais eu en direct, je me rendrai… pas avant.
<< Allô ! Ici tour de contrôle… Vous arrêtez vos blagues : on n’est pas le premier Avril…>>
Elle vissa le canon sur la nuque du commandant.
- Dis-leur que c’est pas une blague. Dis-leur ou je commence par toi… Magne-toi !
- Ici le commandant Jean-Marc Lagrange… Je confirme la prise d’otage de notre vol par l’une de nos hôtesses de l’air.
- C’est une plaisanterie de mauvais goût et je…
Elle saisit le micro :
- Ici Monique Bertin, je vous donne une heure pour entendre mon mari sinon je fais tout sauter.
- Mais nous…
- Une heure, pas plus !
Elle coupa la liaison.
- Monique, intervint le commandant de bord, tu délires…tu… Ce n’est pas croyable que toi…
Elle dévisageait avec une grande satisfaction ce petit macho dégoulinant de trouille.
- Regarde au coin de ta cabine… Le petit truc que tu vois scotché est un explosif relié à cette poire dans ma main : un système très efficace. J’ai juste fait mon p’tit marché sur le net.
- Mais comment t’as fait pour passer tout ça en bas.
Elle sourit.
- Depuis le temps, je les connais bien les mecs de la sécurité. En plus, j’ai pas la gueule du terroriste moyen.
- Tu déconnes là, il faut que tu retrouves la raison. Tu sais, dans ce genre de boulot, on passe tous par des états de…
- Ferme-là ! Prie pour qu’ils me mettent en relation avec mon mari…
Le commandant de bord et son co-pilote ne prononcèrent plus un mot. De temps en temps, ils échangeaient des regards mêlés d’inquiétude et d’incrédulité.
Adossée à la paroi, Monique alluma une cigarette. Personne ne l’empêchera de fumer.
Un quart d’heure avant la fin de l’ultimatum, elle ordonna :
- Tu me passeras la communication dans le vestiaire. Je n’en bougerai plus jusqu’à ce que je l’ai. Ils ont encore jusqu’à et quart, pas plus. Salut chef.
- Tu es…
- Oui, givrée.
- Arrête de déconner maintenant !
- Pas de conneries toi Jean-Marc, ricana-t-elle, n’oublie pas cette petite poire dans ma main.
- On peut trouver une autre solution.
Le regard absent, elle lâcha :
- Il doit m’expliquer, c’est tout.
Elle sortit de la cabine.
- Comandant Jean-Marc Lagrange, ici la tour de contrôle. Vous me recevez ?
- Je vous… vous reçois, balbutia-t-il. Alors vous l’avez retrouvé son mari ? Elle est devenue complètement folle, elle a vraiment installé des explosifs.
- Nous avons effectivement retrouvé la trace de son mari.
Il poussa un ouf de soulagement.
- Passez-lui la communication, qu’on en finisse avec cette histoire.
Un toussotement succéda à ses propos.
- Il y a un disons… un problème.
- Mais quoi ? s’impatienta-t-il.
- Son mari… son mari s’est suicidé il y a 2 ans.
21:10 Publié dans De la poésie au quotidien | Lien permanent | Commentaires (0)
08/05/2007
Souleymane Diamanka
07:00 Publié dans De la poésie au quotidien | Lien permanent | Commentaires (0)
23/04/2007
Monsieur Ernesto

L'illustration est de Yves Budin qui vient de publier aux carnets du dessert de lune Visions of Miles
Longtemps il a réclamé le « Monsieur » devant son pseudonyme. Quand un voisin de bar l’appelait d’un « Ernesto vient boire un coup », il corrigeait : Non Ernesto ne veut pas boire un coup, mais Monsieur Ernesto accepte volontiers un verre. Non mais ! Les bonnes manières ne sont pas faites pour les chiens…
Il lui est arrivé de dormir sous le porche dans un carton, après une soirée trop arrosée. Lorsqu’il n’a plus ni jambes ni métro pour rentrer. Sinon, jamais de la vie il ne se mélangerait aux autres dans un lieu d’accueil. Non, vraiment, ça ne lui dit pas… Des gardiens, l'extinction des feux, la prison, comme s'il n’en était pas sorti. Non ça lui dit vraiment pas. Il squatte un appartement dans un immeuble habité. Il ne dit pas, où.
-On ne sait jamais. Il y a trop de gens malhonnêtes.
Moi j’ai ma maison à moi. Bien sûr que non, elle est pas à moi. Mais c’est chez moi. Là où j’habite. Je paye pas de loyer et je suis chauffé à l’oeil, s'il vous plait... Une combine avec un vieux compteur. Un trou dedans pour bloquer l’horloge qui tourne et le tour est joué. La clef, je l’ai eue par une vieille connaissance. Une gardienne d’immeuble. Une bonne copine que j’ai pas mal câliné par le passé, même du temps où elle était mariée. Lui, il était souvent parti. Et elle, elle avait chaud aux fesses alors je lui ai rendu la vie agréable. Elle me renvoie l’ascenseur. Normal. Je vais encore la voir de temps à autre quand elle m’appelle, mais c’est plus comme avant.
-Il me manque trop de points à la retraite. A cause de tous ces jours évaporés dans l’emploi du temps. La prison, la cavale, les braquages, ça vous occupe un homme. Une vie bien remplie, quand j’y repense.
-Les femmes, envolées les unes après les autres… La première, il y a longtemps qu’elle a mis les bouts, avec un forain... Si ça se trouve, elle est déjà morte. J’ai encore une photo, ou ce qu'il en reste. Une de perdue dix au jus...
-Au début, j’étais typographe. Un sacré boulot et des gars au poil! Va savoir à quoi ça sert toute cette saleté de progrès. Je me suis bien marré avec les compagnons de l’atelier, oui…
-En ce temps-là, les ouvriers savaient se faire respecter. Le métier s'est perdu. Bouffé par ce soi-disant, putain de progrès. Belle saleté, oui. Et regarde les tous, ceux-là. Ils font dans leur culotte. Prêts à vendre père et mère pour que le système continue à leur remplir la gamelle. Pas un seul pour racheter l’autre. Tous des faux culs. Ils viennent boire un verre et ils s’empressent de rentrer à la maison. Leurs bobonnes les attendent. Ils crânent comme ça, mais pas de danger qu’ils soient en retard. La soupe les attends ! La télé et au lit. Parfois une galipette, quand madame veut bien. Et c’est elle qui décide comment ça se passe. Ils se gavent de télé. Regarde comme il sont moches, gras, laids. On le croirait démoulés d’une usine à cons.
Un long silence. Ernesto semble se plonger profondément dans ses souvenirs.
-Moi c’est la routine qui m’a tué. Rien à faire. Quand ça ronge un homme, il faut se bouger… Changer d’itinéraire pour se rendre au boulot, au début ça donne l’impression d’être un autre. Ca dure trois quatre rue. Puis de toute façon arrive l’angle où il faudra tourner à gauche. De toute façon. Et cette façon-là, elle finit par peser. Des tonnes. Il reste bien la solution de regarder en l’air. Là-haut le ciel, les pigeons. Mais on fout les pieds dans la merde sans s’en rendre compte.
Au début je croyais encore en Dieu… J’étais encore jeune, c’est pas moi qui ai cessé de croire en lui, c’est lui qui a cessé de croire en moi. C'est toujours comme ça. Pas grand-chose à attendre de ce coté là non plus… Je devrais pas dire trop de mal des soutanes vu que je tape aussi dans leur râtelier. J’ai ma cantine chez les frangines du couvent. Un bol de soupe, un morceau de pain, du fromage. Mes vêtements sont en bon état. J’ai la casquette assortie à la veste en tweed... Avant j’allais au secours populaire pour les vêtements, mais les fringues des pauvres ne valent pas tripette. Pas comme chez les snobinards. Eux ils savent se mettre le cul au chaud.
Moi j’aurais aimé être lord à cause des chevaux. J’ai mes tuyaux sur le tiercé et je les échange contre des canons au bar. Les journaux coûtent chers. Alors comme je peux pas lire « Le Monde » tous les jours, ni les canards des courses, je garde un oeil sur la télévision. Pour pas qu’un canasson m’échappe. Des fois, j’aurais pu gagner des fortunes si j’avais eu l’argent au bon moment, pour le parier. Je me débrouille bien quand je compare à certains. Une bonne cuite de temps en temps. Je rigole pas souvent, mais quand même un peu. Et quand je parle philosophie c’est parce que j’en ai un petit coup dans le nez. Parce que moi mon gars, y a rien plus que l’hypocrisie qui me dégoûte. Les gros, ils protègent bien leurs plates-bandes. Et eux y a pas de danger qu’ils y aillent en prison.
— Tu vois mon gars moi je pense qu’un taulard, ça donne du boulot à pas mal de monde : le juge, les flics, les avocats, les gardiens. Et qu’ensuite un taulard, ça travaille beaucoup et à des tarifs très compétitifs. Une économie parallèle incontournable, dit-il en agitant l’index, comme un avocat dans sa plaidoirie. Manutention d’imprimés en tout genre, cuisines industrielles dans ses centrales modèles. La multinationale de repas collectif en connaît un rayon dans la rentabilité des taulards.
« Le redressé paye même ses cigarettes plus cher que dans le civil et avec la bénédiction de la République. Le sous-homme loue aussi sa télévision, sa sécurité et l’air qu’il respire. Ce qui ne l’empêche pas de se pendre. Économique ou politique, le système répressif ne défaille jamais. dès la maternelle il faut intégrer les règles du système, et comprendre que seuls ses représentants dominants ont le droit de les transgresser.
Le gendarme et le douanier maintiennent le prix du marché des produits illicites. Ils surveillent que le marché ne soit pas inondé par des vendeurs irresponsables, sinon les cours s’effondreraient. La rentabilité devient plus importante, si l’offre est limitée. De temps à autre, il faut faire un peu de ménage parmi les commerçants les moins coopératifs, de façon à maintenir le marché dans des normes acceptables. L’argent de la drogue sert parfaitement le système. Les pauvres en produisent pour s’acheter des armes dans des guerres entretenues par des gens dont c’est l’intérêt de les entretenir. Les riches ont le pétrole, les autres l’illusion du paradis terrestre. Que le produit abonde et les cours s’effondrent. Alors, plus d’industrie d’armes, plus de guerres et la désolation du chômage. À un bout ou à l’autre de la chaîne les pouilleux trinquent. Pertes et profits identifiables. C.Q.F.D...
— Moi, Ernesto, j’assume mon irresponsabilité, mon inconséquence et autres déviances, mais je voudrais bien que l’on me soumette une autre explication qui tienne aussi compte des lois du marché. », c’est ce qu’il dit quand il se met en colère Monsieur Ernesto, .
— C’est ce que je pense, vraiment. Si on me cherche, on me trouve au « Café du Bon Coin », ou « Au canon d’en face », chez Robert pour les intimes, ou « Au bistrot du champ de courses ».
Dans mon jeune temps, j’étais un poète, mais j’ai eu le malheur de mélanger les affaires et le cœur. Ça ne réussi jamais.
19:35 Publié dans De la poésie au quotidien | Lien permanent | Commentaires (0)
24/03/2007
De la prétention littéraire

collage Maryvonne Lequellec
Pour écouter la musique de l'ami Patrick Chartrolen lisant ce texte....
C’est sûr, si j’avais été moins lâche, il aurait été plus judicieux de partir quand il en était encore temps. Pour se remettre des frayeurs, on laisse glisser sa plume tout le long de la ligne en espérant en tirer quelques récompenses. Mais tout cela est vain. Les plaisirs spirituels sont bien trop spirituels, les physiques, s’ils finissent en apothéose et procurent plus de satisfaction que de planter sa plume dans un encrier, ils épuisent la bête.
Il reste la littérature pour faire le bilan de tout ce temps où j’ai fini par me demander si tout cela a été bien réel. J’ai souvent replongé à l’eau au risque de me noyer encore et d’appeler à l’aide, parce que ce bateau est mieux dans les tempêtes, avec des voiles blanches et rondes de la force d’un ciel d’ardoise. Plein de cet oxygène animé de vent polisson à faire péter la cage thoracique. Piailler avec les mouettes en s’ébattant dans les risées, en plongeant, filant, planant, rebondissant sur les cascades de l’air. Avis de coup de vent, tempête, tornade, ouragan, il n’y a que dans les turbulences, quand le zeph souffle dans les drisses, que les roseaux trépignent, que les haubans sifflent, que la membrure craque, que le toit remue, que l’eau ruisselle en fines lézardes transparentes sur les vitres, qu’on sent réellement le poids du vivant. On sait qu’après arrivera le soleil qui réveillera tout ça. Comme une grande lessive dans un bistrot qui vient d’ouvrir. Alors que le sol est encore mouillé, que l’odeur du café emplit déjà la salle et que vous êtes le premier client. Cette appréhension perce sous la peau de ces instants. Il n’y a rien à dire. Ce sont par ces moments là qu’on légitime nos heures dans ce foutoir.
On a beau avoir l’impression que dans le temps imparti, on ne réussira pas à boucler ce pourquoi on pense être fait, -il est étrange de croire qu’on doive mener à bien un projet ou subir un ensemble d’événements-, on ne désespère plus, bien que le corps s’amenuise, que l’échine se courbe et que le ton de la voix devienne moins arrogant et que ce projet-là, quoi qu’il arrive, ne laissera jamais assez de temps à l’existence. Que chaque jour sera toujours trop court, chaque heure incomplète, chaque instant inachevé suspendu au néant, comme un manque permanent..
Depuis le temps que l’imminence du désastre est perceptible, on s’étonne qu’il ne se soit pas encore produit. Tout échappe, c’est bien la seule certitude que peut avoir la marionnette qui coupe son fil pour s’aventurer au-delà du cercle des projecteurs. Si elle savait, elle s’abstiendrait de tenter de s’évader. Chercher la raison qui pousse à écrire, peindre ou dessiner, c’est perdre son temps. Il faut agir pour se vider de tout ce prurit et se remplir à nouveau, tout simplement. Ce qui a été fait n’est plus à faire et ne pèsera plus de tout son poids de remords. Tant pis si cela a été mal fait, et tant mieux dans le cas contraire. C’est en faisant qu’on apprend à se soulager mieux chaque fois.
09:30 Publié dans De la poésie au quotidien | Lien permanent | Commentaires (1)
18/03/2007
Les fréres Joubran
Originaire de Nazareth, en Galilée, Samir Joubran, virtuose du oud déjà consacré dans le monde arabe, accède aujourd'hui à une reconnaissance internationale.
Samir & Wissam ont commencé à tourner hors du Moyen-Orient en Août 2002, leur réputation n'a cessé de croître au fil des concerts en Europe, au Canada et au Brésil. Leur premier album "Tamaas", paru sur le label daquÌ en 2003, est un chef d'œuvre, témoignage de leur connaissance intime de la musique et de l'histoire de leurs instruments, et de leur formidable talent d'improvisateurs.
Leur plus jeune frère, Adnan, considéré comme un prodige par ses frères aînés, a fait ses débuts sur la scène internationale en Octobre 2004.

Pour découvrir le travail de Wissam Joubran
08:25 Publié dans De la poésie au quotidien | Lien permanent | Commentaires (0)


