30/05/2007
ICI MÊME
Ces textes sont extraits de ICI MÊME
à paraître aux éditions Tarabuste dans l'anthologie annuelle
Les photos sont de Misha GORDIN
L'imparfait rend compte des défaites.
C'est le moindre jeu du destin...
Tout ce qui a été ressenti l’a été avec force.
Mystère de la vie perverti par les dommages
Des joies sans suites, nous retiennent
Avec de simples éclats de voix
Au fond d'un bouge où s'estompent les rêves.
J'aurais tout connu, des générosités obséquieuses
Aux hommes enterrés sans sépulture.
La pitié, le salpétre, le juste achévement,
le souffle de la couleur qui vibre à l'infini.
Loin de vous, j'ai fui, pour survivre.
Mais je ne comprends toujours pas les notes
Des mélodies savantes qui sous mon chapeau.
Déroulent leurs sons. Est ce bien normal?

J'ai repris à mon compte les croyances,
Les rires contagieux, les perles convaincues d'orage.
Avec pour toute innocence, des chagrins
qui brûlent entre les façades cruelles.
Je n'ai pas fui ces montagnes.
Mais comment revenir sans bagage vaniteux
Dans le territoire de l'enfance qui vacille.
Lorsque chaque instant est compté.
Scénario pour les corps sans pitié
D'une humanité que tout réduit à l’ordure.
Dire l'instant émerveillé, devient insolence
Aux hommes obscurcis par trop de misère.
Echapper à la foule des regards convergents.
Se divertir de miracles au compte de la fugue.
Calme lumière.

Rien ne laisse tranquille ni l'apparent calme,
Ni la paisible rivière.
L'hiver a sa part de jours éreintés de grenaille.
Etrange sensation de monotonie
Qui effleure à la surface plate du ciel de mercure.
Dans l'eau deux soleils, un de lune, l'autre de terre.
Ils s'observent, s'attirent, se repoussent.
Frères jumeaux.
A chacun revient sa part.
Inventaire sans miracle de l'adolescence anéantie
Par le manque de soleil.
Des affamés j'ai gardé les vertus de l'illumination,
Les tenailles du silence et la tyrannie de l'aube.
L'avantage d'être aussi lointain permet de convenir du factice.
Les jours ressemblent de plus en plus à des mois
Et la plaine n'offre pas de vue à l'aigle.
Sous sa pelisse la terre nue s'ennuie
De ses ramures fatiguées de l'hiver.

La musique douce envahie les recoins où poser ses pas.
Tapis d'images dans lesquelles se reconnaître, les lumières incendient par-delà les monts.
Il faut se perdre dans la confusion ou la trajectoire d’un clandestin au fond d'un contenair.
Pointe d'orgueil, ces cicatrices dissimulées au regard.
En ce temps là j'écrivais des poèmes reflets de la tourmente, obscurs et cruels, durs à lire, moins à écrire.
Ils parlaient des compagnons de nostalgie adolescente
dont les âmes mortes ne sauraient réveiller les corps.
Ils ont oublié l'essentiel, mais trouvé le repos.
Aimer les hommes malgré la démence
Qui les rend si lointain à tout.
Le malheur ne touche pas les animaux.
Calmer les vents de terre par des instants fragiles,
des offices de tendresse, des regards, des phrases parfois.
Muscles sous la peau.
Pour retrouver le monde fantastique de Misha Gordin Cliquez ici
21:05 Publié dans De la poésie au quotidien | Lien permanent | Commentaires (2)
27/05/2007
Des relations humaines entre auteur et éditeur

Cette photo provient du site du photographe Cara Barer cliquez sur son nom pour voir son travail...
Ce silence n’augure rien de bon. Je vieillis ? Il devient moins exigent ? Il s’est habitué à mon style. C’est mauvais signe. Cela voudrait-il dire qu’il ne sera plus capable à l’avenir de discernement ? Je vais devoir être obligé de changer encore de crémerie. Cela ne lui à donc pas suffit de faire faillite et de m’emporter par le fond trois textes, passés à la concurrence, chez un fou dingue. Un de ces emplumés du chiffre, pas foutu de parler de style, seulement de pognon. Un de ces gestionnaires sorti d’une de ces usines à crétin, sec comme un bilan. J’aurais pu aller lui porter le nouveau manuscrit à celui-là, parce que finalement c’est mon nouveau patron. Pas question je préfère encore mon Thénardier, au moins je sais à quoi m’attendre avec lui. L’autre avec sa tronche de médecin légiste m’inquiète plus encore. Oh non, il ne cause pas, il compte l’emplumé et je ne pèse pas lourd dans son bilan à cette enclume. Il pinaille avec des arguments de premier de la classe, finalement les quelques écrivaillons avec un peu de souffle qu’il aurait pu ramener dans son écurie, ils sont passé à la concurrence. Soit envolés du nid les piafs, soit retournés chez le vieux soit planant vers des plus prometteurs encore. Je lui suis resté fidèle, je ne sais pas pourquoi. Par fainéantise sûrement, par amitié peut être aussi, par empathie, par compassion, un peu tout ça à la fois. Peut-être aussi parce que j’espérais qu’on allait continuer à s’engueuler avant chaque publication...
08:45 Publié dans De la prétention littéraire | Lien permanent | Commentaires (0)
26/05/2007
Nocturne indien

Peinture Evaristo
Attendre. Attendre.
Votre accompagnateur décide de s’adresser dans un de ces bureaux car vous n’avez pas le temps ni la raison de rester là. Devant vous cinquante ou cent personnes. Pourtant observer un tel lieu où s’entasse autant de souffrance et de douleurs ne peut être qu’instructif sur le sens de l’existence. Des hommes des femmes livrés à leur douleur attendent sans lamentation, ne pestent pas contre l’administration ou les dirigeants qui les maintiennent dans cet état. De l’abnégation dans leur regard, leur corps. Le peu de luminosité du lieu atténue les couleurs. Les saris deviennent plus ternes. Tout paraît si triste. Seules les pupilles noires des grands yeux blancs se détachent de cette masse humaine. Ils ont l’intensité de ceux d’acteurs de théâtre muet. Le lieu est ponctué de toux, de râles, de gémissements. Vous ne savez plus si vous êtes dans l’antichambre de la mort ou dans celle de l’enfer. De même vous ignorez si vous êtes au siècle dernier tant la vétusté retire toute temporalité au lieu. Ici des êtres sans âge, sans nom, vont et viennent. Des figurants d’une apocalypse lente. Que s’est-il passé pour que nous en soyons arrivés là ? Une suite d’événements qui les as plongé dans cet état d’atterrement.
La scène se répète aussi à l’extérieur de ce grand bâtiment chaulé en jaune qui ressemble à un gros pâté cubique dans lequel on aurait percé des fenêtres, puis fait sortir à chaque étage des dizaines de tuyaux en Vinyle par où descendent les eaux usées. Celles d’origine étant bouchés. Cela donne un air d’usine délabrée au bâtiment, comme s’il s’agissait d’un sinistre abattoir humain. Un lieu hanté, répugnant d’horreur. Dehors le même spectacle. Des gens attendent là depuis des jours la fin d’un proche. Et comme il n’existe pas d’autre lieu d’accueil, ils bivouaquent sous un grand hangar métallique qui ressemble à une gare routière dans laquelle les cars ne s’arrêteraient plus. Là, à même le sol, sur une natte jetée, ils dorment et vivent autour d’un brasier sur lequel ils cuisinent. Les gens urinent et caguent à une vingtaine de mètres de l’endroit où ils vivent. Et l’odeur insoutenable des défections humaines ne semble pas les déranger.
Un de ces hommes, accroupi au milieu du terrain vague pour uriner laissait voir une monstrueuse paire de testicules, atteinte d’éléphantiasis. Ses attributs de la taille de celles d’un taureau en bonne santé relèvent plus de la faculté de médecine que du phantasme inassouvi. Sa paire de testicules est une énigme. Comment pouvait-il encore avancer avec de telles protubérances entre les jambes ? Ce n’était pas le seul à porter les stigmates de cette maladie plusieurs personnes âgées croisées dans la rue avaient un de leurs membres atteint.
Et ils attendent, femmes, enfants, vieillards, mêlés sur le sol en un grand corps. Ils préparent le repas de leur être retenu dans ce lieu. Car la nourriture n’est pas prévue. Ceux qui n’ont aucune famille ne peuvent rien espérer. Ceux qui le peuvent encore achètent une boulette de riz à un marchand ambulant. Tenter de survivre dans ce lieu diabolique.
Depuis cet instant, chaque jour en passant devant, vous ne pourrez éviter la vision de cet homme allongé sur le trottoir la tête posée sur les genoux de sa femme. Les yeux cachés par un chiffon sale. Le visage maigre. Le corps osseux. Il portait une vilaine plaie purulente à la jambe. Il ne bougeait pas. Maigre comme peuvent l’être les mourants. Il était probablement déjà mort ou ne tarderait pas. Avec le trottoir pour ses derniers instants au milieu de cette foule que rien ne semble perturber. Personne ne voyait cet homme à l’agonie. Personne ne lui portait secours. Personne ne se penchait sur lui pour écouter ses dernières volontés. Il crevait là, ce chien d’humain, sous le seul regard de cette piétât portant sur sa cuisse le christ descendu de croix avec un bandeau sur les yeux et la bouche déjà ouverte. Humble parmi les siens que plus rien ne désole.
Hagards vous attendez encore et encore ne sachant plus trop pourquoi, ce que vous êtes venu foutre dans ce bazar ? Le temps n’a plus de prise sur vous et vous n’avez plus de prise sur rien. Que pouvez-vous comprendre de ce monde si fuyant ? Ce qu’un instant vous croyez avoir compris, s’avère inexact celui d’après. D’une caste à l’autre on ignore les codes la façon de penser, si cela était évident en Europe, cela le devient encore plus ici. Happé par l’étrangeté de la scène et la vacuité, l’esprit s’échappe dangereusement. La chaleur et la moiteur accentuent cet effet. Vous ne savez plus ce que vous faites là, oubliant la raison même de votre venue en ces lieux. Aucun autre hasard n’aurait pu vous conduire ici. Jamais il ne vous serait venu à l’idée de visiter un tel lieu.
20:35 | Lien permanent | Commentaires (0)
25/05/2007
DEUX ANS D’ABSENCE
Par Mouloud Akkouche

photo Bénédicte Mercier
-Dépêche-toi! râla une brune aux cheveux très courts. Qu’est-ce qui t’arrive ?
Essoufflée, Monique pesta contre les embouteillages du périf et rajusta sa veste d’hôtesse de l’air.
Un quart d’heure plus tard, le commandant de bord annonça le départ pour New York.
Avec les autres hôtesses et stewards, Monique commença la distribution de sourires et de recommandations aux voyageurs. Une lumière brillait dans son regard. Elle était heureuse d’avoir repris le boulot 17 jours auparavant. Après une très grave dépression, elle était restée plusieurs mois en arrêt de maladie. Contrairement à l’avis de son médecin, elle avait décidé de reprendre son poste. A peine sa tenue de travail revêtue, elle s’était à nouveau senti rassurée, au sein d’une famille, et retrouva rapidement le goût de vivre. Persuadée d’être sortie complètement de sa nuit, elle avait abandonné sur-le-champ les antidépresseurs et les séances chez son psy. Excepté avec une hôtesse d’une autre compagnie, Monique ne parlait pas beaucoup d’elle, ses collègues ne connaissaient pas grand chose de sa vie privée.
-Je reviens Karine, dit Monique à la chef de cabine.
Dans les toilettes réservées au personnel, elle fouilla dans son sac et sortit une photo. Ses mains se mirent à trembloter. Les yeux sur le cliché, elle murmura plusieurs fois: << Fabrice, faut vraiment que tu me dises pourquoi… >>. La lumière disparut de son regard. Elle grimaça et rangea la photo.
Comme des centaines de fois, elle enfila le gilet de sauvetage puis, joignant les gestes à la parole, expliqua au passager les consignes de sécurité. Le seul moment qu’elle n’aimait pas du tout, elle se trouvait ridicule.
L’avion avait décollé depuis une demi-heure lorsqu’elle ouvrit la porte de la cabine de pilotage.
Jean-Marc, le commandant de bord, la salua d’un hochement de tête. C’était un type d’une quarantaine d’années plutôt agréable qui, cependant après quelques verres à l’hôtel, voulait souvent s’envoyer en l’air avec des hôtesses. Il avait aussi tenté sa chance avec elle… Face à une ancienne championne de boxe française, le dragueur avait compris qu’il valait mieux garer ses couilles.
- Jean-Marc?
Il se tourna vers elle.
- Qu’est-ce que tu veux ?
Elle braqua l’ arme sur sa nuque.
- Si tu m’écoutes, tout ira bien.
- Mais tu es folle ?
Le co-pilote ouvrit des yeux ronds.
- J’ai collé trois bombes dans les chiottes. Si tu passes pas ce message à la tour de contrôle, je fais tout sauter.
- Mais qu’est-ce qui…
- Ta gueule et lis !
Il entra en contact avec la tour de contrôle:
- Ici, le commandant de bord du vol AH 567, je dois faire une déclaration urgente. Me recevez-vous tour de contrôle ?
- 5 sur 5.
- Je….
- Nous vous recevons, vous pouvez parler.
Le papier dans les mains, il débuta sa lecture d’une voix tremblotante :
- Ceci est un message de Monique Bertin… Je suis hôtesse de l’air sur le vol AH 567 en direction de New York et… et je viens de prendre en otage cet avion. J’ai installé plusieurs explosifs. Ma demande est simple : je veux que vous contactiez mon mari Paul Bertin pour qu’il s’explique en direct avec moi… Je veux savoir pourquoi il m’a quittée. Je veux savoir. Quand je l’aurais eu en direct, je me rendrai… pas avant.
<< Allô ! Ici tour de contrôle… Vous arrêtez vos blagues : on n’est pas le premier Avril…>>
Elle vissa le canon sur la nuque du commandant.
- Dis-leur que c’est pas une blague. Dis-leur ou je commence par toi… Magne-toi !
- Ici le commandant Jean-Marc Lagrange… Je confirme la prise d’otage de notre vol par l’une de nos hôtesses de l’air.
- C’est une plaisanterie de mauvais goût et je…
Elle saisit le micro :
- Ici Monique Bertin, je vous donne une heure pour entendre mon mari sinon je fais tout sauter.
- Mais nous…
- Une heure, pas plus !
Elle coupa la liaison.
- Monique, intervint le commandant de bord, tu délires…tu… Ce n’est pas croyable que toi…
Elle dévisageait avec une grande satisfaction ce petit macho dégoulinant de trouille.
- Regarde au coin de ta cabine… Le petit truc que tu vois scotché est un explosif relié à cette poire dans ma main : un système très efficace. J’ai juste fait mon p’tit marché sur le net.
- Mais comment t’as fait pour passer tout ça en bas.
Elle sourit.
- Depuis le temps, je les connais bien les mecs de la sécurité. En plus, j’ai pas la gueule du terroriste moyen.
- Tu déconnes là, il faut que tu retrouves la raison. Tu sais, dans ce genre de boulot, on passe tous par des états de…
- Ferme-là ! Prie pour qu’ils me mettent en relation avec mon mari…
Le commandant de bord et son co-pilote ne prononcèrent plus un mot. De temps en temps, ils échangeaient des regards mêlés d’inquiétude et d’incrédulité.
Adossée à la paroi, Monique alluma une cigarette. Personne ne l’empêchera de fumer.
Un quart d’heure avant la fin de l’ultimatum, elle ordonna :
- Tu me passeras la communication dans le vestiaire. Je n’en bougerai plus jusqu’à ce que je l’ai. Ils ont encore jusqu’à et quart, pas plus. Salut chef.
- Tu es…
- Oui, givrée.
- Arrête de déconner maintenant !
- Pas de conneries toi Jean-Marc, ricana-t-elle, n’oublie pas cette petite poire dans ma main.
- On peut trouver une autre solution.
Le regard absent, elle lâcha :
- Il doit m’expliquer, c’est tout.
Elle sortit de la cabine.
- Comandant Jean-Marc Lagrange, ici la tour de contrôle. Vous me recevez ?
- Je vous… vous reçois, balbutia-t-il. Alors vous l’avez retrouvé son mari ? Elle est devenue complètement folle, elle a vraiment installé des explosifs.
- Nous avons effectivement retrouvé la trace de son mari.
Il poussa un ouf de soulagement.
- Passez-lui la communication, qu’on en finisse avec cette histoire.
Un toussotement succéda à ses propos.
- Il y a un disons… un problème.
- Mais quoi ? s’impatienta-t-il.
- Son mari… son mari s’est suicidé il y a 2 ans.
21:10 Publié dans De la poésie au quotidien | Lien permanent | Commentaires (0)
22/05/2007
Chardons bleus (extrait )
Dans le désarroi de n’avoir nul lieu d’où naître
Il faut à chaque heure justifier sa légitimité.
Découvrir au-delà de la forme les multiples sens
De cette parole qui n’en est plus une.
Quand le vent dessine des risées sur la surface des flaques.
Vivre paria et se maintenir vivant, tant que possible
en courbant l’échine sous un suaire invisible,
ni de sang ni de heurts, mais de mots
presque imperceptibles comme autant de flagellations.
De l’errant les haillons et du lépreux le regard.
Juste de l’autre coté de la rue, la banlieue
où la langue apprise y a l’amertume insolente
La soif du monde n’en est pas moins intense.
Vos crachats sont utiles, ils donnent l’acuité
Et cette si particulière brûlure de lucidité,
Ce ne peut être que l’affrontement contre la plénitude
dans ces visions si étranges de ce ghetto
où l’enfermement est dehors.
21:50 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (0)
Les fabuleux dessins de Pierre Ballouhey
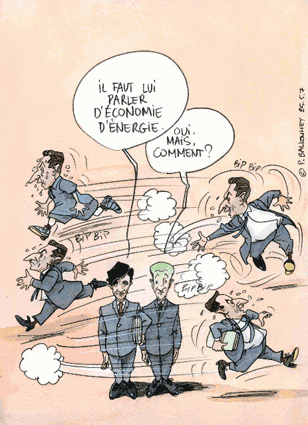
Un enfant de coeur (extrait)
Marguerite ne perdait pas une miette de mon récit, cela devait lui sembler si abracadabrant. Elle n’a pas eu besoin de me prier pour que je continue mes explications. Parfois elle me disait :
— Bon, tu me diras le reste demain.
Alors j’attendais avec impatience de la revoir pour lui raconter la suite. Une soirée sans Margueritte me paraissait longue.
— Alors t’es prête à entendre la suite, je lui demandais.
— Oui, allez vas-y…
— Au village, à la fin de ma première année scolaire, j’ai eu droit à un prix d’acrobatie. Tout le monde a ri, sauf moi. Je l’ai déchiré leur prix. L’institutrice a prétendu qu’il valait mieux m’avoir comme cireur de parquet et que j’allais coûter cher en fonds de culotte à mes parents. Je passais plus de temps sous la table que dessus. Je ne comprenais pas encore qu’il fallait rester toute la journée sans bouger. Lors d’une inspection, elle nous a fait un cours sur la pomme. À la mienne, il ne restait que le trognon. J’ai su rapidement lire et écrire, alors je suis passé dans la classe des grands. En écoutant leurs leçons je m’ennuyais moins.
En attendant que passe la journée, je regardais dans la bibliothèque, une grande armoire aux portes vitrées. S’y entassaient les éprouvettes, les flacons de couleur, les bocaux contenant, conservés dans le formol, crapauds, vipères, couleuvres, courtilières. Des boîtes, aux couvercles transparents, renfermaient la collection d’insectes exotiques : mygales, papillons verts et jaunes, phosphorescents, poilus, monstrueux, carnivores, capturés à l’autre bout du monde, dans des expéditions meurtrières au fond d’une jungle impénétrable. Je tremblais de frayeur de savoir qu’un jour ces monstres pourraient retirer l’aiguille qui les perforait de part en part et les clouait sur le support de liège.
Une mouette, toutes ailes déployées, prenait son éternel envol au-dessus de ma tête. Elle était venue, lors d’une violente tempête, mourir de ses blessures dans la cour de l’école. Elle demeurait figée, posée là-haut sur le meuble. Je la regardais en imaginant que, moi aussi, je saurais voler bien que n’ayant pas d’ailes, je parcourrais le monde. L’école ne m’a jamais plu, je n’aimais que le dessin, les voyages et les histoires dans les livres, le reste m’ennuyait. Le calcul mental m’amusait aussi. Je répondais souvent le premier.
Même le Père, qui ne savait ni lire ni écrire, comptait avec ses doigts. Il rabattait de la main gauche le petit doigt de la main droite, pour un, et finissait par le pouce pour cinq. Il a appris ainsi. Le Père m’avait demandé de lui enseigner à écrire son nom, juste cela, pas plus.
Lui, qui de sa vie n’avait jamais connu que la pelle et la pioche avec ses larges mains de bois, suait et s’escrimait à poser les lettres les unes derrière les autres, en essayant de tenir un porte-plume. Il voulait apprendre la graphie de son nom, au lieu de paraître idiot et de tremper le doigt dans l’encre pour signer. Il s’appliquait des heures à recopier la même lettre de gauche à droite. Ne l’intéressaient que celles nécessaires à son projet. Je passais ces moments à côté de lui. Je lui tenais la main pour qu’il les dessine correctement et qu’apparaisse le miracle. Alors, heureux, il prenait sa feuille, se massait le front et la regardait comme pour se venger de son destin. Il pliait les papiers soigneusement et les rangeait au fond de sa veste en velours.
Ce sont les seuls instants de sérénité que j’ai gardés de lui. Il aurait tant voulu apprendre ce qu’on nous enseignait à l’école. Il était fier que je connaisse cela et désirait que j’étudie pour lui. Son existence ne valait pas un coup de trique. La souffrance l’avait poursuivi partout. Il était plus résigné que jamais, comprenant que ses enfants, simplement parce qu’ils lisaient et écrivaient, en savaient déjà plus et s’en sortiraient mieux que lui qui avait traversé tous les coups fourrés de la vie. Il pleurait en regardant son nom écrit de ses propres mains.
Quand on m’a demandé de remplir la fiche pour le recensement je n’ai pas su répondre. Pourquoi on me posait des questions pareilles ? Je ne connaissais ni l’âge ni le lieu de naissance du Père. Je pensais encore que j’allais me distinguer si je demandais ce qu’il fallait inscrire. La seule chose que je pouvais dire c’est que je porte le même nom que lui. Personne ne l’appelait jamais par son nom. Personne ne le connaissait, pas plus que son prénom. On le surnommait Bibi, c’est le diminutif de bicot, c’est tout. À peine si l’on savait d’où il venait. Mais il ne voulait pas y retourner, il avait assez bourlingué, qu’il disait. Alors, il avait posé sa musette dans ce coin de terre, pensant qu’il ne pouvait plus rien changer à son destin. On ignorait son âge exact. Un médecin avait inscrit une date, et un sergent recruteur donné un nom au hasard de l’orthographe, et au suivant. On ne savait rien de lui, sinon qu’il parlait avec un accent difficilement compréhensible.
20:35 Publié dans A la manière de | Lien permanent | Commentaires (1)
20/05/2007
Voyage au bout du monde....

Photo: Bénédicte Mercier
Dans le café chez Raymonde le tube cathodique déversait son flot d’informations et son quotidien d'oiseaux mazoutés, de guerres, de catastrophes. La conversation continuait de plus belle, car rien de tout cela ne peut avoir de l’importance.
-C’est encore le pape à béquilles qu’est pas bien…
-Non à mobiles…
-J’y arriverais jamais à me souvenir…
-Alors, la ramène pas tout le temps.
-Il sent de plus en plus le sapin, le pape, dit son voisin…
-C’est pas drôle !
-Non mais t’en as déjà vu un rigolo toi ?
-Le pape, il est contre l’avortement, renchérit un autre qui semblait vouloir s’imposer dans la conversation.
-C’est normal, on fouille pas dans le sac à main des dames, lui rétorqua-t-on du bout du bar.
Un Monsieur du bar s’écria comme s’il était en colère : Si c'est dieu qui à créé l'homme; il s'est bien foutu de sa gueule! T’imagine ça il a même fait l'homme l’égal de la femme. Moi personnellement qui vous cause je suis pour l'égalité des sexes.
-Oui mais, quel dénominateur commun?
-En tout cas je trouve le mien bien comme il est… Et toi ?
-Je sais pas, je l’ai pas vu...
-Mais ce que tu peux être con…
-Il falloir qu’on leur mesure le clitoris et qu’on leur pèse les ovaires, pour savoir si la femme est l’égale de l’homme…
-Et inversement!
-Pas légal, létal!
-Toi tu causes sans savoir ce que ça veux dire.
-J’ai fait des études moi monsieur, je suis allé aux grandes écoles
-Mais t’es sorti par la petite porte.
-Où il vont chercher toutes ces conneries?
-Dans la boîte à sucre avec le peigne…
Un monsieur était devant son demi et regardait les bulles monter à la surface
-Moi je dis que c'est en pétant dans l'eau que les têtards ont inventé la limonade!
-OOOOOOOOOOOh! Ça c’est une trouvaille.
-C’est Einstein qui a découvert la loi de la relativité mais on n’a pas eu besoin de ça pour découvrir Robert?
-C’est pas Robert c’est Albert !
-Non Robert c’est le nom du monsieur qui a mis des têtards dans sa limonade…
Puis une histoire de pédophilie aux informations
-Avec toutes ces conneries qu'on entend, maintenant quand les gamins sortent des écoles, je vérifie que mon imper est bien boutonné!
-Violer des mômes; c'est enfantin!
-Ah toi t’es vraiment drôle. Si, si, je t’assure.
Un partisan de la peine de mort: faudrait les zigouiller ces fumiers pour leur apprendre à vivre!
Et ça continuait pendant des heures. De la parole inutile, pour jongler avec le rien ou le néant. Qu’importe, alors... Il savaient qu’ils n’iront pas plus loin que ce bout de comptoir en formica seul lieu où quelqu’un peut faire attention à eux. La solitude en bandoulière, et le silence à jamais refermé sur eux.
21:15 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (1)
19/05/2007
J’AI JAMAIS CRISPE PERSONNE.
Par Mouloud Akkouche

Les illustrations sont de Yves Budin qui vient de publier aux carnets du dessert de lune Visions of Miles
Mon portable frétilla sur le guéridon.
- Jo à l’appareil.
- C’est Dominique, tu es où ?
- Au téléphone…
- Non, je rigole pas. J’ai eu les organisateurs qui t’ont attendu à l’aéroport.
Chargés comme des mulets, un groupe de scouts s’installa bruyamment sur ma droite.
- Je suis arrivé en avance, je suis à Cahors.
- Qu’est-ce que tu fous à Cahors ?
- Je bois un demi.
- Appelle les tout de suite !
- Le festival commence dans une semaine, on a le temps.
- Non, je te connais quand tu pars en vadrouille…
Un sourire en coin, je secouai la tête.
- A 72 ans, j’irai pas loin.
- Arrête tes âneries, ils vont venir te chercher et t’emmener à l’hôtel.
Ce jeune con commençait à vraiment m’agacer. Chaque fois qu’il me parlait, j’avais l’impression qu’il s’adressait à un gosse de 12 ans. Et toujours avec son putain d’accent snob. Pas à mon âge qu’un branleur allait me diriger.
- Je serai à l’heure au concert, le reste c’est mon problème.
- Joe, tu me crispes avec tes caprices…
- Toi, tu me gonfles !
Et je coupai mon portable.
Pour qui se prenait-il ? La maison de prod me l’avait collé depuis une année aux basques et, sans rechigner, j’ai tout accepté de ce petit requin aux dents longues qui connaît que dalle en Jazz. Il me voit juste comme un paquet de lessive à vendre aux plus offrants. Il m’a même engueulé une fois parce que je m’étais soûlé au bar d’un grand hôtel. A mon âge, je peux faire ce que je veux quand même. Je le crispe, c’est la meilleure celle-là. C’est bien le premier qui me dit ça en 72 ans. Je vis seul depuis des lustres, ne vois que les gens que j’aime bien et ne fais que les deux seules choses qui me plaisent au monde : chanter et gratter ma guitare. Au moindre ennui ou lourdeur du quotidien, je me carapate pour ne me consacrer qu’au bon côté de l’existence. Qui voulez-vous que je crispe ? Faut du temps et de la promiscuité pour crisper quelqu’un, et sans doute un peu moins d’égoïsme. La seule femme avec qui j’avais vécu plus de trois mois m’avait jeté à la face: Jo, tu ne penses qu’à t’amuser, tu finiras comme un vieux gosse ridé. Elle n’avait pas tort. Le soir même de sa constatation, je faisais ma valise… et ma brosse à dents n’a jamais plus eu de compagne.
- Encore un demi, s’il vous plait.
Mon Stetson sur la tête, je traversai peu après Cahors dans la voiture de location.
***
Ca m’a pris d’un seul coup, j’ai eu envie de me prendre quelques jours avant mon concert à Souillac, le temps d’une balade dans cette région… Celle de mes premiers pas de Jazzman en Europe. Débarqué en 1954 des Etats-Unis, la première personne qui m’a tendu la main fut un étudiant en médecine qui organisait un festival de musique à Marsauliac sur Célé. Mon premier concert solo avait eu lieu dans une grange retapée: devant 15 personnes. Un soir, j’avais fait la connaissance d’une jeune fille de mon âge vivant à une dizaine de kilomètres plus loin. Après un mois collé ensemble presque nuit et jour, je devais remonter sur Paris pour signer un contrat avec une maison de disques. Malgré mon insistance, elle n’avait pas voulu me suivre. Par trouille ? Ou peut-être réellement à cause de ses études de comptabilité ? Je lui avais laissé l’adresse de mon hôtel, elle ne m’avait jamais écrit. Deux ans après, j’avais téléphoné ; une voix féminine m’avait annoncé que Martine était morte dans un accident de voiture.
Comme conservé sous une bulle à l’abri du temps, je retrouvai le même village qu’un demi-siècle auparavant. Excepté les piscines et les panneaux de signalisation.
Je me garai sur la place des Platanes et me dirigeai vers l’un des deux bistrots. Concentrés, de nombreux boulistes participaient à un concours dont les lots gagnants étaient égrenés par une voix provenant de haut-parleur.
Une serveuse vint prendre la commande.
- Une Suze.
Avec le recul, je me demandais comment un gosse de Chicago avait pu atterrir dans cet endroit paumé, surtout en 1954. Pour faire pleurer les journalistes parisiens friands de misère clef en main, je m’étais inventé une bio mâtinée de Cosette et de Sans famille. Mi-Noir mi-Italien, j’avais vécu toute mon enfance dans un quartier de la classe moyenne, très éloigné des immeubles lépreux où s’entassaient les familles les plus pauvres. Elevé par ma mère-coiffeuse dans un salon chic, je n’avais jamais eu à souffrir de la faim ou de la violence. Faut dire que mon père, avocat connu dans la région, versait une bonne pension à ma mère pour que personne n’ait vent de mon existence. Habitant la même ville que lui, je ne l’avais jamais rencontré et, malgré mes nombreuses demandes, ma mère refusa toujours de me donner son identité. En triant ses affaires après sa mort, j’étais tombé sur la photo de mon géniteur. Ce jour-là, je compris pourquoi il n’avait jamais voulu me voir, c’était un avocat ultra-conservateur qui avait défendu plusieurs membres du KKK. Il aurait été abattu par un commando des Black Panther.
Après une balade dans le village et au bord du Célé, je décidais de rejoindre Souillac, histoire qu’il ne croit pas que l’invité vedette leur ai fait faux bond.
Au moment d’ouvrir ma portière, j’aperçus un groupe de jeunes assis sur le bord de la fontaine. L’un d’eux, âgé de 17-18 ans, portait un bracelet coloré qui attira mon regard.
- Tu as eu ça où ?
Il me dévisagea froidement.
- On se connaît pas.
- Tu l’as eu où ce bracelet ?
Il vrilla son index sur sa tempe.
- Il est bargeot le vieux. Faut pas picoler quand on tient pas.
Il démarra son scooter. Les autres l’imitèrent aussi. Sauf une ado secouant la tête au rythme d’un baladeur.
- Eh !
- Ouais, fit-elle en ôtant ses écouteurs.
- Tu connais le garçon qui porte un bracelet bi-colore ?
- Marc, ben ouais.
- Il habite ou ?
Elle haussa les épaules.
- Il squatte par-ci par-là quand il s’engueule avec son père et… Comme il se prenne la tête tout le temps….
- Il habite où son père ?
Elle tendit le bras.
- Là-haut : à Caniac du Causse.
***
Accueillis par les aboiements des chiens, je criai plusieurs fois avant que quelqu’un ne pointe son nez. Vêtu d’un jean et d’un Marcel, un homme rondouillard s’approcha de moi avec un air méfiant. Il ôta sa casquette.
- C’est pourquoi ? demanda-t-il avec un accent rocailleux.
- C’est au sujet… Vous avez bien un fils ?
Il leva les yeux au ciel.
- Malheureusement.
- Je voudrais vous…
- Qu’est-ce qu’il a fait encore ?
Mal à l’aise, je triturai mon chapeau.
- C’est à dire que…
Il s’épongea le front.
- Vous êtes pas le premier à se plaindre de lui… Autant le faire au frais.
D’un geste, il me demanda de le suivre.
Le seuil à peine franchi, je crus que mon cœur allait lâcher. Sans attendre les formules d’usage, je m’assis. La table était encombrée de Dépêches du Midi et de revues agricoles.
- Vous êtes tout pâle. Qu’est-ce qui vous arrive ?
- Vous avez de la gnole ?
-…
- Donnez-moi un verre s’il vous plait.
Sentant que j’étais très mal, il me servit un petit verre de prune que j’avalai d’un trait.
- Ca va mieux.
- Bon, c’est pas que je m’ennuie mais j’ai du boulot. Qu’est-ce qu’il a fait alors encore comme connerie ?
- La photo là…sur le mur… c’est…. c’est à vous.
Il esquissa un sourire.
- Ben sûr : c’est ma mère.
Sous son œil agacé, je me resservis un verre.
- Vous êtes né quand ?
Je sentis que mes questions commençaient à l’agacer. Sans mon grand âge, il m’aurait foutu à la porte depuis longtemps.
- En 55.
Après nos explications, nous restâmes un très long moment silencieux, troublés par cette brutale intimité : un père et un fils se retrouvant pour la première fois sous le regard d’une femme morte. Chaque fois mes yeux se posaient sur elle, je me demandais ce qu’elle aurait pu penser de cette situation. A un moment, j’ai eu l’impression de la voir sourire… Un des effets de la gnole.
- Je sais pas quoi dire.
- Et moi donc.
Il ne cessait de secouer la tête.
- C’est incroyable.
- Elle ne vous avait jamais parlé de moi ?
- Non mais… Il y a une vingtaine d’années, j’ai nettoyé tout le grenier de la ferme… Putain con ! Mon grand-père avait un de ces bazars.
Il se roula une cigarette avant de reprendre :
- J’ai trouvé un paquet de lettres qu’elle vous avait écrit… Elles étaient toutes retournées avec écrit dessus le destinataire n’habite plus à l’adresse indiquée.
- Quelle était l’adresse ?
- Je crois un hôtel à Pantin.
Quand j’étais remonté en septembre 54, le patron de l’hôtel meublé avait mis mes affaires sur le palier et demandé de déguerpir à cause des impayés.
- Je ne savais pas qu’en revenant ici, tout ça me reviendrait à la gueule.
- Ah ! Le v’là ce saligot. Il va m’entendre.
Par la fenêtre, je vis son fils, mon petit-fils, garer son scooter devant une grange. Nous descendîmes rapidement le chemin qui y conduisait. Le paysan en avait gros sur la patate. J’allais assister à ma première scène de famille.
- Je vais lui en coller une !
Soudain, j’entendis le son d’une batterie.
- C’est quoi ça ?
- Y fait du bruit avec son truc là ! Y sais faire que ça, un jour, je vais lui balancer dans la mare.
Il fila un coup de pied dans la porte.
- T’as une convocation des gendarmes !
- J’ai rien fait, moi.
- Ouais c’est moi peut-être qui ait mis des chaînes aux portes de la gendarmerie.
Je réprimai un rire.
- Tu vas en prendre.
D’un geste, je lui attrapai le bras.
- Calmez-vous !
- Qu’est-ce qui fout là cui-là ?
Comme si mes révélations venaient juste de faire leurs effets, il dévisagea tour à tour son fils et son père.
- C’est ton Grand-Père.
Il éclata de rire.
- Les vieux, faut vraiment arrêter la picole.
Instinctivement, je lui en retournai une.
- M’appelle plus jamais le vieux !
***
Le lendemain matin, après une soirée ou nous avions arrosé nos re… trouvailles, nous déjeunions ensemble. Je ne cessai de triturer le bracelet que Marco m’avait rendu. Une babiole offerte un demi-siècle avant à Martine.
Mon portable sonna.
- Joe, j’écoute.
- Qu’est-ce que tu fous ?
- Je serai à Souillac en début d’après-midi.
Je fermai mon portable.
- C’est mon manager, il est un peu pot de colle.
Je me plantai devant la fenêtre de la cuisine.
- Marco, je voudrais te demander un service…
Il garda la tartine suspendue au-dessus de son bol.
- Quoi ?
Je me raclai la gorge.
- Je voudrais que tu montes sur scène avec moi…
Son père éclata de rire.
- N’importe quoi, il sait rien foutre ce gosse.
- Qu’est-ce t’en sais, toi à par le bal du village, tu connais rien d’autre. T’as jamais bougé de ce bled !
- Ca suffit tous les deux. Tu peux me croire, ton fils à du talent.
- Dans ces métiers, il y a que des….
- Laisse-le tenter sa chance au moins.
Marco dévisagea son père qui baissa les yeux.
- D’toute façon, il est majeur, y fait c’qui veut.
- Tu me dis oui ou merde, je pars dans un quart d’heure.
Il lâcha la tartine dans son bol.
- C’est O.K !
Une demi-heure plus tard, nous étions tous trois devant la bagnole. Mal à l’aise, aucun n’osait briser le silence. Comme un con, je tendis la main à mon propre fils en lui promettant de revenir et m’installai derrière le volant.
- Marco, t’as pas oublié tes papiers.
- Non.
- Et ton portable ?
- Oui.
- Tu reviens à la fin du concert, j’ai besoin de toi pour le champ du bas et pour abattre le Marronnier. Fais gaffe à ton fric.
Marco leva les yeux au ciel.
- Papa, tu me crispes.
- Je sais, je sais, je suis un père emmerdant…. Allez, viens que j’te fasse la bise mon affreux jojo.
Avec une pointe de jalousie, je les regardai s’embrasser sur les joues et échanger un regard traversé d’une affection retenue. Crisper quelqu’un a du bon parfois… A cet instant précis, je ressentis un irrépressible regret, la certitude d’avoir oublier l’essentiel. Pas le moment de lâcher ma p’tite larme, mon public m’attendait à Souillac.
- Vas-y le fiston et m’fait pas honte. Je vais surveiller la télé, voir si tu y passes. Fais gaffe à toi.
Sur la route, je souris en pensant à la gueule de mon manager. Une bonne farce du destin que cette nouvelle recrue.
Si vous voulez connaître les oeuvres de Mouloud Akkouche CLIQUEZ ICI

22:45 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (1)
18/05/2007
Saudade entre Pessoa et Bévinda

« Ce que tu fais, fais-le suprêmement »

Erostratus
“Et pourtant – je le pense avec tristesse – j’ai mis en Caeiro tout mon pouvoir de dépersonnalisation dramatique, j’ai mis en Ricardo Reis toute ma discipline intellectuelle revêtue de la musique qui lui est propre, j’ai mis en Alvaro de Campos toute l’émotion que je n’accorde ni à la vie, ni à moi-même. (...)
Enfant, j’avais déjà tendance à créer autour de moi un monde fictif, à m’entourer d’amis et de connaissances qui n’avaient jamais existé – (je ne sais pas bien entendu s’ils n’ont pas existé ou si c’est moi qui n’existe pas.
Un jour…– ce fut le 8 mars 1914 – je m’approchai d’une commode haute, et prenant un papier, je commençai d’écrire, debout, comme je le fais chaque fois que je le peux. Et j’écrivis une bonne trentaine de poèmes d’affilée, dans une sorte d’extase dont je ne saurais définir la nature. Ce fut le jour triomphal de ma vie, et je n’en connaîtrai jamais de semblable. Je débutai par un titre Le gardeur de troupeau et ce qui suivit fut l’apparition en moi de quelqu’un que j’ai d’emblée appelé Alberto Caeiro. Pardonnez-moi cette absurdité : en moi était apparu mon maître. "
Extraits de la lettre à Adolpho Casais Montero, le 13 janvier 1935. (La traduction intégrale, par Rémy Hourcade, de la lettre se trouve dans Sur les hétéronymes, éditions Unes, 1985.)
“Je suis un gardeur de troupeaux.
Le troupeau c’est mes pensées
et mes pensées sont toutes des sensations.
Je pense par les yeux et par les oreilles
par les mains et par les pieds
par le nez et par la bouche.”
(…)
Alberto Caeiro, Le Gardeur de troupeau
Èditions Unes, 1986, traduit du Portugais par Rémy Hourcade et Jean-Louis Giovannoni.
“ La réalité n’a pas besoin de moi.”
(idem)
“J’impose à mon esprit altier l’exigence assidue
De la hauteur, et au hasard je laisse,
Et à ses lois, le vers :
Car, lorsqu’est souveraine et haute la pensée,
Soumise la phrase la cherche,
Et le rythme esclave la sert.”
Ricardo Reis, Odes, in Poèmes Païens, Christian Bourgois, 1989.
“Je pressens le crâne que je serai
(…)
Lors c’est moins l’instant que je pleure,
que ce moi futur que je vois,
Vassal absent et nul
Du destin universel. "
(idem)
"Nombreux sont ceux qui vivent en nous ;
Si je pense, si je ressens, j’ignore
Qui est celui qui pense, qui ressent.
Je suis seulement le lieu
Où l’on pense, où l’on ressent.
(…)
À celui que je me connais : J’écris. "
(idem)
“ ‘J’ai horreur du mensonge parce que c’est une inexactitude.’ Tout Ricardo Reis – passé, présent et futur – est dans cette phrase.”
Alvaro de Campos, Notes à la mémoire de mon maître Caiero, in Sur les hétéronymes, éditions Unes, 1986, traduction de Rémy Hourcade.
“Fernando Pessoa éprouve les choses mais il ne bouge pas, pas même à l’intérieur.”
(idem)
Que le vivant n'ignore pas la loi.
Il est dans leur nature que se fanent les ross,
Que les plaisirs s'achèvent.
Qui nous connait, ami, tels que nous fumes? Nous-mêmes
Nous ne nous connaissons jamais.
Viens, Nuit extatique et silencieuse,
Viens envelopper dans la nuit manteau blanc
Mon cœur...
Sereinement comme une brise dans l'après-midi
légère,
Paisiblement, comme la caresse d'une mère,
Avec les étoiles brillant au creux de tes mains,
Et la lune mystérieuse masque sur ton visage,.
Tous les sons résonnent d'une autre manière
Lorsque tu viens.
Lorsque tu entres toutes les voix s'éteignent,
Personne ne te voit entrer,
Personne ne sait que tu es entrée,
Sinon en voyant soudain que tout se recueille,
Que tout perd ses arêtes et ses couleurs,
Et qu'au firmament encore bleu clair,
Croissant parfaitement dessiné, ou cercle blanc, ou
simple lumière nouvelle qui vient,
La lune commence à être réelle.
Pour écouter la chanteuse Bévinda qui interpréte Pessoa
Cliquez ICI
09:10 | Lien permanent | Commentaires (0)
16/05/2007
Welcome in india, Sir.
Les photos sont de Bénédicte Mercier

-On m’avait prévenu, mais cela dépasse tout ce que je pouvais imaginer, maugréa-t-il.
Le seuil du hall de l’aéroport franchi, l’impression a perduré. Les impulsions qui lui parvenaient encore au cerveau l’informaient qu’il était à côté de la plaque. Sa garde-robe n’a pas été préparée à ce qui l’attend. Un togolais qui débarque en boubou à Moscou en plein hiver doit ressentir un pareil malaise. Déjà en eau, il sait ne pouvoir quitter ce hammam qu’avec le billet de retour et déjà, il a envie de faire demi-tour.
La douane présente la lenteur qu’il sied à tout le lieu de passage anthropométrique. Inspection de la photo : un coup d’œil pour vérifier que l’homme présent est bien le même. Pas ou peu de vérification de bagages. Aucune question. Mais pas de réponse à cette lenteur dans chaque geste, ce silence de recueillement. La file attend et lentement un à un les passagers passent de l’autre côté du contrôle. Six heures du matin et déjà la chemise trempée de sueur lui colle à la peau du dos. Pas de climatisation. Quelques ventilateurs tournent lentement, trop lentement eux aussi, comme s’ils avaient réglé leur vitesse sur celle de l’administration locale. L’austérité est de mise en ces lieux.
Son tour arrive. L’homme qui porte barbe et moustaches de maharadja l’hypnotise, il ressemble à un lancier du bengale coiffé d’un turban enroulé autour de la tête. Avec un regard de félin, d’un seul coup d’œil il perçoit le niveau de palpitation cardiaque de la victime qu’il observe. Il le voit en sueur et tamponne le passeport sans autre façon.
-Welcome in India, sir.
-Thank you, sir, osera-t-il timidement.
Plus loin un chauffeur attend dans la foule en levant devant lui une pancarte avec le nom mal orthographié de Norbert Carratini.
-Un seul r, comme dans baratin dit-il au chauffeur qui ne comprit rien.
Le chauffeur, un homme jeune, parle un anglais que l’accent local rend difficilement compréhensible. Il s’empare des valises, hèle un porteur et le conduit à une voiture dont le modèle antédiluvien semble directement sorti d’un roman de Somerset Maugham. A peine les valises dans le coffre qu’il soulève le capot et plonge le nez dans la jauge à huile.
-Mauvais présage. Tant pis je suis là, et je ne peux plus faire demi tour, pensa Norbert.
C’est sur la route du transfert, entre l’aéroport et la ville de destination, qu’il a commencé à prendre conscience que rêve et réalité sont comme le corps et l’esprit, deux choses séparées. Cette impression, il a commencé à la ressentir à l’instant de toucher le sol. Ce corps oublié, qui va l’empêcher de dormir, il va le redécouvrir et rentrer dedans, pourtant chaleur et fatigue cumulées, auraient dû l’assommer.
Le spectacle de bon matin est paisible. Nulle part au monde, il ne doit en exister un semblable. Le long de la route des gens accroupis observent les voitures qui passent de si matinal horaire. Ils semblent attendre. Ce n’est qu’après plusieurs kilomètres qu’il comprendra que ces gens répandent le contenu de leurs entrailles sur ce qui a été des trottoirs. Une ribambelle de rachitiques est occupée à se soulager les tripes de son bol de riz épicé et cague le long de l’avenue. Les étrons qui sortent de ces corps efflanqués ne peuvent guère rivaliser de taille avec la moindre crotte joufflue d’un caniche européen. Ces minuscules déjections n’auront pas le temps de refroidir que déjà ils s’inscriront au menu de petits cochons noirs qui déambulent en hordes libres dans les rues. Avec un régime aussi vitaminé, ils ne peuvent être que bien portants. Comme rien ne se crée, ni ne se perd et que tout se transforme, ils finiront à leur tour dans l’estomac des Chrétiens autochtones, les seuls qui cuisinent cette viande. La poésie du cochon de lait à la broche ne survit pas sous ces latitudes.
Le spectacle ahurissant lui a fait oublier quelque temps la conduite intempestive et hasardeuse du chauffeur. Les pupilles rivées sur la route, il s’adressa à lui avec insistant:
-Quiet, sir. Quiet. We have the time. Don’t drive so quickly, please .
Et le chauffard mi-compatissant, mi-amusé jettera un œil dans le retro-viseur visiblement agacé par ce blanc-bec qui lui somme de tempérer son utilisation intempestive du klaxonne, du frein et de l’accélérateur…
-Yes, yes… We have the time. We can arrive toworrow. I préfère that, than never …
-Ok, sir répondra le chauffeur.
Il sera alors rassuré. Pour quelques instants seulement.
-Mais il est dingue. Il ne va pas doubler là. Mais, si, Bon dieu. Mais qui m’a foutu un abruti pareil.
En triple file, alors qu’un attelage de zébus était en train de doubler un bus à l’arrêt, il est passé allégrement à travers tout ça et dans un virage, sans aucune visibilité, au mépris des règles minimum de sécurité. Klaxon bloqué, phares allumés, dans une embardée, il a mordu le bas coté et soulevé un nuage de latérite rouge obligeant piétons, vélos et rickshaws à se jeter dans le fossé. A cet instant il a compris que le seul code de la route qui s’applique ici est celui de la jungle. Le plus volumineux et le plus cinglé a raison, férocement raison. Emettre un doute c’est abréger sa durée dans cet univers.

Cramponné au fond de son siège, il n’ose plus élever la voix, tellement il sait déjà que toute protestation sera inutile. Alors remettant son destin entre les mains de la providence, il tentera de s’endormir. Cette tentative restera vaine malgré douze heures d’avion, une nuit blanche, un déménagement éreintant et des préparatifs épiques qui ont duré des mois. Prendre une telle décision se prépare. Pensez donc, faire un long séjour dans un pays au nom aussi exotique que Pondichéry. Tout le monde a entendu parler, des comptoirs français des indes. Vos parents se souviennent de leurs noms appris par cœur au lycée. Cochin, Chandernagor, Mahé, Karaikal, Pondichéry. L’Alsace et la Lorraine des tropiques, perdus corps et bien.
Pondichéry… Rien que le nom lui a ravi l’âme. La mystique du voyage… Les aventuriers du golf du Bengale et la cote du Coromandel face aux Nicobar Islands, plus loin la Birmanie et le Vietnam. Sur la carte, ça faisait joli. Il n’y a pas à dire. Les amis en bavaient d’envie, lorsqu’il évoquait devant eux son départ. Pas besoin d’en rajouter pour épater la galerie, car ce n’est pas tous les jours qu’un inconscient ose se jeter à l’eau du haut de ces falaises. Personne n’avait osé le prévenir qu’il y aurait peut-être des difficultés de compréhension. Pensez donc, tout le monde parle encore français a Pondicherry, avec deux r et un y pour l’épellation anglaise, du moins c’est ce que semblent vouloir encore croire les irréductibles francophones. Le fait qu’habituellement le voyage se fasse en sens inverse n’a pas éveillé en lui le moindre soupçon, trop occupé à préparer le départ.
Il décharge dix litres d’adrénaline par minute… Combien de cheveux blancs a-t-il attrapé en deux heures. En regardant son visage dans le rétro, il remarque son teint blafard, ne sachant pas s’il est du à la seule fatigue ou si la peur se lit à ce point sur son visage. Par moments, il n’a pas pu s’empêcher de fermer les yeux, tant paraissait éminente sa fin. Mentalement il écrivait son testament : ça je le donne à untel ; il sera content. Ça à un autre, ça lui plaisait bien. Il est persuadé que dans ce jeu de massacre il ne pourra pas atteindre vivant son lieu de destination. Et pourtant, en pilant, allumant les phares, faisant hurler le klaxonne, mordant le bas coté, donnant des grands coups de volants pour rétablir la situation, ça passe. Il ignore comment, mais il est encore de ce monde. Plus pour longtemps certes, car au régime de deux cents pulsations minute, le cœur va lâcher. Des sueurs froides lui parcourent l’échine. Il manque d’air. La fatigue, les bouteilles vidées et les émotions des derniers jours risquent de le faire flancher.

S’il avait su qu’un chauffeur encore jeune n’était pas une garantie pour arriver à bon port, en voyant celui-là il lui aurait interdit de toucher le volant et n’aurait pas abandonné sa vie entre les mains de ce kamikaze dont le karma va devenir le sien pendant une paire d’heure. Question d’expérience, lui, en son karma, il y croit moins. Et ce type, il aurait préféré ne l’avoir jamais rencontré. Il l’effrayera plus que n’importe quelle autre situation louche dans un bas quartier. Des chauffards, il en a pourtant croisé par le passé, tous plus inconscients les uns que les autres. Mais là tout le pays semblait mépriser le danger. Les chèvres aussi croient en leur karma et elles traversent en troupeau entier la nationale se foutant éperdument des véhicules. Comment être le même après une telle frayeur ? Il ne pouvait espérer meilleur comité d’accueil pour lui donner envie de fuir ventre à terre.
-Si après cela on désire rester en Inde, c’est qu’on est un foutu pervers. Et si on y survit, alors on peut s’adapter à bien d’autres situations, car on est aussi blindé que ces Ambassador.
Norbert Caratini maudissait déjà l’entreprise pour laquelle il allait travailler. Sachant leur expérience et leur connaissance du problème, il les jugera criminel de n’avoir pas pensé à lui épargner de telles émotions. Car eux ne pouvaient, ne devaient pas ignorer l’étendue de sa frayeur et le cauchemar de ces deux heures de transfert entre l’aéroport international et son lieu de destination.
-« Plus rien ne sera pareil et vous ne pourrez plus voir le monde avec les mêmes yeux. Plus rien n’aura de sens… Plus rien auquel vous raccrocher, alors qu’un vide vertigineux s’installera sous vos pieds. Pendant tout ce temps, il vous faudra tenir en funambule sur le fil ténu du peu de raison qu’il vous restera. Ce sera le bain de révélateur de vous-même dans lequel vous serez plongé en permanence qui fera qu’un autre naîtra de vous, sur vos décombres. Un être hybride jaillira de cette carcasse, façonné avec les restes de l’ancien. Les couches du passé vont se décoller les une après les autres, ce qui vous provoquera un trouble intense », lui avait prédit une connaissance bien intentionnée, avant de partir.
-Mais qu’est ce qu’il me raconte ?
Norbert l’avait alors regardé avec des yeux de mérou apoplectique. Il ignorait le sens de ses paroles et le prenait pour un type gentil, mais légèrement dérangé avec ses encens thérapeutiques et ses flux énergétiques. Lui et ses prédictions à la mord-moi. Il l’avait écouté d’un œil compatissant. En pensant qu’un bon Tranxene lui serait plus qu’utile, bien qu’il ne soit pas vraiment agité.

Fini les petits paysages aux bosses sages, aux formes douces, plantureuses et maternelles des contreforts pyrénéens. Tout dans ce nouveau monde semblait chaotique, violent, cruel, terrible. L’univers des hommes est ainsi, il n’en doutait pas, mais il ignorait qu'il pu l'être à ce point. Tout lui paraîtra crasseux, et ce ne sera pas une simple impression. Tout est crasseux, poussiéreux, sale, infect, déglingué ou mal entretenu.
Malgré le choc, il trouvait encore de la beauté dans ces temples décorés de spots lumineux et de guirlandes électriques qui clignotent et sont censés mettre en valeur les laques brillantes des statues polychromes, dont le bestiaire oscille entre le tombeau de Toutankamon, Disneyland et une fête à neu-neu en technicolor.
Le sacré, les dieux monos ou polygames, les religions pluridisciplinaires ou polymorphes tout cela n’aura aucun sens et lui apparaîtra comme un décor de théâtre auquel, quoi qu’il apporte comme connaissance livresque et comme raisonnement, il ne comprendra rien.
-Pour appréhender ce qui se passe ici, il faut se contenter de lire le travail des érudits, qui n’ont pas été assez fous pour vérifier leurs dires sur le terrain. Ils avaient bien raison à l’abri de leur forteresse en bouffant d’édition… Mais surtout ne jamais mettre les pieds sous ces maudites tropiques.

08:55 Publié dans Extraits de romans | Lien permanent | Commentaires (0)
Rldasedlrad les dlcmhypbgf
Par Valéry Larbaud

Photo Bénédicte Mercier: Cochin
Il y a quelques jours, étant de passage à Nantes, au retour d'une excursion à Belle-Île, j'ai lu, dans un journal de Paris, que j'allais publier un livre formé de plusieurs nouvelles dont une, la dernière, était intitulée « Rldasedlrad les dlcmhypbgf ».
En province française, je lis volontiers les journaux de Paris. Il me semble toujours que je vais y trouver des nouvelles de mes amis, de mon quartier, de ma maison. Un fait divers qui s'est passé dans mon arrondissement m'intéresse comme si je connaissais les gens qui y ont joué un rôle ; et s'il y avait à Paris, comme à Londres, des journaux de quartiers, j'achèterais, en même temps que "le Journal", "le Temps" et "l'Intransigeant",le quotidien du Cinquième arrondissement qui s'appellerait, par exemple, "la Lanterne du Panthéon" ou peut-être "l'Âme latine".
Voilà pourquoi, pendant tout mon séjour à Nantes, je n'ai pas manqué d'acheter les journaux de Paris. J'avoue qu'ils ne m'ont donné aucune nouvelle de mon quartier. Ils n'ont même pas su me dire où en étaient les travaux de repavement des Boulevards et de la rue Soufflot. Mais, en compensation, ils m'ont appris qu'on allait publier un certain nombre d'ouvrages de mes amis, et un d'entre eux m'a même donné des nouvelles de moi-même, nouvelles qui m'ont un peu surpris, puisque, si je me souviens bien d'avoir écrit trois des ouvrages qu'il annonçait sous mon nom, je suis très assuré de n'avoir jamais écrit « Rldasedlrad, etc.»
Et pourtant ce journal l'affirmait sans hésitation aucune. Un certain nombre de personnes que je croisais dans les rues de Nantes l'avaient lu comme moi, et ceux qui s'en souvenaient encore devaient en être persuadés. Si un ami, de passage à Nantes, m'avait aperçu dans la foule, rue Crébillon, et m'avait appelé par mon nom, il aurait pu se trouver un passant qui aurait songé : Tiens, voilà justement l'auteur de cette chose qui a un titre imprononçable. Ainsi je me trouvais, dans une certaine mesure, responsable de « Rldasedlrad les dlcmhypbgf ».
Je sais bien que c'était un mensonge et que c'était la machine à imprimer qui l'avait fait. Mais je suis trop le lecteur d'Erewhon pour ne pas croire à l'intelligence des machines et pour ne pas voir une intention dans leurs erreurs. Quand je dictais, justement, ma traduction d'Erewhon à une jeune dactylographe distraite et dépourvue d'orthographe («Attention, Mademoiselle, vous allez encore écrire «chute» avec deux t», c'était fait), j'ai pu constater que la machine à écrire donnait quelques signes non douteux d'intelligence. Dans les chapitres où il n'est question que des aventures et des amours du héros, tout allait à peu près bien en ce qui concernait la ponctuation ; mais dès que nous passions à un de ces chapitres qui sont surtout des essais philosophiques, il devenait clair que la copiste se désintéressait complètement de son travail et renonçait à comprendre ce qu'elle écrivait. Pourtant, de loin en loin, l'oeil de son esprit essayait de saisir le sens de ce qu'elle venait de transmettre au papier, mais il ne voyait rien et se détournait vite vers une autre région de sa vie intérieure. Eh bien, la machine à écrire, malicieusement, enregistrait ce mouvement d'attention déçue. Ne possédant pas, dans ses ressources sémantiques, un signe spécial, le point d'incompréhension, elle prenait ce qui s'en rapprochait le plus, et mettait un point d'interrogation au bout de chacune des phrases que la copiste avait cherché à comprendre et n'avait pas comprises, transformant ainsi les plus rondes affirmations de Samuel Butler en de timides questions au lecteur.
Evidemment, en m'attribuant un ouvrage intitulé « Rldasedlrad les dlcmhypbgf », la linotype de ce journal avait voulu, ou bien se moquer de moi, ou bien me fournir un thème, me conseiller d'écrire sur un sujet qui lui tenait à coeur, et qu'elle avait essayé, en son langage de machine, de m'indiquer. Or une linotype est une machine d'aspect trop sérieux pour qu'on puisse s'arrêter à l'hypothèse d'une plaisanterie. Qu'avait-elle donc voulu me dire, et quel sujet me demandait-elle de traiter ?
De l'excellent Musée d'histoire naturelle au riche Musée de peinture de Nantes, et du quai de l'Erdre à la place de la Bourse, j'ai considéré attentivement ce message machinien. La cryptographie n'avait rien à y voir, et aucune clé n'aurait pu m'y faire lire par exemple : "Onorate l'altissimo poeta", ou : Eh va donc, sans-talent ! Le seul mot humain qu'elle avait réussi à former : «les», inséré entre deux mots de son langage, pouvait me faire penser qu'il s'agissait d'une maxime, d'un avis qu'elle m'offrait, comme : «Méprise les méchants critiques ». Mais le contexte même me montrait qu'il fallait y voir, ou plutôt y chercher, un titre qui m'était proposé.
Par malheur, je n'ai pu le déchiffrer qu'à demi. J'ai bien trouvé, dans le premier mot, trois groupes de lettres qui faisaient un sens à peu près acceptable. Rlda pouvait être un prénom féminin slave prononcé Rulda ou Rilda, et rad m'a fait songer, je ne sais pourquoi, non au mot allemand qui signifie «roue», mais aux voies ferrées : un mot scandinave qui viendrait du latin rete, à moins qu'il ne s'apparente à des mots germaniques qui signifient : «Je fais transporter»; reit --- rid ---. Le groupe intermédiaire sed, était du moins parfaitement clair. Donc je devais comprendre : «Pour rencontrer la belle Rilda, il faut faire un voyage.»
Mais, dans cette explication, j'avais négligé la présence de «l» entre sed et rad. Pour en tenir compte, il me fallait donc considérer un nouveau groupement, dont le sens était : «le noble chemin de fer de Rilda» : Rldas edl rad. Du reste, cela revenait à peu près au même : il y avait toujours une femme et un voyage, comme dans une séance de cartomancie.
Eh bien, qui était donc cette Rlda, et valait-elle le voyage ? La suite aurait dû me l'apprendre. «Les» qui m'avait paru si clair devenait incompréhensible. Il valait mieux le considérer comme une graphie phonétique : «laisse»; c'est-à-dire : Renonce à Rlda et au voyage. Mais le troisième mot commençait par me donner à entendre que cette personne était «douce»
Oserais-je dire, à présent, que je ne me suis pas amusé à Nantes ? Et ce n'est pas seulement à cette linotype parisienne que j'ai dû quelques moments agréables. Nantes a un fleuve immense divisé en plusieurs bras par des îles couvertes de maisons et de rues à l'infini qui ne sont pourtant que les faubourgs de la ville. On y voit aussi un remarquable passage vitré, un passage à plusieurs étages, théâtral, avec des escaliers de fer dont les paliers superposés donnent accès à des boutiques aux belles devantures luisantes, rangées comme des vitrines de musée autour d'aériennes galeries. Enfin, le long d'un quai, au beau milieu de la ville, en pleine rue, passent les trains, qui ont tous l'air de grands rapides qui vont rejoindre les paquebots en partance. C'est toute l'Amérique des romans de Jules Verne (qui est né à Nantes), --- l'Amérique des années qui ont précédé et suivi la guerre de Sécession, --- l'Amérique des longues barbes en pointe et des képis dont la coiffe était rabattue sur une courte visière carrée, et des uniformes bleu foncé à parements et ganses blanches pour l'infanterie, jaunes pour la cavalerie et rouges pour l'artillerie, --- une Amérique extraordinairement moderne et qui restera toujours moderne, grâce à Jules Verne; --- mais ce serait encore mieux si les locomotives qui passent dans les rues de Nantes avaient des chasse-neige et de grosses cloches.
08:45 Publié dans carnets de voyages | Lien permanent | Commentaires (0)
Un enfant de coeur (extrait)

Près de l’entrée, la crèche des gosses abandonnés à la naissance ou des enfants de parents incarcérés. Ils attendaient là une solution qui tardait à venir, ou une éventuelle famille d’accueil. Tous s’entassaient dans cette cour des malédictions, ce cul de basse-fosse. Tous étaient des gosses d’ivrogne, à de rares exceptions. Tous des cas d’urgences ou comme nous des cas sans solution immédiate. Le Père buvait, mais on était bien vivants et en bonne santé.
La dame en blanc nous a indiqué nos dortoirs respectifs. Le Petit résidait chez les petits, qui ne sont pas tenus de faire leur lit. Nous deux, dans une autre pièce. Hauts plafonds, huit lits par chambrée, en deux impeccables rangées de quatre. Couvertures blanches au carré, murs blancs, draps blancs, cela nous changeait du pensionnat.
Les couloirs, on les traversait en rangs, pour aller au réfectoire, aux douches, aux dortoirs ou à la télé. Partout, interdit de parler. Dans la cour, ne pas crier. Obsédant silence. Fuir, fuir ces murs, cette porte verte, la longueur des jours, le blanc. Le monde était derrière cette porte verte. Ailleurs… Loin de ces couteaux dentés à bouts ronds en inox, de ces verres et de ces assiettes transparentes, de cette odeur de Javel, d’éther, de produits d’entretien. Le monde n’a pas cette couleur, cette odeur. Il sent, il pue, il transpire. Chaud, froid, tendre et cruel, tout à la fois. Mais pas ainsi, blanc, blanc, blanc. Du blanc pour le personnel. Des blouses grises, des shorts marrons, des baskets bleues pour les pensionnaires. On ne risquait pas de nous confondre avec eux, une fois nos tenues de bagnards enfilées. L’administration ne connaît pas la fantaisie. Le règlement et l’uniforme sont ses seuls lots.
Le monde et la vie ne pénétraient pas en ces lieux. Pour y goûter au monde, il aurait fallu posséder l’énorme trousseau de clefs de Mlle D. Accroché comme suspendu à sa hanche, ou enfoui dans la poche de sa blouse, il la déformait par une bosse, au niveau de sa cuisse. Elle tournait ses clefs nerveusement sur leur anneau pour se donner un air. Il y avait la grosse clé de la grande porte, et les petites des bureaux ou des dortoirs. Au total, un bon kilo de ferraille. Chaque instant de l’existence était régi par ce concert de métal.
Pour tout, il fallait lever le doigt. Demander l’autorisation. La cour étant dépourvue de w.-c. on y pénétrait par le perron d’entrée du bâtiment, mais cela relevait du règlement. En dehors des temps autorisés le surveillant nous interdisait l’accès aux toilettes. Son veto était irrémédiable et il avait les moyens, dissuasifs et persuasifs, pour nous apprendre à ne pas trépigner d’impatience. Il arrivait qu’une subite envie doive attendre l’heure du repas. Les urinoirs étaient regroupés dans la même pièce que les lavabos et douches où l’on se lavait les mains avant d’aller au réfectoire. Alors, si on ne pouvait plus tenir, on urinait discrètement dans le parterre de géraniums.
On est devenus des champions du sport intérieur en serrage de sphincters ou rétention de vessie. On a rapidement appris à reconnaître les moments stratégiques pendant lesquels on devait impérativement penser à nos besoins pour s’éviter ce genre de désagrément. C’était vital ! L’administration doit pouvoir tout contrôler, y compris l’intérieur. Il faut obéir à ses sacro-saintes lois, qui ont été mises en place pour notre bien, et surtout ne jamais douter un instant qu’elles ont été faites pour ça. Sinon c’est à devenir fou.
Le règlement, l’administration nous l’a fait pénétrer jusqu’au plus profond de nous-mêmes. Et on peut leur faire confiance aux agents zélés de l’administration. Ils se démènent pour justifier leur salaire. Stoïque et hautaine, Mlle D. demeurait de marbre face aux incontinences des pensionnaires. Rien ni personne, ni larmes de crocodile, ni supplication ne la faisait fléchir.
Les après-midi pluvieux, on descendait dans la salle de jeux au sous-sol. Étaient mis à notre disposition une table de ping-pong quatre raquettes, un jeu de petits chevaux, un autre de dames, et des cartes dépareillées. Pas de livres ni de revues, rien à lire, à regarder ou à découvrir. Il fallait attendre que passe la journée, que s’écoulent cruellement les minutes martelées au carillon du désœuvrement et de l’ennui, que les jours fuient. Par beau temps, on restait dans la cour avec pour tout décor le bitume, deux balançoires et, là-haut, le ciel bleu où j’aurais voulu me perdre.
Souvent, entre les grands, éclataient des bagarres. Elles n’avaient pas le temps de dégénérer. Le surveillant qui traînait toujours dans les parages y mettait de l’ordre, au hasard des têtes qu’il rencontrait sur son passage. Il se frayait un chemin à coups de pied et des claques. À part se battre pour s’occuper, le Tatoué , un pensionnaire, ne connaissait aucun autre métier. Proche de la majorité, il avait déjà passé les trois quarts de sa vie en foyers, fuguant de l’un avant d’être transféré dans un autre. Il ne s’est pas éternisé et a été expédié dans un centre d’adaptation par le travail. Il a dû atterrir dans un hôpital psychiatrique ou en prison.
Il n’aurait pas dû être agressif. La dose de calmant qu’il avalait chaque jour avait de quoi abrutir un troupeau de mammouths. Il parlait lentement, avec une légère mousse blanchâtre au coin de la bouche. Même le plus violent poison ne le calmait pas, tellement il était accoutumé aux tranquillisants.
08:34 Publié dans Extraits de romans | Lien permanent | Commentaires (0)
14/05/2007
Temples du Sud indien

Photos Bénédicte Mercier
Que la gorgée d’eau qu’il a bu ai pu terrassé un hippopotame, tant elle contenait de bactéries et de matières fécales, il ne faut pas en douter un seul instant. C’est un poison puissant. Redoutable, typhoïde garantie à l’imprudent européen qui oserait pareille chose. Non rien de cela ne lui arrivera. Ce vieil homme fait cela depuis des siècles. Son corps est immunisé contre les pires poisons. Maigre comme un i , mais frais comme un centenaire épanoui. Rien de ce que vous avez connu ne vous sert plus. Si partout dans le monde on ne croit que ce que l’on voit, ici ce que vos yeux voient, votre cerveau ne le croit pas.
Non ce n’est pas possible qu’un homme puisse boire à même le cul de la vache l’urine quelle pisse. Panacée bien incroyable à ses yeux d’occidental et pourtant rien d’anormal à cela. On insistera pour que vous en buviez lorsque vous ferez une chute de vélo pour vous remettre d’aplomb alors que vous êtes sonné sur le bitume. Vous refuserez malgré l’insistance bienveillante.
Juste retour des choses. L’érudition ne sert plus à rien. L’hygiène, le bon sens, la raison, vos croyances, tout ça il faut le mettre par-dessus bord, pour se délester la compréhension. Tout ça n’a plus rien à faire dans ce monde-là.
Le moindre geste, la moindre scène anecdotique est perçue comme une situation hyperréaliste. Le cerveau capte en permanence avec une acuité qu’il n’a pas dans un lieu où il a déjà pris ses repères. Et cela provoque un état second. Ces souvenirs que vous avez oublié et qui reviennent par flashs, précis et lumineux ils vous éclairent sur le passé et vous aide à comprendre ce qui s’est joué sur le moment que vous n’aviez pas compris. L’état de découvreur est un état erratique où tous les sens sont en alerte. Le voyage nettoie le cerveau. Il décortique la réalité pour la percevoir et rendre acceptable. Cette femme mourante allongée dans des détritus, le visage couvert de mouches qu’elle ne chasse plus qu’avec un geste las, combien d’heures lui reste-t-il à vivre ?
Ce soir probablement elle sera morte, et des familles entières passent, des enfants jouent, des chiens erratiques dont la gale a fait tomber les derniers poils cherchent leur nourriture dans les déchets. Eux aussi ignorent la mourante. Peut-être attendent-ils simplement la nuit pour mieux se partager son cadavre. Vous, vous ne voyez plus qu’elle. Ses yeux envahissaient toute la scène du spectacle. Vous ne saviez plus si vous aviez peur de cet être, ou de la perception palpable de votre propre finitude. Avec cette morte, vous avez apprivoisé celles des autres.
Il a fini par douter, de la réalité de son être. Cela à commencé par l’odorat. Il ne savait plus si l’odeur putride qu’il percevait n’était finalement pas l’amorce d’un parfum bien plus subtil d’un raffinement le plus extravagant. Sa peur du début lui paraît si stupide, elle s’est métamorphosée. Tout lui paraît si étrangement simple. Comment avait-il pu s’embarrasser de désirs si stupidement superflus en vogue en occident et se sentir menacé par un système aussi passablement archaïque et désuet que l’Inde. Il lui semblait maintenant qu’il pouvait vivre simplement et être heureux en s’inspirant de ces gens.
C’est dans la proximité des deux états si opposés que se niche le sublime. L’état de transe émotionnelle que provoque tant de beauté de sublimation du temporel et l’état de la réalité actuelle. Ce raccourci temporel provoque comme un vide sidéral. Cela se passe sur la même planète, au même endroit et ce n’est que dans la confrontation de ces deux instants que la réalité vacille et conduit à la détresse du spectateur. Comment vivre parmi tant de vermines entouré de ces mouches agressives agglutinées en grappes noires et voraces.

18:40 Publié dans carnets de voyages | Lien permanent | Commentaires (0)
12/05/2007
Abed Azrié

Par Isabelle Jacq
Présenter Abed Azrié, c'est avant tout évoquer la beauté de sa voix . Abed Azrié est un chanteur à la voix profonde, chaude et sensuelle. Si proche de nous, jusqu'au point de nous révéler à nous-même, comme un souffle bienfaiteur, son chant régénère et procure une incommensurable joie intérieure. Né à Alep, au confluent de l'Orient et de l'Occident, Abed Azrié s'installe en France où il vit désormais .Sa musique rassemble les instruments traditionnels de ses origines orientales auxquels il adjoint des instruments occidentaux. Ses compositions contemporaines font renaître les grands poètes de langue arabe, le mysticisme du plus grand théosophe de l'islam: Ibn Arabi, et les muwwashahat, ces merveilleux poèmes andalous du 11è siècle. Son travail est une évocation permanente d'une mémoire spirituelle orientale. Dans l'album intitulé " l'épopée de Gilgamesh", Abed Azrié remonte à l'origine de l'humanité et nous rapporte, au travers son chant, la plus ancienne trace écrite d'épopée qui contient en germe les mythes fondateurs de la plupart des religions. Gilgamesh est ce héros démesuré de la mythologie sumérienne qui , face à la peur de la mort, cherchera toute sa vie le secret de l'immortalité. A travers son chant, Abed Azrié nous dévoile la profonde modernité de ce récit mythique. Dans l'album " Les Soufis" enregistré en 1979, Abed chante les poètes mystiques du 9è au 13è siècle. Puis, dans le" chant de l'arbre oriental" (1985), il adapte les poèmes d'auteurs contemporains de Syrie, du Liban, d'Irak et de Palestine. En 1989, dans l'album intitulé "Aromates", le chanteur exalte la beauté de la poésie arabe contemporaine et mystique. Là où Abed Azrié rencontre véritablement le Flamenco et les musiques espagnoles, c'est dans l'album intitulé "Suerte", "La bonne fortune", en espagnol. Avec la voix de Serge Guirao, ils évoquent deux cultures , arabe et espagnole qui, sous l'effet du chant, des accords de guitare ,des percussions ,de l'accordéon, du trio à cordes et des instruments orientaux ,fusionnent d'une manière harmonieuse et parfaite. Sur le thème de l'amour, Abed et Serge rendent un somptueux hommage à la femme. Dans son nouvel album, Abed Azrié chante "Omar Kayyam", poète perse, défenseur d'un islam tolérant et adepte des joies de la vie. Face au fanatisme religieux, il nous invite à aimer sans entrave les joies simples qu'elle procure, à nous enivrer de la diversité des parfums et des couleurs, des sons et des autres cultures qui nous entourent . Abed Azrié, homme de lumière, se veut avant tout un "homme de liberté". Il croit à l'art comme ferment humaniste et, face à nos doutes et à nos questions, ces mêmes questions, par sa voix posées, donnent l'apaisement d'une réponse.
Contact artistique d'Abed Azrié: Boris Kurtz, Artmada Productions, 3 rue des Missionnaires 78000 Versailles. tel: 01 39 49 92 92 ; Email: artmada@wanadoo.fr
Retrouvez Isabelle Jacq sur son site EN CLIQUANT ICI
14:19 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (1)
08/05/2007
Souleymane Diamanka
07:00 Publié dans De la poésie au quotidien | Lien permanent | Commentaires (0)
01/05/2007
Un bandonéon mélancolique
Par Mathias Heizmann

Croiser la viole de gambe et le bandonéon, réunir un musicien contemporain épris de tango et de milongaet l’un des musiciens baroques le plus célèbre du moment, voilà qui n’est pas habituel.
Dans son remarquable texte d’introduction, Jean-Luc Tamby rappelle les enjeux de cette création : Daniel Brel cherche une musique en forme d’association libre qui renonce à théâtraliser le discours en le pliant à ce que la tradition de la composition nomme un développement. Entièrement tournée vers le passé, elle ne cesse de se souvenir d’autres musiques et joue avec la mélancolie comme d’autres jouent avec leur mémoire face aux impossibles deuils .
Les inventeurs du tango introduisirent dans la danse l’interruption du mouvement * : on pouvait ainsi jouer sur des variations rythmiques infimes et envisager une interprétation dépassant le rythme musical proprement dit. La musique de Daniel Brel se situe elle aussi dans ce type d’espaces, au-delà des figures musicales, sur les plages désertées par ceux qui souhaitent faire de cet art un objet trop palpable.
Que la viole et le bandonéon puisse fusionner à ce point restera pour beaucoup un mystère tout comme restera mystérieux la réussite d’un projet qui touche aux racines subjectives de la musique. Surgie tout droit de ce lieu obscur où se forment les rêves, l’œuvre de Daniel Brel est aujourd’hui indispensable : pour l’avoir simplement compris et si remarquablement jouée, Vincent Dumestre mérite tous les éloges…
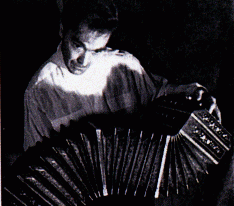
Si nous ne sommes pas en mesure de vous faire écouter la musique de Daniel Brel, les palois auront la chance de l'entendre au THEATRE DU MONTE-CHARGE 7, Rue Rivarès 64000 PAU du 03/05/2007 au 05/05/2007
10:35 Publié dans Les copains d'abord | Lien permanent | Commentaires (0)


