30/03/2007
Les Crobards
Par Mèze Malnuit

L'illustration est de Yves Budin qui vient de publier aux carnets du dessert de lune Visions of Miles
Voila ça y est l'idée fait son chemin. On va republier Malnuit. Oui c'est un événement. Ce sera pour l'automne probablement. C'est Bédé qui s'est mis au clavier pour exhumer ces textes devenus introuvables. Je vous en dirai plus au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Mais pour commencer juste un petit morceau pour le plaisir, comme on lèche les plats...
Crobard : n.m. Dessin à main levée qui ne fait qu’esquisser l’image d’un être ou d’une chose. (Petit Larousse – voir : croquis)
C’est peut-être cette idée, plutôt ce sentiment, qui rendait tous les autres toquards, et ridicules, et dérisoires…
Quelque chose qui encourageait cette fantaisie, ou quelqu’un, tout ce qui pouvait la favoriser, j’en tenais compte. Je fonçais dans le tas tête baissée, sans trop savoir ce qui m’attendait – en général une bosse – mais parfois une veine, et alors je tâtais je fouinais je creusais, ou une nappe et je barbotais comme un canard et je plongeais le cœur content à la recherche du POISSON D’OR… C’est c’que Servole appelait « le sapage de base » et qui n’était rien de plus qu’une discussion que je provoquais ou que je suscitais – dont j’étais avide – sans idée plus précise que l’espoir d’y trouver mon compte… Les gens m’attiraient, comme ils m’attirent toujours, pour ce qu’ils sont, ci ou ça – barman ou professeur ou clochard ou peintre – et pour ce qu’ils peuvent être : rien pour moi ou bien le moyen de faire un pas dans le sens de ce sentiment d’un maître, d’un but, d’une sagesse. J’étais ce qu’il y a de plus normal ! – et je me faisais brutal quand on trouvait ça bizarre, c’est tout – quand ça me faisait chier de dire que j’avais besoin des autres. Friable, fragile et tout, je réussissais à passer pour fort. Je l’étais de me savoir faible – mais c’est un peu fastoche ; les filozofs i’ commençaient à me les faire grosses comme ça !
Les gens étaient des fruits, fallait en pomper le jus et après on jetait la peau… Mais ils n’étaient pas tous QUE ÇA, pas si simple… Fallait même qu’ils soient autre chose – surtout ! Ceux qui vivaient avec le cœur, qui parlaient avec le cœur, ceux-là je les respectais ; les autres, pas mon job, pas de quartier on presse et on jette – façon de dire que c’était vite vu et que, si je visais du côté du cœur c’est que je cherchais le mien : où est-il, que veut-il, pourquoi qu’i’ m’emmerde ?… J’avais MAL AU CŒUR. Je voulais connaître la souffrance des autres (pas les chagrins d’amour, mes p’tites, ou alors du vrai chagrin de vrai cœur brisé – et pas d’histoires j’ai ma baguette de sourcier !). Je voulais APPRIVOISER LA SOUFFRANCE. C’est peut-être pour ça qu’il m’arrivait de la nier, et avec elle l’organe, son instrument et siège. Ou de la rechercher…
Pirot m’avait dit un jour que je me dépatouillais devant lui avec mes monstres : « Je crois que je comprends ce que vous dites Malnuit, mais je crois aussi que vous vous créez des problèmes » - Il avait raison, il y était passé avant moi… Il n’empêche, imaginaire ou réelle, j’avais une bombe dans le ventre. Illusion ou réalité, TOUT pouvait être l’une ou l’autre ou les deux, et l’était ; c’était de la petite farine d’en chicaner. Un bonhomme c’était un mélange de désirs et d’angoisses, c’était pas clair et pas compréhensible, ça disait oui et ça disait non et ça faisait pas la différence… Fallait qu’il marche avec des cannes pour apprendre à marcher sans cannes, un jour. – Je m’disais qu’il importait plus de le désirer que d’y parvenir – Puisque je pouvais imaginer un maître à vivre et à penser, il existait donc ; j’avais qu’à suivre mon imagination en me foutant du maître comme de ma première queue ; j’étais moi-même ce maître, ou je devais l’être, ou je voulais l’être, ou je l’étais pas aucune importance et tout est dit les jeux sont faits, t’es gagnant t’es perdant c’est recto et verso pipi et caca, t’as pas à te tortiller les amygdales t’es dans le bon train tchouf tchouf tchouf, je faisais le tour de la terre – que ceux qui m’aiment me suivent – je leur tendais la main au passage : montez montez vous allez voir comme c’est beau et comme c’est pénard ! Montez attrapez-moi ça rapido et attention à la marche !
Accroche-toi y’a du vent ! Alors , c’est-y pas du bon temps qu’on s’paye ? – krut krut treug krut krut treug qu’est-ce tu dis d’ça ?… t’as vu les vaches… c’est fou c’qu’y a d’vaches tout du long qui zieutent avec des yeux ronds… Et ça tu sais c’que c’est ça ? non c’est pas la frontière… t’as peur ?… t’occupe pas c’est tout cuit, tu vas voir la région par là, vache de bath… trook trook krrrt – tiens on va ralentir baisse les gaz… alors ? – vouais j’veux bien… Skol !… ça réchauffe hein… vouais… non, c’est le soleil qu’a disparu… un autre, ouais – à la tienne !… Vingt dieux c’est encore plus chouette la nuit… on voit plus rien ça paraît immense… on dirait qu’on fait du sur-place j’aime… quand tu penses qu’on roule à 200… comme si le temps s’était arrêté… plus d’temps plus d’espace plus rien… une espèce d’absolu quoi… merde ça vaut l’jus !…
Tiens, un coup avec Chomé j’me rappelle… j’sais plus s’il habitait Grenoble ou s’il était venu exprès… ç’avait été la grande ballade. C’était toujours la grande ballade avec lui. Enfin la grande ballade… je veux dire qu’on écumait le royaume à grandes foulées, à toute vapeur… via Vladivostok par Tombouctou et Vancouver, n’importe quoi n’importe comment pourvu qu’ça bombe, et les courants d’air faut pas y craindre, ni le phylloxera, et ça tombait du plafond à chaque minute, toutes qu’on les a nettoyées bel et bien ces putains d’araignées, slarp avec la langue pendant des heures ; la fiesta ; ce lour-là ou un autre, j’dis bien c’était toujours la fête. Sûrement qu’ça tenait à ce qu’on était comme qui dirait 2 doigts de la main… Y’a des années qu’on se connaissait déjà, depuis le bahut au commencement ; on avait 10-12 ans ; c’était au quart de poil – et j’y pense, c’est ça le vrai dialogue, quand tu parles et t’as pas besoin de faire le détail on se comprend, pas de ficelles et pas de pièges à con et pas besoin de tâter le terrain, tu connais, c’est les yeux fermés, à l’aveugle, lui c’est le paralytique, une paire royale… et une paix royale ; parce que ça se passe dans la paix, et la confiance et l’abandon… Y’a rien à dire, c’est pas du racontable –
Ce jour-là on avait pas débandé. De bar en bistrot on a pt’être bien écumé la ville en égrenant nos chapelets – Parce que c’est comme la religion, causer, c’est comme la prière quand y’a la foi – et la foi… Au juste c’est pas qu’on l’avait… j’en sais rien ; mais ce qui est sûr c’est qu’on avait besoin de rien d’autre, tant qu’on était en train. On parlait de l’amour ; de la vie ; de la mort. On parlait de rien et de tout ; on assassinait et on accouchait en même temps ; c’était la vie parallèle, la vie ramassée, précipitée, et passée au tamis, des tonnes de graines à calibrer – ça c’est bon ça c’est pas bon – des kilomètres de rails avalés à 200 à l’heure, et le temps c’était du bidon, un épouvantail pour les oiseaux peureux, on s’en tapait on se perchait dessus les ailes en action et on se compissait, volupté et Cie, en attendant l’apocalypse… On dansait le calypso des vieilles nippes et on criaillait HOULA HOULAAAA pour faire crouler la charpente du bon Dieu ; c’te farce !… Qu’est-ce que c’était la vie ? Un point dans l’espace mental ; une chiure séchée sur la vitre de l’éternité ; pas ce qu’on en dit de par le monde des hommes en tous cas. Les hommes ? ce qu’on était nous-mêmes, là, à parler devant une bière, une saucisse dans le buffet et un abcès sous la dernière molaire inférieure : de la chair à pâté pour la poudre à canons ou du polystyrène à fabriquer des pions que les anges déplacent sur les fesses des élues-martyres en se curant les dents… Les mots avaient des ailes, et de la grâce, et du plomb dans les ailes et la mort aux trousses ; à volonté ; feu sur le monde à volonté, et sauve qui peut… La grande cavalcade, le jour où l’on dérouille, où l’on ouvre les portes et on en ferme d’autres, le jour du grand décompte, de la re-création, le ménage en grand et la vidange énorme, à toi, à moi, à toi, je tire , tu pares, on pousse, tiens aide-moi on va soulever ça, regarde cette couche, au panier, ouvre la fenêtre, fous-moi ça en l’air, t’as vu la lune elle pleure, t’entends – c’est quoi ? – je sais pas – tu vois rien ? – fait nuit totale – attends t’affole pas – file-moi une clope – écoute – ça bouge là-dessous – j’ai mal aux chailles – commande un sec ça étouffe la douleur – elle avait un petit sourire tu peux pas savoir – pas dègue cette allemande – c’est d’la Kronenbourg – j’te parle de cette fille là – et si Dieu existait qu’est-ce ça changerait ? – t’irais au trou, dans la trappe, crac – passe devant j’te suis – raison majeure : trop familier avec moi – suis flatté – et l’cul au rouge pendant 1000 ans – rigole pas ça m’lance – j’vais l’inviter à faire l’amour – je m’sens vieux mon vieux – ça vous passera avant qu’ça me prenne elle t’a dit ? – ouais – conne – de près pas si chouette que ça – tout à la fois – fait un billard ? – change de décor – la mer – mézigue c’est pareil – dans le ventre et dans la tête – avec des vagues comme ça – autre chose – depuis l’temps – cré salaud – savait pas à quoi s’en tenir – tait pourtant clair enfin – te mets jamais à la place des autres tu peux pas savoir – fff – t’aime bien comme ça vieux – des fois qu’ça voudrait – pas la différence – c’est qu’on va loin – tu crois qu’ça va péter un jour ? – pas – c’que tu veux – rien c’est extra – un trottoir, une ville, des lumières – une chance qu’on s’connaisse bien des fois – pareil tu crois pas ? – d’être ensemble – pareil aussi, rien, rien à part ! – vie de dormir, moi non plus non – la vie est pas c’qu’elle devrait être et elle l’est, obligé – ch’ment dans l’coup – pas assez à – parlais des femmes – pas en sortir – justement le hic on en sort ! – remettre ça – où ça ? – comme tu veux tu t’retrouves toujours le bec dans l’eau – pine en l’air et l’drapeau blanc au bout – terrible à dire – comme si c’était vrai ! – à bouffer du foin – parle plus – c’est ouvert – comme en 14 ! – va s’écouter un pe-tit-blouzz – l’endroit ? – sur bandes – j’en bande – bandons – fatigué ? – comme si c’était t’à l’heure – une paire de fesses que j’y foutrais la langue – tu vas t’échauffer les glandouilles, c’est pas bon pour toi – tièrement d’accord mais qu’est-ce – sais plus c’qu’on disait –
… Deux jours que ça a duré. On collait nos tripes au plafond et on faisait l’autopsie… Ce qu’on devenait, ce qu’on restait, ce qu’on perdait, avec le temps… Pile ou face, tu coules ou tu flottes, si tu flottes c’est guère mieux… Couler pour couler tu perds rien tu verras, au fond c’est mieux même, personne s’en doute ; perdre son temps pour perdre son temps j’aime autant qu’ça soit du ciné… On a dû voir un film je sais plus (à propos j’me suis toujours demandé pourquoi les cinés ferment après minuit…) Sortis de la salle on retrouvait la nôtre et la séance continuait, la vraie, et le film avait rien de fabriqué, pas fait pour les foules, entrée libre et personne s’en doutait, et c’était la plongée dans le noir ultramarin et intestinal, un noir d’âme plus noir que l’encre, et fallait faire gaffe aux faux-pas, du polar avec des décors qu’étaient pas – si, qu’étaient, du sang frais, du cœur en lé, et des jardins et des allées et des luias et des cantiques au diable et à ses complexes parce que le diable est plus près de l’homme, plus saignant dans le genre steak et plus compréhensif. Des injures et des coups de gueule pour rien, et si Dieu existait, il devrait sortir de son trou – depuis le temps qu’il désertait les rues ! – Le besoin d’amour devenait mystique, c’est-à-dire carnassier, comme il était toujours dans l’attente qu’on lui prête garde – un besoin qui, satisfait, eût bouché tous les chiottes de la ville… N’importe quoi tout est bon, tout y passe… Raconter ça ? J’aurais mieux fait de le coller d’abord à l’œil-de-bœuf, mon œil ! Sans blague, t’as vu çui-là ? – qu’est-ce que j’peux dire ? Y’en a déjà qui croient que j’suis rond, ou dingue. – Et si j’l’étais, qu’est-ce que ça changerait… Je dis que les mots sont drogués, bulles de savon bulles de salive, complètement loufs, et 1000 fois dingue l’homme s’en sert, 1000 fois louf à fouler aux pieds, fou à lier… Vouais, ça me revient maintenant : il avait une piaule en ville Chomé… mais on avait couché dans un studio dont j’avais la clé – c’est Servole qui me l’avait filée pour un temps, il était en passe de le balancer sans y avoir jamais habité – vivait chez ses parents je suppose. Un studio duplex à la sortie de la ville… Chomé lisait « l’Adoration » et moi je soliloquais au ralenti – le friselis des pages me rappelait qu’il était là, ce grand jonc, et je lui demandais s’il était bon ce bouquin – « J’sais pas j’ai pas mes lunettes » - Bien sûr il les avait sur le nez ; même que ça lui faisait un drôle d’air docte drôlderdoct drôlderdoct…
21:20 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (0)
29/03/2007
DANGER PUBLIC
Par Mouloud Akkouche
De retour d’un salon littéraire polar, j’attendais sur le quai d’une gare. Fatigué mais la tête pleine de bons souvenirs. Heureux de mon week-end. Un jeune flic de la police ferroviaire passa seul devant moi. Soudain, il lâcha : « Notre peuple vaincra. ». Je regardais autour de nous deux : personne d’autre. Et d’un pas tranquille, ce jeune fonctionnaire de police rejoignit ses collègues. Ventre noué, je le suivis des yeux et m’apprêtais à lui demander des explications. A quoi bon ? Ma famille m’attendait et je ne voulais pas ‘’ bénéficier ‘’ d’un outrage rébellion. Bref, pas envie de passer quelques heures au poste.
Dernièrement, j’ai vu une vieille femme- de type européen- se faire agresser verbalement par un flic de cette même police ferroviaire. Mais ce jour-là, une autre femme d’une quarantaine d’année, très élégante, prit la défense de l’octogénaire en assénant : « Un peu de respect, cette vieille dame pourrait être votre mère ! ». A l’évocation de sa génitrice, le flic baissa immédiatement les yeux, penaud. La montagne de muscles en uniforme redevenue un petit gosse timide. Apprivoisé. Un noir se mit aussi à défendre la vieille femme ; le flic releva d’un seul coup la tête, bave aux lèvres tel un pitt-bull assermenté. Prêt à fondre sur une proie plus facile.
Les exemples de ce genre sont nombreux. Habitué à ce genre de situations, je ne réagis plus. Impuissant. Depuis quelque temps, langues et matraques se délient au quotidien. Cette phrase lâchée par un fonctionnaire de la République me rappela la lecture d’un livre de Albert Cohen : « O vous frères humains ! ». Une histoire sombre se déroulant en Europe au début du vingtième siècle. La ‘’ bête immonde ‘’ reprend en ce moment du poil de la bête dans l’hexagone, une bête de mieux en mieux nourrie. Très simple de transformer le ministère de l’identité nationale en secrétariat d’état aux affaires immigrés. Darquier de Pellepois et Papon sont morts, pas leurs héritiers. Méfiance: l’histoire sert aussi des plats surgelés.
Pourquoi ce jeune flic a balancé cette phrase ? Connerie ? Racisme ? Sans doute beaucoup de raisons. Ou d’irrationalité ? En réalité, il venait de recevoir sa part d’héritage et commençait à l’utiliser. L’héritage de son ministre de tutelle quittant-le jour même- ses fonctions pour un avenir présidentiel.
Et j’ai repensé aux yeux inquiets de cette octogénaire tremblante de peur sur un quai de gare. D’autres regards ont défilé, regards de panthéonisés et d’anonymes dont il faudrait se rappeler. Lucie Aubrac, vous nous manquez. On pensera à vous et aux ‘’ justes ‘’ le 22 avril et le 6 mai.
Si vous voulez connaître les oeuvres de Mouloud Akkouche

19:05 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (0)
28/03/2007
Les Crobards
de Méze Malnuit

L'illustration est de Yves Budin qui vient de publier aux carnets du dessert de lune Visions of Miles
Voila ça y est l'idée fait son chemin. On va republier Malnuit. Oui c'est un événement. Ce sera pour l'automne probablement. C'est Bédé qui s'est mis au clavier pour exhumer ces textes devenus introuvables. Je vous en dirai plus au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Mais pour commencer juste un petit morceau pour le plaisir, comme on lèche les plats...
Crobard : n.m. Dessin à main levée qui ne fait qu’esquisser l’image d’un être ou d’une chose. (Petit Larousse – voir : croquis)
Je me souviens d’un soir, c’est pas vieux… un bal huppé où je suis entré en fausse, avec les gars de l’orchestre – un des 3 ou 4 qui devaient se produire – justement l’orchestre des Archi. – Servole voulait pas — « Pas pour nous c’machin-là » - Tous les types sapés à mort, et les gonzesses fallait voir : décolletés, paire de cuisses, tout du grand luxe… Servole il maudissait sa mère et jurait une fois de plus de se faire curé, ou pédé, ou de se la couper, ou de s’engager dans la Légion… Moi je me fredonnais des comptines pour détourner en corner… Mais quand Bill Coleman emboucha son cuivre, je plaquai tout là et, taillant ma fissure dans la masse compacte des gambergeurs, je déboulai sur l’estrade et j’y posai mon cul. Les projecteurs en pleine poire je buvais des yeux le grand prêtre. Non pas que Bill Coleman soit du 4 étoiles, - il a jamais atteint la Voie Lactée du Jazz où Armstrong a planté sa tente une fois pour toutes – mais en l’occurrence, c’est un type honnête, de la bonne interprétation… J’en voulais et j’en voulais encore, de sa trompinette et de ses solos… Il avait pas tardé à me percer à jour, Bill…J’étais comme un enfant qui reconnaît se mère… J’avais perdu le fil, et le secret de mes origines je le retrouvais après des jours et des jours dans le désert… Le chagrin emmagasiné se trouvait soudain une issue et sortait par la bouche de Bill – After you’ve gone – La délivrance. Le pardon. La paix du cœur. Swingman… La brume était dissipée, la voie libre, et Bill chantait pour moi. Mon frère, je te regardais dans les yeux pendant que tu vidais cette gousse – et sur ta pauvre voix de nègre les autres dansaient, consciencieusement, scrupuleusement, à la perfection, comme d’excellents élèves qu’ils étaient, sensibles au seul tempo mais insensibles à la vie, à la haine et à l’amour que tu exprimais et qui me secouaient comme un prunier YAAA ! – Le seul couple qui touchait sa bille était juste devant moi, un négre et une blonde qui s’aimaient d’amour, une merveille de grâce et de force, une paire comme elles le seront toutes le jour où LA VIE aura gagné la bataille – la vie, le sang, une débauche de plaisir partagé comme j’en ai jamais vu avant ni retrouvé depuis ! – une condamnation à mort de l’exhibitionnisme lucratif – un couple totalement égoïste et pur –
Quand je dis que j’ai jamais rien pigé à la musique (j’ai dit ça ?) faut s’entendre… Pour moi tout est musique, c’est-à-dire que TOUT CONDUIT À LA MUSIQUE – À la musique et à la danse. (Pour un qui bricole du stylo et du pinceau, on pourra pas m’accuser d’être borné). Parce que tout ce qui vit est RYTHME. Et tout est vie. Même la mort qui vient à son heure donner le dernier coup de gong – dont l’écho hante nos mémoires parce qu’il nous obsède de la réminiscence obscure de nos vies antérieures, notamment notre vie fœtale.
Notre âme est charnelle, gorgée de sang et douloureuse. C’est la brousse, la jungle, et non pas un jardin à la française. La musique en est l’expression immédiate : elle ne peut se soumettre à une volonté didactique ou à une idée préconçue… Wagner et Jean-Philippe Rameau ne sont pas des musiciens – Ce sont des faiseurs, des fabricants – un goitreux et un lèche-cul. Ils composaient pour les hyènes et pour les colibris – pas pour les hommes.
Be cool boy… J’étais relax. Balaise Blaise… Bill oubliait les toupies qui ciraient la piste, et il jouait pour jouer, et il jouissait de me voir jouir… Quand il était obligé de balancer un air tarte à la mode pour « honorer » son contrat – hé – il me jetait un regard misérable, et je lui faisais les gros yeux. – J’attendais que ça passe en sirotant la mousse que le garçon-trotteur, qui m’avait à la bonne, m’avait refilée…
Let’s go – Ils s’en donnaient les gars…
Assis sur le bord de l’estrade, j’en prenais plein les feuilles, et c’était bon. La fille à qui j’avais foutu la main, dans la cohue, me jetait du sournois à chaque tour de piste et je rigolais. Sa petite chose intime je l’avais dans la main, bien au creux, et pour toujours que ça te plaise ou non la belle ! – Ça valait bien la gifle qu’elle m’avait retournée – Tiens, j’ouvre, regarde… tu la vois dis, ta petite chatte, roulée en boule et qui ronronne de plaisir ? Alors, pas la peine de t’fatiguer, ta rancune c’est de la frime – tu vois, j’me marre… - Let’s go – Fais comme moi – Éteins la veilleuse et laisse-toi porter, pénétrer, retourner… t’es pas mieux comme ça ? t’as toujours envie de bouder ? Les chatouilles appellent les caresses et les caresses suscitent l’amour… Regarde Glaizo qui traîne son gros cœur tout gonflé… Laisse tomber ce cavalier à la noix qui danse comme un charme et cours vers mon pote et invite-le, et si il te dit « J’sais pas danser » fais le danser quand même… Regarde Bacaze qui se bouffe les ongles, serait-y pas qu’il se sent seulabre ? sa Poppy est retournée avec l’autre – I’m crazy ‘bout you baby, tu pourrais pt’êt’ kekchose pour lui ? – Ah nom de dieu, la sympathie c’est le fruit rare, l’objet de luxe, la chose qu’on mesure – pi d’abord ce gars-là je connais pas. – Ben alors, raison de plus, laisse-toi aller, Y’A LE FEU À LA CAVE !
- Viens là Bacaze, laisse tomber ton fagot, écoute ça… Tu sens comme ça remue… le bon truc j’te dis… le cataplasme impeccable… Vise le batteur, il est joille… t’as pas l’impression, bye bye baby, y’a rien qui tient le coup… du vent… du vent… Écoute un peu… j’me sens parti… viens avec moi, bon dieu, me laisse pas … Ça va ?… Tu t’souviens l’autre soir, Memphis Slim… on s’est marré non… j’parle pas musique, je sais, faut pas comparer les types entre eux, z’ont tous leurs tics… c’est quand tu voyages pépère avec le bonhomme, c’est bath… avec ou sans escales… quand tu – moi en tous cas ce qui me plait pas trop je tiens pas compte, si le mec colle à son truc je marche… j’crois que ça dépend de pas mal de trucs, les conditions et tout le reste, si on a bien bouffé à midi et tout ça, ou bien baisé la dernière fois, tout le bizness… Gerry Mulligan… Ray Charles bon dieu… toi t’aimes bien Fats Domino moi j’accroche pas… Et le Duke ?… c’est comme Armstrong, on a l’impression qu’ils en sortent jamais… des poissons dans l’eau… mais c’que j’en dis… C’que je cherche c’est l’VOYAGE. – J’en ai pas tant à foutre que le bonhomme soit un vrai kèke ou un médiocre… comment savoir d’ailleurs… Le seul critère c’est qu’il fabrique de la vie, du carbure… -
Les p’tits gars ce soir-là ils carburaient ! – Le batteur avait la trouille au ventre parce qu’il décollait – ça y est, il avait trouvé la bonne mesure, le bon mélange… Temps en temps Glaizo se radinait avec une bière qu’on vidait à trois chacun une tasse en discutant le bout de maigre : les fesses, ces vacheries d’paires de fesses etcetera…
J’avais repéré Chaff dans le tas ; il apparaissait entre deux slows une nénette pendue à son cou – et jamais la même, sacré tombeur – mais tombeur de bois mort…
Bacaze s’échauffait… Les « Mélo » avaient épuisé leur répertoire et puisaient dans les pots-pourris, question de durer jusqu’à l’aube… J’avais eu droit à mon petit charleston – la seule chose que j’danse mais sur les chapeaux de roues, faut voir – j’avais écœuré tout le monde…
Les clampins dégageaient la piste les uns après les autres. Restaient les jusqu’à-la-lie…
Le batteur soufflait un peu en buvant sa limonade, et Bacaze avait pris la relève… Petit à petit, piano ma sano, le Dieu du Rythme déliait ses poignets et un sourire lui montait en coin – juste en coin : si tu jubiles tu foires, la synchro c’est sérieux…

20:20 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (0)
25/03/2007
Le livre sous le signe de la sagesse?


Ai vu au salon du livre une blonde tout de rose habillée, ayant autant d’audace dans le regard qu’un hérisson qui tente de traverser une autoroute, racolant debout devant le stand d’un grand distributeur comme une dame de petite vertu tenant son bouquin au titre évocateur « Y a pas de mâle » et je n’invente rien… La pauvre ai-je pensé… Si le contenu avait quelque pertinence, aurait-elle besoin d’en arriver là… Suis repassé un quart d’heure au même endroit. Elle avait réintégrer sa cage pour mon grand malheur visuel car sa plastique plus que sa plume avait de quoi attirer l'œil et augmenter de façon significative le taux de tétostérone de la population masculine…
Pour comparaison, l’ami Arthur qui de forme plantureuse n'a qu'une proéminance stomacale à faire valoir, sans bouger de sa chaise vendait son Odyssée Africaine à de simples quidam, qui avaient déjà lu La route de la soie, et en redemandaient de son plumage. C’est bien là concurrence déloyale, s’il en est, n’est ce pas ?

12:35 Publié dans La vie des bêtes racontée aux enfants | Lien permanent | Commentaires (1)
L’ordre des letrtes
Sleon une étude de l’Uvernitisé de Cmabridge, l’odrre des ltetres dans un mot n’a pas d’ipmrotnace, le suele ccoshe ipmrotnate est que la pmeirère et la drenèire soeint à la bnnoe pclae. Le rsete peut êrte dans un dsérorde ttoal et vuos puoevz tujoruos lrie snas porlbème. C’est prace que le creaveu hmauin ne lit pas chuaqe ltetre elle-mmêe, mais le mot cmome un tuot. La peruve…
Alors ne veenz puls m’ememdrer aevc les corerticons ottrahhggropqiues.
11:20 Publié dans Analyses de littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
24/03/2007
De la prétention littéraire

collage Maryvonne Lequellec
Pour écouter la musique de l'ami Patrick Chartrolen lisant ce texte....
C’est sûr, si j’avais été moins lâche, il aurait été plus judicieux de partir quand il en était encore temps. Pour se remettre des frayeurs, on laisse glisser sa plume tout le long de la ligne en espérant en tirer quelques récompenses. Mais tout cela est vain. Les plaisirs spirituels sont bien trop spirituels, les physiques, s’ils finissent en apothéose et procurent plus de satisfaction que de planter sa plume dans un encrier, ils épuisent la bête.
Il reste la littérature pour faire le bilan de tout ce temps où j’ai fini par me demander si tout cela a été bien réel. J’ai souvent replongé à l’eau au risque de me noyer encore et d’appeler à l’aide, parce que ce bateau est mieux dans les tempêtes, avec des voiles blanches et rondes de la force d’un ciel d’ardoise. Plein de cet oxygène animé de vent polisson à faire péter la cage thoracique. Piailler avec les mouettes en s’ébattant dans les risées, en plongeant, filant, planant, rebondissant sur les cascades de l’air. Avis de coup de vent, tempête, tornade, ouragan, il n’y a que dans les turbulences, quand le zeph souffle dans les drisses, que les roseaux trépignent, que les haubans sifflent, que la membrure craque, que le toit remue, que l’eau ruisselle en fines lézardes transparentes sur les vitres, qu’on sent réellement le poids du vivant. On sait qu’après arrivera le soleil qui réveillera tout ça. Comme une grande lessive dans un bistrot qui vient d’ouvrir. Alors que le sol est encore mouillé, que l’odeur du café emplit déjà la salle et que vous êtes le premier client. Cette appréhension perce sous la peau de ces instants. Il n’y a rien à dire. Ce sont par ces moments là qu’on légitime nos heures dans ce foutoir.
On a beau avoir l’impression que dans le temps imparti, on ne réussira pas à boucler ce pourquoi on pense être fait, -il est étrange de croire qu’on doive mener à bien un projet ou subir un ensemble d’événements-, on ne désespère plus, bien que le corps s’amenuise, que l’échine se courbe et que le ton de la voix devienne moins arrogant et que ce projet-là, quoi qu’il arrive, ne laissera jamais assez de temps à l’existence. Que chaque jour sera toujours trop court, chaque heure incomplète, chaque instant inachevé suspendu au néant, comme un manque permanent..
Depuis le temps que l’imminence du désastre est perceptible, on s’étonne qu’il ne se soit pas encore produit. Tout échappe, c’est bien la seule certitude que peut avoir la marionnette qui coupe son fil pour s’aventurer au-delà du cercle des projecteurs. Si elle savait, elle s’abstiendrait de tenter de s’évader. Chercher la raison qui pousse à écrire, peindre ou dessiner, c’est perdre son temps. Il faut agir pour se vider de tout ce prurit et se remplir à nouveau, tout simplement. Ce qui a été fait n’est plus à faire et ne pèsera plus de tout son poids de remords. Tant pis si cela a été mal fait, et tant mieux dans le cas contraire. C’est en faisant qu’on apprend à se soulager mieux chaque fois.
09:30 Publié dans De la poésie au quotidien | Lien permanent | Commentaires (1)
21/03/2007
Aide aux artistes dans le besoin

12:20 Publié dans Petit traité de médecine à l'usage des rustres | Lien permanent | Commentaires (1)
la piste des larmes
Par Alain jégou
l’inquiétude perdure
qui vient de lui
sa silhouette massive
qui fait frémir
et s’évanouir les femmes
le malotru grognon
l’intrus mal léché
qui met les griffes
dans le plat
celui que tous redoutent
et n’osent éjecter
de leurs coteries minus
le mastard que tous envient
le malabar dont chacun
se targue d’être l’ami
celui qui d’un gnon
enverrait dinguer
la planète entière
finira reclus
rejeté par ses pairs
exclus par jalousie
décrété par ses fans d’hier
ennemi public numéro un
que la meute ravie
aboyante hystérique
déchirera à belles dents

Nous préparons pour septembre la publication d'un recueil de textes de Alain Jégou sur la nation indienne, qui reprendra des textes parus aux éditions Wigwam et aux éditions Blanc Silex, ainsi que des textes inédits sur son voyage à la rencontre des hommes de l'AIM (American Indian Mouvement) et un hommage à Léonard Peltier.
08:05 | Lien permanent | Commentaires (1)
19/03/2007
Ouagadougou-Paris en mobylette.....

Au festival culture-aventure, j'ai croisé un fou sympathique qui se soigne par le voyage. Vincent Colin possède un réel talent de photographe doublé de celui d'aventurier. Si le reportage sur son voyage souffre de manque de moyens, -caméra d'appareil photo numérique oblige- par contre il respire cette fraîcheur qu'on ne retrouve que chez les professionnels du périple qui ont un talent de photographe. Jugez par vous même de ses photos en noire et blanc sur son site...
The Pigeot Delta my friend!
Ici, pas une seconde sans voir une mobylette du type nos bonnes vieilles 103 Peugeot; c'est le moyen de transport national!
J'ai vite fait le tour des modèles en vente, neuf et occasion, et pas de doute les occases font vraiment peur!
J'ai donc acheté une Peugeot Delta neuve, 710 euros et 1 Km au compteur! C'est un peu le modèle "vintage" avec le phare rond, mais ça fait aussi tout terrain avec la fourche "best quality"!!! Bon elle ne fait pas vraiment « MEEH MEEHHHH!!!!! » Comme prévu, mais plutôt ....mmmmMeeeeuuuu...... Je ne suis pas prêt d'arriver!!! Et les pédales sont loin d'être inutiles au démarrage!!! (voilà pourquoi y’a des pédales sur les mobylettes....)
Bonne surprise, les plaques de la mob sont vierges, donc ça sera plus pratique pour taper le type de bécane, l'année et tout ce qui est utile. J'ai également eu des fausses factures, une avec un prix inférieur et d'occasion pour la douane, une vraie pour les flics au Burkina, et une autre vierge pour la France!!
Pour en savoir plus sur Ouagadougou-Paris en mobylette... cliquez sur le lien


Photo Vincent Colin
09:25 Publié dans carnets de voyages | Lien permanent | Commentaires (0)
18/03/2007
Les fréres Joubran
Originaire de Nazareth, en Galilée, Samir Joubran, virtuose du oud déjà consacré dans le monde arabe, accède aujourd'hui à une reconnaissance internationale.
Samir & Wissam ont commencé à tourner hors du Moyen-Orient en Août 2002, leur réputation n'a cessé de croître au fil des concerts en Europe, au Canada et au Brésil. Leur premier album "Tamaas", paru sur le label daquÌ en 2003, est un chef d'œuvre, témoignage de leur connaissance intime de la musique et de l'histoire de leurs instruments, et de leur formidable talent d'improvisateurs.
Leur plus jeune frère, Adnan, considéré comme un prodige par ses frères aînés, a fait ses débuts sur la scène internationale en Octobre 2004.

Pour découvrir le travail de Wissam Joubran
08:25 Publié dans De la poésie au quotidien | Lien permanent | Commentaires (0)
17/03/2007
Lhasa de Sela

Cette fille me colle le frisson chaque fois que je l'écoute... Je ne sais pas pourquoi... La fêlure de sa voix, si posée si fragile. Sa présence sur scène me font penser à Edith Piaf... Une référence...
A ECOUTER SANS MODERATION
00:05 | Lien permanent | Commentaires (0)
14/03/2007
Les Crobards de Malnuit

Collage Maryvonne Lequellec
Voila ça y est l'idée fait son chemin. On va republier Malnuit. Oui c'est un événement. Ce sera pour l'automne probablement. C'est Bédé qui s'est mis au clavier pour exhumer ces textes devenus introuvables. Je vous en dirai plus au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Mais pour commencer juste un petit morceau pour le plaisir, comme on lèche les plats...
Crobard : n.m. Dessin à main levée qui ne fait qu’esquisser l’image d’un être ou d’une chose. (Petit Larousse – voir : croquis)
Inondé du sang des femmes et de leur sève tu es en train de revivre le rite de la naissance et tu es le premier homme et le dernier et tu te débats dans la fantasmagorie infernale et divine du Commencement et tu retournes à la Source qui est sans commencement ni fin et de toutes tes forces débridées tu réintègres le chaos fondamental et l’ordre suprême de la nuit des temps qui est dans la femme comme le secret de la lutte des sexes et de l’attachement animal et du cannibalique et du platonique et le secret de ta faiblesse et ta misère et ta soif intarissable et ta faim perpétuelle et et et la femme s’ouvre et se referme et tu t’enfonces dans l’œsophage et tu pénètres dans l’estomac qui n’est qu’un sac et son anus s’ouvre et se referme et tu t’enfonces dans le rectum et tu pénètres dans l’intestin et sa vulve s’ouvre et se referme et tu pénètres dans la matrice et la femme s’ouvre et se referme mille et mille fois tu t’enfonces en elle et la femme s’ouvre et se referme et tu t’enfonces dans son cœur et tu pénètres JUSQU’À SON ÂME
Mais ce n’est plus toi c’est personne et tu assistes au gigantesque spectacle ébahi et secoué comme si une décharge faisait trembler au fond de toi tout au fond UNE CORDE quelque part tout au fond de la chair et tout au fond de la mémoire une corde et cette corde traverse ton plexus solaire et ton cerveau vibre doucement dans sa boîte imprimant aux globes de tes yeux une imperceptible bougeotte et ton voisin de table n’est qu’une tache d’encre presque une ombre et peut-être une illusion visuelle un grain de poussière sur ta pupille et la petite corde te fait un peu mal elle résonne autour de la nuque comme si le bulbe était à son tour secoué par un infime écho et tu voudrais penser à autre chose et tu passes la main sur ta nuque et tu te frottes les yeux mais ta pensée ne suit pas tu ne penses pas c’est personne et personne non plus ne pense pas comment pourrait-il penser lui qui n’est personne et personne c’est rien personne c’est rien personne alors. Alors…
— Quoi
— Qu’est-ce qu’on fait ?
— Qu’est-ce que tu veux faire ?
— Ché pas
— Et toi ?
— Ché pas. Rien…
19:30 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (0)
Paroles de Coyote
Par Alain Jégou
Alain dont j'ai publié en avant première des textes en juillet 2006 sur le blog, n'est plus marin pécheur. Il a revendu l'Ikaria son bateau qui péche toujours du côté de Lorient, mais avec un autre capitaine. Il ne regrette pas son repos bien mérité quand il entend souffler le vent, il est bien content de ne plus être chahuté au large. Il se consacre dorénavant totalement à l'écriture. Vous le retrouverez de temps à autre sur le blog. Au gré de ses humeurs de ses coups de gueule aussi.

photo Gérard Gautier
En certaines années bigrement évaporées, nous mioches, esprits neufs et purs, attentifs et clients benoîts de toutes aventures cousues de fil blanc et truffées d’un héroïsme simplet, avons été manipulés de la façon la plus abjecte qui soit. Empapaoutée notre cervelle toute molle de fraîcheur, maculée notre crédulité, salopée notre jugeote, par les fourbes faiseurs de magazines et fanzines westerns.
Scénaristes, dialoguistes, dessinateurs, emberlificoteurs de pensées juvéniles, à la solde d’une culture, d’un culte et des vraies foireuses valeurs de la race indélébile des seigneurs. Toujours appliqués à nous bourrer le mou de leurs pernicieux principes, de leurs impayables conceptions du bien et du mal, à nous faire ingurgiter, sans autre forme de jugement possible, leurs vérités toutes moulées pour nos âmes de chérubins. Toujours affairés à nous faire abonder dans le sens de leur giration spirituelle. Acharnés à nous foutre les foies, à nous dégoûter ou nous faire nous moquer de l’autre, du différent, de l’autrement coloré ou charpenté.
Les héros farauds de nos boulimies aventureuses avaient tous le regard et les idées purs braqués sur la ligne bleu uniforme des sierras ? Bien sûr tous blancs de peau et ne permettant pas que quiconque émette le moindre doute sur la noblesse raciale de leurs origines.
C’était pas de vulgaires trouducs à face de rats et teint chiasseux, nos héros amerloques. La belle allure qu’ils entretenaient et la forme olympique de leurs balèzes carrures. Franchement, c’était pas des lopes les Kit Carson, Buck John, Davy Crockett, Bleck Le Roc, Buffalo Bill et autres Cornflakes Joe de la saga du Grand Ouest sauvage. Pas comme ces enflés de diables rouges qu’avaient aucun respect et aucune tenue dans leurs façons d’être et d’agir, qui se mettaient à une dizaine pour torturer et estourbir un pauvre pionnier sans défense sous les yeux horrifiés de sa famille qu’ils massacraient ensuite.
Qu’ils soient natifs du Tennessee ou du Nevada, de l’Ohio ou de l’Indiana, de l’Arizona ou de l’Oklahoma, du Texas ou du New Mexico, ils avaient tous de la classe, nos idoles de B.D. Tous aussi fortiches les uns que les autres à manier le coutelas ou la Winchester, à suivre une piste ou traquer l’ennemi, à dresser un mustang ou chasser le bison. Jamais froid, jamais faim, jamais soif, jamais fatigués, jamais peur, jamais envie de pisser, ils chevauchaient sur les vastes étendues sauvages toujours en quête de nouvelles aventures, de nouveaux faits d’armes et de bravoures à accomplir. Ils étaient la fierté de l’Amérique.
Sans chiqué ni forfanterie, ils vous mettaient en fuite toute une tribu d’énergumènes énervés et sanguinaires pour délivrer la caravane des colons fourvoyés en si périlleuse situation, vous descendaient trois ou quatre bisons d’un seul coup de fusil ou vous abattaient un grizzly d’un uppercut dans les gencives, sans la moindre émotion.
L’ennemi numéro un, le souffre-douleur, le faire-valoir, de ces supermen vedettes de la conquête de l’Ouest, évidemment c’était l’Indien. Tampon de toutes affabulations, le vilain moche, le cruel, l’infâme, le méchant Peau-Rouge, le suppôt de Satan, le barbare ultra, le tueur et violeur de femmes et d’enfants, le chasseur de scalps, le buveur de millésimes judéo-chrétiens, l’être le plus abject de la planète, c’était lui, c’était bien lui, l’incroyable incroyant, qu’il fallait combattre sans relâche, exterminer sans rémission du plus petit au plus grand, génocider jusqu’au dernier.
L’Indien, affublé de toutes les tares et vilenies les plus hardies, décrété durement et sans appel l’ennemi définitif de toute l’humanité en marche vers son idéal progressiste, ne pouvait être qu’un obstacle à cette avancée vers l’Eden convoité.
Alléluia pour nos frères, héroïques conquérants du Nouveau Monde ! Pour nos pionniers dévots défricheurs de terres vierges, porteurs et défenseurs ardents de la parole du Christ ! Sonnez trompettes ! Roulez tambours ! Pour l’arrivée toujours à point de notre cavalerie. Hourra pour nos p’tits gars fringants et audacieux ! Hourra pour la Grande Amérique ! Son peuple ! Son président ! Et sa politique expansionniste et exterminatrice !...
Voilà ce qu’ils voulaient nous inculquer, les salauds de bidouilleurs de pensées mineures. Nous ont violé le rêve et l’innocence. Toujours habiles et persuasifs, experts à faire passer l’Amérindien pour un être dénué de tout sentiment humain, à nous faire frémir et pétocher maousse devant le faciès ingrat, l’œil sournois, le nez busqué et la mâchoire crispée par la haine, le corps paré de ses peintures de guerre, presque nu, son cul juste couvert d’un morceau d’étoffe grossière, du combattant féroce montant à cru l’apaloosa véloce, rapide et âpre à décocher ses flèches vers tous corps étrangers, à décoller du crâne de l’ennemi abattu, mort ou seulement blessé, la chevelure sanglante pour s’en faire un trophée, à tailler dans le vif des chairs des prisonniers attachés solidement à d’étranges et effrayants poteaux de torture.
Durant de longues années le mythe escroc a bien vécu. L’arnaque historique menée de mains de maîtres est parvenue à duper d’imparable façon plusieurs générations de petits hommes blancs, admiratifs et respectueux à souhait de la parole des grands.
Ca n’est qu’à la fin des années 1960, avec la naissance de l’AIM (American Indian Movment) et le combat mené par ses activistes que les mioches lecteurs de BD ont découvert le pot aux roses, pris conscience que les méchants n’étaient pas ceux que les dessinateurs et dialoguistes de leurs illustrés avaient sournoisement désignés à leur vindicte juvénile, mais bien ces salopards de Kit Carson, George Custer, William Cody, Philip Sheridan, tous ces chasseurs de scalps et massacreurs de natives dont le seul crime fut d’exister et de résister à leurs ambitions impérialistes.
( éd. Alcatraz Press, Un siège pour les aigles, janvier 1995)
06:07 Publié dans La vie des bêtes racontée aux enfants | Lien permanent | Commentaires (0)
12/03/2007
Mémoire d'homme

photo Bénédicte Mercier
Le Père ne m'attendait pas, je venais sans prévenir. Il savait que j'allais venir. Il ignorait quand mais il n'avait plus que cela à faire, attendre. Le reste du temps il discutait ou dormait, assis appuyé au mur de sa maison, le dos protégé du vent glacial du haut Atlas, ce souffle qui coupe en deux. Après tout ce temps sans avoir donné de nouvelles je revenais le voir. Je devrais me refaçonner à son corps, sa démarche malhabile. A ses bras maigres, ses mains énormes, presque difformes à la peau tendue où saillent les os et les veines.
Dans ce décor de rocailles et d'oliviers racornis, il avait retrouvé sa nature profonde, perdue sous la pluie et dans la brume. Celui qu'enfant j'avais connu immense était maintenant un vieillard recroquevillé, petit, voûté, avec un visage mat et osseux, des yeux noirs profonds, fentes rusées et pétillantes et un large sourire sur une bouche fine entourée d'une barbe qu'il rasait avec son crane et ses sourcils au marché hebdomadaire. De son habituelle voix rauque il me racontera ses souvenirs avec un accent inaudible. Je regarderai cet homme avec la vision d'un autre monde. Les liens qui nous uniront ne seront pas des chemins de parole. Je serai l'étranger et ma langue intriguera la tante qui ne cessera de me regarder, tout en chassant machinalement les mouches.
J'ai passé ma journée à l'attendre. Il tardait. Quand je suis arrivé je n'ai trouvé que la vieille tante. Elle m'a serré dans ses bras fort contre elle et s'est mise à pleurer. Je n'ai pas compris pourquoi elle se répandait de la sorte. Il n'y avait jamais eu de joie à l'arrivée ni de peine au départ. Nous sommes ainsi... Si je venais c'était bien, sinon la faute en incombait à la vie. Puisqu'il faut se séparer alors que cela ne soit pas couronné par des scènes de larmes et de cris. A quoi bon?
Elle m'a fait signe qu'il était absent, parti loin, vers le barrage... Elle m'a indiqué la direction d'un geste du bras puis elle a pleuré. Heureuse certainement de me voir. Elle m'a apporté le thé puis a rangé mes bagages. J'avais avec moi un pantalon de velours, une bonne chemise et un pull d'hiver. Ceux que j'avais offert auparavant au Père lui avaient tellement plu. Il ne les avait pas quittés durant mon séjour, si fier de ses solides vêtements de paysan français. Un pantalon de velours côtelé et une chemise épaisse… Il tardait.
Un gamin qu'on était allé cherché est venu. Il avait semble-t-il été suffisamment à l'école pour qu'on se comprenne. Mais que veulent dire les mots? J'insistais pour lui demander où était passé le vieux. S'il savait quand il reviendrait. Je l'attendais depuis le début de l'après-midi. Bien sûr il devait être parti loin pour tarder tant. Le gamin n'a su que me dire.
-Mon père est mort!
Je lui ai fait répéter. Il a confirmé ce que je venais de percevoir. Ce n'était pas de celui du traducteur dont il s'agissait, mais du mien. Puis il m'a désigné du doigt pour qu'il n'y ait plus d'erreur possible. Je pouvais l'attendre longtemps encore... Il avait profité de l'hiver pour partir. Personne ne m'avait prévenu. Personne ne savait où j'habitais. Je n'habitais plus nulle part. J'errais avec mon sac d'une maison à l'autre. Ce n'est pas une affaire extraordinaire que d'oublier de vivre. Parti seul, sans fils pour lui fermer les yeux. Ses compagnons l'avaient escorté à sa dernière étape. Lui qui s'étonnait d'être revenu vivant des carnages de l'Europe. Il appréciait à sa juste valeur le répit accordé. Il en ignorait la durée, mais n'y prêtait pas d'importance.
Les paroles non dites et qu'il faut un jour prononcer écorchent la gorge. Ces mots qui ne sont jamais venus par pudeur, lorsqu'on n'a pas appris à les dire, restent comme un dette. Je savais qu'il faudrait maintenant témoigner pour toute cette hébétude, ce temps perdu à chercher l'issue.
Le lendemain, est arrivé son ami, l'ancien militaire. Le sergent balafré d'Indochine. Il a parlé longtemps, ri beaucoup, dit sa chance d'avoir connu un bon camarade comme le Père, si calme et posé, résolument sage. Il a compté sur ses doigts les années de tourmente, de guerre, de souffrance...
-Oui, c'est comme ça, pour nous, la vie!
Il s'est souvenu de cette époque et de ceux qui ont quitté ce monde, puis il s'est tu. Il semblait avoir lui aussi atteint la sagesse après toutes ces tempêtes.
-Ah, Imma, Imma, Imma!
Il a imploré sa mère, comme pour l'interroger sur sa venue dans ce monde. Il a allumé une pipe de kif et s'est évaporé dans ses pensées comme rassuré sur la destinée du grand voyage.
-Maintenant il est tranquille. Pas comme nous! Il a rejoint Allah! C'est bien! Tu dois pas te faire de souci! C'est moi qui lui ai fermé les yeux! On est là aujourd'hui, demain c'est fini! Un jour bientôt ce sera mon tour, un autre le tien, puis tes enfants et les enfants de tes enfants. Va savoir quand? Personne ne sait! Sauf Mounana! Il faut se préparer, tous les jours! Faire la prière! Etre un bon croyant!
Je n'ai pas osé lui dire que je n'en avais pas pris vraiment le chemin. Mais sait-on jamais? La rédemption existe.
-Toi, maintenant il te faut des enfants! C'est ton père qui veut! Tu étais son préféré! Il ne te l'a jamais dit, pour ne pas faire de différence! Mais il a voulu que tu le saches! Il pensait que tu reviendrais! Tu vois, il te connaissait bien!
J'aurais bien aimé lui donner la joie d'être grand-père, mais la vie a vu différemment. Et ce n'est pas lui qui a faiit naître un goût pour la paternité.
-Tu sais, nous il a fallu toujours qu'on se battre. Lui avec la pelle et la pioche, moi avec le fusil et la baïonnette! On a fait la vie qu'on a pu! Il faut le voir pour le croire! Maintenant c'est mieux pour lui!
Une telle confiance dans l'existence d'un au-delà m'a apporté la sérénité. Comment mettre en doute de telles paroles? Je sentais l'apaisement de la douleur de vivre dans l'intonation de la voix de cet homme. A combien de compagnons sur les champs de bataille a-t-il apporté un soutien moral dans leurs derniers instants? Comment est-il revenu de cet enfer aussi paisible?
Je les imaginais tous les deux assis, le Père et lui, le dos au mur pour capter la chaleur de la journée, égrenant un chapelet, se racontant leurs souvenirs devant un parterre d'autres vieux médusés par le récit de la vie si aventureuse de leur compagnons.
-Pour tous c'est pareil, on ne peut pas rester ici, il faut partir! La France, le Canada, l'Australie, la Hollande! Ici on ne revient que pour mourir! Guérir de la nostalgie! Enfin ce que je dis! Ton père m'a tout raconté! Ta mère et ses enfants. Sa première femme et son enfant mort ici. Ses bouteilles, son travail, sa solitude. Non il a bien fait de revenir. Les enfants appartiennent à une femme, pas à un homme... C'est comme ça!
Ces deux là avaient dû se parler beaucoup. Peut-être avaient-ils cherché une explication à leur maudite trajectoire. Si tous deux ont été bannis du royaume de la félicité de leur vivant, ils n'en ont pas gagné pour autant un coin de paradis.

photo Bénédicte Mercier
Son ami m'a guidé dans un champ. Une parcelle de terre que rien n'aurait distinguée d'une autre si elle n'avait été recouverte de rocailles dressées, orientées vers l'est. On s'est arrêtés près d'un léger renflement sur le sol à l'endroit où reposait le corps du Père. Des bouquets d'épines aux dards longs empêchaient de marcher sur les sépultures. Quelques herbes sèches bougeaient, agitées par le vent frais. Des chardons sauvages et le néant.
Cette nuit-là je n'ai pas dormi et le point rouge des cigarettes a ponctué les heures qui s'écoulaient.
Cette vie qui avait été la nôtre remontait dans ma mémoire comme le fleuve à sa source. Trajectoire de l'homme de peine. Humbles en pleine force de l'âge que ce pays ne peut nourrir. Terre rude, sans pitié, rouge, couverte de caillasses barbares. Jamais je n'aurais eu le droit de le pleurer. Il n'aurait pas voulu. On ne pleure pas un homme qui a enfin trouvé la paix.
Sa voix me revenait:
-Ton pays!... C'est celui qui te nourrit!... Oublie pas ça, fils!... La terre qui te donne son lait, comme une femme!... Un jour tu comprendras!... Un jour!...
Il avait raison, sa philosophie imparable ressemblait à des blocs de roche extraits à la dynamite. Sa dernière demeure parmi les herbes jaunes se limitait à deux cailloux dressés, un à la tête, l'autre aux pieds. Des épines noires étaient répandues sur le sol, pour que les chèvres ne foulent pas la terre à cet endroit. Il était revenu et je lui avais pardonné son alcoolisme, son inconséquence. Quoi qu'il ait pu faire ou dire il était à l'origine de mes jours. Et le maudire c'était aussi me maudire.
Il avait retrouvé les paysages de son enfance pour apaiser la nostalgie de la douleur de vivre. Par le passé, en Normandie, il avait acheté un bout de terrain en friches au milieu des bois pour se construire un havre de paix. On accédait au terrain par un chemin boueux qui traversait d'autres propriétés. Il avait transformé cet arpent boisé en champ. Lors de l'acquisition de la futaie de châtaigniers sauvages dont les fruits trop petits n'étaient pas consommables il avait coupé les arbres pour les transformer en bois de chauffage. Un bulldozer avait arraché les racines et les avait poussées dans un coin du champ en un tas presque aussi haut qu'une maison. Cela lui avait coûté quatorze mille anciens francs. Il était fier d'avoir conquis ce pré sur la nature sauvage. Je l'accompagnais souvent dans les bois où il passait ses journées à élaguer des branches, enlever les mauvaises herbes. Il avait semé de la luzerne au grand régal des lapins de garenne qui pillaient allègrement sa récolte et creusaient leurs terriers au beau milieu de son terrain. En bas coulait un ruisseau qui prenait sa source quelques arpents plus loin. Il aurait aimé y construire sa cabane en planches pour venir y passer des jours paisibles, loin des soucis de la maison et des remontrances de sa femme.

photo Bénédicte Mercier
Quelque part au monde il doit exister sur la carte un point fait pour soi, un endroit où l'on se sent imperturbable quoi qu'il advienne. Un lieu où il n'est pas besoin de justification, à part celle d'être là assis et de contempler le ciel. Un coin où l'on retourne la nuit dans ses rêves. Un simple arbre suffit au pied duquel on peut dire: "Ici je me sens bien". Le père avait gardé un seul châtaignier qui me paraissait immense. Il s'y réfugiait lorsque la bruine tombait trop dru ou pour se protéger du soleil. Sa frondaison si épaisse ne laissait couler l'eau que par gros temps. Il semblait que toutes les feuilles orientées dans le même sens formaient une toiture naturelle. Il pleuvait au delà du périmètre de l'arbre mais pas sous ses branches. Je ne suis jamais repassé près de cet arbre. Faute de temps, de mémoire aussi. La vie a de drôles de soubresauts. Peut-être que depuis, cet arbre est tombé en morceaux, foudroyé par un éclair. Pourtant, sans l'avoir revu, je sais qu'il existe encore. Etrange certitude. Il m'attend. Par lui je prendrai racine sur cette terre où je n'ai pas d'endroit où aller.
Personne ne m'avait prévenu du décès du père. Souvent j’avais changé de maison. Mais est-ce si important de posséder une adresse alors que l'on est simplement de passage?
Ce texte est extrait de Le Soleil des fous paru aux éditions Paris Méditerranée. Si vous désirez vous procurer Le Soleil des fous Cliquez ici
21:35 Publié dans La vie des bêtes racontée aux enfants | Lien permanent | Commentaires (0)
10/03/2007
La vie d'artiste...

Mon travail était remis en cause par des gens dont je soupçonne l’existence suffisamment terne pour ne pas être racontable même par un génie. Leur histoire ne réussirait pas à remplir un chapitre. À peine trois pages lâches, pas même une trame de mauvaise nouvelle. Ces types n'auront connu de la vie que la voie royale, du berceau au bac à sable, des études brillantes au poste confortable de directeur littéraire. Pas foutu de pondre un articulet qui ne soit un summum de poncifs. Pas capable d'écrire une lettre personnelle pour répondre par la négative, trop faux derche, taux de testostérone pas assez élevé. J'ai récolté suffisamment de leurs correspondances au style insipide pour en tapisser un mur. Ils sont vissés à leur siège éjectable et le savent bien, alors ils publient du consensuel mais pas de l'original. Ils veulent des noms vendus d'avance, pas du talent inconnu trop difficile à fourguer. De l'histoire facile et joliment écrite qui ne dérange pas dans les chaumières. De l'académique, mais pas du sanguinaire quartier de bœuf, à la manière de Soutine. Comme si la façon dont je raconte la chaîne pouvait être trop monotone. Le brave homme n’y est jamais allé à l’usine. Il n’a pas connu la monotonie de la chaîne. Il l’a ressenti jusque dans le cœur du texte et il me dit : c’est monotone. Comment ne pas perdre son sang froid, ai je essayé de me justifier ? Il faut se contenter d'une apparition sur scène contrôlée et dosée à l'infinitésimal. La nuance, le pastel, le non dit, le entre les lignes. Mais surtout ne pas déranger l’estomac du lecteur qu’il est. Il leur faut aussi du convenu, de la référence, pour notre brave directeur littéraire.
Il n’y a que madame Germaine. La très gentille, madame Germaine. Ce n'était pas encore mûr, qu’elle me disait. Je devais passer à autre chose. Elle reconnaissait le talent, bien que ce ne soit pas son genre. Madame Germaine, m’a toujours répondu par une lettre gentille avec beaucoup de compassion et plein de gentils encouragements. Une vraie grande dame charitable avec tout plein de charmants sentiments, madame Germaine. Et elle me répétait toujours la même chose. Cette femme devait être bonne comme du bon pain blanc ou de la miche de Noël, ce n’est pas possible autrement. Aujourd’hui on s’écrirait encore, si ça se trouve. Elle m'a encouragé mais ne m’a pas publié : elle a eu la mauvaise idée de mourir entre temps, madame Germaine.
C’est sûr, j’étais fait pour l’écriture. Mais ce n’était pas assez bien écrit pour elle. Je n’ai jamais su si madame Germaine préférait des gaufrettes ou des boudoirs avec son Darjeeling. Bien gentille, quand même. Je ne lui en veux de m’avoir laissé là, au milieu du gué alors que je ne savais pas encore où aller. Beaucoup de politesses, de délicatesses, de bonnes intentions pour rien.
Elle n’est pas la seule qui m’ait refusé et qui ne soit plus de cette galaxie. Combien d’éditeurs qui ont eu ce manuscrit entre les mains en faillite ? De directeurs littéraires à la rue ? C’est une compensation minime qui n’est pas rassurante pour autant.
03:45 Publié dans De la prétention littéraire | Lien permanent | Commentaires (1)
08/03/2007
La comète Jeff Buckley
Buckley était un homme d’une autre espèce que celle connue sur terre. On a retrouvé que ses bottes près du fleuve Mississipi. S’y est-t-il baigné en pleine nuit ? Il a tout simplement disparu comme il était apparu.
Non seulement Jeff Buckley a disparu dans les eaux du Mississipi mais son chef-d’œuvre est inconnu aux États-Unis.

« Pourquoi les radios US n’ont-elles pas diffusé « Grace » ? C’est ridicule. Ce disque est tellement phénoménal que si les radios ne le passent pas, qu’est-ce qui va passer ? Ce disque a un public culte. Il va devenir de plus en plus populaire, c’est évident. » (Rock & Folk, octobre 1999)
Le témoigange suivant est celui de Ben Harper qui a eu l’occasion de le rencontrer plusieurs fois.
« La première d’entre elles m’a laissé un souvenir impérissable. Lui et moi étions en tournée en Europe, en 1996, et à l’affiche de plusieurs grands festivals, dont les Eurockéennes de Belfort. Ce jour-là, pendant les balances, Jeff s’est approché de moi, m’a tendu sa guitare slide, et m’a demandé de lui apprendre quelque chose. En l’attrapant, je me suis aperçu qu‘elle était accordée d’une façon si étrange que j’étais incapable de m’en servir. Je la lui ai donc rendue aussitôt pour qu’il m’explique comment il faisait. Nous nous sommes alors promis d’aller ensemble voir jouer Page et Plant, qui étaient également à l’affiche du festival. Je savais qu’on pourrait accéder aux côtés de la scène. Lorsque Jeff a terminé son concert, il avait encore de la promo à faire, et je lui ai proposé de nous rejoindre près de la scène de Page et Plant. Le groupe avait déjà commencé, et le gars de la sécurité, sur l’aile droite de la scène, nous en a refusé l’accès. Nous l’avons donc contourné pour essayer l’autre côté, où nous avons assisté au show. Jeff n’arrivait pas. Nous sommes donc retournés de l’autre côté pour voir s’il nous y cherchait. Personne. Le même type nous a alors montré le carré presse. Pensant y trouver Jeff, nous sommes descendus. Personne non plus. Il y avait beaucoup de poussière. Tout à coup, dans le coin de mon œil, j’ai perçu un mouvement, comme si un oiseau venait de s’envoler au-dessus des montagnes d’amplis. Et en levant la tête, j’ai vu Jeff, accroché à plusieurs mètres de haut juste au-dessus de la scène, suspendu dans les airs. C’est le truc le plus incroyable que j’aie jamais vu. Je me suis dit qu’un type capable de faire ça ne vivait pas sur la même planète que nous. » (Rolling Stone, février 2003)
Pour écouter Jeff Buckley, cliquez ici
17:35 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (2)
07/03/2007
Bonne Nouvelle !
21:20 Publié dans La vie des bêtes racontée aux enfants | Lien permanent | Commentaires (0)
04/03/2007
Et si l’avenir des petits éditeurs passait par un raccourci ?
S’adapter à un marché en perte de vitesse.
L’éditorial de Louis Dubost des éditions l’Idée Bleu est révélateur du malaise qui règne actuellement au sein des petits éditeurs. Ecoutons son discours :
Nouvelles (mauvaises) du p'tit commerce des muses...
Depuis quelques temps déjà, et ça s'accélère depuis quelques mois, les conditions d'existence deviennent difficiles pour les éditeurs dans un « marché » du livre très mollasson, karchérisé par la grande distribution de l'ultralibéralisme triomphant sur tous les marchés, donc, après celui de la musique il y a quelques années, aucune raison que celui du livre fasse exception!
Les librairies indépendantes qui soutiennent nos livres, sont fragilisées à l'extrême, les ventes des best-sellers leur échappe de plus en plus - elles se font dans les « grandes surfaces »….
…. et par Internet - de sorte que, privés de trésorerie pour assurer les échéances de fin d'année, les libraires vident les rayonnages et opèrent des « retours » massifs : du coup, les éditeurs en subissent les dommages collatéraux et se trouvent asphyxiés par le manque de trésorerie.
Quant au militantisme, il est devenu comme quasi un mot grossier dans un tel contexte. Il reste encore, trop éparpillés - problème : comment les informer de nos publications -…
…Il semblerait que ce qui s'accélère en ce moment n'est pas de l'ordre conjoncturel, mais bien plus profondément structurel. Une mutation radicale s'opère dans nos modes de vie, il va donc falloir faire avec.
Pour l'heure, sans être critique, notre situation est difficile. Comme celle de tous les métiers du livre. Le livre a-t-il encore un avenir? Oui, affirme notre pessimisme indécrottablement lucide, mais autrement. Reste à inventer les façons de procéder et d'être: ce qui ne devrait pas, en principe, effrayer des...poètes! ( habitués aux vaches maigres aurait-il pu conclure)
Louis Dubost constate :
Premièrement ; que le marché est en train de changer et il craint à court terme de ne plus y avoir sa place,
Deuxièmement ; que sa trésorerie de ce fait est malmenée par des retours massifs d’où sa situation difficile.
Troisièmement ; que malgré cela un avenir lui semble possible…
Donc à partir de l’hypothèse qu’un avenir est possible, nous allons essayer de comprendre comment les petits éditeurs pourront tenter de se maintenir sur le marché. Mais avant d’aller plus loin il est intéressant de se pencher sur ce que dit Chris Anderson, rédacteur en chef de Wired.
Nous ne savons penser qu’en termes de best-sellers – nous pensons que si une œuvre n’est pas un Hit, elle ne se vendra pas et par conséquent, qu’elle ne remboursera pas ses coûts de production. En gros, c’est une logique selon laquelle seulement les Hits ont le droit d’exister. Or des personnes comme Vann-Adibé et les responsables de iTunes, Amazon et Netflix ont découvert que les “bides” se vendent aussi. Et parce qu’ils sont tellement plus nombreux que les succès, l’argent qu’ils rapportent peut rapidement créer un formidable nouveau marché.
Quand on n’a plus à payer les étagères de présentation et même, dans le cas de services de distribution numérique tels qu’iTunes, ni de coûts de reproduction, ni pour ainsi dire de coûts de distribution, un bide devient une vente comme les autres et garantit la même marge qu’un succès. Les Hits et les “bides” sont, d’un point de vue strictement économique, égaux. Tous les deux sont de simples enregistrements dans une base de données, que l’on appelle en cas de demande, aussi intéressants l’un que l’autre à proposer à la vente. Brusquement, la popularité n’a plus le monopole de sa profitabilité.
Etonnant comme raisonnement non ?
La dématérialisation du stock ou le POD ( print on demand).
Au colloque l’Avenir du livre à Sciences Po le 22 février, on à beaucoup parlé de la dématérialisation du livre… et de la spécificité de l’objet livre qui ne s’accordait pas avec cette dématérialisation. On peut ne pas croire à la dématérialisation du livre au profit de l’écran et sérieusement envisager la dématérialisation du stock, ce qui est une nuance de taille.
C’est la solution qui semble s’imposer pour maintenir la rentabilité de l’activité des petits éditeurs car certains produits ne sont rentables qu’à long terme. Entendons nous bien, quand il s’agit de non rentabilité : c’est sur le court terme et la rotation rapide, mais pas sur le long terme. Ce qui change terriblement la donne. En effet, même un produit difficile à vendre sur le cours terme peut devenir rentable, voir très rentable sur le long terme, le cas d’école de En attendant Godot est ici plus qu’exemplaire. En effet il semblerait que le livre produit culturel réponde difficilement à la théorie dominante que le commerce peut tout vendre et sait tout vendre en un laps de temps de plus en plus réduit.
Chaque typologie de produit à son rythme d’existence. Le manga se vend au japon sur une semaine maximum, trois jours disent les plus optimiste, après si le stock est en rupture, si votre tirage de 250 000 exemplaires est épuisé dés le premier jour et si vous avez des demandes énormes et que vous ne pouvez pas réimprimer avant une semaine, vos ventes sont définitivement perdues, ce n’est pas la peine de réimprimer.
A l’opposé de cet exemple on sait qu’un ouvrage de poésie aura un rythme d’écoulement très lent, quelques dizaines d’exemplaires par an. Et une mévente dans des secteurs à rotation lente n’est pas synonyme de non qualité, Beckett en a été la preuve. Quel éditeur aurait misé sur Delerm à ses débuts?
Par quel coup de baguette magique cela serait-il une solution ?
Le zéro stock ou stock minimum est préconisé dans toutes les industries sauf dans le livre…
- Parce que le processus de fabrication oblige à faire des séries relativement importantes (de 1000 à 3000 exemplaires en fonction du type de produit)
- Parce que le processus de distribution diffusion l’oblige à présenter à de nombreux points de vente en même temps le produit et donc à multiplier les risque de mévente.
En dématérialisant le stock, on diminue les coûts de fabrication et de fait, le point mort d’un ouvrage, puisqu’on fait en partie l’économie de l’impression, des frais de stockages. Donc en ayant immobilisé moins d’argent on peut espérer dépendre de moins d’exemplaires vendus pour retour sur investissement. Ce qui est différent d’une rentabilité moindre.
Par contre processus oblige, cette dématérialisation du stock ne peut se faire que sur des produits très spécifiques. Du texte essentiellement.
Pas étonnant donc que les pépiniéristes d’auteurs aient depuis toujours adoptés la stratégie de « la durée de longue vie » de l’ouvrage, puisqu’il s’agit de leur survie en milieu hostile et ils l’ont fait avec des tirages en offset qui ont plombé leur trésorerie, ce qui ne sera plus le cas avec l’impression numérique.
Cette stratégie ressemble étrangement à celle de la "longue traîne".
Des arguments en faveur de l’impression numérique…
En effet ; la vente s’y fait à coup sûr, puisque impression à la demande ou avec des stocks réductibles à l’unité. Le petit éditeur n’a quasiment pas d’avance de trésorerie à faire ou si peu qu’il peut se constituer un catalogue cohérent très rapidement. Et l’éditeur n’a pas à subir l’effet pervers des retours de fin d’année.
Pour la même somme immobilisée sur un ouvrage imprimé en offset, il peut en sortir quatre en numérique et multiplier ses chances de vendre des exemplaires d’auteurs totalement inconnu comme pouvaient l’être à l’époque Delerm, Bobin, Autin Grenier, Metz et les autres.
Imaginez un roman de mille pages d’un inconnu. Le simple fait qu’il soit en offset oblige l’éditeur qui désire le produire à l’imprimer à mille exemplaires pour que la production d’un tel ouvrage soit rentable. Et s’il ne se vend pas, ou peu. La perte est aussi importante.
En imprimant par petite quantité en numérique, on prend le pari sur la durée et non plus sur l’effet de masse, car cela ne procure que peu de surface visible au produit. La promotion se fait via les circuits classiques, ou via l’outil Internet et de bouche à oreille, lentement. Actuellement même si on sait pertinemment qu’on ne peut tabler que sur cinq cent ventes, mais qu’effet de pile oblige, on se doit d’offrir au regard du public cette marchandise pour lui donner une chance d’être vendue. Il faut donc repenser tout le système de production, distribution, exploitation du livre.
Pour des ouvrages de fabrication complexes, comme les cartonnés. Il est bien sûr que ce type de production ne peut pas s’adapter au procédé numérique. Je vois mal comment caler une chaîne de reliure pour cinquante exemplaire. Mais en théorie rien d’impossible.
On le voit cet démocratisation des moyens va provoquer un véritable appel d’air qui permettra à nombre de petits éditeurs de s’engouffrer dans cette brèche Des éditeurs comme Rhubarbe, il y a deux ans ne possédait aucun titre au catalogue alignent déjà une production intéressante où se dessine une vraie ligne éditoriale. Cette démocratisation aura son revers, puisque n’importe qui pourra faire n’importe quoi et certains parlent déjà d’anarchie… Ce qui fera la différence sera le rapport avec le texte…
Ce qui importe, c’est le coefficient…
Le coefficient de la profession c’est le fatidique chiffre cinq, bien que mon expérience m’a appris que pour nombre de groupes on pensait en fonction d’un coefficient dix ou douze. J’en ai eu l’exemple à mon dernier poste de chef de fabrication. Alors prononcer ce mot devant mes amis me cloue immanquablement au pilori du traître qui assure sa pitance par ailleurs comme fonctionnaire et pérore des âneries.
Cela induit le fait que nombre d’ouvrage ne seront pas publiés parce qu’ils ne trouveront pas avec le procédé d’impression offset le public qui lui permettra de se maintenir dans ce coefficient.
Actuellement les éditeurs lorsqu’ils cessent l’exploitation d’un titre, déstockent et soldent les ouvrages et de fait ils perdent les droits sur les contrats signés. L’exploitation via l’Internet et l’impression sans stock permettra au texte de perdurer sur le marché et à l’éditeur de continuer à proposer l’ouvrage à la vente sans se départir du contrat. Pour des éditeurs de poésie, il est impossible de réimprimer et d’immobiliser leur argent sur des réimpressions aux ventes plus qu’aléatoires.
L’éditimpribraire, ou un raccourci possible de la chaîne du livre.
La chaîne du livre redeviendra-t-elle celle du dix-neuvième siècle, qui était celle de l’éditeur imprimeur libraire. Dans quelques années, quand les presses numériques seront vraiment très performantes, et je suis sidéré de la vitesse à laquelle la qualité d’impression et la productivité progresse avec ce matériel ; quel procédé d’impression sera le mieux adapté à au marché ?
Ce ne sera pas la première fois que le marché imposera une mutation technologique ;
Ne verrons-nous pas naître des libraires éditeur imprimeur qui posséderont des bases de données. Et le texte et l’image seront imprimés à la demande sur un site de production et l’ouvrage pourra être distribué à l’unité par la poste ou produit dans un délai de quelques heures et fourni au client qui passera le prendre chez l’éditimpribraire. Car ce qui compte, c’est bien la pertinence du contenu et non pas le processus de fabrication de l’objet. Et les amis typographes qui s’escriment encore à faire de l’édition typographique en plomb et bois gravés, je les considère d’abord comme des maîtres typographes, qui exercent un savoir faire de métier ancien. En effet ce qui fait la différence entre un éditeur et un typographe talentueux c’est le contenu de l’objet et non pas l’objet. Le texte, tout simplement. Combien ai-je vu de ces maîtres du plomb s’escrimer superbement avec du vélin d’Arches sur du texte qui ne méritait d’être lu que d’un œil distrait.
Alors que les conservateurs des vieux métiers se rassurent, il y aura encore des vieux métiers à conserver. On sait déjà que certaines presses numériques ont un rendu de qualité égal ou supérieur au procédé offset. L’étendue du gamut (capacité de reproduction des couleurs) est plus large sur une IGEN 3 de chez Rank Xerox que sur n’importe quelle presse offset. Pour laquelle il faudra passer en exachromie (impression en six couleurs) et non plus en quadrichromie (impression en quatre couleurs) pour récupérer l’écart de qualité qui se creuse entre les deux procédés au profit de l’impression numérique. Bien sûr ce matériel n’a pas encore atteint la cadence de production des presses offset, mais ce n’est qu’une question de temps.
Que n’ai-je entendu sur « Le Livre » ? Ce mot-là fait tomber en pamoison la moitié de l’engeance humaine fréquentée. Combien d’ennemis farouches m’aura value cette réflexion « Le contenant n’a aucun intérêt, ce n’est jamais que de la cellulose de la colle et du fil à coudre » ? Et c’est dit avec l’expérience de celui qui a noirci comme conducteur de machines, ou les as fait noircir comme fabricant dans la presse et l’édition, des milliers de tonnes de papier. C’est le contenu qui est intéressant pas l’objet.
Souvenons-nous…
L’impression avec la ronéo de nos années de révolution culturelle valait bien toutes les belles impressions typographiques du monde. Le Dé bleu, Le Castor Astral, toutes ces micros entreprises ont fait un impressionnant travail de découvreur de talent, tout en débutant avec les moyens techniques dérisoires, celui des militants de l’époque… La ronéo coincée dans le garage ou la cave entre le congélateur et la machine à laver.
Certains d’autres de ces petits éditeurs sont passés par le plomb, car à cette époque, les imprimeries bazardaient leurs casses pour gagner de la place dans les ateliers et plutôt que de fondre les caractères certains imprimeurs préféraient les donner à ces jeunes illuminés aux yeux d’apôtres. C’était le moyen le moins cher qui leur permettait de publier malgré une absence cruelle de trésorerie. La revue Travers, et les éditions Folle Avoine, sont de ceux-là. Ce n’est pas les moyens techniques qui fait l’éditeur, mais le grain de folie qui l’anime. Et son approche du texte… Voilà pour le passé, mais qu’en sera-il de l’avenir ?
Retrouvez cet article sur Lekti-Ecriture.com
13:25 Publié dans Analyses de littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
03/03/2007
Du monde littéraire

Collage: Maryvonne Lequellec
Ce texte est extrait de Putain d'Etoile paru en 2003.
En contemplatif j’ai cru pouvoir m'inventer une emprise sur la réalité, voire la supplanter avec un stylo. Arrive le moment de trouver un éditeur pour ce paquet d’inepties et c’est à ce moment quelle revient au galop ; la grande réalité...
Je le confirme, je suis bon à rien, mais prêt à sortir le grand jeu pour réussir. Mettre des talons aiguilles, des collants résilles, une perruque. Faire la folle, accepter toutes les fantaisies, les vices, les coups tordus, le knout, la cravache et j'en passe. J'étais prêt à tout. Tout. Tout. Pourvu qu'on me publie. Malheureusement, j'ignorais avec qui je devais passer mes week-ends. Personne ne m'a jamais présenté l'ogresse des auteurs. Je ne suis pas regardant, ni dégoûté, pourvu qu'on m’imprime. Il faut déjà avoir des relations pour s'en faire d’autres. Je me serais contenté d'une simple place de treizième couteau, dans une boucherie de quartier.
Si j'avais eu l’embryon d’une réponse positive d'un éditeur, j'aurais au moins eu une raison de m'entêter, de me bastonner avec ce roman. Mais là, rien… Quelques lettres, que j'ai soupçonnées être des modèles du genre, me sont parvenues. Je résume: entre deux genres, propos justes, force dans la description, saura toucher le lecteur, mais, vu la conjoncture, nous ne pouvons pas vous publier.
Ecrire pour empiler des feuilles ne sert à rien. Alors on balance son manuscrit en désespoir de cause, au petit bonheur la chance, à un éditeur dont on croit que c'est le métier, le sacerdoce, la profession de foi, « Le Livre ». À les écouter, du livre en voici, du livre en voilà, mais ils s'en tamponnent le coquillard. Du blé par-ci, de la fraîche par-là, passez la monnaie, de l'oseille en paquet. Pas vu je t'embrouille. Je m'énerve, c'est plus fort que moi ! Quand je parle de ces gens, je deviens atrabileux, désagréable, et il ne faut pas me chauffer longtemps.
En attendant, il faut bien survivre. Deux éléments essentiels à sauvegarder, manger et écrire. Le reste n'est que luxe, voire même luxure. Avoir un travail à côté m'a toujours sauvé la mise. Une saleté de boulot de pue-la-sueur, qui m'a rempli la bedaine, en attendant la gloire ou une autre fadaise…
Quand disparaît la magie de l'écriture, arrive l'ennui, terrible et mélancolique, qui rend atone toute journée, indépendamment des événements. Pas le moindre goût à baguenauder, pas même pour la bagatelle. Ça ressemble à un électroencéphalogramme plat. On sent se liquéfier l'intérieur. Les quelques neurones disponibles sont victimes de tétanie. Dans un état indéfinissable, on se momifie vivant. Traîner du lit au frigo, ouvrir un yaourt, fumer une cigarette, siroter une canette pour essayer de dissiper ce brouillard intense qui persiste devant les yeux. Rien n'attire l'attention. Rien n'est acceptable. On se croirait sur le Chemin des dames, en plein hiver, quand le vent descendu de Russie fouaille les rares arbres. Le ciel résonne du coassement des corbeaux, seuls êtres vivants en ces lieux. Ils attendent qu'une rafale de shrapnels vienne vous arracher la tripaille pour festoyer.
Si vous n'avez jamais mis les pieds dans ces endroits qui portent encore des traces abominables de l'histoire, un jour de frimas en janvier… Allez-y, vous comprendrez mon allusion. Il faut avoir vécu là-bas, pour appréhender le moral d'un type qui n’a plus de prise sur rien et ne travaille pas à l'inspiration. Évidemment, une âme bien pensante dira que la lecture peut compenser ce mal à vivre. Certes... Mais l'ersatz est médiocre. J’ai plus souvent trouvé de littérature dans la rubrique des faits divers de La Dépêche Libérée que dans une ambiance décrite par un plumitif pré-pubère. Le quotidien, il faut se le coltiner, au ras des fraises, quand on a décidé de s’attaquer au naturalisme. C’est la seule école pour ce genre-là. Dans ce jeu-là il faut souvent passer par la case prison, et surtout ne pas avoir la prétention de pondre des pages pour la postérité. Peu m’en chaut d’avoir des lecteurs quand je ne respirerais plus cet oxygène. Ici et maintenant, vite et bien. Désolé si l’image du poète romantique prend un coup de manche de pioche derrière la nuque…
Avec le froid, la vie quitte le corps en commençant par le bout des doigts. Les membres se recroquevillent et deviennent des appendices superflus, du bois mort… La tête se rétrécit à la taille d'un œuf et s'alourdit au point de vouloir exploser. Tout est indécent. Les mots prononcés contre cette malédiction n'y font rien. On reste persuadé qu'on aurait dû en finir au moment où tout s'écroulait. Il ne faudrait pas survivre aux instants de bonheur et en profiter pour partir aux fraises la paix dans l'âme. Devenir transparent lorsqu’on atteint la perfection... Un soulagement envahit. Enfin il n'y a plus rien à perdre, ou à prouver. Le cerveau saturé se déconnecte. Le corps ressent une douleur irradiante qui confisque les poumons, le cœur, la gorge, le bas du dos, excite les tripes et coupe en deux. À quoi bon faire le niais et donner dans la grimace ? J'aurais voulu que tout s'arrête là. Que la boule m’échappe et dégringole en bas de la colline.
J'ai eu l'adresse de la maison d'édition au hasard d'une revue de poésie imprimée en ronéo baveuse sur du papier qui peluchait, avec une couverture en kraft et des agrafes rouillées. J'ai encore envoyé le manuscrit, comme on jette un coup de pied dans la première poubelle qui passe à portée. Et alors que je n'y croyais plus, une lettre m'est arrivée. Le directeur littéraire m'accusait d'avoir commis un crime de jeunesse. Il m'en voulait de n'avoir pas réussi à dégager la substantifique moelle. Selon lui, toute la matière était là, mais empesée, engluée, mal fagotée. Je devais dégraisser et jeter des chapitres entiers muscler tout ça en soulevant le poids des mots. J'ai bien été obligé de convenir de la précipitation, par manque d’expérience. Je m'étais contenté du minimum, alors que je prétendais frapper la cible au cœur. Ma fierté en a été écornée. Il avait raison le bougre. Pour atteindre mon objectif j’avais besoin d’un minimum de recul et de lucidité.
Je pouvais consentir à quelques sacrifices sans que le sujet n'en soit dénaturé. Une matière dense, on ne peut pas l'altérer, même en supprimant des phrases, des paragraphes, des chapitres. Ils sont tous contenus en un seul. Le noyau dur, au fond de l'abîme.
Rien à dire, le zouave avait foutrement raison. Je ne sais pas pourquoi mais je me sentais en confiance avec lui. Sans fioriture, à la hussarde, sans circonvolution, il était allé droit au but... Probablement les salamalecs manquaient, mais cela avait le mérite d'être clair, précis, net et sans bavure. Trop mou là! Trop direct là! Virer les deux tiers! Ça irait bien mieux ainsi. Emploi catastrophique des virgules, accord des temps déplorable. Recomposer les trois quarts ! Il sentait que l’électricité passait, malgré tous les défauts de branchement. Au final, il me publierait.
Le dernier mot méritait que je m'y arrête. Puisqu’il allait me publier, j’étais prêt à subir tous ses vices… Je courberais l’échine j’obéirais au doigt et à la botte, je lui lécherais les mains, les pieds, j’en ferais des tonnes… Car personne d'autre avant lui n'avait daigné jeter un seul regard sur mon prurit verbeux...
Si je me méfiais des états d'âme de tous les banquiers de l'encre, lui m'inspirait le respect. Il ne tirait de son travail que son rachitique salaire. Pas comme ces bouffeurs de papier. Il payait de sa personne, lui. En vrai assistant il aidait les parturientes de mon genre condamnées à accoucher leurs textes en beuglant et ça l’amusait. Ce type avare de sourire, au regard franc et pas trop patibulaire, en connaissait un rayon sur le métier. Je n'étais pas le premier dans le genre ni le dernier qu'il avait publié. À l'en croire, j'avais de la chance. Je n'étais pas en train de pourrir au fond d'une geôle pour de sombres raisons politiques. De quoi je me plaignais ? Il m'énervait avec sa critique cinglante et sa dent dure. Mais je savais qu'il avait raison, entièrement raison, totalement raison.
Il fallait simplifier pour dominer parfaitement le sujet. Devenir un acrobate de la phrase, un trapéziste de la formule et ne pas s'engluer dans des figures absconses. Je pensais avoir dompté la façon, mais il m'infirmait et il me fallait l'accepter. J’avais l'impression que la proie allait m'échapper sans que j’en ai goûté la saveur. Pas assez fine, la mouture ne dégageait pas totalement son parfum dans le breuvage. À l'aveugle, dans le vide et sans les mains, je devais me jeter à l'eau. Avec lui, j'en ai bavé. J'ai dit souvent, amen. Et comme un vicieux j'en ai redemandé. Et ça l'amusait. Et j'en aurais accepté encore plus, parce que c'était ça ou crever.
Ma théorie sur l’intemporalité n'avait pas produit l'admiration, loin de là. Trop alambiquée à son goût mon concept de chronologie à l'orientale, de scénario à tiroirs. Pas assez maîtrisé. Je devais le comprendre de moi-même ou à l'usure.
Je me suis vissé au bureau, qu'il fasse soleil ou que la montagne soit recouverte de neige. Rien dans l'existence n'avait autant d'intérêt que ces feuilles. Ma vie dépendait d'elles. J'ai ramassé toutes mes forces dans le seul but d’attraper au moins une érection dans ce grand lupanar littéraire et pouvoir miser une seconde fois. Je devais acquérir la rigueur qui me faisait défaut. Quelle foutaise… J'étais jeune, pas bien démoulé, pas assez tordu et je me déroulais le grand cinéma.
En jardinier, je taillais d'un petit coup sec la phrase encombrée. Elle se redressait. Les adjectifs intempestifs, les répétitions inutiles allaient choir dans la sciure. Poussé par le seul désir d’être publier, couper dans la matière devenait un acte rituel. Cela a pris du temps. Pendant des semaines, des mois, essorer chaque phrase, la soupeser, la tâter, la comparer. Je lui ai retourné le manuscrit langé, pouponné, sans cataplasme inutile, ni branli-branla de poète mal inspiré, comme il me l’avait demandé...
Couvert de ratures, des bouts de feuilles recollées, le paquet de feuilles ressemblait à une copie de film muet qui aurait séjourné dans une malle humide. Seul un masochiste se serait esquinté les yeux sur un tel torchon. Il m'a obligé à tout retaper et je l’ai fait...
Il pensait, qu'en resserrant encore quelques boulons on obtiendrait un résultat plus probant. Il suffisait de s'y remettre. Cela en valait la peine. Pour la énième fois j’ai encore trifouillé dans le capot. J'avais, à mon insu, gagné en densité. Un peu comme si j’avais réduit des confitures en pâte de fruits
J'avais toute la vie pour moi. J'écrivais pour ne plus avoir l'impression d'une existence inutile. À qui d'autre raconter mes salades? Avec deux doigts et la régularité d'un métronome, le tic-tac des touches emplissait mes journées libres. Page à page j'avançais. La ramette diminuait. Il l'a relu. Il restait encore quelques broutilles, mais le ravalement avait eu lieu. Il en convenait enfin.
Seulement il n'avait plus la fonction qui lui aurait permis de me publier, éjecté de son poste pour de sombres raisons financières. Triste époque. Il me publierait c'est sûr: mais quand? Chez qui? Il cherchait une autre crêmerie. Il me donnerait des tuyaux. Il ne fallait pas désespérer et soumettre à d'autres le manuscrit. Il n'était pas le seul éditeur dans ce foutu pays. Je n'en doutais pas un instant. Aussi, plutôt que de perdre mon temps à écrire des fadaises que personne ne lirait jamais, j'ai rangé hors de ma vue le tas de feuilles dans un placard, pour en être définitivement débarrassé.
Faute de mieux, j'ai décidé de pratiquer l’onanisme et de me faire si possible sévèrement plaisir. Écrire pour écrire. Balancer toute la sauce. Faire gicler les contraintes. Culbuter ces bigoteries du langage prononcées avec coquetterie, la lèvre en cul de poule. Le bon mot où s'épanouit la beauté de l'esprit. À la tronçonneuse et à la dynamite, oui… Du viol de langue, en iconoclaste voyou. Pourquoi se retenir?
Défroquer le verbe, empaler la phrase, cracher la formule, éructer l’adjectif, roter à l’aise et se promener avec les roubignolles à l’air. Puisque c’est râpé pour la gloire et mal barré pour l’Académie, que le casse-croûte est plus qu’aléatoire, pourquoi se compromettre avec ces tyrannies?
N’attendre rien de personne procure une certaine liberté. Se foutre de la contrainte grammairienne, des lois de la syntaxe, de celles du marché et de ses margoulins. Le jus de quotidien est bien plus truculent que tous ces styles qui reniflent le « à la manière de »… Niaiseries et fadaises cousues de fil blanc pour pisse copie et bas bleus. Du jazz, du blues, de l’acide, mais pas de la littérature, encore moins de poésie. Regardez comme j’écris bien ! Alors elles arrivent ces médailles ? Comme ils sont intelligents les beaux premiers des meilleures ventes… Je préfère l’honnêteté du cirque. Une seule pirouette ratée et le trapéziste va avec ses côtes tâter la sciure. Pas comme ces gigolos qui s’en sortent en étalant leur culture…
Pas étonnant que le brave directeur littéraire ne comprenne rien au bruit des ateliers, à la monotonie du travail sur machine, aux odeurs de solvants, d’encre, de colle, de papier, à la fatigue, à la sueur. Le brave homme a-t-il déjà ressenti l’excitation quand démarrent les rotatives et le plaisir d’avoir fini un travail. Retranché dans son bureau, il n’a jamais roulé que sur la voie royale et pense que son intellect va lui permettre d’éclairer son jugement. Sérieux, notre homme croit aux valeurs du système, comme à une assurance qui le protégerait du néant de l’existence. Il se raccroche comme il peut au bastingage par peur des requins. Pitoyable Pierrot nyctalope, juste bon à finir cloué sur une porte. Cet homme n’est qu’un pioupiou, un simple dé pipé, dans ce grand business. Les lettres de refus qu’il écrit sont dictées uniquement par le banquier de service au blaser impeccable, avec rangers au pieds et parabellum à la ceinture. Le galonné du commerce, c’est lui le grand clown à la chemise brune, le prescripteur de la soupe, l’Auguste qui dicte tout le tintouin.
Notre directeur littéraire avec ses lunettes en écailles, ses vestes en cachemire, tweed, ou laine de vigogne n’est là que pour la façade. Les auteurs sont des êtres si sensibles qu’ils ne peuvent entendre le discours de la raison économique supérieure. Il tient la méthode des camps d’extermination où on diffusait la musique aux victimes pour les rassurer sur leur avenir. Dans ces bouges, les charmantes potiches à l’entrée assurent le décorum, car chez les éditeurs il n’y a pas encore de gorilles comme dans les grandes surfaces. Un magasin sans pitbulls à l’entrée ne peut pas être sérieux. Rien à tirer. Quel illuminé attenterait au dernier manuscrit du philosophe à la mode. Même la concurrence ne s’y intéresse pas, et malgré ça l’Auguste de ce grand cirque se fait du pognon. L’apparence est sauve. Nous sommes entre gens qui savent lire, n’est-ce pas ?
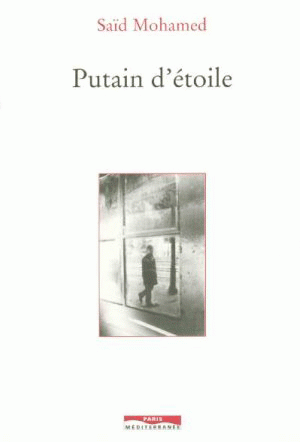
05:20 Publié dans Petit traité de médecine à l'usage des rustres | Lien permanent | Commentaires (0)



