03/03/2007
Du monde littéraire

Collage: Maryvonne Lequellec
Ce texte est extrait de Putain d'Etoile paru en 2003.
J’ai écrit par dépit, pour me servir une meilleure part de gâteau, avec un casting choisi, des éclairages et un script maîtrisés. Dans la réalité, tout fout le camp, en tous sens, sans prise sur le cours des jours. J’ai gaspillé mon temps à chercher un sens, perdu souvent la raison, noyé mes illusions, pour m'apercevoir que tout ça est dérisoirement inutile.
En contemplatif j’ai cru pouvoir m'inventer une emprise sur la réalité, voire la supplanter avec un stylo. Arrive le moment de trouver un éditeur pour ce paquet d’inepties et c’est à ce moment quelle revient au galop ; la grande réalité...
Je le confirme, je suis bon à rien, mais prêt à sortir le grand jeu pour réussir. Mettre des talons aiguilles, des collants résilles, une perruque. Faire la folle, accepter toutes les fantaisies, les vices, les coups tordus, le knout, la cravache et j'en passe. J'étais prêt à tout. Tout. Tout. Pourvu qu'on me publie. Malheureusement, j'ignorais avec qui je devais passer mes week-ends. Personne ne m'a jamais présenté l'ogresse des auteurs. Je ne suis pas regardant, ni dégoûté, pourvu qu'on m’imprime. Il faut déjà avoir des relations pour s'en faire d’autres. Je me serais contenté d'une simple place de treizième couteau, dans une boucherie de quartier.
Si j'avais eu l’embryon d’une réponse positive d'un éditeur, j'aurais au moins eu une raison de m'entêter, de me bastonner avec ce roman. Mais là, rien… Quelques lettres, que j'ai soupçonnées être des modèles du genre, me sont parvenues. Je résume: entre deux genres, propos justes, force dans la description, saura toucher le lecteur, mais, vu la conjoncture, nous ne pouvons pas vous publier.
Ecrire pour empiler des feuilles ne sert à rien. Alors on balance son manuscrit en désespoir de cause, au petit bonheur la chance, à un éditeur dont on croit que c'est le métier, le sacerdoce, la profession de foi, « Le Livre ». À les écouter, du livre en voici, du livre en voilà, mais ils s'en tamponnent le coquillard. Du blé par-ci, de la fraîche par-là, passez la monnaie, de l'oseille en paquet. Pas vu je t'embrouille. Je m'énerve, c'est plus fort que moi ! Quand je parle de ces gens, je deviens atrabileux, désagréable, et il ne faut pas me chauffer longtemps.
En attendant, il faut bien survivre. Deux éléments essentiels à sauvegarder, manger et écrire. Le reste n'est que luxe, voire même luxure. Avoir un travail à côté m'a toujours sauvé la mise. Une saleté de boulot de pue-la-sueur, qui m'a rempli la bedaine, en attendant la gloire ou une autre fadaise…
Quand disparaît la magie de l'écriture, arrive l'ennui, terrible et mélancolique, qui rend atone toute journée, indépendamment des événements. Pas le moindre goût à baguenauder, pas même pour la bagatelle. Ça ressemble à un électroencéphalogramme plat. On sent se liquéfier l'intérieur. Les quelques neurones disponibles sont victimes de tétanie. Dans un état indéfinissable, on se momifie vivant. Traîner du lit au frigo, ouvrir un yaourt, fumer une cigarette, siroter une canette pour essayer de dissiper ce brouillard intense qui persiste devant les yeux. Rien n'attire l'attention. Rien n'est acceptable. On se croirait sur le Chemin des dames, en plein hiver, quand le vent descendu de Russie fouaille les rares arbres. Le ciel résonne du coassement des corbeaux, seuls êtres vivants en ces lieux. Ils attendent qu'une rafale de shrapnels vienne vous arracher la tripaille pour festoyer.
Si vous n'avez jamais mis les pieds dans ces endroits qui portent encore des traces abominables de l'histoire, un jour de frimas en janvier… Allez-y, vous comprendrez mon allusion. Il faut avoir vécu là-bas, pour appréhender le moral d'un type qui n’a plus de prise sur rien et ne travaille pas à l'inspiration. Évidemment, une âme bien pensante dira que la lecture peut compenser ce mal à vivre. Certes... Mais l'ersatz est médiocre. J’ai plus souvent trouvé de littérature dans la rubrique des faits divers de La Dépêche Libérée que dans une ambiance décrite par un plumitif pré-pubère. Le quotidien, il faut se le coltiner, au ras des fraises, quand on a décidé de s’attaquer au naturalisme. C’est la seule école pour ce genre-là. Dans ce jeu-là il faut souvent passer par la case prison, et surtout ne pas avoir la prétention de pondre des pages pour la postérité. Peu m’en chaut d’avoir des lecteurs quand je ne respirerais plus cet oxygène. Ici et maintenant, vite et bien. Désolé si l’image du poète romantique prend un coup de manche de pioche derrière la nuque…
Avec le froid, la vie quitte le corps en commençant par le bout des doigts. Les membres se recroquevillent et deviennent des appendices superflus, du bois mort… La tête se rétrécit à la taille d'un œuf et s'alourdit au point de vouloir exploser. Tout est indécent. Les mots prononcés contre cette malédiction n'y font rien. On reste persuadé qu'on aurait dû en finir au moment où tout s'écroulait. Il ne faudrait pas survivre aux instants de bonheur et en profiter pour partir aux fraises la paix dans l'âme. Devenir transparent lorsqu’on atteint la perfection... Un soulagement envahit. Enfin il n'y a plus rien à perdre, ou à prouver. Le cerveau saturé se déconnecte. Le corps ressent une douleur irradiante qui confisque les poumons, le cœur, la gorge, le bas du dos, excite les tripes et coupe en deux. À quoi bon faire le niais et donner dans la grimace ? J'aurais voulu que tout s'arrête là. Que la boule m’échappe et dégringole en bas de la colline.
J'ai eu l'adresse de la maison d'édition au hasard d'une revue de poésie imprimée en ronéo baveuse sur du papier qui peluchait, avec une couverture en kraft et des agrafes rouillées. J'ai encore envoyé le manuscrit, comme on jette un coup de pied dans la première poubelle qui passe à portée. Et alors que je n'y croyais plus, une lettre m'est arrivée. Le directeur littéraire m'accusait d'avoir commis un crime de jeunesse. Il m'en voulait de n'avoir pas réussi à dégager la substantifique moelle. Selon lui, toute la matière était là, mais empesée, engluée, mal fagotée. Je devais dégraisser et jeter des chapitres entiers muscler tout ça en soulevant le poids des mots. J'ai bien été obligé de convenir de la précipitation, par manque d’expérience. Je m'étais contenté du minimum, alors que je prétendais frapper la cible au cœur. Ma fierté en a été écornée. Il avait raison le bougre. Pour atteindre mon objectif j’avais besoin d’un minimum de recul et de lucidité.
Je pouvais consentir à quelques sacrifices sans que le sujet n'en soit dénaturé. Une matière dense, on ne peut pas l'altérer, même en supprimant des phrases, des paragraphes, des chapitres. Ils sont tous contenus en un seul. Le noyau dur, au fond de l'abîme.
Rien à dire, le zouave avait foutrement raison. Je ne sais pas pourquoi mais je me sentais en confiance avec lui. Sans fioriture, à la hussarde, sans circonvolution, il était allé droit au but... Probablement les salamalecs manquaient, mais cela avait le mérite d'être clair, précis, net et sans bavure. Trop mou là! Trop direct là! Virer les deux tiers! Ça irait bien mieux ainsi. Emploi catastrophique des virgules, accord des temps déplorable. Recomposer les trois quarts ! Il sentait que l’électricité passait, malgré tous les défauts de branchement. Au final, il me publierait.
Le dernier mot méritait que je m'y arrête. Puisqu’il allait me publier, j’étais prêt à subir tous ses vices… Je courberais l’échine j’obéirais au doigt et à la botte, je lui lécherais les mains, les pieds, j’en ferais des tonnes… Car personne d'autre avant lui n'avait daigné jeter un seul regard sur mon prurit verbeux...
Si je me méfiais des états d'âme de tous les banquiers de l'encre, lui m'inspirait le respect. Il ne tirait de son travail que son rachitique salaire. Pas comme ces bouffeurs de papier. Il payait de sa personne, lui. En vrai assistant il aidait les parturientes de mon genre condamnées à accoucher leurs textes en beuglant et ça l’amusait. Ce type avare de sourire, au regard franc et pas trop patibulaire, en connaissait un rayon sur le métier. Je n'étais pas le premier dans le genre ni le dernier qu'il avait publié. À l'en croire, j'avais de la chance. Je n'étais pas en train de pourrir au fond d'une geôle pour de sombres raisons politiques. De quoi je me plaignais ? Il m'énervait avec sa critique cinglante et sa dent dure. Mais je savais qu'il avait raison, entièrement raison, totalement raison.
Il fallait simplifier pour dominer parfaitement le sujet. Devenir un acrobate de la phrase, un trapéziste de la formule et ne pas s'engluer dans des figures absconses. Je pensais avoir dompté la façon, mais il m'infirmait et il me fallait l'accepter. J’avais l'impression que la proie allait m'échapper sans que j’en ai goûté la saveur. Pas assez fine, la mouture ne dégageait pas totalement son parfum dans le breuvage. À l'aveugle, dans le vide et sans les mains, je devais me jeter à l'eau. Avec lui, j'en ai bavé. J'ai dit souvent, amen. Et comme un vicieux j'en ai redemandé. Et ça l'amusait. Et j'en aurais accepté encore plus, parce que c'était ça ou crever.
Ma théorie sur l’intemporalité n'avait pas produit l'admiration, loin de là. Trop alambiquée à son goût mon concept de chronologie à l'orientale, de scénario à tiroirs. Pas assez maîtrisé. Je devais le comprendre de moi-même ou à l'usure.
Je me suis vissé au bureau, qu'il fasse soleil ou que la montagne soit recouverte de neige. Rien dans l'existence n'avait autant d'intérêt que ces feuilles. Ma vie dépendait d'elles. J'ai ramassé toutes mes forces dans le seul but d’attraper au moins une érection dans ce grand lupanar littéraire et pouvoir miser une seconde fois. Je devais acquérir la rigueur qui me faisait défaut. Quelle foutaise… J'étais jeune, pas bien démoulé, pas assez tordu et je me déroulais le grand cinéma.
En jardinier, je taillais d'un petit coup sec la phrase encombrée. Elle se redressait. Les adjectifs intempestifs, les répétitions inutiles allaient choir dans la sciure. Poussé par le seul désir d’être publier, couper dans la matière devenait un acte rituel. Cela a pris du temps. Pendant des semaines, des mois, essorer chaque phrase, la soupeser, la tâter, la comparer. Je lui ai retourné le manuscrit langé, pouponné, sans cataplasme inutile, ni branli-branla de poète mal inspiré, comme il me l’avait demandé...
Couvert de ratures, des bouts de feuilles recollées, le paquet de feuilles ressemblait à une copie de film muet qui aurait séjourné dans une malle humide. Seul un masochiste se serait esquinté les yeux sur un tel torchon. Il m'a obligé à tout retaper et je l’ai fait...
Il pensait, qu'en resserrant encore quelques boulons on obtiendrait un résultat plus probant. Il suffisait de s'y remettre. Cela en valait la peine. Pour la énième fois j’ai encore trifouillé dans le capot. J'avais, à mon insu, gagné en densité. Un peu comme si j’avais réduit des confitures en pâte de fruits
J'avais toute la vie pour moi. J'écrivais pour ne plus avoir l'impression d'une existence inutile. À qui d'autre raconter mes salades? Avec deux doigts et la régularité d'un métronome, le tic-tac des touches emplissait mes journées libres. Page à page j'avançais. La ramette diminuait. Il l'a relu. Il restait encore quelques broutilles, mais le ravalement avait eu lieu. Il en convenait enfin.
Seulement il n'avait plus la fonction qui lui aurait permis de me publier, éjecté de son poste pour de sombres raisons financières. Triste époque. Il me publierait c'est sûr: mais quand? Chez qui? Il cherchait une autre crêmerie. Il me donnerait des tuyaux. Il ne fallait pas désespérer et soumettre à d'autres le manuscrit. Il n'était pas le seul éditeur dans ce foutu pays. Je n'en doutais pas un instant. Aussi, plutôt que de perdre mon temps à écrire des fadaises que personne ne lirait jamais, j'ai rangé hors de ma vue le tas de feuilles dans un placard, pour en être définitivement débarrassé.
Faute de mieux, j'ai décidé de pratiquer l’onanisme et de me faire si possible sévèrement plaisir. Écrire pour écrire. Balancer toute la sauce. Faire gicler les contraintes. Culbuter ces bigoteries du langage prononcées avec coquetterie, la lèvre en cul de poule. Le bon mot où s'épanouit la beauté de l'esprit. À la tronçonneuse et à la dynamite, oui… Du viol de langue, en iconoclaste voyou. Pourquoi se retenir?
Défroquer le verbe, empaler la phrase, cracher la formule, éructer l’adjectif, roter à l’aise et se promener avec les roubignolles à l’air. Puisque c’est râpé pour la gloire et mal barré pour l’Académie, que le casse-croûte est plus qu’aléatoire, pourquoi se compromettre avec ces tyrannies?
N’attendre rien de personne procure une certaine liberté. Se foutre de la contrainte grammairienne, des lois de la syntaxe, de celles du marché et de ses margoulins. Le jus de quotidien est bien plus truculent que tous ces styles qui reniflent le « à la manière de »… Niaiseries et fadaises cousues de fil blanc pour pisse copie et bas bleus. Du jazz, du blues, de l’acide, mais pas de la littérature, encore moins de poésie. Regardez comme j’écris bien ! Alors elles arrivent ces médailles ? Comme ils sont intelligents les beaux premiers des meilleures ventes… Je préfère l’honnêteté du cirque. Une seule pirouette ratée et le trapéziste va avec ses côtes tâter la sciure. Pas comme ces gigolos qui s’en sortent en étalant leur culture…
Pas étonnant que le brave directeur littéraire ne comprenne rien au bruit des ateliers, à la monotonie du travail sur machine, aux odeurs de solvants, d’encre, de colle, de papier, à la fatigue, à la sueur. Le brave homme a-t-il déjà ressenti l’excitation quand démarrent les rotatives et le plaisir d’avoir fini un travail. Retranché dans son bureau, il n’a jamais roulé que sur la voie royale et pense que son intellect va lui permettre d’éclairer son jugement. Sérieux, notre homme croit aux valeurs du système, comme à une assurance qui le protégerait du néant de l’existence. Il se raccroche comme il peut au bastingage par peur des requins. Pitoyable Pierrot nyctalope, juste bon à finir cloué sur une porte. Cet homme n’est qu’un pioupiou, un simple dé pipé, dans ce grand business. Les lettres de refus qu’il écrit sont dictées uniquement par le banquier de service au blaser impeccable, avec rangers au pieds et parabellum à la ceinture. Le galonné du commerce, c’est lui le grand clown à la chemise brune, le prescripteur de la soupe, l’Auguste qui dicte tout le tintouin.
Notre directeur littéraire avec ses lunettes en écailles, ses vestes en cachemire, tweed, ou laine de vigogne n’est là que pour la façade. Les auteurs sont des êtres si sensibles qu’ils ne peuvent entendre le discours de la raison économique supérieure. Il tient la méthode des camps d’extermination où on diffusait la musique aux victimes pour les rassurer sur leur avenir. Dans ces bouges, les charmantes potiches à l’entrée assurent le décorum, car chez les éditeurs il n’y a pas encore de gorilles comme dans les grandes surfaces. Un magasin sans pitbulls à l’entrée ne peut pas être sérieux. Rien à tirer. Quel illuminé attenterait au dernier manuscrit du philosophe à la mode. Même la concurrence ne s’y intéresse pas, et malgré ça l’Auguste de ce grand cirque se fait du pognon. L’apparence est sauve. Nous sommes entre gens qui savent lire, n’est-ce pas ?
En contemplatif j’ai cru pouvoir m'inventer une emprise sur la réalité, voire la supplanter avec un stylo. Arrive le moment de trouver un éditeur pour ce paquet d’inepties et c’est à ce moment quelle revient au galop ; la grande réalité...
Je le confirme, je suis bon à rien, mais prêt à sortir le grand jeu pour réussir. Mettre des talons aiguilles, des collants résilles, une perruque. Faire la folle, accepter toutes les fantaisies, les vices, les coups tordus, le knout, la cravache et j'en passe. J'étais prêt à tout. Tout. Tout. Pourvu qu'on me publie. Malheureusement, j'ignorais avec qui je devais passer mes week-ends. Personne ne m'a jamais présenté l'ogresse des auteurs. Je ne suis pas regardant, ni dégoûté, pourvu qu'on m’imprime. Il faut déjà avoir des relations pour s'en faire d’autres. Je me serais contenté d'une simple place de treizième couteau, dans une boucherie de quartier.
Si j'avais eu l’embryon d’une réponse positive d'un éditeur, j'aurais au moins eu une raison de m'entêter, de me bastonner avec ce roman. Mais là, rien… Quelques lettres, que j'ai soupçonnées être des modèles du genre, me sont parvenues. Je résume: entre deux genres, propos justes, force dans la description, saura toucher le lecteur, mais, vu la conjoncture, nous ne pouvons pas vous publier.
Ecrire pour empiler des feuilles ne sert à rien. Alors on balance son manuscrit en désespoir de cause, au petit bonheur la chance, à un éditeur dont on croit que c'est le métier, le sacerdoce, la profession de foi, « Le Livre ». À les écouter, du livre en voici, du livre en voilà, mais ils s'en tamponnent le coquillard. Du blé par-ci, de la fraîche par-là, passez la monnaie, de l'oseille en paquet. Pas vu je t'embrouille. Je m'énerve, c'est plus fort que moi ! Quand je parle de ces gens, je deviens atrabileux, désagréable, et il ne faut pas me chauffer longtemps.
En attendant, il faut bien survivre. Deux éléments essentiels à sauvegarder, manger et écrire. Le reste n'est que luxe, voire même luxure. Avoir un travail à côté m'a toujours sauvé la mise. Une saleté de boulot de pue-la-sueur, qui m'a rempli la bedaine, en attendant la gloire ou une autre fadaise…
Quand disparaît la magie de l'écriture, arrive l'ennui, terrible et mélancolique, qui rend atone toute journée, indépendamment des événements. Pas le moindre goût à baguenauder, pas même pour la bagatelle. Ça ressemble à un électroencéphalogramme plat. On sent se liquéfier l'intérieur. Les quelques neurones disponibles sont victimes de tétanie. Dans un état indéfinissable, on se momifie vivant. Traîner du lit au frigo, ouvrir un yaourt, fumer une cigarette, siroter une canette pour essayer de dissiper ce brouillard intense qui persiste devant les yeux. Rien n'attire l'attention. Rien n'est acceptable. On se croirait sur le Chemin des dames, en plein hiver, quand le vent descendu de Russie fouaille les rares arbres. Le ciel résonne du coassement des corbeaux, seuls êtres vivants en ces lieux. Ils attendent qu'une rafale de shrapnels vienne vous arracher la tripaille pour festoyer.
Si vous n'avez jamais mis les pieds dans ces endroits qui portent encore des traces abominables de l'histoire, un jour de frimas en janvier… Allez-y, vous comprendrez mon allusion. Il faut avoir vécu là-bas, pour appréhender le moral d'un type qui n’a plus de prise sur rien et ne travaille pas à l'inspiration. Évidemment, une âme bien pensante dira que la lecture peut compenser ce mal à vivre. Certes... Mais l'ersatz est médiocre. J’ai plus souvent trouvé de littérature dans la rubrique des faits divers de La Dépêche Libérée que dans une ambiance décrite par un plumitif pré-pubère. Le quotidien, il faut se le coltiner, au ras des fraises, quand on a décidé de s’attaquer au naturalisme. C’est la seule école pour ce genre-là. Dans ce jeu-là il faut souvent passer par la case prison, et surtout ne pas avoir la prétention de pondre des pages pour la postérité. Peu m’en chaut d’avoir des lecteurs quand je ne respirerais plus cet oxygène. Ici et maintenant, vite et bien. Désolé si l’image du poète romantique prend un coup de manche de pioche derrière la nuque…
Avec le froid, la vie quitte le corps en commençant par le bout des doigts. Les membres se recroquevillent et deviennent des appendices superflus, du bois mort… La tête se rétrécit à la taille d'un œuf et s'alourdit au point de vouloir exploser. Tout est indécent. Les mots prononcés contre cette malédiction n'y font rien. On reste persuadé qu'on aurait dû en finir au moment où tout s'écroulait. Il ne faudrait pas survivre aux instants de bonheur et en profiter pour partir aux fraises la paix dans l'âme. Devenir transparent lorsqu’on atteint la perfection... Un soulagement envahit. Enfin il n'y a plus rien à perdre, ou à prouver. Le cerveau saturé se déconnecte. Le corps ressent une douleur irradiante qui confisque les poumons, le cœur, la gorge, le bas du dos, excite les tripes et coupe en deux. À quoi bon faire le niais et donner dans la grimace ? J'aurais voulu que tout s'arrête là. Que la boule m’échappe et dégringole en bas de la colline.
J'ai eu l'adresse de la maison d'édition au hasard d'une revue de poésie imprimée en ronéo baveuse sur du papier qui peluchait, avec une couverture en kraft et des agrafes rouillées. J'ai encore envoyé le manuscrit, comme on jette un coup de pied dans la première poubelle qui passe à portée. Et alors que je n'y croyais plus, une lettre m'est arrivée. Le directeur littéraire m'accusait d'avoir commis un crime de jeunesse. Il m'en voulait de n'avoir pas réussi à dégager la substantifique moelle. Selon lui, toute la matière était là, mais empesée, engluée, mal fagotée. Je devais dégraisser et jeter des chapitres entiers muscler tout ça en soulevant le poids des mots. J'ai bien été obligé de convenir de la précipitation, par manque d’expérience. Je m'étais contenté du minimum, alors que je prétendais frapper la cible au cœur. Ma fierté en a été écornée. Il avait raison le bougre. Pour atteindre mon objectif j’avais besoin d’un minimum de recul et de lucidité.
Je pouvais consentir à quelques sacrifices sans que le sujet n'en soit dénaturé. Une matière dense, on ne peut pas l'altérer, même en supprimant des phrases, des paragraphes, des chapitres. Ils sont tous contenus en un seul. Le noyau dur, au fond de l'abîme.
Rien à dire, le zouave avait foutrement raison. Je ne sais pas pourquoi mais je me sentais en confiance avec lui. Sans fioriture, à la hussarde, sans circonvolution, il était allé droit au but... Probablement les salamalecs manquaient, mais cela avait le mérite d'être clair, précis, net et sans bavure. Trop mou là! Trop direct là! Virer les deux tiers! Ça irait bien mieux ainsi. Emploi catastrophique des virgules, accord des temps déplorable. Recomposer les trois quarts ! Il sentait que l’électricité passait, malgré tous les défauts de branchement. Au final, il me publierait.
Le dernier mot méritait que je m'y arrête. Puisqu’il allait me publier, j’étais prêt à subir tous ses vices… Je courberais l’échine j’obéirais au doigt et à la botte, je lui lécherais les mains, les pieds, j’en ferais des tonnes… Car personne d'autre avant lui n'avait daigné jeter un seul regard sur mon prurit verbeux...
Si je me méfiais des états d'âme de tous les banquiers de l'encre, lui m'inspirait le respect. Il ne tirait de son travail que son rachitique salaire. Pas comme ces bouffeurs de papier. Il payait de sa personne, lui. En vrai assistant il aidait les parturientes de mon genre condamnées à accoucher leurs textes en beuglant et ça l’amusait. Ce type avare de sourire, au regard franc et pas trop patibulaire, en connaissait un rayon sur le métier. Je n'étais pas le premier dans le genre ni le dernier qu'il avait publié. À l'en croire, j'avais de la chance. Je n'étais pas en train de pourrir au fond d'une geôle pour de sombres raisons politiques. De quoi je me plaignais ? Il m'énervait avec sa critique cinglante et sa dent dure. Mais je savais qu'il avait raison, entièrement raison, totalement raison.
Il fallait simplifier pour dominer parfaitement le sujet. Devenir un acrobate de la phrase, un trapéziste de la formule et ne pas s'engluer dans des figures absconses. Je pensais avoir dompté la façon, mais il m'infirmait et il me fallait l'accepter. J’avais l'impression que la proie allait m'échapper sans que j’en ai goûté la saveur. Pas assez fine, la mouture ne dégageait pas totalement son parfum dans le breuvage. À l'aveugle, dans le vide et sans les mains, je devais me jeter à l'eau. Avec lui, j'en ai bavé. J'ai dit souvent, amen. Et comme un vicieux j'en ai redemandé. Et ça l'amusait. Et j'en aurais accepté encore plus, parce que c'était ça ou crever.
Ma théorie sur l’intemporalité n'avait pas produit l'admiration, loin de là. Trop alambiquée à son goût mon concept de chronologie à l'orientale, de scénario à tiroirs. Pas assez maîtrisé. Je devais le comprendre de moi-même ou à l'usure.
Je me suis vissé au bureau, qu'il fasse soleil ou que la montagne soit recouverte de neige. Rien dans l'existence n'avait autant d'intérêt que ces feuilles. Ma vie dépendait d'elles. J'ai ramassé toutes mes forces dans le seul but d’attraper au moins une érection dans ce grand lupanar littéraire et pouvoir miser une seconde fois. Je devais acquérir la rigueur qui me faisait défaut. Quelle foutaise… J'étais jeune, pas bien démoulé, pas assez tordu et je me déroulais le grand cinéma.
En jardinier, je taillais d'un petit coup sec la phrase encombrée. Elle se redressait. Les adjectifs intempestifs, les répétitions inutiles allaient choir dans la sciure. Poussé par le seul désir d’être publier, couper dans la matière devenait un acte rituel. Cela a pris du temps. Pendant des semaines, des mois, essorer chaque phrase, la soupeser, la tâter, la comparer. Je lui ai retourné le manuscrit langé, pouponné, sans cataplasme inutile, ni branli-branla de poète mal inspiré, comme il me l’avait demandé...
Couvert de ratures, des bouts de feuilles recollées, le paquet de feuilles ressemblait à une copie de film muet qui aurait séjourné dans une malle humide. Seul un masochiste se serait esquinté les yeux sur un tel torchon. Il m'a obligé à tout retaper et je l’ai fait...
Il pensait, qu'en resserrant encore quelques boulons on obtiendrait un résultat plus probant. Il suffisait de s'y remettre. Cela en valait la peine. Pour la énième fois j’ai encore trifouillé dans le capot. J'avais, à mon insu, gagné en densité. Un peu comme si j’avais réduit des confitures en pâte de fruits
J'avais toute la vie pour moi. J'écrivais pour ne plus avoir l'impression d'une existence inutile. À qui d'autre raconter mes salades? Avec deux doigts et la régularité d'un métronome, le tic-tac des touches emplissait mes journées libres. Page à page j'avançais. La ramette diminuait. Il l'a relu. Il restait encore quelques broutilles, mais le ravalement avait eu lieu. Il en convenait enfin.
Seulement il n'avait plus la fonction qui lui aurait permis de me publier, éjecté de son poste pour de sombres raisons financières. Triste époque. Il me publierait c'est sûr: mais quand? Chez qui? Il cherchait une autre crêmerie. Il me donnerait des tuyaux. Il ne fallait pas désespérer et soumettre à d'autres le manuscrit. Il n'était pas le seul éditeur dans ce foutu pays. Je n'en doutais pas un instant. Aussi, plutôt que de perdre mon temps à écrire des fadaises que personne ne lirait jamais, j'ai rangé hors de ma vue le tas de feuilles dans un placard, pour en être définitivement débarrassé.
Faute de mieux, j'ai décidé de pratiquer l’onanisme et de me faire si possible sévèrement plaisir. Écrire pour écrire. Balancer toute la sauce. Faire gicler les contraintes. Culbuter ces bigoteries du langage prononcées avec coquetterie, la lèvre en cul de poule. Le bon mot où s'épanouit la beauté de l'esprit. À la tronçonneuse et à la dynamite, oui… Du viol de langue, en iconoclaste voyou. Pourquoi se retenir?
Défroquer le verbe, empaler la phrase, cracher la formule, éructer l’adjectif, roter à l’aise et se promener avec les roubignolles à l’air. Puisque c’est râpé pour la gloire et mal barré pour l’Académie, que le casse-croûte est plus qu’aléatoire, pourquoi se compromettre avec ces tyrannies?
N’attendre rien de personne procure une certaine liberté. Se foutre de la contrainte grammairienne, des lois de la syntaxe, de celles du marché et de ses margoulins. Le jus de quotidien est bien plus truculent que tous ces styles qui reniflent le « à la manière de »… Niaiseries et fadaises cousues de fil blanc pour pisse copie et bas bleus. Du jazz, du blues, de l’acide, mais pas de la littérature, encore moins de poésie. Regardez comme j’écris bien ! Alors elles arrivent ces médailles ? Comme ils sont intelligents les beaux premiers des meilleures ventes… Je préfère l’honnêteté du cirque. Une seule pirouette ratée et le trapéziste va avec ses côtes tâter la sciure. Pas comme ces gigolos qui s’en sortent en étalant leur culture…
Pas étonnant que le brave directeur littéraire ne comprenne rien au bruit des ateliers, à la monotonie du travail sur machine, aux odeurs de solvants, d’encre, de colle, de papier, à la fatigue, à la sueur. Le brave homme a-t-il déjà ressenti l’excitation quand démarrent les rotatives et le plaisir d’avoir fini un travail. Retranché dans son bureau, il n’a jamais roulé que sur la voie royale et pense que son intellect va lui permettre d’éclairer son jugement. Sérieux, notre homme croit aux valeurs du système, comme à une assurance qui le protégerait du néant de l’existence. Il se raccroche comme il peut au bastingage par peur des requins. Pitoyable Pierrot nyctalope, juste bon à finir cloué sur une porte. Cet homme n’est qu’un pioupiou, un simple dé pipé, dans ce grand business. Les lettres de refus qu’il écrit sont dictées uniquement par le banquier de service au blaser impeccable, avec rangers au pieds et parabellum à la ceinture. Le galonné du commerce, c’est lui le grand clown à la chemise brune, le prescripteur de la soupe, l’Auguste qui dicte tout le tintouin.
Notre directeur littéraire avec ses lunettes en écailles, ses vestes en cachemire, tweed, ou laine de vigogne n’est là que pour la façade. Les auteurs sont des êtres si sensibles qu’ils ne peuvent entendre le discours de la raison économique supérieure. Il tient la méthode des camps d’extermination où on diffusait la musique aux victimes pour les rassurer sur leur avenir. Dans ces bouges, les charmantes potiches à l’entrée assurent le décorum, car chez les éditeurs il n’y a pas encore de gorilles comme dans les grandes surfaces. Un magasin sans pitbulls à l’entrée ne peut pas être sérieux. Rien à tirer. Quel illuminé attenterait au dernier manuscrit du philosophe à la mode. Même la concurrence ne s’y intéresse pas, et malgré ça l’Auguste de ce grand cirque se fait du pognon. L’apparence est sauve. Nous sommes entre gens qui savent lire, n’est-ce pas ?
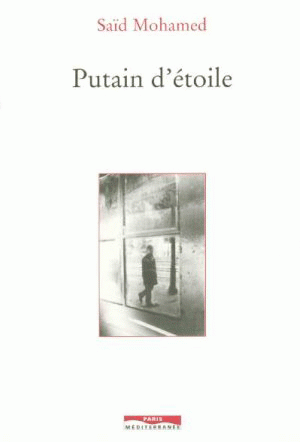
05:20 Publié dans Petit traité de médecine à l'usage des rustres | Lien permanent | Commentaires (0)



Les commentaires sont fermés.