27/03/2012
Patrick Auzier, l'homme du feu.
Au pays du rêve de Patrick Auzier...

Il me reste des bribes de ces fêtes très étranges auxquelles j’ai assisté. Les musiciens qui soufflaient dans des saxophones portaient des masques de carnaval et des perruques dorées dont les boucles se répandaient sur les épaules, alors que d'autres étaient affublés de chignons et de loups de satin noir. Certains, torses nus et le visage bariolé de peintures zoulous frappaient des tambours. La procession était suivie par une foule en transe qui dansait et chantait. Cela sentait la poudre noire, la transpiration et le rut. Les corps étaient prêts au coït et l'âme à l'ivresse. Comme dans une fête primitive, la foule scandait un hymne festif autant qu'une prière païenne. La procession s'enfonçait dans les bois pour rendre hommage aux esprits de la terre. Des humanoïdes, mi-chair, mi-éponge qui avaient commencé à prendre la couleur de l'écorce et du lichen étaient accrochés aux arbres. Comme si ces types arrivaient d'une autre planète et avaient échappé à une giclée de neutrons en pleine poire en se cachant au fond d'une galerie désaffectée. Après y être restés des générations entières sans avoir jamais vu le jour, ils auraient, lors de leur première sortie, tenté d'escalader les arbres et se seraient brûlés à la lumière. Tétanisés, statufiés par la photosynthèse qui se serait déclenché à cause des mutations des corps déshabitués à la lumière. Ces corps semblaient avoir stoppé leur évolution à mi chemin entre le chou-fleur et le rosbif.
La sarabande, qui s'avançait dans le sentier, s'est arrêtée aux pieds de grands chênes. Une troupe de percussionnistes avait confectionné des trampolines avec des chambres à air de camions et de voitures. Attachés à des élastiques, tendus depuis le faîte de l'arbre, les acrobates sautaient le long d'un xylophone géant en tubes de bambou qui partait depuis le sol rejoignait les premières branches d'un chêne séculaire. Enfermés dans des cages de bambou, en haut des arbres, des violonistes jouaient une symphonie. Dissimulés dans les fougères, des feux de Bengale illuminaient cette fête. Des officiants aux déguisement de forbans portaient des flambeaux et des fusées rouges et jetaient des ribambelles de pétards au milieu de la foule qui se déhanchait sur un hymne endiablé. Combien de jours et de nuits a duré cette étrange fête? Je n’en sais rien.
Mais j’ai souvenir qu’une autre nuit la fête a eu lieu dans un château désaffecté. Au milieu d’un énorme nuage de fumée, dans la grande cour entourée de murailles, les explosions retentissaient. Les traînées versicolores des fusées retombaient en mèches folles, sifflaient dans tous les sens, assourdissantes. Secouaient la terre, remuaient le ciel et faisaient tout trembler. Observant la trajectoire aux départs des missiles, les musiciens de jazz étaient prêts à se jeter à terre, ou à s'abriter derrière leur pupitre en cas de besoin. Des bouts de carton enflammés retombaient à l'intérieur de l'enceinte ce qui provoquait des cris, des mouvements de foule. On n'y voyait pas à trois mètres, aussi, c'est la tête levée au ciel que chacun guettait les retombées enflammées. Les explosions redoublaient et le rythme ne mollissait pas. Les filles dansaient et suaient dans cette nuit moite et électrique.
Une autre nuit encore, l'embrasement a eu lieu sur un plan d'eau. Les musiciens avaient pris place dans des barques, et des violonistes ainsi qu’un saxophoniste jouaient doucement, un air très mélancolique sur le rythme de la cascade, dans le sous-bois illuminé par des feux de Bengale, dissimulés parmi les fougères. Les silhouettes énigmatiques étendaient leurs ombres sur l'eau dont le reflet s'étirait en ondoyant. A la surface du lac comme des sortes de génies malfaisants, des fusées hors bords sifflant et pétaradant couraient en tous sens.
Francis Marmande, Le Monde, 21 août 1999
La Compagnie Lubat se signale par son rapport aux mots, aux poètes, au rap, à la langue, au scat, à la tchatche, à l’invention syllabique. Au milieu, Auzier est le silence essentiel. Il s’est révélé comme l’homme du feu. Commençant par des installations pyrotechniques de facture classique, puis compliquant.
Au début, on a cru de ses feux qu’ils étaient une fantaisie de la Compagnie, une drôlerie pimentée de dérision, le détournement d’une réjouissance populaire. Et puis il a fallu se rendre à l’évidence. Les feux d’Auzier de plus en plus ingénieux, donnant un spectacle de plus en plus simple, par le fait, sont la clef de l’invention ; Le lien entre enfance et artistes, musique et rêve. Quand Auzier embrase un château, une forêt, un lac, c’est d’une autre manière. L’autre pyrotechnie. Il a travaillé le
rythme, le tempo, les commandes électriques, les emplacements inédits, les déclenchements inattendus, les fils qui courent sur la foule avec les vecteurs de comète, les bouquets de flammes que l’on contemple au-dessous, les synchronies instrumentales…
Dans la forêt, sa Nuit des Soli-Sauvages donne lieu à une création saisissante. Portal et Shepp bien ensemble, dans les fontaines blanches. Des murs, des gerbes et des fusées qui jaillissent du fond de l’eau du lac. Comme un symbole de la Compagnie, Auzier n’a cessé de perfectionner l’art qu’il a inventé. Chemin faisant, en vingt-deux ans d’apprentissage autodidacte, il fabrique ses pièces et s’est donné une technique au trombone : vingt-deux ans d’études en public, dont onze pour trouver l’embouchure.
Après quoi il conclut trois heures de Soli-Sauvages et d’invention pyrotechnique, seul devant un Niagara de flammes, commande les gerbes par le son, au trombone incroyablement maîtrisé, puis dans un coin, fond en larmes. « Prendre toujours les mêmes », comme regrettent les notables avant d’en reprendre un, c’est la forme pyrotechnique de la fidélité active.
20:49 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (2)
16/02/2010
Juste quelqu'un de bien
In mémoriam
La nouvelle est tombée comme un coup de poing: Crash d'un ULM à Granville

C'est pas le genre à la ramener sur le devant de la scène, loin de là même. Il préfère la discrétion bonhomme. Il cause pas beaucoup, mais quand il cause il sait de quoi il parle. Lui c'est tout le biotope des herbus de la baie du mont St Michel, la faune, la flore, les praires, les bulots, les salicornes et les phoques.
Pourtant il a bon caractère le Gérard, le Gégé comme tous l'appelle ici. Mais la mer qu'on vide à coup de filets de plus en plus grands jusqu'à épuisement des ressources ça le chagrine, et pas qu’un peu. Il suit les campagnes d’étude des anchois dans le golf de Gascogne sur la Thalassa et ce qui était prévu, depuis des années déjà, est arrivé. Les poissons, se font rare.

Il n’est pas sûr que certaines espèces se régénèrent même en arrêtant la pêche immédiatement. L’anchois, le merlu, la sole, la morue, et maintenant les espèces des grands fonds qui sont aussi en voie de raréfaction. Ces espèces-là n’étaient pas habituées à subir une telle prédation. On a beau compter les œufs, voir où ils ont été pondu, connaître le Gulf stream c’est pas sûr que les anchois pointent à nouveau leur nez sur les pizzas. Voila que les japonais se remettent à la chasse à la baleine, que la chair des bélugas du St Laurent est gavée de Cadmium, que le lait maternel des mamans Inuits est devenu toxique à cause de leur alimentation à base de phoque… Cul par dessus tête il va ce monde.

Photo: Gérard Gautier
Et il vous faudrait le voir parler de l'observation des phoques en ULM. Mais il refuse les interviews de la radio ou de la télévision parce que ça ramènerait trop de monde sur le coin et que les phoques ont pas besoin de voir des gens.
Ils ont rien demandé les phoques, sauf qu’on leur foute la paix quand ils font leur sieste sur les bancs de sable.
Alors ceux de TF1, ou de Monté Carlo peuvent courir. C’est pas lui qui leur vendra la mèche pour leur business. Il ne le dit même pas avec rancœur, non simplement avec le sourire du cueilleur de champignon, qui sait où et quand et qui même contre de l’argent ne parlera pas. Car le respect, ça se mérite, c’est comme la confiance.

Photo: Gérard Gautier
Le Gégé, c’était un cancre à l’école, mais quand il cause aux jeunes, il vous faut voir comment ils l’écoutent et avec quel respect. Ils savent d’instinct qu’un bonhomme comme ça ne ment pas. Avec sa tête burinée et son bonnet posée sur son crâne qui n’est plus très couvert il a tout du sage.
Quand il était élève au lycée agricole, il n’y croyait pas aux rations de farine animale et à la poudre d’os pour améliorer l’alimentation des vaches. Des sornettes de cet acabit au gars Gégé ça refusait de lui rentrer dans le crâne. Fallait pas compter sur lui pour de l’intelligence pareille. Jamais avant il aurait dit ce qu’il en pensait de leur monde. Il préférait regarder les piafs par la fenêtre ça lui semblait moins malsain. Et le temps lui a donné raison. Ces gens qui le prenaient pour un imbécile heureux viennent le consulter, pour savoir comment ça peut se faire qu’ils aient pu se gourer à tel point. S’ils avaient regardé vivre les piafs, les rouges-gorges et les mésanges, peut être qu’ils auraient su comment l’équilibre de la vie est fragile. Tout ça c’est seulement du bon sens.
-Quand je pense qu'il y en a qui s'ennuient, moi j'ai pas le temps de tout faire. Il faut que je finisse mon ULM hydravion, celui-là pour me poser en mer. Il faudrait que je vende quelques photos pour me payer une caméra performante.

Photo:Gérard Gautier
Alors le gars Gégé, c’est mon nez qui m’a conseillé de le guider sur le Salon du Livre jeunesse de Montreuil à la rencontre des éditeurs, parce que quand j’ai vu ses photos de dauphins, de baleine, de phoques, de fous de Bassan, de mouettes, et de tous ces oiseaux dont j’ai oublié le nom, j’ai su que ça les intéresserait, les minos et les marchands de papiers. Mais comme il ne connaît pas ce terrain-là, je l’ai guidé, comme il l’a fait pour moi entre les sables mouvants de la baie. Comme promis, voici aussi quelques belles photos prises par lui.

Tournepierrre

Stern artique

Dauphin
Pour suivre le travail de recherche sur les phoques en baie du Mont Saint Michel Cliquez ici
17:24 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (1)
28/02/2009
Passage des Indes (2)

Andréa a penché un peu la tête sur le coté, et m’a regardé comme pour me gronder.
— Dis donc tu vas bien toi, tu maigris trop me lança-t-elle ?
— Oui, je sais mais je me suis attrapé deux ou trois diarrhées de suite.
— Tu as pris des médicaments au moins.
— Oui, mais ça s’arrête et puis ça recommence.
— Faut bien soigner ça. Tu n’as pas de sang ? Pas de fièvre ?
— Non.
— Bon. Alors Intétrix ou Imossel c’est le meilleur. J’en ai plein la pharmacie. Et puis j’ai ça aussi dit-elle ouvrant la porte de la réserve. Elle en revint avec une bouteille de pastis.
— Ce sont des amis qui me l’ont rapporté de France. Il faut que tu en boives un ou deux fonds de verre sans eau Et il faut que tu manges plus. Tu maigris à vue d’œil c’est pas bien. Il ne faut pas que tu tombes malade. Ici le climat est très dur, comme tu t’en es aperçu.
Elle se préoccupait de ma santé comme s’il s’était agi d’un de ses enfants tout en faisant fi de la sienne. Étrangement cela me rassurait aussi, de savoir que j’avais été adopté par la vieille soeur. Car l’orphelinat était un lieu où je comprenais ce qui se passait contrairement à tous les autres où je pouvais aller dans ce foutu pays. J’avais pensé que grâce a elle j’apprendrais beaucoup de l’Inde. Moi aussi j’y avais trouvé refuge.
— Depuis que je suis ici les choses ont bien changées. Je me souviens qu’on allait en vélo et ça faisait rire les Indiens. Il n’y avait qu’une seule route empierrée et peu de voitures. C’est étrange de voir comment la vie a évolué. Tout cela est vraiment proche, le temps ne se déroule pas comme en Europe, tout ici est plus lent ; le temps s’écoule d’une façon si paisible qu’il en paraît étrange. Je ne veux pas retourner en France. Pourquoi faire ? Ma vie est ici, auprès des enfants.

matin de Noël 2003 à l'orphelinat. les plus jeunes découvrent leurs cadeaux et embrassent leur maman Andréa...
16:26 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : soeur andréa, orphelinat, pondicherry
03/10/2008
Bernard Hugues
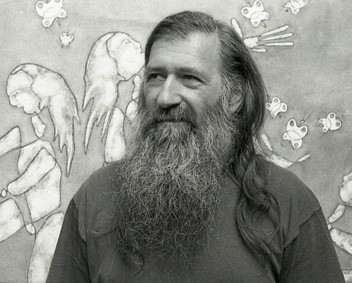
Dans sa montagne, il habitait un hameau relié au monde par une simple piste qui se tortillait dans le chant des cigales. Au bout, quelques habitants affrontaient la solitude des grands châtaigniers, la sécheresse de l'été et la neige de l'hiver. Il vivait là au rythme des saisons partageait son temps entre son atelier d'artiste peintre et son jardin. Dans ce paradis d'arbres et de vallées.
Il avait aménagé sa maison, de ses mains remonté des pans de murs, consolidé des toitures. Il parlait peu et abattait son travail avec la constance d'une machine. De la journée, il ne s'accordait un instant de répit que pour se rouler une cigarette de tabac gris.

Ils n'étaient plus que six habitants dans ce coin perdu, deux couples de jeunes nouvellement arrivés et des autochtones nés là, ayant vécus là, sans intention d'aller ailleurs. Leur seul paysage étant ces dômes de montagnes et la vallée qui s'enfonce devant eux. Ils s'y sentaient en sécurité cachés dans un pli de la terre, loin de ces étendues à perte de vue où l'oeil ne peut pas se reposer que sur des points fixes.
Tout autour de la maison, il avait débroussaillé, et jusque loin sous les arbres, car il redoutait l’ennemi sournois qui ne prévient pas ; le feu. Parfois les Canadairs passaient au-dessus de la colline si prés tête, qu'ils apercevait les pilotes dans leur combinaison jaune aux commandes de leur arroseur céleste.
Dans son livre, il parlait si bien de ces gens qui savent qu'ils ne sont pas faits pour être soldats et qui se refusent à rentrer dans le rang quoi qu’il leur en coûte. Il avait écrit cette histoire que lui avait raconté son ami, ce témoignage d'un simple ouvrier agricole qui avait décidé de se suicider plutôt que de courber l'échine. La grande muette n’était pas parvenue à faire obéir ce simple paysan, pensant faire plier celui-là comme les autres. C'était faire peu de cas de l'entêtement cévenol, car, pour vivre dans ces conditions de rudesse, têtu il faut l'être.
Mais cela en vaut la peine et la récompense est là quand on se lève le matin sur cet étang de brume qui recouvre la vallée. Ce spectacle qui vaut bien tous les sacrifices. Dans ce pays vidé de travail, ne reste que des retraités, car comment vivre avec ces revenus que veut bien accorder la terre. Les arpents abandonnés tout autour partaient en friches.

Il vivait hors du temps et s'employait à peindre, à écrire et à planter des châtaigniers sur ses terres. Roc face à la mer. Rien semble-t-il n'aurait pu l'entamer. Il dégageait une telle énergie paisible et offrait ses sourires si naturellement. Occupé par ses passions, il semblait indéracinable dans sa veste de velours. Il a préparé le repas sur le feu de cheminée, et s'en est allé chercher à la cave un grand bocal de sa récolte de cèpes, et les a accompagnés d'un confit et d’un vin local.

Bernard Hugues était peintre et écrivain. Il est décédé en 2003.
Le Refus publié en 1982 aux éditions Ressacs, va reparaître aux éditions l'Arganier dans la collection ressacs. Une rétrospective de l'oeuvre peinte de Bernard Hugues aura lieu en mai 2009 dans les Cévennes.
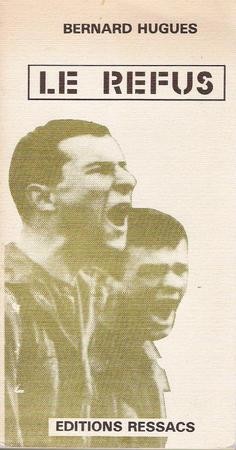
22:14 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (0)
16/12/2007
La très belle histoire du vigneron bourguignon candide et de son ouvrier sans-papiers aux prises avec la diabolique administration...

collage Maryvonne Le Quellec
Source: Libération
Alice Géraud
Millet est un ancien officier de l’armée française en Algérie. Il en a conservé un vocable suranné aux accents plus paternalistes que colonialistes à l’égard de la communauté arabe. Benali Sahnoune, algérien, était alors clandestin en France, il n’avait pas de boulot. Millet l’a fait embaucher sur le domaine viticole de sa fille. Petit à petit, le travailleur clandestin a appris le métier de la vigne. Il a commencé par trier les sarments, puis se familiarisant, il a appris à les attacher, à ébourgeonner, à tailler… «C’est un bon vigneron», dit Michel Millet. Mais, la semaine dernière, alors qu’il se rendait sur le domaine de Châtenoy-le-Royal (Saône-et-Loire), Benali Sahnoune a été arrêté sur la route par les gendarmes et emmené au centre de rétention administrative de Lyon. Il doit être expulsé d’un jour à l’autre vers l’Algérie. Michel Millet a d’abord été en colère. Puis il a pleuré. L’histoire de Benali Sahnoune se confond avec celle des milliers de clandestins expulsés chaque année. En 2002, il a fui le nord-ouest d’Alger, région sinistrée par la guerre civile, laissant sur place femme et enfants, pour espérer trouver un travail en France. Il a rejoint Chalon-sur-Saône, où son père est installé depuis 1962, sa mère et ses frères et sœurs (français, eux) depuis une quinzaine d’années. Il s’est vu refuser, comme la plupart des Algériens, le statut de réfugié. A quand même trouvé du boulot. Déclaré. Il pensait que cela plaiderait pour sa régularisation. Il s’est trompé.
Lors de son arrestation, il a montré ses feuilles de paie, ses cotisations à la Mutuelle sociale agricole… «Ils m’ont dit que ça ne servait à rien.» Benali Sahnoune est résigné. Michel Millet, son employeur, n’y arrive pas. Benali Sahnoune sait que «c’est comme ça». Michel Millet ne le savait pas. Cet homme de 73 ans vient de découvrir une France qu’il ne connaissait pas. Celle «des humiliations» et «du mépris». Comme sa fille, il a été convoqué chez les gendarmes. Il lui a été signifié qu’il pouvait être poursuivi pour «aide à l’entrée, au séjour et à la circulation d’un étranger en situation irrégulière». Le procureur n’a pas voulu donner suite. Mais Michel Millet n’est pas dupe : «On est une famille de notables convenables, cela explique.»
Quelques jours après l’arrestation de Benali Sahnoune, il s’est rendu avec Zerka et Amoulkeir, les deux sœurs de Benali, au centre de rétention administrative de l’aéroport de Lyon. Après deux heures de route, ils ont sonné au centre de rétention. On leur a demandé d’attendre sous le vague Abribus qui fait office de salle d’attente. Au bout de trois quarts d’heure dans le froid, croyant avoir été oubliés, ils ont resonné. Les policiers sont sortis, leur ont fait comprendre que leur impatience était de mauvais aloi. Ils ont été sanctionnés d’une privation de visite et sont repartis à Chalon. La colère au ventre. Avec un accent bourguignon comme on n’en entend plus, le «r» roulant et traînant, Michel Millet peste contre «cette droite de cons».
L’ancien président local de la CGPME (le très droitiste syndicat des petits et moyens patrons), qui fréquente le ban et l’arrière-ban des notables chalonnais, a des gros mots pleins la bouche contre la politique d’immigration de la France, la politique tout court et ses représentants. A sa femme qui s’inquiète de le voir sortir de ses gonds face à la presse, il répond : «Ne vous inquiétez pas Geneviève, je sais que je parle à un journal de gauche, je prends toutes les précautions d’usage.» Les sœurs de Benali sourient. Parfois le taclent sans ménagement.
Curieux trio que ce monsieur aux allures de gentleman-farmer version bourguignonne de la IIIe République et ces deux jeunes femmes portant le voile et le verbe haut. Ils sont retournés ensemble mercredi au centre de rétention pour un dernier au revoir à Benali. Cette fois-ci, ils ont pu entrer. Ils lui ont apporté sa valise et quelques cadeaux pour la famille au bled. Ils ont droit à vingt minutes d’entretien. Dans la salle aux murs blafards, personne n’arrive vraiment à parler. Michel Millet répète : «C’est ridicule tout ça.»
QUOTIDIEN : samedi 15 décembre 2007
07:15 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (0)
14/12/2007
Je chanterai pour toi
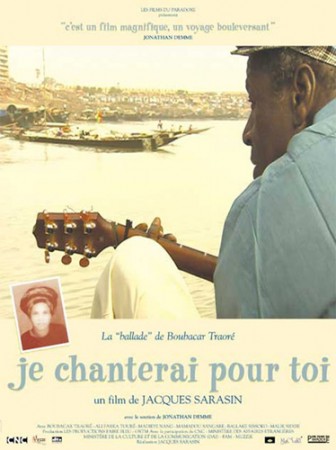
Dès son jeune âge, Boubacar Traoré se passionne pour le football. Mais c’est en chapardant la guitare de son grand frère musicien qu’il se met à la musique, en autodidacte.
Dans les années soixante, dans un Mali devenu indépendant il multiplie les concerts et la radio diffuse ses chansons qui deviennent de véritables hymnes à ce pays en pleine reconstruction, plein d’espoir et de promesses.
Le succès est fulgurant ; Karkar est le chantre de ce nouvel élan. Il se souvient de cette époque de bohême : « Le peuple malien m’aimait. J’étais son Johnny Hallyday, son James Brown, mais je n’avais pas de quoi me payer des cigarettes. »
Dès la fin des années soixante, l’euphorie des commencements retombée, le Mali se fossilise dans une « révolution culturelle » de plus en plus rigide.
Le soir, les rues se vident, les cafés ferment, les guitares se taisent, la bohême s’achève et les contingences naturelles contraignent Boubacar Traoré à laisser de côté sa musique. Il travaille alors comme tailleur ou comme ouvrier agricole. « Si tu es marié et si tu as des enfants, tu ne peux pas faire de la musique, parce que tu ne gagnes pas d’argent avec. Alors je ne joue pas. » Ce silence durera plus de 20 ans.

En 1981, la mort de son frère fait renaître le mythe : Le Mali tout entier dans la confusion, pense avoir perdu celui dont les chansons avait accompagné l’indépendance. Quelques années plus tard, des journalistes de la télévision malienne retrouvent par le grand des hasards Karkar bien vivant, derrière une table au marché de Kayes où il vendait des babioles. Ressuscité, il fait exploser le standard téléphonique de la chaîne à qui il donne une interview en direct.
Mais la confusion perdure : Le Mali ne fait pas le lien entre le mythe Karkar et le chanteur Boubacar Traoré.
En 1988, Pierrette, sa femme adorée, décède lors d’un accouchement. Anéanti, Karkar confie ses enfants à une vieille tante et, sur les conseils d’un ami, part en France pour refaire sa vie. Il erre alors pendant des années dans les foyers Sonacotra de la région parisienne et travaille comme maçon.
C’est un producteur de disques anglais qui, avec l’aide du directeur du Centre Culturel Français à Bamako, parvient à le convaincre de reprendre une guitare dont il ne voulait plus entendre parler : ils le décident à enregistrer son premier album : « Mariama ». Karkar revient alors s’installer à Bamako avec sa famille.

15:40 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (0)
11/10/2007
La prose du Transibérien
Par blaise Cendrars
En ce temps-là, j'étais en mon adolescence
J'avais à peine seize ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance
J'étais à 16.000 lieues du lieu de ma naissance
J'étais à Moscou dans la ville des mille et trois clochers et des sept gares
Et je n'avais pas assez des sept gares et des mille et trois tours
Car mon adolescence était si ardente et si folle
Que mon coeur tour à tour brûlait comme le temple d'Ephèse ou comme la Place Rouge de Moscou quand le soleil se couche.
Et mes yeux éclairaient des voies anciennes.
Et j'étais déjà si mauvais poète
Que je ne savais pas aller jusqu'au bout.
Le Kremlin était comme un immense gâteau tartare croustillé d'or,
Avec les grandes amandes des cathédrales, toutes blanches
Et l'or mielleux des cloches...
Un vieux moine me lisait la légende de Novgorode
J'avais soif
Et je déchiffrais des caractères cunéiformes
Puis, tout à coup, les pigeons du Saint-Esprit s'envolaient sur la place
Et mes mains s'envolaient aussi avec des bruissements d'albatros
Et ceci, c'était les dernières réminiscences
Du dernier jour
Du tout dernier voyage
Et de la mer.
Pourtant, j'étais fort mauvais poète.
Je ne savais pas aller jusqu'au bout.
J'avais faim
Et tous les jours et toutes les femmes dans les cafés et tous les verres
J'aurais voulu les boire et les casser
Et toutes les vitrines et toutes les rues
Et toutes les maisons et toutes les vies
Et toutes les roues des fiacres qui tournaient en tourbillon sur les mauvais pavés
J'aurais voulu les plonger dans une fournaise de glaive
Et j'aurais voulu broyer tous les os
Et arracher toutes les langues
Et liquéfier tous ces grands corps étranges et nus sous les vêtements qui m'affolent...
Je pressentais la venue du grand Christ rouge de la révolution russe...
Et le soleil était une mauvaise plaie
Qui s'ouvrait comme un brasier
En ce temps-là j'étais en mon adolescence
J'avais à peine seize ans et je ne me souvenais déjà plus de ma naissance
J'étais à Moscou où je voulais me nourrir de flammes
Et je n'avais pas assez des tours et des gares que constellaient mes yeux
22:20 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (0)
21/09/2007
Passe Ouest
par Alain Jégou
J'ai eu le grand privilège avec Bénédicte Mercier -témoin photographe de la scène- de partir un jour en péche avec Alain Jégou et son équipage. Il faisait trés beau temps, la mer était calme depuis trop longtemps, raison pour laquelle la péche n'a pas été bonne. Travail d'homme de peine, paroles d'homme d'écume. A l'homme je rends hommage en vous offrant des extraits de son recueil, Passe Ouest qui vient de paraître... Une poésie qui sent l'iode, le poisson séché, le fuel, le café et le tabac, la sueur, la fatigue, la peur aussi face aux éléments, à la voix rauque et chaleureuse comme celle du marin de Lorient.

Mélancoliques déjà de notre enfance révolue, nous marchions têtes baissées, cognant nos fronts volontaires aux puissantes bourrasques de vent, dans les rues de la ville endormie, sur les avenues désertes, les places engourdies dans la lumière blafarde de quelques réverbères anémiés, pour gagner le port de pêche où nous espérions trouver un boulot à notre portée, comme débarquer, déglacer ou laver les caisses et les paniers, dans le brouhaha de la nuit portuaire, les couinements des grues, les invectives, les gueulantes et les goualantes lancées par les dockers ou les trieuses, toute la faune énervée des hommes et des femmes qui s’activaient sur les gros rafiots ventrus, les quais ou la criée.
Nippés comme des clodos, des hobos, des brûleurs de dur, des poètes beat , des Kerouac, des Cassady, fonçant à tout berzingue dans la grande nuit américaine ou remontant la Troisième Avenue pour aller se jeter dans les volutes et les chorus d’un Harlem sauvage et passionnel, emmitouflés dans nos blousons et nos parkas, avec la même audace, le même désir fougueux, la même énergie surmultipliée, nous arpentions le pavé de l’Avenue de La Perrière, ombres mouvantes précipitées dans l’univers frisquet, pour accomplir notre grand destin aventureux.
Vers minuit, dans la cohue et le brouhaha , commençait l’embauche des dockers professionnels, puis celle des occasionnels et de quelques ados, manutentionnaires volontaires comme nous, lorsqu’il y avait suffisamment de boulot pour tous. Les yeux rivés sur le tableau des tonnages annoncés, nous tirions sauvagement sur nos gauldos puis recrachions de longues fumerolles bleutées, comme le faisaient tous ces mecs, ces durs à cuire aux trombines burinées par les vents, le sel et le jaja aigrelet de l’existence, en écoutant défiler les noms des heureux gagnants, puis les postes et les bateaux qui leur étaient attribués.
Parfois, dans les nuits de gros arrivages, nous nous retrouvions au pied des grues ou aux tables de triage, puis en fin de vente, la matinée bien avancée, à laver les caisses et le sol de la criée, vannés, lessivés, mais toujours satisfaits de l’effort fourni au sein du groupe , toute cette fratrie frappée que nous nous plaisions à fréquenter, en nous foutant bien de toutes ces médisances et mésestimes dont elle faisait l’objet, de tous les qualificatifs méprisants, injurieux, dont l’affublaient les bourges et les culs bénis de la cité.
En plus des quelques biffetons, l’argent de poche durement gagné, pour nous payer quelques toiles, bouquins, vinyles ou soirées dans les troquets bruyants du centre-ville, nos jeunes corps ,bouillant de fougue et de désir, exultant au contact des formes dévergondées de nos petites amoureuses d’un jour , nous avions l’impression de faire notre révolution en trimant avec les zonards et les loubards du port, toute la populace des marginaux de l’époque. Nous étions neufs, vrais, sincèrement éblouis et gourmands de vie, et nous pensions différemment, autrement mieux que nos parents.
Je n’ai pas oublié ces années où les navires étaient encore si nombreux que les derniers arrivés pour la vente du Pan coupé devaient attendre qu’une place à quai se libère pour pouvoir débarquer leur pêche, ou glisser leur étrave entre deux coques et mettre les gaz en puissance pour les écarter dans les craquements de bordés, afin d’aller coller leur proue au béton balafré.
Non plus l’ambiance survoltée qui régnait sous la criée, les appels et plaisanteries des mareyeurs et poissonniers agglutinés derrière les barrières en attendant le coup de sifflet annonciateur de l’ouverture de la vente de 5 heures. La ruée sur les caisses convoitées et les négociations houleuses qui s’en suivaient avec les patrons de rafiots pour décrocher le produit au plus bas prix.
Ni les vociférations et coups de gueule impressionnants, les rixes et bastons pour un emplacement, une caisse chavirée accidentellement ou un chariot subtilisé sournoisement. Le brouhaha, l’excitation, l’énervement et les corvées d’après-vente pour livrer les acheteurs, les magasins de marée ou les poissonniers ambulants avant qu’ils ne se trissent et embouquent l’avenue de la Perrière pour aller se jeter un grand crème, un verre de rhum ou de blanc, selon l’ appétence de chacun, avant de gagner leurs points de vente attitrés ou les chemins vicinaux de leurs tournées campagnardes.

Conservé aussi en mémoire la précipitation des navires à quitter à nouveau le port, dans la nuit encore bien opaque, la boucaille ou les vents tonitruants, les intempéries ou les calmes plats, la froidure des hivers pince sans rire ou la moiteur des étés facétieux, pour atteindre les zones de pêche avant le lever du jour.
Pas oublié non plus les ventes de fin de semaine, les samedis surchargés lorsque toute la flottille se retrouvait bord à bord, pour inonder le marché de la manne grouillante et frétillante. Les tonnes débarquées, larguées à prix raisonnable ou bradées, selon l’humeur des acheteurs et les envies de leur clientèle, l’éternel problème de l’offre et de la demande.
La rage aux tripes et l’amertume au cœur parfois de voir le fruit de tant d’efforts et prises de risques finir dans les tinettes ou partir à la congélation pour un prix dérisoire. Mais comment prévoir ? (Je laisse aux gommeux des hémicycles et prétentiards des officines décisionnaires le soin de répondre à cette épineuse question . Ils ont sûrement quelques solutions toutes prêtes dans leurs attachés-cases , genre diminution de quotas ou destruction de quelques navires en sus, en omettant bien sûr d’aborder le problème de la concurrence des produits d’importation en provenance de pays où les marins sont payés à coups de trique pour naviguer sur des rafiots plus pourris que ceux qui se délitent depuis des décennies dans nos cimetières marins).
Emu aussi au seul souvenir de ce vieux qui trimballait son ennui sur les quais, un après-midi que nous rentrions de marée, ce vioque avec ses yeux bleus mouillés , sa voix cassée et son crâne déplumé, qui nous observa longuement avant de se décider à l’ouvrir et tenter d’instaurer le dialogue, posant quelques questions sur l’actualité du métier avant d’ évoquer ses propres années de navigation tandis que nous débarquions notre pêche. C’était un ancien bosco des chalutiers, qu’avait passé toute sa carrière, débutée à 15 ans, terminée à 55, à trimer et morfler dans le nord de l’Atlantique, entre Ouest Bretagne, Ouest Ecosse et Mer d’ Irlande. Un vioque bourlingueur à la carcasse usée par toutes ses années de galère, qui ne parvenait pas à réprimer ses émotions lorsqu’il me racontait son port de Keroman des années 50 et 60, comme « c’était grouillant de vie et débordant d’activités à l’époque », alors « qu’aujourd’hui, c’est tellement triste cette criée craspec et ces bassins sans navires ! » . Ca me touchait âpre ses propos et regrets. Je sais, la nostalgie c’est jugé plutôt nase par les temps qui courent où il est de meilleur ton de sprinter après la rentabilité, sans sentiments ni états d’âme surtout. N’empêche, j’oublierai jamais la conversation que j’eus en cet après-midi d’un certain mois de mai avec le vieux bonhomme nostalgique. Je comprenais tellement bien ce sentiment qui l’étreignait, cette si désagréable sensation de spoliation, toujours le même manque obsédant, la même impression de disparition absurde et le temps qui filoche sans espoir de retour, la vie qui nous fuit et toutes ces choses qui changent ou disparaissent autour de nous, qui mutent ou s’évanouissent pour nous rappeler à quel point nous sommes fragiles et périssables.

Milliers d’heures égrenées à l’horloge de la criée depuis cette brève conversation. Bien des choses ont encore changé. La vente s’est informatisée. Le plus gros des acheminements se fait par camions. Les magasins de marée ont été transformés, modernisés, mis aux normes européennes. L’époque est férue de conformité, d’uniformisation et de normalisation. Honnis, exclus, broyés, soient ceux qui ne peuvent ou ne veulent se fondre dans le moule ! «Inconcevable ! Intolérable ! Comment peut-on tenir propos aussi rétrogrades ? » Beaucoup de navires ont été vendus ailleurs, offerts en pâture aux pelleteuses massacreuses, débités à la tronçonneuse ou au chalumeau, sabordés et coulés en loucedé dans un secteur choisi, sans concertation avec la profession, par les autorités du quartier, abandonnés à la vase des cimetières marins ou déposés sur des ronds-points au milieu de parterres de fleurs et de chiures de piafs citadins. Le vioque doit être mort aujourd’hui et c’est tant mieux pour lui. Il était déjà tant usé, déprimé, pas la tronche ni le cœur à faire un centenaire. Heureux qu’il n’ait assisté qu’au début de l’action de bouleversement et d’éradication .
Adaptés, intégrés, sortis bon an mal an de la marginalité, les survivants de la « filière pêche » ont dû serrer les dents, faire des concessions, s’asseoir sur certaines libertés pour conserver leurs permis de navigation et leurs licences d’exploitation. Restent les plus coriaces et suffisamment passionnés, ceux qui parviennent à oublier toutes les mesquineries et directives iniques pour continuer à naviguer leur vie sur l’océan géant. Ceux qui vivent le présent, sans souci du danger, avec la même passion que ceux qui les ont précédés. Sachant fort bien qu’une fois le port quitté, plus rien ni personne, même le plus pointilleux des inquisiteurs tourmenteurs, ne parviendra à leur pourrir le rêve ni altérer un seul instant leurs plus folles et somptueuses émotions. Une façon de raisonner, d’éprouver, de se comporter, qu’aurait certainement plu au vieux bosco nostalgique.

Coincées entre la coque et le vivier, les couchettes s’imbibent et mouillent leur paillasse à chaque coup de roulis. Les paquets de mer et les embruns roublards, s’immiscent, pénètrent partout, sous les cirés, les vareuses, les pulls, les jeans et les sous-vêtements, s’écoulent le long des corps transis, assiègent le poste-avant, glissent sur les barrots de pont, imprègnent allègrement les duvets, les couvertures, les frusques de rechange et les taies bricolées.
Trempées, salées, craquelées, violacées, les chairs exsudent à leur tour leur excédent d’humeurs et de douleurs muettes. Trop exténuées pour se défaire de leurs enveloppes de toile et de tissus grossiers, ratatinées comme des sardines dans la saumure, usées, blasées, elles frémissent brièvement avant de s’écrouler dans l’humidité, les effluves de fond de cale et la froidure intruse qui investissent leur couche.

Le crépuscule dissout toutes les esbroufes et tracasseries de la journée. Contrairement à tous ces gens qui redoutent l’ombre et l’opacité des nuits sans lune, il me plaît de naviguer à l’aveuglette, de tâtonner de l’étrave dans la vague fantôme qui vient froufrouter du suaire contre la coque errante, de sentir, pressentir, deviner, imaginer l’espace et me l’approprier sans aucune influence, le gérer à ma guise et contrecarrer au débotté.
Excitant aussi d’être bigleux lorsque tout s’agite et bourbouille dangereusement autour de soi. Plus angoissant pour certains, plus fascinant pour d’autres. Tant qu’à se colleter avec le spécieux des éléments, autant le faire dans les plus enivrantes conditions.
L’agressivité et la furie de mer trempées dans le brou de la nuit , n’ont plus les mêmes prestance ni transparence. Plus sournoises, plus insidieuses, elles peuvent paraître encore plus redoutables, ou captivantes, selon la façon que l’on a d’apprécier les qualités de la prestation.

Refouler toutes les aigreurs et amertumes passées. Se refaire un faciès, une dégaine, une démarche, un discours, une devanture, une manière d’être et de se reconstituer dans l’ailleurs farouche, juste pour pouvoir s’accepter et s’immiscer de temps à autre dans le moule ridicule de la conformité.
Après des années d’efforts et d’inconfort, de mistoufles et d’effritements, des marées de violences et d’écoeurements , d’émotions et de fascinations, avec tout le lot de petites joies dérisoires et de sentiments d’accomplissement poilants. On a eu beau dire et gémir, hâbler et s’emporter, médire et maudire, c’est pourtant sur la mer, seulement là, qu’on a pu goûter au chiche bonheur de se sentir entier. Pour vivre, pas mieux mais différent.
N’importe quel soliloque étranglé par le temps, le cri d’intempéries aux mœurs dissolues, l’hululement des vents et l’obsédante harangue du flot intransigeant.
N’importe quelle méditation sabotée par la clameur des orages gougnafiers, la méchante mélopée des nues exacerbées, le swing des ciels de grêle, le rut des foudres et des antiennes, les crissements, craquements, claquements de tons des ondes et des ondées, le tempo délirant des forces subversives.
N’importe quelles sensations affectées par la hardiesse des agressions, l’ampleur des dépressions, l’afflux de haute tension et le chahut énervant.
N’importe quel pet de plombs possible en n’importe quelles conditions de ciel et d’océan. Juste dit pour obtenir un chouia d’attention et de compréhension. Pour ne plus subir seul n’importe quelle déveine, naufrage ou débine de sentiments.

Lorsqu’on se trisse vers un ailleurs c’est toujours avec l’espoir de trouver un brin de bien-être ou de plénitude en sus, du moins quelque chose qui pourrait y ressembler, comme une espèce d’équilibre, de sérénité à deux balles, susceptibles de combler nos lacunes et lézardes existentielles .
Lorsqu’on se lance dans l’aventure, décide de tout laisser derrière soi pour entreprendre le voyage, on a toujours cette naïveté d’y croire. On imagine et magnifie. On occulte la fatigue et les embûches, se débarrasse de l’anxiété pour se berlurer le méningé, ne plus voir que le choucard côté des choses, les belles miches de la vie nouvelle qui nous attend à l’arrivée.
Lorsqu’on met son sac à bord d’un rafiot de pêche, c’est aussi pour se payer une bonne tranche de dépaysement, une espèce de dinguerie, de folie furieuse, susceptible de nous faire oublier tous nos emmerdes existentiels. On pourrait, à condition de ne pas craindre de passer pour un vantard ou un débile profond, comparer aussi cet embarquement-là à une espèce de quête d’évasion, de plénitude, avec quelque âpreté en sus, juste pour le fun et la beauté du geste.
Même le cerveau méchamment secoué et arrosé, ça reste quand même une somptueuse expérience, à condition qu ‘on ait suffisamment de résistance et d’obstination pour continuer à s’en persuader. L’illusion grassement nourrie pour triompher du maousse blues aqueux, c’est pas pour rien qu’on entretient la chose, qu’on continue à se leurrer et sublimer envers et contre tout. La seule façon sûrement de ne pas être définitivement largué.

Baratin du tintouin mutin dont il est de bon ton de s’extasier lorsqu’on a les pieds au sec et le cul bien calé dans le moelleux d’un canapé sis derrière la baie vitrée d’une villa ou la banquette d’une bagnole aux essuies-glaces actifs garée sur un parking du bord de mer.
Et aussi la démesure, le chaos hystérique projeté grandeur presque nature dans les cerveaux confits. Une salle obscur ou un écran de téloche, rien de tel pour se fader le grand frisson, le pif bien carré dans l’haleine d’infini et les châsses enchâssées dans le décolleté des vagues siliconées.
L’aventure à portée de main et d’esprit, par l’entremise de quelques clichés et scènes de pêcheries mouvementées. Décor ad hoc pour frimeurs en quête de sensations fortes. Rêveurs, chabraques mais pas téméraires, toujours en mal de sensationnel virtuel.
Le culte du héros ordinaire, le type un peu brindezingue, qui se collète avec un univers hostile, ça fait ardemment saliver, s’extasier les illuminés, beaucoup moins ceux qu’ont réellement endossé la défroque du fêlé.

Entretien avec Slaheddine Haddad publié le 30 septembre 2004 dans le quotidien tunisien Le Renouveau.
S.H. - En avant-propos de votre Carnet de bord, IKARIA LO 686 070, on peut lire les lignes suivantes : « puisse ce mince témoignage vous permettre de découvrir et connaître un peu mieux cet univers qui fut le mien durant toutes ces années, et le demeurera tant qu’il me restera une goutte de sang iodé pour faire naviguer le cœur en cet étrange et fascinant ailleurs »
C’est toute une vision du monde que vous nous révélez et on a comme l’impression que dans une mer le ciel n’est pas le seul à se refléter ?
A.J. - Oui, c’est toute une vision du monde, plutôt d’un monde, si peu ou mal connu, que j’ai voulu faire découvrir au lecteur, en relatant les faits et gestes, les attitudes et âpres aptitudes d’un univers mouvant et diantrement émouvant, fait de tumultes, d’affrontements, de douleurs et de violences, de fracas et de turbulences, mais aussi, de temps à autre, de bonaces, de quiétudes, de bonheurs paisibles et de sérénité suave, un monde qui, tour à tour, bouillonne et vitupère, s’exalte et exulte, roule et houle, miroite et ondule, chamarre et réverbère, pactise ou exaspère, loin les cités et le staccato des mouvements de la vie ordinaire.
C’est « cet étrange et fascinant ailleurs », ces étendues marines de l’Atlantique Nord, avec leurs frasques tempétueuses et sautes d’ humeur fréquentes, et toute la fascination qu’elles font déferler dans le cœur des hommes qui sont assez fous, passionnés et téméraires pour y fourvoyer leur vie, qui font la matière première de ce livre.
S.H. – Ce qui frappe dans vos écrits, c’est cet amour démesuré pour les choses et les hommes de la mer que la houle n’arrive pas à défaire.
A.J. – La résistance, autant physique que mentale, la maîtrise de soi et l’obstination sont les qualités primordiales dans notre métier, aussi le respect et la conscience permanente de la puissance des forces qui nous entourent. Il n’y a aucune chance de survie dans ce boulot sans un minimum d’humilité. C’est tellement disproportionné ! Il faut savoir se faire accepter, tolérer, par le flot. Pas de fanfaronnades ni d’esbroufe, surtout pas ! C’est une histoire de passion et d’attraction entre l’homme et l’élément, deux natures résolument ardentes et solitaires qui se confondent dans le fracas et la démesure.
On ne gagne jamais contre la mer, on observe, on soupèse, on évalue, on négocie, on agit et manœuvre du mieux qu’on peut et c’est toujours elle qui décide de l’issue de la partie. Lorsqu’elle veut engloutir et défaire, rien ni personne ne peut l’arrêter ni se soustraire à son étreinte meurtrière. Elle peut être particulièrement cruelle, implacable et injuste, et c’est à nous de composer et réagir en conséquence, à nous de nous adapter pour durer.
S.H. – Cette alternance entre la pêche et l’écriture (deux activités complémentaires) a été rompue depuis quelques mois puisque vous avez décidé de quitter une mer qui elle, ne vous a point quitté. Comment vivez-vous ce semblant de divorce ?
A.J. – Je ne pense pas qu’on puisse comparer ma cessation d’activité professionnelle à une espèce de divorce entre la mer et moi. J’ai seulement cessé de naviguer à la pêche, mais ne me suis pas éloigné d’un pouce du rivage qui m’a vu naître. Trop accro à cet environnement-là pour parvenir à respirer et exister ailleurs.
C’est très éprouvant ce métier, physiquement surtout. Le corps souffre de tous ces frimas, intempéries, coups de tabac, qu’il subit inexorablement. Au fil des années, la charpente craque et les articulations ont de plus en plus de mal à remplir leur fonction, le moindre effort peut se transformer en véritable calvaire. Passé le cap de la cinquantaine peu sont ceux qui peuvent se targuer de ne point souffrir de cette oxydation de la carcasse. Comme les vieilles coques, nos abattis rouillent et se détériorent sous l’effet de la corrosion, des embruns et des vents.
L’esprit aussi est souvent mis à rude épreuve. Non seulement la tension permanente causée par le poids des responsabilités à bord, la tenue du navire et la sauvegarde de l’équipage, le choix des zones de pêche, l’importance des captures à assurer pour préserver la rentabilité de l’entreprise, mais aussi le bras de fer constant avec les administrations et organismes communautaires européens, les contrôles en mer et à la criée, les décrets et directives iniques et inappropriés, ont eu raison de mes enthousiasme et détermination. Après une trentaine d’années consommées sur le flot déjanté, il m’a paru plus judicieux de jeter l’éponge que de m’obstiner à poursuivre une aventure exténuante qui m’apportait désormais plus de tracas que de joies.
Je m’investis un peu plus dans l’écriture à présent, tout en conservant un œil sur l’océan qui roule et gronde immuablement sous mes fenêtres.
S.H. – Prendre le large, c’est comme aller au front, pourtant il doit exister une différence, un sens ?
A.J. – A chaque nouvel appareillage, lorsqu’on largue les amarres pour gagner le large, comme l’environnement nos sentiments varient selon les saisons. Ce sont les conditions météorologiques et l’état de la mer qui déterminent l’état d’esprit de l’équipage.
En hiver, il est toujours difficile de devoir tout quitter pour aller mettre son existence en péril dans la nuit froide et venteuse, aller se colleter avec un océan particulièrement irascible et violent, mais une fois le cap affiché, le port laissé loin derrière, les souvenirs de quiétude et de confort estompés, lorsque l’étrave pioche dans la vague énervée, ce sont toujours l’excitation et le désir de surpassement qui reprennent le dessus.
Je n’oserais comparer la mer à un champ de bataille, car les risques de s’y faire tuer sont tellement moindres ! Au front, la mort peut survenir de n’importe où et à tout moment. Sur l’océan, même dans les pires conditions, lorsqu’on a suffisamment d’expérience et de vivacité, il est toujours possible de pressentir le danger, de voir venir la déferlante assassine, et de faire l’impossible pour lui échapper. En mer, il y a la vie, fougueuse, intempestive et majestueuse, qui peut de temps à autre se révéler dangereuse. Au front, il n’y a que la mort, sinistre, sournoise et répugnante.
S.H. – Toujours dans ce carnet de bord, vous dites : « La mer est une femelle exclusive et démonstrative, aguicheuse et embobineuse, embosseuse et dévoreuse. (p.43). Elle nous suce les sangs, nous vampirise et se nourrit de toutes nos forces vives ». En terminant la lecture du carnet de bord, on a quand même cette vive impression que la mer est plus que prenante pour le pêcheur que vous êtes, ne laisse aucune alternative ?
A.J. – Je me permets de comparer la mer à un personnage féminin, un être particulièrement présent, exclusif, absolu et véhément, parce que c’est ainsi qu’elle m’est toujours apparue. Lorsqu’elle m’a mis le grappin dessus, j’ai compris que c’en était fini de mes ternes insouciances et libertés factices. Pas de demi-passion possible, à la vie-à la mort dans la beauté sublime de ses galbe et rondeurs, ou le minable ennui dans les paysages mornes, frigides et figés de quelque campagne ou cité. J’avais le choix des épousailles, mais la mariée était si séduisante que je n’ai pas hésité un seul instant à m’embarquer avec elle. C’était la plus folle décision que je puisse prendre , mais je ne l’ai jamais regrettée.
S.H. – Qui est Alain Jégou, un pêcheur-poète ou un poète-pêcheur ?
A.J. – Et un pêcheur-pécheur aussi bien sûr, puisque avant tout humain parmi les humains, frère de tourments et de douleurs de tous les êtres égarés dans la folie des temps, luttant pour leur survie sur tous les continents et toutes les mers de la planète Terre.
22:45 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (2)
09/06/2007
51 32 00 > 51 25 00 > 51 14 00…
Passe Ouest suivi de Ikaria LO 686070
de Alain Jégou aux éditions Apogée
Pour recevoir le bon de commande cliquez sur Bon jegou.pdf
Derniers ouvrages publiés par Alain:
Qui contrôle la situation ? éd. La Digitale, 2005
Juste de passage (paso por aqui), éd. Citadel Road, 2005
Symphonie érotique, éd. Fibres Libres & L'Autre Rive, 2005
Gracias a la vida, Ed. Le chat qui tousse, 2004
Totems d'ailleurs, ed. Le Dé bleu
Comme du vivant d'écume, ed. La Digitale
Paroles de sable, ed. La Digitale
Ikaria LO 686070, ed. Travers
Kerouac city blues, ed. La digitale
La piste des larmes, ed. Blanc silex
Jack Kerouac et la Bretagne, ed. Blanc Silex
Chair de Sienne, ed. Cadex
Flüchtige Schatten - Ombres furtives, ed.AVA
- Audernach (Allemagne)
42 07 00 > 42 12 00 > 42 20 00…
Par Alain Jégou

Dans les bannettes, ça pionce et ronfle saccadé, au même rythme que celui du clapotis frappant la coque dévergondée. Les effluves de rêves, de cœurs et de corps, traversent le pont par la même voie d’aération. Curieux mélange qui se fond et disparaît dans la fraîcheur matutinale de l’air.
Quelques goélands, installés confortablement sur l’enveloppe du Bombard ou agrippés à la rambarde du gaillard, tels des véliplanchistes à leur wishbone, houppette au vent et œil perforant la bulle d’horizon , se font véhiculer gratos. Pas de petites économies d’énergie pour ces feignasses notoires, même pas caps de plonger et de chasser eux-mêmes pour se remplir la panse. Plus fastoche de cueillir les boyaux et les rejets de captures hors taille, les déchets d’après virage, triage et étripage, que de se mouiller le plumage pour courser les bancs de sprats, de sardines ou d’anchois, comme le font ces « abrutis » de Fous de Bassan, de macareux, de Guillemots ou de cormorans.
De sacrés malins, les goélands ! La preuve : déjà quelques minutes avant que ne soient entamées les manœuvres de virage, avant que l’équipage n’ait fini d’enfiler ses cirés pour se pointer sur le pont, on les voit rappliquer, surgir de nulle part, s’exciter et piailler autour du navire, comme s’ils avaient pressenti l’action et flairé la curée. Pas encore né le zig qui parviendra à élucider le mystère, à leur faire cracher le morceau, à percer le secret de leur curieux don de prémonition. Pas né non plus celui qui parviendra à leur claquer le beignet afin qu’ils cessent enfin de godelurer dans la mature et de nous chier sur le caillou en caquetant de plaisir lorsqu’ils sont rassasiés.
Les feux de poupe et projecteurs de pont des autres rafiots de la flottille bringuebalent à quelques encablures. Ca clignote et papillote au rythme du tangage et du roulis, agresse la pupille et éblouit celui qui suit.
La manne attend dans les fonds endormis. Dès les premières lueurs de l’aube, les premiers rayons suffisamment fringants pour pénétrer et perforer l’onde jusqu’au tréfonds, elle sortira de sa léthargie, s’extirpant de l’ombre rocheuse ou de la gangue de vase, pour se dégourdir les pinces, la carapace ou les écailles, aller goûter aux joies du jogging sous-marin et se payer ensuite une copieuse tranche de plancton en guise de petit déj . Le premier qui collera en pêche, juste avant le jour, sera le mieux placé pour accueillir dans son piège tout ce petit monde gracile et frétillant.
Il fait bon fendre l’écume en cette nuit finissante, avec pour seul souci de faire le choix du creux où filer l’outil de travail pour entamer la longue journée. Une décision qu’il faut prendre seul, en espérant qu’elle sera bonne. Juste une histoire de pif et d’expérience. Balancer l’attirail vite fait avant de confier la barre à l’homme de quart et de sauter à son tour dans les bras de Morphée.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Le vent propage sa hargne dans le ciel malléable, sème sa zone, violente l’espace et secoue le pucier des ondées lunatiques. Il gribouille des éclairs sur la peau de la mer, tord le cou aux nuages, fait voler de l’écume au cul des satanics et trifouille dans les chairs de la houle résiduelle pour réveiller ses spasmes et sursauts outranciers.
Les vagues, ivres de courants d’air, aussi exubérantes qu’une bande de crevettes en goguette, s’égayent dans tous les sens, se bousculent et s’enchevêtrent, se mêlent les pinceaux et se ratatinent la crête sur l’étrave des navires, en pêche ou à la cape.
Le paysage giflé, boxé, dérouillé par la clique hystérique, mute et chamboule sous les yeux blasés des matelots éreintés. Emmitouflés dans leurs cirés, la clope aux lèvres et les pieds bien calés contre les planches de parc, certains attendent l’abordage du pavillon, d’autres l’arrivée des panneaux ou le largage du cul. D’autres encore, que le grain passe pour crocher dans la bouée ou lovés dans leur couchette, que l’accalmie revienne pour recoller en pêche.
Les forces conjuguées de la mer et des vents imposent leurs lois aux hommes des équipages. A chaque patron de savoir jusqu’où il peut aller, jusqu’à quelle force son rafiot résistera, à quel moment il deviendra urgent d’aller chercher l’abri des côtes ou de mettre à la cape pour se préserver du pire.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Les visages d’aucuns sont comme des cartes marines, lardés de failles, de crevasses et de ridules ombrées. Grêlés de cratères et récifs efflanqués ou parsemés de platures au galbe lisse et gras.
Dans le grain et les nuances des zones de transparence, le réseau des veinules et des nervures, sinueuses comme des lignes de fonds, on peut lire et découvrir tout l’univers des troubles et turbulences, le calque des sentiments concrétisés au fil des expériences, les paysages poignants modelés par quelques milliers d’heures de trime, d’inquiétudes et de fatigues immenses.
Morsures des vents et des froidures. Brûlures du sel et du soleil. Eraflures, boursouflures, balafres et scarifications. Pigmentation étrange des traits. Toute l’œuvre plastique issue de l’action des éléments et du tirage des émotions.
Trou de l’Insécurité, Mer de l’Intranquillité, Basse de la Culpabilité, Pic de la Désolation, Plature des Meurtrissures, Coursive de la Colère, Vasière des Rancoeurs, Plateau des Griefs, Récif des Regrets… Tout un inventaire, aussi étrange et fascinant que n’importe quelle carte hydrographique ou plan de sédimentation, affiché sur les chairs des racleurs d’océan.
09:15 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (0)
22/05/2007
Chardons bleus (extrait )
Dans le désarroi de n’avoir nul lieu d’où naître
Il faut à chaque heure justifier sa légitimité.
Découvrir au-delà de la forme les multiples sens
De cette parole qui n’en est plus une.
Quand le vent dessine des risées sur la surface des flaques.
Vivre paria et se maintenir vivant, tant que possible
en courbant l’échine sous un suaire invisible,
ni de sang ni de heurts, mais de mots
presque imperceptibles comme autant de flagellations.
De l’errant les haillons et du lépreux le regard.
Juste de l’autre coté de la rue, la banlieue
où la langue apprise y a l’amertume insolente
La soif du monde n’en est pas moins intense.
Vos crachats sont utiles, ils donnent l’acuité
Et cette si particulière brûlure de lucidité,
Ce ne peut être que l’affrontement contre la plénitude
dans ces visions si étranges de ce ghetto
où l’enfermement est dehors.
21:50 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (0)
20/05/2007
Voyage au bout du monde....

Photo: Bénédicte Mercier
Dans le café chez Raymonde le tube cathodique déversait son flot d’informations et son quotidien d'oiseaux mazoutés, de guerres, de catastrophes. La conversation continuait de plus belle, car rien de tout cela ne peut avoir de l’importance.
-C’est encore le pape à béquilles qu’est pas bien…
-Non à mobiles…
-J’y arriverais jamais à me souvenir…
-Alors, la ramène pas tout le temps.
-Il sent de plus en plus le sapin, le pape, dit son voisin…
-C’est pas drôle !
-Non mais t’en as déjà vu un rigolo toi ?
-Le pape, il est contre l’avortement, renchérit un autre qui semblait vouloir s’imposer dans la conversation.
-C’est normal, on fouille pas dans le sac à main des dames, lui rétorqua-t-on du bout du bar.
Un Monsieur du bar s’écria comme s’il était en colère : Si c'est dieu qui à créé l'homme; il s'est bien foutu de sa gueule! T’imagine ça il a même fait l'homme l’égal de la femme. Moi personnellement qui vous cause je suis pour l'égalité des sexes.
-Oui mais, quel dénominateur commun?
-En tout cas je trouve le mien bien comme il est… Et toi ?
-Je sais pas, je l’ai pas vu...
-Mais ce que tu peux être con…
-Il falloir qu’on leur mesure le clitoris et qu’on leur pèse les ovaires, pour savoir si la femme est l’égale de l’homme…
-Et inversement!
-Pas légal, létal!
-Toi tu causes sans savoir ce que ça veux dire.
-J’ai fait des études moi monsieur, je suis allé aux grandes écoles
-Mais t’es sorti par la petite porte.
-Où il vont chercher toutes ces conneries?
-Dans la boîte à sucre avec le peigne…
Un monsieur était devant son demi et regardait les bulles monter à la surface
-Moi je dis que c'est en pétant dans l'eau que les têtards ont inventé la limonade!
-OOOOOOOOOOOh! Ça c’est une trouvaille.
-C’est Einstein qui a découvert la loi de la relativité mais on n’a pas eu besoin de ça pour découvrir Robert?
-C’est pas Robert c’est Albert !
-Non Robert c’est le nom du monsieur qui a mis des têtards dans sa limonade…
Puis une histoire de pédophilie aux informations
-Avec toutes ces conneries qu'on entend, maintenant quand les gamins sortent des écoles, je vérifie que mon imper est bien boutonné!
-Violer des mômes; c'est enfantin!
-Ah toi t’es vraiment drôle. Si, si, je t’assure.
Un partisan de la peine de mort: faudrait les zigouiller ces fumiers pour leur apprendre à vivre!
Et ça continuait pendant des heures. De la parole inutile, pour jongler avec le rien ou le néant. Qu’importe, alors... Il savaient qu’ils n’iront pas plus loin que ce bout de comptoir en formica seul lieu où quelqu’un peut faire attention à eux. La solitude en bandoulière, et le silence à jamais refermé sur eux.
21:15 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (1)
19/05/2007
J’AI JAMAIS CRISPE PERSONNE.
Par Mouloud Akkouche

Les illustrations sont de Yves Budin qui vient de publier aux carnets du dessert de lune Visions of Miles
Mon portable frétilla sur le guéridon.
- Jo à l’appareil.
- C’est Dominique, tu es où ?
- Au téléphone…
- Non, je rigole pas. J’ai eu les organisateurs qui t’ont attendu à l’aéroport.
Chargés comme des mulets, un groupe de scouts s’installa bruyamment sur ma droite.
- Je suis arrivé en avance, je suis à Cahors.
- Qu’est-ce que tu fous à Cahors ?
- Je bois un demi.
- Appelle les tout de suite !
- Le festival commence dans une semaine, on a le temps.
- Non, je te connais quand tu pars en vadrouille…
Un sourire en coin, je secouai la tête.
- A 72 ans, j’irai pas loin.
- Arrête tes âneries, ils vont venir te chercher et t’emmener à l’hôtel.
Ce jeune con commençait à vraiment m’agacer. Chaque fois qu’il me parlait, j’avais l’impression qu’il s’adressait à un gosse de 12 ans. Et toujours avec son putain d’accent snob. Pas à mon âge qu’un branleur allait me diriger.
- Je serai à l’heure au concert, le reste c’est mon problème.
- Joe, tu me crispes avec tes caprices…
- Toi, tu me gonfles !
Et je coupai mon portable.
Pour qui se prenait-il ? La maison de prod me l’avait collé depuis une année aux basques et, sans rechigner, j’ai tout accepté de ce petit requin aux dents longues qui connaît que dalle en Jazz. Il me voit juste comme un paquet de lessive à vendre aux plus offrants. Il m’a même engueulé une fois parce que je m’étais soûlé au bar d’un grand hôtel. A mon âge, je peux faire ce que je veux quand même. Je le crispe, c’est la meilleure celle-là. C’est bien le premier qui me dit ça en 72 ans. Je vis seul depuis des lustres, ne vois que les gens que j’aime bien et ne fais que les deux seules choses qui me plaisent au monde : chanter et gratter ma guitare. Au moindre ennui ou lourdeur du quotidien, je me carapate pour ne me consacrer qu’au bon côté de l’existence. Qui voulez-vous que je crispe ? Faut du temps et de la promiscuité pour crisper quelqu’un, et sans doute un peu moins d’égoïsme. La seule femme avec qui j’avais vécu plus de trois mois m’avait jeté à la face: Jo, tu ne penses qu’à t’amuser, tu finiras comme un vieux gosse ridé. Elle n’avait pas tort. Le soir même de sa constatation, je faisais ma valise… et ma brosse à dents n’a jamais plus eu de compagne.
- Encore un demi, s’il vous plait.
Mon Stetson sur la tête, je traversai peu après Cahors dans la voiture de location.
***
Ca m’a pris d’un seul coup, j’ai eu envie de me prendre quelques jours avant mon concert à Souillac, le temps d’une balade dans cette région… Celle de mes premiers pas de Jazzman en Europe. Débarqué en 1954 des Etats-Unis, la première personne qui m’a tendu la main fut un étudiant en médecine qui organisait un festival de musique à Marsauliac sur Célé. Mon premier concert solo avait eu lieu dans une grange retapée: devant 15 personnes. Un soir, j’avais fait la connaissance d’une jeune fille de mon âge vivant à une dizaine de kilomètres plus loin. Après un mois collé ensemble presque nuit et jour, je devais remonter sur Paris pour signer un contrat avec une maison de disques. Malgré mon insistance, elle n’avait pas voulu me suivre. Par trouille ? Ou peut-être réellement à cause de ses études de comptabilité ? Je lui avais laissé l’adresse de mon hôtel, elle ne m’avait jamais écrit. Deux ans après, j’avais téléphoné ; une voix féminine m’avait annoncé que Martine était morte dans un accident de voiture.
Comme conservé sous une bulle à l’abri du temps, je retrouvai le même village qu’un demi-siècle auparavant. Excepté les piscines et les panneaux de signalisation.
Je me garai sur la place des Platanes et me dirigeai vers l’un des deux bistrots. Concentrés, de nombreux boulistes participaient à un concours dont les lots gagnants étaient égrenés par une voix provenant de haut-parleur.
Une serveuse vint prendre la commande.
- Une Suze.
Avec le recul, je me demandais comment un gosse de Chicago avait pu atterrir dans cet endroit paumé, surtout en 1954. Pour faire pleurer les journalistes parisiens friands de misère clef en main, je m’étais inventé une bio mâtinée de Cosette et de Sans famille. Mi-Noir mi-Italien, j’avais vécu toute mon enfance dans un quartier de la classe moyenne, très éloigné des immeubles lépreux où s’entassaient les familles les plus pauvres. Elevé par ma mère-coiffeuse dans un salon chic, je n’avais jamais eu à souffrir de la faim ou de la violence. Faut dire que mon père, avocat connu dans la région, versait une bonne pension à ma mère pour que personne n’ait vent de mon existence. Habitant la même ville que lui, je ne l’avais jamais rencontré et, malgré mes nombreuses demandes, ma mère refusa toujours de me donner son identité. En triant ses affaires après sa mort, j’étais tombé sur la photo de mon géniteur. Ce jour-là, je compris pourquoi il n’avait jamais voulu me voir, c’était un avocat ultra-conservateur qui avait défendu plusieurs membres du KKK. Il aurait été abattu par un commando des Black Panther.
Après une balade dans le village et au bord du Célé, je décidais de rejoindre Souillac, histoire qu’il ne croit pas que l’invité vedette leur ai fait faux bond.
Au moment d’ouvrir ma portière, j’aperçus un groupe de jeunes assis sur le bord de la fontaine. L’un d’eux, âgé de 17-18 ans, portait un bracelet coloré qui attira mon regard.
- Tu as eu ça où ?
Il me dévisagea froidement.
- On se connaît pas.
- Tu l’as eu où ce bracelet ?
Il vrilla son index sur sa tempe.
- Il est bargeot le vieux. Faut pas picoler quand on tient pas.
Il démarra son scooter. Les autres l’imitèrent aussi. Sauf une ado secouant la tête au rythme d’un baladeur.
- Eh !
- Ouais, fit-elle en ôtant ses écouteurs.
- Tu connais le garçon qui porte un bracelet bi-colore ?
- Marc, ben ouais.
- Il habite ou ?
Elle haussa les épaules.
- Il squatte par-ci par-là quand il s’engueule avec son père et… Comme il se prenne la tête tout le temps….
- Il habite où son père ?
Elle tendit le bras.
- Là-haut : à Caniac du Causse.
***
Accueillis par les aboiements des chiens, je criai plusieurs fois avant que quelqu’un ne pointe son nez. Vêtu d’un jean et d’un Marcel, un homme rondouillard s’approcha de moi avec un air méfiant. Il ôta sa casquette.
- C’est pourquoi ? demanda-t-il avec un accent rocailleux.
- C’est au sujet… Vous avez bien un fils ?
Il leva les yeux au ciel.
- Malheureusement.
- Je voudrais vous…
- Qu’est-ce qu’il a fait encore ?
Mal à l’aise, je triturai mon chapeau.
- C’est à dire que…
Il s’épongea le front.
- Vous êtes pas le premier à se plaindre de lui… Autant le faire au frais.
D’un geste, il me demanda de le suivre.
Le seuil à peine franchi, je crus que mon cœur allait lâcher. Sans attendre les formules d’usage, je m’assis. La table était encombrée de Dépêches du Midi et de revues agricoles.
- Vous êtes tout pâle. Qu’est-ce qui vous arrive ?
- Vous avez de la gnole ?
-…
- Donnez-moi un verre s’il vous plait.
Sentant que j’étais très mal, il me servit un petit verre de prune que j’avalai d’un trait.
- Ca va mieux.
- Bon, c’est pas que je m’ennuie mais j’ai du boulot. Qu’est-ce qu’il a fait alors encore comme connerie ?
- La photo là…sur le mur… c’est…. c’est à vous.
Il esquissa un sourire.
- Ben sûr : c’est ma mère.
Sous son œil agacé, je me resservis un verre.
- Vous êtes né quand ?
Je sentis que mes questions commençaient à l’agacer. Sans mon grand âge, il m’aurait foutu à la porte depuis longtemps.
- En 55.
Après nos explications, nous restâmes un très long moment silencieux, troublés par cette brutale intimité : un père et un fils se retrouvant pour la première fois sous le regard d’une femme morte. Chaque fois mes yeux se posaient sur elle, je me demandais ce qu’elle aurait pu penser de cette situation. A un moment, j’ai eu l’impression de la voir sourire… Un des effets de la gnole.
- Je sais pas quoi dire.
- Et moi donc.
Il ne cessait de secouer la tête.
- C’est incroyable.
- Elle ne vous avait jamais parlé de moi ?
- Non mais… Il y a une vingtaine d’années, j’ai nettoyé tout le grenier de la ferme… Putain con ! Mon grand-père avait un de ces bazars.
Il se roula une cigarette avant de reprendre :
- J’ai trouvé un paquet de lettres qu’elle vous avait écrit… Elles étaient toutes retournées avec écrit dessus le destinataire n’habite plus à l’adresse indiquée.
- Quelle était l’adresse ?
- Je crois un hôtel à Pantin.
Quand j’étais remonté en septembre 54, le patron de l’hôtel meublé avait mis mes affaires sur le palier et demandé de déguerpir à cause des impayés.
- Je ne savais pas qu’en revenant ici, tout ça me reviendrait à la gueule.
- Ah ! Le v’là ce saligot. Il va m’entendre.
Par la fenêtre, je vis son fils, mon petit-fils, garer son scooter devant une grange. Nous descendîmes rapidement le chemin qui y conduisait. Le paysan en avait gros sur la patate. J’allais assister à ma première scène de famille.
- Je vais lui en coller une !
Soudain, j’entendis le son d’une batterie.
- C’est quoi ça ?
- Y fait du bruit avec son truc là ! Y sais faire que ça, un jour, je vais lui balancer dans la mare.
Il fila un coup de pied dans la porte.
- T’as une convocation des gendarmes !
- J’ai rien fait, moi.
- Ouais c’est moi peut-être qui ait mis des chaînes aux portes de la gendarmerie.
Je réprimai un rire.
- Tu vas en prendre.
D’un geste, je lui attrapai le bras.
- Calmez-vous !
- Qu’est-ce qui fout là cui-là ?
Comme si mes révélations venaient juste de faire leurs effets, il dévisagea tour à tour son fils et son père.
- C’est ton Grand-Père.
Il éclata de rire.
- Les vieux, faut vraiment arrêter la picole.
Instinctivement, je lui en retournai une.
- M’appelle plus jamais le vieux !
***
Le lendemain matin, après une soirée ou nous avions arrosé nos re… trouvailles, nous déjeunions ensemble. Je ne cessai de triturer le bracelet que Marco m’avait rendu. Une babiole offerte un demi-siècle avant à Martine.
Mon portable sonna.
- Joe, j’écoute.
- Qu’est-ce que tu fous ?
- Je serai à Souillac en début d’après-midi.
Je fermai mon portable.
- C’est mon manager, il est un peu pot de colle.
Je me plantai devant la fenêtre de la cuisine.
- Marco, je voudrais te demander un service…
Il garda la tartine suspendue au-dessus de son bol.
- Quoi ?
Je me raclai la gorge.
- Je voudrais que tu montes sur scène avec moi…
Son père éclata de rire.
- N’importe quoi, il sait rien foutre ce gosse.
- Qu’est-ce t’en sais, toi à par le bal du village, tu connais rien d’autre. T’as jamais bougé de ce bled !
- Ca suffit tous les deux. Tu peux me croire, ton fils à du talent.
- Dans ces métiers, il y a que des….
- Laisse-le tenter sa chance au moins.
Marco dévisagea son père qui baissa les yeux.
- D’toute façon, il est majeur, y fait c’qui veut.
- Tu me dis oui ou merde, je pars dans un quart d’heure.
Il lâcha la tartine dans son bol.
- C’est O.K !
Une demi-heure plus tard, nous étions tous trois devant la bagnole. Mal à l’aise, aucun n’osait briser le silence. Comme un con, je tendis la main à mon propre fils en lui promettant de revenir et m’installai derrière le volant.
- Marco, t’as pas oublié tes papiers.
- Non.
- Et ton portable ?
- Oui.
- Tu reviens à la fin du concert, j’ai besoin de toi pour le champ du bas et pour abattre le Marronnier. Fais gaffe à ton fric.
Marco leva les yeux au ciel.
- Papa, tu me crispes.
- Je sais, je sais, je suis un père emmerdant…. Allez, viens que j’te fasse la bise mon affreux jojo.
Avec une pointe de jalousie, je les regardai s’embrasser sur les joues et échanger un regard traversé d’une affection retenue. Crisper quelqu’un a du bon parfois… A cet instant précis, je ressentis un irrépressible regret, la certitude d’avoir oublier l’essentiel. Pas le moment de lâcher ma p’tite larme, mon public m’attendait à Souillac.
- Vas-y le fiston et m’fait pas honte. Je vais surveiller la télé, voir si tu y passes. Fais gaffe à toi.
Sur la route, je souris en pensant à la gueule de mon manager. Une bonne farce du destin que cette nouvelle recrue.
Si vous voulez connaître les oeuvres de Mouloud Akkouche CLIQUEZ ICI

22:45 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (1)
12/05/2007
Abed Azrié

Par Isabelle Jacq
Présenter Abed Azrié, c'est avant tout évoquer la beauté de sa voix . Abed Azrié est un chanteur à la voix profonde, chaude et sensuelle. Si proche de nous, jusqu'au point de nous révéler à nous-même, comme un souffle bienfaiteur, son chant régénère et procure une incommensurable joie intérieure. Né à Alep, au confluent de l'Orient et de l'Occident, Abed Azrié s'installe en France où il vit désormais .Sa musique rassemble les instruments traditionnels de ses origines orientales auxquels il adjoint des instruments occidentaux. Ses compositions contemporaines font renaître les grands poètes de langue arabe, le mysticisme du plus grand théosophe de l'islam: Ibn Arabi, et les muwwashahat, ces merveilleux poèmes andalous du 11è siècle. Son travail est une évocation permanente d'une mémoire spirituelle orientale. Dans l'album intitulé " l'épopée de Gilgamesh", Abed Azrié remonte à l'origine de l'humanité et nous rapporte, au travers son chant, la plus ancienne trace écrite d'épopée qui contient en germe les mythes fondateurs de la plupart des religions. Gilgamesh est ce héros démesuré de la mythologie sumérienne qui , face à la peur de la mort, cherchera toute sa vie le secret de l'immortalité. A travers son chant, Abed Azrié nous dévoile la profonde modernité de ce récit mythique. Dans l'album " Les Soufis" enregistré en 1979, Abed chante les poètes mystiques du 9è au 13è siècle. Puis, dans le" chant de l'arbre oriental" (1985), il adapte les poèmes d'auteurs contemporains de Syrie, du Liban, d'Irak et de Palestine. En 1989, dans l'album intitulé "Aromates", le chanteur exalte la beauté de la poésie arabe contemporaine et mystique. Là où Abed Azrié rencontre véritablement le Flamenco et les musiques espagnoles, c'est dans l'album intitulé "Suerte", "La bonne fortune", en espagnol. Avec la voix de Serge Guirao, ils évoquent deux cultures , arabe et espagnole qui, sous l'effet du chant, des accords de guitare ,des percussions ,de l'accordéon, du trio à cordes et des instruments orientaux ,fusionnent d'une manière harmonieuse et parfaite. Sur le thème de l'amour, Abed et Serge rendent un somptueux hommage à la femme. Dans son nouvel album, Abed Azrié chante "Omar Kayyam", poète perse, défenseur d'un islam tolérant et adepte des joies de la vie. Face au fanatisme religieux, il nous invite à aimer sans entrave les joies simples qu'elle procure, à nous enivrer de la diversité des parfums et des couleurs, des sons et des autres cultures qui nous entourent . Abed Azrié, homme de lumière, se veut avant tout un "homme de liberté". Il croit à l'art comme ferment humaniste et, face à nos doutes et à nos questions, ces mêmes questions, par sa voix posées, donnent l'apaisement d'une réponse.
Contact artistique d'Abed Azrié: Boris Kurtz, Artmada Productions, 3 rue des Missionnaires 78000 Versailles. tel: 01 39 49 92 92 ; Email: artmada@wanadoo.fr
Retrouvez Isabelle Jacq sur son site EN CLIQUANT ICI
14:19 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (1)
30/03/2007
Les Crobards
Par Mèze Malnuit

L'illustration est de Yves Budin qui vient de publier aux carnets du dessert de lune Visions of Miles
Voila ça y est l'idée fait son chemin. On va republier Malnuit. Oui c'est un événement. Ce sera pour l'automne probablement. C'est Bédé qui s'est mis au clavier pour exhumer ces textes devenus introuvables. Je vous en dirai plus au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Mais pour commencer juste un petit morceau pour le plaisir, comme on lèche les plats...
Crobard : n.m. Dessin à main levée qui ne fait qu’esquisser l’image d’un être ou d’une chose. (Petit Larousse – voir : croquis)
C’est peut-être cette idée, plutôt ce sentiment, qui rendait tous les autres toquards, et ridicules, et dérisoires…
Quelque chose qui encourageait cette fantaisie, ou quelqu’un, tout ce qui pouvait la favoriser, j’en tenais compte. Je fonçais dans le tas tête baissée, sans trop savoir ce qui m’attendait – en général une bosse – mais parfois une veine, et alors je tâtais je fouinais je creusais, ou une nappe et je barbotais comme un canard et je plongeais le cœur content à la recherche du POISSON D’OR… C’est c’que Servole appelait « le sapage de base » et qui n’était rien de plus qu’une discussion que je provoquais ou que je suscitais – dont j’étais avide – sans idée plus précise que l’espoir d’y trouver mon compte… Les gens m’attiraient, comme ils m’attirent toujours, pour ce qu’ils sont, ci ou ça – barman ou professeur ou clochard ou peintre – et pour ce qu’ils peuvent être : rien pour moi ou bien le moyen de faire un pas dans le sens de ce sentiment d’un maître, d’un but, d’une sagesse. J’étais ce qu’il y a de plus normal ! – et je me faisais brutal quand on trouvait ça bizarre, c’est tout – quand ça me faisait chier de dire que j’avais besoin des autres. Friable, fragile et tout, je réussissais à passer pour fort. Je l’étais de me savoir faible – mais c’est un peu fastoche ; les filozofs i’ commençaient à me les faire grosses comme ça !
Les gens étaient des fruits, fallait en pomper le jus et après on jetait la peau… Mais ils n’étaient pas tous QUE ÇA, pas si simple… Fallait même qu’ils soient autre chose – surtout ! Ceux qui vivaient avec le cœur, qui parlaient avec le cœur, ceux-là je les respectais ; les autres, pas mon job, pas de quartier on presse et on jette – façon de dire que c’était vite vu et que, si je visais du côté du cœur c’est que je cherchais le mien : où est-il, que veut-il, pourquoi qu’i’ m’emmerde ?… J’avais MAL AU CŒUR. Je voulais connaître la souffrance des autres (pas les chagrins d’amour, mes p’tites, ou alors du vrai chagrin de vrai cœur brisé – et pas d’histoires j’ai ma baguette de sourcier !). Je voulais APPRIVOISER LA SOUFFRANCE. C’est peut-être pour ça qu’il m’arrivait de la nier, et avec elle l’organe, son instrument et siège. Ou de la rechercher…
Pirot m’avait dit un jour que je me dépatouillais devant lui avec mes monstres : « Je crois que je comprends ce que vous dites Malnuit, mais je crois aussi que vous vous créez des problèmes » - Il avait raison, il y était passé avant moi… Il n’empêche, imaginaire ou réelle, j’avais une bombe dans le ventre. Illusion ou réalité, TOUT pouvait être l’une ou l’autre ou les deux, et l’était ; c’était de la petite farine d’en chicaner. Un bonhomme c’était un mélange de désirs et d’angoisses, c’était pas clair et pas compréhensible, ça disait oui et ça disait non et ça faisait pas la différence… Fallait qu’il marche avec des cannes pour apprendre à marcher sans cannes, un jour. – Je m’disais qu’il importait plus de le désirer que d’y parvenir – Puisque je pouvais imaginer un maître à vivre et à penser, il existait donc ; j’avais qu’à suivre mon imagination en me foutant du maître comme de ma première queue ; j’étais moi-même ce maître, ou je devais l’être, ou je voulais l’être, ou je l’étais pas aucune importance et tout est dit les jeux sont faits, t’es gagnant t’es perdant c’est recto et verso pipi et caca, t’as pas à te tortiller les amygdales t’es dans le bon train tchouf tchouf tchouf, je faisais le tour de la terre – que ceux qui m’aiment me suivent – je leur tendais la main au passage : montez montez vous allez voir comme c’est beau et comme c’est pénard ! Montez attrapez-moi ça rapido et attention à la marche !
Accroche-toi y’a du vent ! Alors , c’est-y pas du bon temps qu’on s’paye ? – krut krut treug krut krut treug qu’est-ce tu dis d’ça ?… t’as vu les vaches… c’est fou c’qu’y a d’vaches tout du long qui zieutent avec des yeux ronds… Et ça tu sais c’que c’est ça ? non c’est pas la frontière… t’as peur ?… t’occupe pas c’est tout cuit, tu vas voir la région par là, vache de bath… trook trook krrrt – tiens on va ralentir baisse les gaz… alors ? – vouais j’veux bien… Skol !… ça réchauffe hein… vouais… non, c’est le soleil qu’a disparu… un autre, ouais – à la tienne !… Vingt dieux c’est encore plus chouette la nuit… on voit plus rien ça paraît immense… on dirait qu’on fait du sur-place j’aime… quand tu penses qu’on roule à 200… comme si le temps s’était arrêté… plus d’temps plus d’espace plus rien… une espèce d’absolu quoi… merde ça vaut l’jus !…
Tiens, un coup avec Chomé j’me rappelle… j’sais plus s’il habitait Grenoble ou s’il était venu exprès… ç’avait été la grande ballade. C’était toujours la grande ballade avec lui. Enfin la grande ballade… je veux dire qu’on écumait le royaume à grandes foulées, à toute vapeur… via Vladivostok par Tombouctou et Vancouver, n’importe quoi n’importe comment pourvu qu’ça bombe, et les courants d’air faut pas y craindre, ni le phylloxera, et ça tombait du plafond à chaque minute, toutes qu’on les a nettoyées bel et bien ces putains d’araignées, slarp avec la langue pendant des heures ; la fiesta ; ce lour-là ou un autre, j’dis bien c’était toujours la fête. Sûrement qu’ça tenait à ce qu’on était comme qui dirait 2 doigts de la main… Y’a des années qu’on se connaissait déjà, depuis le bahut au commencement ; on avait 10-12 ans ; c’était au quart de poil – et j’y pense, c’est ça le vrai dialogue, quand tu parles et t’as pas besoin de faire le détail on se comprend, pas de ficelles et pas de pièges à con et pas besoin de tâter le terrain, tu connais, c’est les yeux fermés, à l’aveugle, lui c’est le paralytique, une paire royale… et une paix royale ; parce que ça se passe dans la paix, et la confiance et l’abandon… Y’a rien à dire, c’est pas du racontable –
Ce jour-là on avait pas débandé. De bar en bistrot on a pt’être bien écumé la ville en égrenant nos chapelets – Parce que c’est comme la religion, causer, c’est comme la prière quand y’a la foi – et la foi… Au juste c’est pas qu’on l’avait… j’en sais rien ; mais ce qui est sûr c’est qu’on avait besoin de rien d’autre, tant qu’on était en train. On parlait de l’amour ; de la vie ; de la mort. On parlait de rien et de tout ; on assassinait et on accouchait en même temps ; c’était la vie parallèle, la vie ramassée, précipitée, et passée au tamis, des tonnes de graines à calibrer – ça c’est bon ça c’est pas bon – des kilomètres de rails avalés à 200 à l’heure, et le temps c’était du bidon, un épouvantail pour les oiseaux peureux, on s’en tapait on se perchait dessus les ailes en action et on se compissait, volupté et Cie, en attendant l’apocalypse… On dansait le calypso des vieilles nippes et on criaillait HOULA HOULAAAA pour faire crouler la charpente du bon Dieu ; c’te farce !… Qu’est-ce que c’était la vie ? Un point dans l’espace mental ; une chiure séchée sur la vitre de l’éternité ; pas ce qu’on en dit de par le monde des hommes en tous cas. Les hommes ? ce qu’on était nous-mêmes, là, à parler devant une bière, une saucisse dans le buffet et un abcès sous la dernière molaire inférieure : de la chair à pâté pour la poudre à canons ou du polystyrène à fabriquer des pions que les anges déplacent sur les fesses des élues-martyres en se curant les dents… Les mots avaient des ailes, et de la grâce, et du plomb dans les ailes et la mort aux trousses ; à volonté ; feu sur le monde à volonté, et sauve qui peut… La grande cavalcade, le jour où l’on dérouille, où l’on ouvre les portes et on en ferme d’autres, le jour du grand décompte, de la re-création, le ménage en grand et la vidange énorme, à toi, à moi, à toi, je tire , tu pares, on pousse, tiens aide-moi on va soulever ça, regarde cette couche, au panier, ouvre la fenêtre, fous-moi ça en l’air, t’as vu la lune elle pleure, t’entends – c’est quoi ? – je sais pas – tu vois rien ? – fait nuit totale – attends t’affole pas – file-moi une clope – écoute – ça bouge là-dessous – j’ai mal aux chailles – commande un sec ça étouffe la douleur – elle avait un petit sourire tu peux pas savoir – pas dègue cette allemande – c’est d’la Kronenbourg – j’te parle de cette fille là – et si Dieu existait qu’est-ce ça changerait ? – t’irais au trou, dans la trappe, crac – passe devant j’te suis – raison majeure : trop familier avec moi – suis flatté – et l’cul au rouge pendant 1000 ans – rigole pas ça m’lance – j’vais l’inviter à faire l’amour – je m’sens vieux mon vieux – ça vous passera avant qu’ça me prenne elle t’a dit ? – ouais – conne – de près pas si chouette que ça – tout à la fois – fait un billard ? – change de décor – la mer – mézigue c’est pareil – dans le ventre et dans la tête – avec des vagues comme ça – autre chose – depuis l’temps – cré salaud – savait pas à quoi s’en tenir – tait pourtant clair enfin – te mets jamais à la place des autres tu peux pas savoir – fff – t’aime bien comme ça vieux – des fois qu’ça voudrait – pas la différence – c’est qu’on va loin – tu crois qu’ça va péter un jour ? – pas – c’que tu veux – rien c’est extra – un trottoir, une ville, des lumières – une chance qu’on s’connaisse bien des fois – pareil tu crois pas ? – d’être ensemble – pareil aussi, rien, rien à part ! – vie de dormir, moi non plus non – la vie est pas c’qu’elle devrait être et elle l’est, obligé – ch’ment dans l’coup – pas assez à – parlais des femmes – pas en sortir – justement le hic on en sort ! – remettre ça – où ça ? – comme tu veux tu t’retrouves toujours le bec dans l’eau – pine en l’air et l’drapeau blanc au bout – terrible à dire – comme si c’était vrai ! – à bouffer du foin – parle plus – c’est ouvert – comme en 14 ! – va s’écouter un pe-tit-blouzz – l’endroit ? – sur bandes – j’en bande – bandons – fatigué ? – comme si c’était t’à l’heure – une paire de fesses que j’y foutrais la langue – tu vas t’échauffer les glandouilles, c’est pas bon pour toi – tièrement d’accord mais qu’est-ce – sais plus c’qu’on disait –
… Deux jours que ça a duré. On collait nos tripes au plafond et on faisait l’autopsie… Ce qu’on devenait, ce qu’on restait, ce qu’on perdait, avec le temps… Pile ou face, tu coules ou tu flottes, si tu flottes c’est guère mieux… Couler pour couler tu perds rien tu verras, au fond c’est mieux même, personne s’en doute ; perdre son temps pour perdre son temps j’aime autant qu’ça soit du ciné… On a dû voir un film je sais plus (à propos j’me suis toujours demandé pourquoi les cinés ferment après minuit…) Sortis de la salle on retrouvait la nôtre et la séance continuait, la vraie, et le film avait rien de fabriqué, pas fait pour les foules, entrée libre et personne s’en doutait, et c’était la plongée dans le noir ultramarin et intestinal, un noir d’âme plus noir que l’encre, et fallait faire gaffe aux faux-pas, du polar avec des décors qu’étaient pas – si, qu’étaient, du sang frais, du cœur en lé, et des jardins et des allées et des luias et des cantiques au diable et à ses complexes parce que le diable est plus près de l’homme, plus saignant dans le genre steak et plus compréhensif. Des injures et des coups de gueule pour rien, et si Dieu existait, il devrait sortir de son trou – depuis le temps qu’il désertait les rues ! – Le besoin d’amour devenait mystique, c’est-à-dire carnassier, comme il était toujours dans l’attente qu’on lui prête garde – un besoin qui, satisfait, eût bouché tous les chiottes de la ville… N’importe quoi tout est bon, tout y passe… Raconter ça ? J’aurais mieux fait de le coller d’abord à l’œil-de-bœuf, mon œil ! Sans blague, t’as vu çui-là ? – qu’est-ce que j’peux dire ? Y’en a déjà qui croient que j’suis rond, ou dingue. – Et si j’l’étais, qu’est-ce que ça changerait… Je dis que les mots sont drogués, bulles de savon bulles de salive, complètement loufs, et 1000 fois dingue l’homme s’en sert, 1000 fois louf à fouler aux pieds, fou à lier… Vouais, ça me revient maintenant : il avait une piaule en ville Chomé… mais on avait couché dans un studio dont j’avais la clé – c’est Servole qui me l’avait filée pour un temps, il était en passe de le balancer sans y avoir jamais habité – vivait chez ses parents je suppose. Un studio duplex à la sortie de la ville… Chomé lisait « l’Adoration » et moi je soliloquais au ralenti – le friselis des pages me rappelait qu’il était là, ce grand jonc, et je lui demandais s’il était bon ce bouquin – « J’sais pas j’ai pas mes lunettes » - Bien sûr il les avait sur le nez ; même que ça lui faisait un drôle d’air docte drôlderdoct drôlderdoct…
21:20 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (0)
29/03/2007
DANGER PUBLIC
Par Mouloud Akkouche
De retour d’un salon littéraire polar, j’attendais sur le quai d’une gare. Fatigué mais la tête pleine de bons souvenirs. Heureux de mon week-end. Un jeune flic de la police ferroviaire passa seul devant moi. Soudain, il lâcha : « Notre peuple vaincra. ». Je regardais autour de nous deux : personne d’autre. Et d’un pas tranquille, ce jeune fonctionnaire de police rejoignit ses collègues. Ventre noué, je le suivis des yeux et m’apprêtais à lui demander des explications. A quoi bon ? Ma famille m’attendait et je ne voulais pas ‘’ bénéficier ‘’ d’un outrage rébellion. Bref, pas envie de passer quelques heures au poste.
Dernièrement, j’ai vu une vieille femme- de type européen- se faire agresser verbalement par un flic de cette même police ferroviaire. Mais ce jour-là, une autre femme d’une quarantaine d’année, très élégante, prit la défense de l’octogénaire en assénant : « Un peu de respect, cette vieille dame pourrait être votre mère ! ». A l’évocation de sa génitrice, le flic baissa immédiatement les yeux, penaud. La montagne de muscles en uniforme redevenue un petit gosse timide. Apprivoisé. Un noir se mit aussi à défendre la vieille femme ; le flic releva d’un seul coup la tête, bave aux lèvres tel un pitt-bull assermenté. Prêt à fondre sur une proie plus facile.
Les exemples de ce genre sont nombreux. Habitué à ce genre de situations, je ne réagis plus. Impuissant. Depuis quelque temps, langues et matraques se délient au quotidien. Cette phrase lâchée par un fonctionnaire de la République me rappela la lecture d’un livre de Albert Cohen : « O vous frères humains ! ». Une histoire sombre se déroulant en Europe au début du vingtième siècle. La ‘’ bête immonde ‘’ reprend en ce moment du poil de la bête dans l’hexagone, une bête de mieux en mieux nourrie. Très simple de transformer le ministère de l’identité nationale en secrétariat d’état aux affaires immigrés. Darquier de Pellepois et Papon sont morts, pas leurs héritiers. Méfiance: l’histoire sert aussi des plats surgelés.
Pourquoi ce jeune flic a balancé cette phrase ? Connerie ? Racisme ? Sans doute beaucoup de raisons. Ou d’irrationalité ? En réalité, il venait de recevoir sa part d’héritage et commençait à l’utiliser. L’héritage de son ministre de tutelle quittant-le jour même- ses fonctions pour un avenir présidentiel.
Et j’ai repensé aux yeux inquiets de cette octogénaire tremblante de peur sur un quai de gare. D’autres regards ont défilé, regards de panthéonisés et d’anonymes dont il faudrait se rappeler. Lucie Aubrac, vous nous manquez. On pensera à vous et aux ‘’ justes ‘’ le 22 avril et le 6 mai.
Si vous voulez connaître les oeuvres de Mouloud Akkouche

19:05 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (0)
28/03/2007
Les Crobards
de Méze Malnuit

L'illustration est de Yves Budin qui vient de publier aux carnets du dessert de lune Visions of Miles
Voila ça y est l'idée fait son chemin. On va republier Malnuit. Oui c'est un événement. Ce sera pour l'automne probablement. C'est Bédé qui s'est mis au clavier pour exhumer ces textes devenus introuvables. Je vous en dirai plus au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Mais pour commencer juste un petit morceau pour le plaisir, comme on lèche les plats...
Crobard : n.m. Dessin à main levée qui ne fait qu’esquisser l’image d’un être ou d’une chose. (Petit Larousse – voir : croquis)
Je me souviens d’un soir, c’est pas vieux… un bal huppé où je suis entré en fausse, avec les gars de l’orchestre – un des 3 ou 4 qui devaient se produire – justement l’orchestre des Archi. – Servole voulait pas — « Pas pour nous c’machin-là » - Tous les types sapés à mort, et les gonzesses fallait voir : décolletés, paire de cuisses, tout du grand luxe… Servole il maudissait sa mère et jurait une fois de plus de se faire curé, ou pédé, ou de se la couper, ou de s’engager dans la Légion… Moi je me fredonnais des comptines pour détourner en corner… Mais quand Bill Coleman emboucha son cuivre, je plaquai tout là et, taillant ma fissure dans la masse compacte des gambergeurs, je déboulai sur l’estrade et j’y posai mon cul. Les projecteurs en pleine poire je buvais des yeux le grand prêtre. Non pas que Bill Coleman soit du 4 étoiles, - il a jamais atteint la Voie Lactée du Jazz où Armstrong a planté sa tente une fois pour toutes – mais en l’occurrence, c’est un type honnête, de la bonne interprétation… J’en voulais et j’en voulais encore, de sa trompinette et de ses solos… Il avait pas tardé à me percer à jour, Bill…J’étais comme un enfant qui reconnaît se mère… J’avais perdu le fil, et le secret de mes origines je le retrouvais après des jours et des jours dans le désert… Le chagrin emmagasiné se trouvait soudain une issue et sortait par la bouche de Bill – After you’ve gone – La délivrance. Le pardon. La paix du cœur. Swingman… La brume était dissipée, la voie libre, et Bill chantait pour moi. Mon frère, je te regardais dans les yeux pendant que tu vidais cette gousse – et sur ta pauvre voix de nègre les autres dansaient, consciencieusement, scrupuleusement, à la perfection, comme d’excellents élèves qu’ils étaient, sensibles au seul tempo mais insensibles à la vie, à la haine et à l’amour que tu exprimais et qui me secouaient comme un prunier YAAA ! – Le seul couple qui touchait sa bille était juste devant moi, un négre et une blonde qui s’aimaient d’amour, une merveille de grâce et de force, une paire comme elles le seront toutes le jour où LA VIE aura gagné la bataille – la vie, le sang, une débauche de plaisir partagé comme j’en ai jamais vu avant ni retrouvé depuis ! – une condamnation à mort de l’exhibitionnisme lucratif – un couple totalement égoïste et pur –
Quand je dis que j’ai jamais rien pigé à la musique (j’ai dit ça ?) faut s’entendre… Pour moi tout est musique, c’est-à-dire que TOUT CONDUIT À LA MUSIQUE – À la musique et à la danse. (Pour un qui bricole du stylo et du pinceau, on pourra pas m’accuser d’être borné). Parce que tout ce qui vit est RYTHME. Et tout est vie. Même la mort qui vient à son heure donner le dernier coup de gong – dont l’écho hante nos mémoires parce qu’il nous obsède de la réminiscence obscure de nos vies antérieures, notamment notre vie fœtale.
Notre âme est charnelle, gorgée de sang et douloureuse. C’est la brousse, la jungle, et non pas un jardin à la française. La musique en est l’expression immédiate : elle ne peut se soumettre à une volonté didactique ou à une idée préconçue… Wagner et Jean-Philippe Rameau ne sont pas des musiciens – Ce sont des faiseurs, des fabricants – un goitreux et un lèche-cul. Ils composaient pour les hyènes et pour les colibris – pas pour les hommes.
Be cool boy… J’étais relax. Balaise Blaise… Bill oubliait les toupies qui ciraient la piste, et il jouait pour jouer, et il jouissait de me voir jouir… Quand il était obligé de balancer un air tarte à la mode pour « honorer » son contrat – hé – il me jetait un regard misérable, et je lui faisais les gros yeux. – J’attendais que ça passe en sirotant la mousse que le garçon-trotteur, qui m’avait à la bonne, m’avait refilée…
Let’s go – Ils s’en donnaient les gars…
Assis sur le bord de l’estrade, j’en prenais plein les feuilles, et c’était bon. La fille à qui j’avais foutu la main, dans la cohue, me jetait du sournois à chaque tour de piste et je rigolais. Sa petite chose intime je l’avais dans la main, bien au creux, et pour toujours que ça te plaise ou non la belle ! – Ça valait bien la gifle qu’elle m’avait retournée – Tiens, j’ouvre, regarde… tu la vois dis, ta petite chatte, roulée en boule et qui ronronne de plaisir ? Alors, pas la peine de t’fatiguer, ta rancune c’est de la frime – tu vois, j’me marre… - Let’s go – Fais comme moi – Éteins la veilleuse et laisse-toi porter, pénétrer, retourner… t’es pas mieux comme ça ? t’as toujours envie de bouder ? Les chatouilles appellent les caresses et les caresses suscitent l’amour… Regarde Glaizo qui traîne son gros cœur tout gonflé… Laisse tomber ce cavalier à la noix qui danse comme un charme et cours vers mon pote et invite-le, et si il te dit « J’sais pas danser » fais le danser quand même… Regarde Bacaze qui se bouffe les ongles, serait-y pas qu’il se sent seulabre ? sa Poppy est retournée avec l’autre – I’m crazy ‘bout you baby, tu pourrais pt’êt’ kekchose pour lui ? – Ah nom de dieu, la sympathie c’est le fruit rare, l’objet de luxe, la chose qu’on mesure – pi d’abord ce gars-là je connais pas. – Ben alors, raison de plus, laisse-toi aller, Y’A LE FEU À LA CAVE !
- Viens là Bacaze, laisse tomber ton fagot, écoute ça… Tu sens comme ça remue… le bon truc j’te dis… le cataplasme impeccable… Vise le batteur, il est joille… t’as pas l’impression, bye bye baby, y’a rien qui tient le coup… du vent… du vent… Écoute un peu… j’me sens parti… viens avec moi, bon dieu, me laisse pas … Ça va ?… Tu t’souviens l’autre soir, Memphis Slim… on s’est marré non… j’parle pas musique, je sais, faut pas comparer les types entre eux, z’ont tous leurs tics… c’est quand tu voyages pépère avec le bonhomme, c’est bath… avec ou sans escales… quand tu – moi en tous cas ce qui me plait pas trop je tiens pas compte, si le mec colle à son truc je marche… j’crois que ça dépend de pas mal de trucs, les conditions et tout le reste, si on a bien bouffé à midi et tout ça, ou bien baisé la dernière fois, tout le bizness… Gerry Mulligan… Ray Charles bon dieu… toi t’aimes bien Fats Domino moi j’accroche pas… Et le Duke ?… c’est comme Armstrong, on a l’impression qu’ils en sortent jamais… des poissons dans l’eau… mais c’que j’en dis… C’que je cherche c’est l’VOYAGE. – J’en ai pas tant à foutre que le bonhomme soit un vrai kèke ou un médiocre… comment savoir d’ailleurs… Le seul critère c’est qu’il fabrique de la vie, du carbure… -
Les p’tits gars ce soir-là ils carburaient ! – Le batteur avait la trouille au ventre parce qu’il décollait – ça y est, il avait trouvé la bonne mesure, le bon mélange… Temps en temps Glaizo se radinait avec une bière qu’on vidait à trois chacun une tasse en discutant le bout de maigre : les fesses, ces vacheries d’paires de fesses etcetera…
J’avais repéré Chaff dans le tas ; il apparaissait entre deux slows une nénette pendue à son cou – et jamais la même, sacré tombeur – mais tombeur de bois mort…
Bacaze s’échauffait… Les « Mélo » avaient épuisé leur répertoire et puisaient dans les pots-pourris, question de durer jusqu’à l’aube… J’avais eu droit à mon petit charleston – la seule chose que j’danse mais sur les chapeaux de roues, faut voir – j’avais écœuré tout le monde…
Les clampins dégageaient la piste les uns après les autres. Restaient les jusqu’à-la-lie…
Le batteur soufflait un peu en buvant sa limonade, et Bacaze avait pris la relève… Petit à petit, piano ma sano, le Dieu du Rythme déliait ses poignets et un sourire lui montait en coin – juste en coin : si tu jubiles tu foires, la synchro c’est sérieux…

20:20 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (0)
14/03/2007
Les Crobards de Malnuit

Collage Maryvonne Lequellec
Voila ça y est l'idée fait son chemin. On va republier Malnuit. Oui c'est un événement. Ce sera pour l'automne probablement. C'est Bédé qui s'est mis au clavier pour exhumer ces textes devenus introuvables. Je vous en dirai plus au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Mais pour commencer juste un petit morceau pour le plaisir, comme on lèche les plats...
Crobard : n.m. Dessin à main levée qui ne fait qu’esquisser l’image d’un être ou d’une chose. (Petit Larousse – voir : croquis)
Inondé du sang des femmes et de leur sève tu es en train de revivre le rite de la naissance et tu es le premier homme et le dernier et tu te débats dans la fantasmagorie infernale et divine du Commencement et tu retournes à la Source qui est sans commencement ni fin et de toutes tes forces débridées tu réintègres le chaos fondamental et l’ordre suprême de la nuit des temps qui est dans la femme comme le secret de la lutte des sexes et de l’attachement animal et du cannibalique et du platonique et le secret de ta faiblesse et ta misère et ta soif intarissable et ta faim perpétuelle et et et la femme s’ouvre et se referme et tu t’enfonces dans l’œsophage et tu pénètres dans l’estomac qui n’est qu’un sac et son anus s’ouvre et se referme et tu t’enfonces dans le rectum et tu pénètres dans l’intestin et sa vulve s’ouvre et se referme et tu pénètres dans la matrice et la femme s’ouvre et se referme mille et mille fois tu t’enfonces en elle et la femme s’ouvre et se referme et tu t’enfonces dans son cœur et tu pénètres JUSQU’À SON ÂME
Mais ce n’est plus toi c’est personne et tu assistes au gigantesque spectacle ébahi et secoué comme si une décharge faisait trembler au fond de toi tout au fond UNE CORDE quelque part tout au fond de la chair et tout au fond de la mémoire une corde et cette corde traverse ton plexus solaire et ton cerveau vibre doucement dans sa boîte imprimant aux globes de tes yeux une imperceptible bougeotte et ton voisin de table n’est qu’une tache d’encre presque une ombre et peut-être une illusion visuelle un grain de poussière sur ta pupille et la petite corde te fait un peu mal elle résonne autour de la nuque comme si le bulbe était à son tour secoué par un infime écho et tu voudrais penser à autre chose et tu passes la main sur ta nuque et tu te frottes les yeux mais ta pensée ne suit pas tu ne penses pas c’est personne et personne non plus ne pense pas comment pourrait-il penser lui qui n’est personne et personne c’est rien personne c’est rien personne alors. Alors…
— Quoi
— Qu’est-ce qu’on fait ?
— Qu’est-ce que tu veux faire ?
— Ché pas
— Et toi ?
— Ché pas. Rien…
19:30 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (0)
08/03/2007
La comète Jeff Buckley
Buckley était un homme d’une autre espèce que celle connue sur terre. On a retrouvé que ses bottes près du fleuve Mississipi. S’y est-t-il baigné en pleine nuit ? Il a tout simplement disparu comme il était apparu.
Non seulement Jeff Buckley a disparu dans les eaux du Mississipi mais son chef-d’œuvre est inconnu aux États-Unis.

« Pourquoi les radios US n’ont-elles pas diffusé « Grace » ? C’est ridicule. Ce disque est tellement phénoménal que si les radios ne le passent pas, qu’est-ce qui va passer ? Ce disque a un public culte. Il va devenir de plus en plus populaire, c’est évident. » (Rock & Folk, octobre 1999)
Le témoigange suivant est celui de Ben Harper qui a eu l’occasion de le rencontrer plusieurs fois.
« La première d’entre elles m’a laissé un souvenir impérissable. Lui et moi étions en tournée en Europe, en 1996, et à l’affiche de plusieurs grands festivals, dont les Eurockéennes de Belfort. Ce jour-là, pendant les balances, Jeff s’est approché de moi, m’a tendu sa guitare slide, et m’a demandé de lui apprendre quelque chose. En l’attrapant, je me suis aperçu qu‘elle était accordée d’une façon si étrange que j’étais incapable de m’en servir. Je la lui ai donc rendue aussitôt pour qu’il m’explique comment il faisait. Nous nous sommes alors promis d’aller ensemble voir jouer Page et Plant, qui étaient également à l’affiche du festival. Je savais qu’on pourrait accéder aux côtés de la scène. Lorsque Jeff a terminé son concert, il avait encore de la promo à faire, et je lui ai proposé de nous rejoindre près de la scène de Page et Plant. Le groupe avait déjà commencé, et le gars de la sécurité, sur l’aile droite de la scène, nous en a refusé l’accès. Nous l’avons donc contourné pour essayer l’autre côté, où nous avons assisté au show. Jeff n’arrivait pas. Nous sommes donc retournés de l’autre côté pour voir s’il nous y cherchait. Personne. Le même type nous a alors montré le carré presse. Pensant y trouver Jeff, nous sommes descendus. Personne non plus. Il y avait beaucoup de poussière. Tout à coup, dans le coin de mon œil, j’ai perçu un mouvement, comme si un oiseau venait de s’envoler au-dessus des montagnes d’amplis. Et en levant la tête, j’ai vu Jeff, accroché à plusieurs mètres de haut juste au-dessus de la scène, suspendu dans les airs. C’est le truc le plus incroyable que j’aie jamais vu. Je me suis dit qu’un type capable de faire ça ne vivait pas sur la même planète que nous. » (Rolling Stone, février 2003)
Pour écouter Jeff Buckley, cliquez ici
17:35 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (2)
28/11/2006
Cambodge, je me souviens

Je vous en donne quelques passages.
« Aujourd’hui, nous nous sommes réveillées à trois heures du matin pour aller travailler. Deux heures de marche pour aller à la rizière, et toute la matinée à patauger dans cette boue infecte, répugnante… Ma vie a complètement changé ; comme tous les autres ici, je suis jeune, à peine dix ans, fragile. J’ai encore besoin de tout ; de l’école pour apprendre, de bons repas pour grandir, et simplement d’un peu d’affection… Rien de tout cela ne nous est offert, rien d’autre à attendre que le travail jour et nuit. Je ne sais ni lire, ni écrire. Je me sens aveugle, perdue dans une nuit sans fin. Sortirais-je un jour de cette vie inhumaine ?
Après avoir pris un mauvais repas, j’ai vomi, puis je me suis endormie. Cette horreur de nourriture, pas même bonne pour les cochons, a fini par me rendre malade. Et avec le travail si dur, la fatigue s’est accumulée…
Est-ce que j’échapperai à la mort dans ces maudites rizières ? »
Pour ceux qui ont vu le film « La Déchirure »
Nous quittons aujourd’hui le village de Som-Lauth. Nous sommes plus nombreux maintenant. En préparant mes affaires, j’entends des cris et des hurlements à travers les murs de bambou que j’essaye d’écarter pour voir ce qui se passe. Il y a des dizaines de prisonniers, tous maigres, en train de supplier les soldats de ne pas leur faire de mal. Ils sont enchaînés, sans doute depuis longtemps, et ce jour là, c’est le jour de l’exécution. Je tremble comme une feuille. Un soldat tient un couteau taché de sang. Je ne sais pas s’il m’a vue en train d’observer la scène, car pendant un moment j’ai fermé les yeux en serrant les dents. J’ai beaucoup de pitié pour ces prisonniers innocents. Ils sont grands,maigres, ils ont les yeux cernés. Je ne sais pas depuis combien de temps on les as privé de nourriture. En ouvrant les yeux, je ne vois plus le tueur. Il est derrière moi
-Tu peux venir voir de plus près, si tu veux.
Je sursaute, je fais une grimace en voyant son couteau plein de sang.
-N’aies pas peur ! Viens voir ! me dit encore le sauvage. Je secoue la tête. Impossible de faire quoi que ce soit. J’ai très peur qu’il m’assassine à mon tour. Maman n’est pas là, elle est allée à la cuisine demander un peu de provisions. Kim, Sam et Visal sont avec elle. Je ne sais que faire. Je reste là, et je pleure pour ces hommes prisonniers que je ne connaissais même pas. Quant au jeune soldat, il n’a pas l’air du tout d’un assassin. Il est jeune et beau garçon. Il ne dit plus rien quand il me voit pleurer. Il retourne à son devoir et fait déshabiller trois prisonniers pour les envoyer en enfer…
Je n’oublierai jamais ce massacre. C’est la pire chose que j’aie jamais vue. J’ai des douleurs qui me lancent dans les veines. J’ai très mal, et pourtant on ne m’a rien fait. Mais pourquoi ai-je si mal ?
La fuite et l’arrivée en Thaïlande.
« Pourrons nous, une fois en Thaïlande être en sécurité ? J’aimerais pouvoir le croire, mais j’ai peur que ce ne soit pas le cas. Ce que j’attends c’est la paix, je me dis qu’à partir de maintenant, à la seconde même où je respire ce parfum précieux et mystérieux que j’ai cherché toute ma vie, mon cœur est soulagé de tous els dangers de l’existence. Malgré la fatigue et la fièvre qui envahit tout mon corps, je suis heureuse.
-Est-ce qu’on peut continuer ? nous demande oncle Chao après une petite pause.
Tout le monde fait signe que oui, et se met debout pour partir. Mais à ce moment précis, le monde change de couleur. Six Khmers rouges armés jusqu’aux dents sortent de la forêt et braquent leurs canons sur nous. Ils avancent sur nous en silence, prêts à tirer si nous bougeons. Ils sont armés de M79 et d’AK47 chinois. Le chef nous demande à voix basse :
-Où allez-vous comme ça ?
Nous tremblons. Personne n’ose briser le silence. Nous restons immobiles, encerclés par les six fantômes Khmers rouges qui nous fixent avec mépris. Le désespoir a ouvert ses portes sur nous. Tout le contraire de ce que j’avais espéré… Le chef Khmers rouge sort son pistolet et caresse la joue de tante Soeun avec son arme…
Oncle Chao est rouge de colère, mais il ne peut rien faire. C’est maman qui prend la parole :
J’ai une fille qui est gravement malade, elle aa besoin de se faire soigner…
-Venez avec nous ! lui répond le Khmer rouge. Nous avons tout ce Qu’il faut à Beau-Pailin. Un grand hôpital, des médecins et des infirmiers très doués… »
« …A ce moment précis, un autre groupe de soldats surgit de nulle part. nous sommes encerclés, aucune chance d’avancer… mais bizarrement, les Khmers rouges se retirent dans la forêt et les autres militaires nous appellent :
« Mani, mani ! », ce qui signifie : Venez, venez !
de grandes lumières d’espoir brillent dans les yeux de l’oncle Chao. Un sourire de vraie joie se dessine sur ses lèvres. Il articule seulement :
-Venez, nous sommes sauvés !
nous les suivons. Les Khmers rouges ont disparu sans bruit. Nous approchons de nos amis inconnus. Derrière nous, aucun coup de feu. Oncle Chao dit que ce sont des soldats thaïlandais et qu’ils vont prendre soin de nous… Je leur souris. L’un d’eux vient vers moi ;
-Tu as mal à la tête ? me demande-t-il en cambodgien.
Maman lui explique que je suis malade et que je n’arrête pas de délirer . il me prend alors par la taille et m’aide à marcher vers la liberté…
Il émane de ce petit bout de femme une volonté à ébranler n’importe quelle certitude et un instinct de survie monumental. On ne larmoie pas sur soi-même en ces circonstances, sinon on est déjà est mort. La morale n’existe plus, c’est l’instinct à l’état brut, lui seul dicte ce qu’il faut faire. Sur le moment on ne sait pas pourquoi on a choisi cette voie plutôt que l’autre. Au résultat, ils se rendent compte qu’ils sont encore de ce monde parce que c’était le seul choix possible. Comment ont-ils fait ? Ils l’ignorent mais ils l’ont fait.
Il ne faut que quelques heures à Méas pour vous donner l’impression que vous l’avez toujours connu. Nous sommes plusieurs à avoir constaté cette sensation à son contact. Merci Méas...
Prix 15 euros
ISBN 2-914-581-15-7
22:15 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (0)
07/11/2006
Miettes de Ghetto
Par MOULOUD AKKOUCHE
Mouloud, que j'ai connu à Toulouse et recroisé au hasard des pérégrinations fait partie de ces gens qu'on à l'impression d'avoir toujours eu comme ami. Tout en simplicité est en rire contagieux.

Pour Alain Rey qui connaît la valeur des mots.
À la mémoire de Coluche qui n’avait rien promis... et continue de distribuer des millions de repas.
Récemment sur le petit écran, Éric Orsenna, académicien, vantait les mérites des textos et MSN très en vogue chez les jeunes. L’écrivain démontrait avec brio et bonhomie l’apport non négligeable de ce nouveau langage. Puis son raisonnement fut relayé et étayé par l’auteur tout aussi intéressant d’un dictionnaire d’argot. Diams, chanteuse rap parmi les invités, écoutait avec une grande attention cet échange fructueux entre érudits. Un régal pour les téléspectateurs. Diams, visiblement amusée, était sensible à cet éloge du mot-issage. Comment ne pas acquiescer à l’évolution de la langue française ? Éric Orsenna, pour illustrer son argument linguistique, dragua gentiment la rappeuse avec les mots des jeunes des cités et d’ailleurs. Un jeu de séduction plutôt marrant. Pas courant de voir un membre de l’Académie sympathique et vert même sans sa panoplie...
Mais aurait-il eu le même comportement avec la fille d’un de ses collègues du Quai Conti ou une jeune chanteuse d’opéra ? Se lâche-t-il autant aux réceptions du Conseil d’État ? Ses enfants communiquent-ils uniquement avec des textos et MSN truffés de fautes d’orthographe ? Et n’écoutent-ils que du rap ou de la techno ? Cette scène de télé en apparence banale révélait cette posture récurrente à l’égard des jeunes de banlieue : une fausse empathie teintée d’irrespect. Jean-Louis Borloo, ministre d’État, pratique souvent la démagogie du parler « djeune ». Rien à voir avec Éric Orsenna plutôt animé de bons sentiments... En tout cas, l’attitude de l’académicien primesautier me fit penser, toutes proportions gardées, aux éructations indignes d’un ministre de l’Intérieur lors de ses descentes en banlieue. Pourquoi cette étrange mise en parallèle ? À cause de leurs comportements et propos qu’ils ne se seraient pas autorisés dans leur univers très policé : milieu feutré avec plan de table et conversation calibrée. Et tous deux soucieux de la bonne éducation de leur progéniture, attentifs à l’orthographe et aux leçons de solfège. L’un menaçait de karchériser une cité entière tandis que l’autre, beaucoup plus ouvert, affichait un sourire affable dans une émission culturelle. Mais chacun, dans des registres opposés, ne laissant in fine aux jeunes des quartiers « sensibles » que les miettes du gâteau. Chacun son ghetto et les dictionnaires seront bien gardés...
Et aujourd’hui encore, à quelques mois d’un important scrutin, les habitants des banlieues redeviennent les figurants d’une mise en scène politicienne : intermittents réquisitionnés aux services d’ambitions étalées de Voici à TF1. Ségolène Royal propose de geler les prestations familiales des plus démunis et, pendant ce temps, même si ce n’est évidemment pas à mettre sur le même niveau, Nicolas Sarkozy traque les gosses sans papiers dans les écoles primaires pour les expulser. Chacun maniant tour à tour carotte et bâton devant les caméras, un numéro de surenchère pour apparaître plus intransigeant que son adversaire. Plus sécuritaire. Tactique et jeux d’ego classiques pour la quête du pouvoir... Un jeu où des millions de gens sont pris en étau par la gauche cafard et la droite nerf de boeuf exhibant sa caution éphémère : un rappeur à bonnet blanc et sans cervelle. Coincés entre une démagauche people, une droite Flash-Ball et quelques jeunes cons aux pieds de leurs immeubles, ces millions de citoyens n’ont même plus le droit de vivre dans des départements comme les autres mais dans le 9-3 ou 9-5. Quel commentateur a situé l’affaire Clearstream dans le 7-5 ?
Que dire de constructif sur les banlieues ? Tant d’encre a coulé et coulera encore sur ce sujet. Que rajouter à ce flot ? Fonds de commerce électoral, ces barres HLM sont absorbées et recyclées au gré des faits divers par la machine médiatique avant de retomber dans l’oubli. Et de redevenir des coquilles de béton échouées le plus loin possible des centres-villes, coquilles ouvertes juste pour nourrir les JT. Que sont réellement ces banlieues ? Difficile de répondre à cette question. Ce terme recouvre tellement d’éléments disparates. Dans le centre de Paris, les habitants ne sont pas tous identiques ; parmi eux se trouve la même proportion de gens sympathiques et d’abrutis qu’à Bobigny et sur tout le reste de la planète. Mais personne ne pensera à coller tous les Parisiens dans le même panier. Alors qu’on occultera les individualités de l’autre côté des périfs et rocades. Pour ne conserver que les images des jeunes cagoulés brisant des pare-brise. Images plus simples à véhiculer.
À l’heure où j’écris ces lignes, les RG annoncent une probable « nouvelle flambée des banlieues ». Et plus d’exploits de Zidane pour anesthésier... À qui peut profiter une France en flammes ? Qui réussira à tirer profit de ce grand incendie programmé ?
Nicolas Sarkozy, très habile, parle sans rien dire mais s’adresse à chacun. Et partout.
Pas un jour sans qu’il n’intervienne ou fasse monter au créneau l’un de ses lieutenants. Sur tous les fronts... Surtout national.
Un catalogue de promesses sous le bras, il slalome allégrement de la dame patronnesse du 7e arrondissement qui tremble pour les stock-options de son époux, au érémiste au fin fond du Lot, en passant par le banlieusard à la bagnole cramée. Il joue sur du velours : qui n’a pas une raison valable de se plaindre de son existence à un moment ou un autre ? Fort de cette certitude, le patron de l’UMP peut promettre que le soleil se lèvera plusieurs fois par jour et le bonheur régnera de Barbès à Tarascon. L’ancien avocat a bien appris les leçons de Pasqua, son mentor, qui clamait : « Les promesses n’engagent que ceux qui y croient. » Chaque tape sur l’épaule ne lui coûte que les frais de déplacement, réglés par le contribuable. Même les beaux quartiers se rallient à son panache de furet populiste. Lorgnent-ils d’hypothétiques places ? Aveuglés par l’opportunisme, ils en oublient que les mauvais mélanges causent immanquablement gueule de bois et crise de foie. Si Nicolas Sarkozy gagne en avril prochain, Marianne risque de rester longtemps à genoux au-dessus de la cuvette des chiottes...
Et les banlieues sous pression lui servent tour à tour de paillasson et de marchepied pour l’Élysée. Son intérêt n’est pas du tout de régler les tourments réels des grands ensembles. Au contraire. Chaque voiture brûlée lui rapporte plus de voix qu’une campagne publicitaire. Et les émeutiers, ses meilleurs agents électoraux, roulent pour lui. Pourquoi n’emploierait-il pas ces jeunes bénévoles pressés de passer à la télé ? Enfoncées dans la précarité, des familles entières de l’Hexagone, certaines à bout de nerf aux premières loges du désastre, finissent par lui tomber dans les bras ou dans ceux des barbus. Triste alternative. Surtout pour ceux qui, comme moi, sont athées et encartés dans aucun parti...
Un an après la mort de Zyed et Bouna dans un transformateur EDF et les émeutes qui suivirent, rien n’a vraiment changé sur le fond. Les saisons et les caméras passent, les difficultés restent ancrées. J’ai l’impression de me répéter, répéter ce qui s’écrit et se dit depuis des années. Une bouillie indigeste des mêmes maux toujours au menu. Et, bien à l’abri derrière mon écran, je me sens impuissant et donneur de leçons. Peut-être juste bon à alimenter le brouillard déjà épais au-dessus des banlieues ?
Que faire ?
Quand on m’a proposé d’écrire sur ce sujet, j’ai hésité car je ne vis plus en banlieue depuis cinq ans. Mais une partie de ma famille y réside encore et beaucoup d’amis. Chaque fois que je monte à Montreuil, ma ville natale, je me rends compte que le fossé se creuse entre les diverses populations. La mixité sociale de plus en plus compliquée à maintenir. Nombreux gosses de « bobos » (souvent militants Verts et ardents défenseurs des sans-papiers) et de « nouveaux prolos » ne fréquentent pas les mêmes écoles. Mais quels parents auraient envie d’envoyer leurs gamins dans un collège cumulant les handicaps ? Et les récentes propositions de Ségolène Royal pour l’abrogation de la carte scolaire ne feront qu’accentuer ce déficit. Sans dédouaner certains jeunes, responsables d’incivilités dans les établissements scolaires, je ne crois pas que les enfants Hollande ressentiront un jour une profonde humiliation face aux institutions. Ni mes gosses d’ailleurs. Mais force est de constater que l’école est de plus en plus taillée sur mesure pour une minorité. Même si quelques-uns parmi la majorité réussiront à trouver un vêtement en solde... « Si tu es sage dans ton bahut de banlieue, tu pourras entrer à Henri-IV. Sinon deviens champion du monde de foot, comique, rappeur... Leader... ou dealer. Ou vigile. » Petit message à la candidate socialiste qui refuse d’avoir « peur du peuple » : les prestations familiales remplissent aussi un frigo ou règlent une note de chauffage en hiver. Les allocs ne sont pas de l’argent de poche, surtout quand les poches sont trouées.
Depuis une vingtaine d’années, les banlieues sont autant de petits volcans qui se réveillent séparément ou, pour la première fois en novembre 2005 : ensemble. Comme une fatalité. Pourtant, ici et là, des mains anonymes (Jean Acamas et son Chiffon rouge...) continuent inlassablement de tisser et retisser du lien social, réparant les dégâts de la nuit avant d’attaquer la journée. Loin des dorures de la République et des effets d’annonce. En réalité, ces émeutes de l’automne dernier dépassent les frontières des banlieues ; elles sont le reflet d’une société abandonnée en grande partie aux publicitaires et financiers adeptes du court terme. Et sans morale : un mot pas très tendance. Dans toutes les corporations (idem pour la culture), le critère essentiel est la rentabilité ; de nombreux cadres et employés finissent par commettre des incivilités invisibles pour ne pas se faire virer. Mais qui n’a jamais fait des concessions et eu des lâchetés ? Voilà pourquoi chacun, moi compris, ne doit se complaire dans la victimisation et se défausser exclusivement sur la société génératrice de tous les maux. Pareil pour chaque jeune qui ne peut s’exonérer de sa part de responsabilité individuelle. Surtout quand il crame un bus à Marseille ou ailleurs.
Tous ces constats établis : quelles solutions efficaces pour enrayer cette spirale infernale ? Comment agir face à ce gâchis, cette autodestruction d’une partie de la jeunesse ? Critiquer ceux qui fournissent les briquets en haut lieu ne suffit pas... Quoi qu’il en soit, les auteurs, artistes en général, ne sont que des questionneurs du monde. Place maintenant à ceux qui doivent apporter des réponses concrètes : les responsables politiques. Pas ceux axés uniquement sur leurs intérêts, mais des citoyens n'oubliant pas en cours de mandat qu’ils ont été élus par et pour des citoyens. Citoyens usés par les promesses non tenues. Et de plus en plus sceptiques sur le rôle de la politique.
Aujourd’hui, le temps n’a plus le temps.
Et les élections approchent. De gauche ou de droite, nanti ou au RMI, rappelez-vous avant de glisser votre bulletin dans l’urne que le vrai ennemi de la démocratie n’est pas le jeune de banlieue. Ni l’insoumise de cité et le sans-papiers. Ni un écrivain condamné à la cavale...
Et surtout n’oubliez pas au second tour de l’élection du prochain(e) président(e) de la République que les mots Liberté, Égalité, Fraternité peuvent aussi s’effacer au Karcher.
Ce texte a été publié dans l’Humanité du 2 novembre 2006.
Mouloud Akkouche vient de publier
Rue des absents, Atelier In 8 In Octavo.

21:40 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (0)


