30/09/2007
la vie aux indes (6)

Photo Bénédicte Mercier
Combien en ai-je tué, en les achevant d’un coup de gourdin derrière la nuque pour abréger leurs souffrances ou la mienne, en imaginant la leur. Leurs corps tordus me faisait si mal, leurs yeux hagards, brûlants de folie me heurtaient de plein fouet. Comment ont-ils pu survivre malgré tant de misères, de douleurs, d’abnégation. Il me semblait que si j’étais dans la même situation, j’aurais choisi de m’enfuir par la mer, de me laisser engloutir mais que jamais ma dignité n’aurait accepté une telle soumission. Et je savais que je me mentait. Je me savais identique aux autres humains, capables de tous les compromis pour arriver à mes fins, pourvu que je perdure dans ce foutoir. Et se penser par compassion à leur place m’effrayait autant que le spectacle de leurs moignons en guise de mains, de leurs pieds sans doigts, de leurs visages si laids aux faces creusées par la lèpre de leurs pansements sales sur leurs membres sectionnés. Comment supporter une telle vision sans s’écrouler. La lèpre leur a fait fondre le visage comme celui d’un grand brûlé et leur a rongé les cartilages, leur laissant un groin à la place du nez, une bouche de macchabée sans lèvres. Quand je les ai regardé, un haut-le-coeur m’a soulevé le ventre. Pourtant ils semblaient si heureux de me voir qu’ils joignirent leurs membres et me saluèrent à la manière indienne. Comment rendre un autre sourire au leur, qui me parurent si paisible, si doux. Ils m’observaient étrangement. Ils savent lire sur le visage la peur qu’ils inspirent et tentent de rassurer, d’apprivoiser. Pourquoi ne pas avoir fuit avant qu’ils n’arrivent jusqu’à moi et que leur regard ne me transperce ? Un fil m’a retenu auprès d’eux. Une étrange compassion a anéanti toutes mes certitudes sur l’existence. Ces êtres ne sont pas des singes mais des humains, ou ce qu’il en reste. Et cette laideur est fascinante d’étrangeté, car aucun regard ne m’a jamais semblé plus humain, plus doux, plus paisible, plus soumis à la loi de la pourriture de l’existence.
Et quand je me suis réveillé trempé de sueur, j’ai su que ce cauchemar n’en était pas un. La chance d’être passé à côté de toute cette misère m’a semblé si infime que le souffle du boulet m’en hébétait encore. J’étais bien en Inde et les pâles du ventilateur qui semblaient tourner à une vitesse accélérée étaient bien réelles.
19:14 Publié dans carnets de voyages | Lien permanent | Commentaires (0)
26/09/2007
Les copains d'abord

20:55 Publié dans La vie des bêtes racontée aux enfants | Lien permanent | Commentaires (0)
23/09/2007
Kérouac en Bretagne (épisode 3 et fin)
Par Alain Jégou

Il en a marre de la Floride et décide de vendre sa maison de Saint-Petersburg pour aller s’installer dans le Massachusetts, au cap Cod, proche de la mer, de Boston où il espère se rendre de temps en temps afin de poursuivre à la bibliothèque de Harvard ses recherches sur ses origines celtiques, et de Lowell où il pense aussi revoir plus fréquemment la famille Stampas, ses plus proches amis d’enfance.
Il erre entre les bars de Hyannis, écrit Vanité de Duluoz et supporte placidement les humeurs et réprimandes continuelles de Mémère.
C’est à cette période qu’un autre breton, Youenn Gwernig, récemment exilé à New York, découvre inopinément un de ses ouvrages dans la vitrine d’un libraire, puis retrouve sa prose dans la revue Evergreen et décide de lui écrire par l’intermédiaire de la revue. Jack, enthousiasmé par sa lettre, lui répond illico et l’invite à venir le visiter à Hyannis.
Le grand Younn, comme le surnomment ses amis, vit dans le quartier de Brooklyn. Il est sculpteur sur bois et travaille à Manhattan chez un fabricant de meubles. Il dispose de peu de journées de loisir et doit négocier avec le boss pour obtenir suffisamment de temps libre pour faire le voyage au cap Cod. Il prétexte la mort d’un présumé cousin dans les forêts du Massachusetts.
Cumulant un jour de repos dominical et une perm supplémentaire accordée par son patron conciliant, il grimpe ravi dans le zinc qui doit le déposer à quelques miles de chez son futur ami.
Comme tous les exilés de la planète, Youenn Gwernig cherche la compagnie de ses compatriotes. Il fréquente les cercles culturels et associations multiples où se réunissent fréquemment les bretons de New York. Il retourne régulièrement en Bretagne. Cela fait déjà une dizaine d’années qu’il mène cette vie d’émigré volontaire.
Tout le long du trajet, il pense avec un peu d’appréhension à ce que va être cette première rencontre avec Jack, ce curieux écrivain américain affublé d’un nom typiquement breton. Il se demande comment il va être accueilli par le bonhomme. Il sait si peu de choses sur lui, sur son œuvre et sa vie. Juste un roman dévoré goulûment et quelques textes parus dans Evergreen, c’est peu pour faire connaissance. Sans ce nom repéré dans la vitrine et retrouvé au sommaire du magazine, sans doute ne l’aurait-il jamais découvert ni approché.
Jack, asticoté sans cesse par toutes sortes d’emmerdeurs, doit verrouiller sa porte et n’ouvre qu’aux amis proches ou livreurs attitrés. Ils ont convenu d’un mot de passe, un nom breton : Kadoudal, que Youenn devra brailler à tue-tête devant l’huis bouclé à double tour.
Arrivé à bon port, le grand gaillard de Scaër Finistère s’exécute de vive voix et v’là nos deux bretons d’Amerloquie qui se tombent dans les bras.
C’est pas discret leurs effusions et toasts tonitruants. Ca fait un de ces baroufs lorsqu’ils croisent le verre. Les mémés du quartier en tressaillent de frayeur. Les yec’hed mad ! déflagrants balancés dans les airs par le farouche guerrier de Scaër font dresser leurs bigoudis et cliqueter leurs dentiers. Aux accents inconnus du chant de beuverie du celte, elles s’imaginent scalpées, violées et torturées, victimes expiatoires de nouvelles guerres indiennes.
Soucieuses de préserver leur flasque intégrité, elles ourdissent en sourdine et sonnent la cavalerie.
Arrive un soldat bleu, solitaire-débonnaire, un poor lonesome hero sans sabre ni monture. Pas de charge ni de salve, il somme poliment les frères de sang breton de la mettre en veilleuse et poursuivre dans le tipi leur pow-wow délirant.
Pas franchement hostiles ni réfractaires atrabilaires, plus jouasses et expansifs que discourtois et agressifs, nos deux potes obtempèrent et vont d’un même élan, rouleur et bon marcheur, vers un havre isolé, conçu et adapté pour le genre de ramdam qu’ils comptent bien se payer.
C’est pas une maison bleue adossée à la colline mais un bar à billard où les mecs de Hyannis viennent picoler le soir et jouer dans le brouillard de leurs mégots de cigares. Jack y a ses habitudes. Il a posé sa marque sur la peau du comptoir. Ici, tout le monde s’en tape qu’il soit ou pas l’écrivain qu’il prétend, celui dont les livres sont traduits en plusieurs langues et lus dans le monde entier. Il est seulement un ex môme de Lowell Massachusetts, qu’a bourlingué partout, qu’est revenu au pays pour se pinter la fiole en leur bonne compagnie.
Après avoir longuement éclusé les bibines et eaux-de-feu coriaces de l’amitié, abondamment déblatéré avec les gars du cru, échangé quelques jolis coup de queue et hurlé victoire autour du green troué, inhalé suffisamment de volutes et remugles effrontés, lequel des deux a eu la barge idée d’aller fouiner en mer ? Clamer à l’océan leur ivresse de trouvaille et serments de revoyures ? Plonger en harmonie dans le flux immuable où paissent les baleines et se fondent les détresses ? Personne ne le saura, puisque Youenn m’a dit qu’il ne s’en souvenait pas.
Ce dont il se souvient, et avec tant d’émotion, ce sont tous les courriers, appels téléphoniques et rencontres qui ont suivi ce week-end mouvementé.
Lorsque Jack se marie avec Stella Stampas, sœur de Sebastian, son plus proche ami d’enfance, tué en Italie durant la guerre, qu’ils vont s’installer à Lowell avec Mémère, Youenn leur rend visite dès que son travail le lui permet.
Jack vient aussi le voir à New York. Ils fréquentent ensemble les bars louches et les boites de jazz. Jack, toujours trop exubérant et gueulard, est souvent à deux doigts de se faire corriger. Le grand Youenn en impose et veille sur lui. T’as trouvé un bon garde du corps dit Lucien Carr à Jack un soir qu’ils traînent tous trois ensemble du côté de Times Square.
Jack, désemparé, désespéré, torturé par ses visions et cauchemars, téléphone souvent au milieu de la nuit. Il délire et tient de longs discours, incompréhensibles pour la plupart, éructe et balbutie, se taît puis redémarre en un flux déroutant, poignant et fulgurant. Youenn est subjugué par la voix déchirante de son ami. Et cela dure souvent des heures. Il n’ose pas raccrocher, même en sachant qu’au petit matin il lui faudra se faire violence pour se sortir du lit et aller travailler. Il ne peut abandonner Jack en cet état de détresse immense, si proche de la mort.
Ti Jean est heureux de cette rencontre avec son copain de Bretagne. Il a besoin de liens fraternels, de partage et de chaleur véritables. Comme autrefois avec Sebastian Sampas, Allen Ginsberg, Neal Cassady, William Burroughs, John Clelon Holmes, Gary Snyder, Lawrence Ferlinghetti, et bien d’autres, il trouve en Youenn l’interlocuteur, le frère, avec qui tout partager et vivre sans retenue. Et ce gaillard-là, qu’est breton comme lui, le comprendra certainement mieux que tous ces intellos d’américains bon teint.
Youenn, qui doit retourner en Bretagne en l’été 1967, lui propose de l’y accompagner. Ils feront le voyage ensemble, jusqu’à Huelgoat. Au dernier moment Jack doit y renoncer. Mémère a été hospitalisée et ses éditeurs attendent le manuscrit de Vanité de Duluoz pour lequel ils lui ont versé des avances.
L’année suivante, Jack, Stella, Mémère et les deux chats, déménagent une nouvelle fois. Ils retournent en Floride, à St-Petersburg. Il écrit à Youenn que cette fois c’est O.K., il fera le voyage avec lui en Bretagne en l’été 1969.
Pas de manuscrit à rendre. Pas d’hospitalisation pour Mémère. Seulement en cet été 69, c’est lui qu’est au plus mal. Il meurt le 21 octobre au St-Anthony’s Hospital de Saint Petersburg.
Quand je tomberai
dans l’affre inhumain
de la mort vertigineuse
je saurai (si
assez malin pour m’rappeler)
que tous les tunnels
noirs de la haine
ou de l’amour dans lesquels
je tombe, sont,
au fait,
des éternités rayonnantes
et vraies
pour moi
184e Chorus
Mexico City Blues
08:25 Publié dans La vie des bêtes racontée aux enfants | Lien permanent | Commentaires (0)
21/09/2007
Passe Ouest
par Alain Jégou
J'ai eu le grand privilège avec Bénédicte Mercier -témoin photographe de la scène- de partir un jour en péche avec Alain Jégou et son équipage. Il faisait trés beau temps, la mer était calme depuis trop longtemps, raison pour laquelle la péche n'a pas été bonne. Travail d'homme de peine, paroles d'homme d'écume. A l'homme je rends hommage en vous offrant des extraits de son recueil, Passe Ouest qui vient de paraître... Une poésie qui sent l'iode, le poisson séché, le fuel, le café et le tabac, la sueur, la fatigue, la peur aussi face aux éléments, à la voix rauque et chaleureuse comme celle du marin de Lorient.

Mélancoliques déjà de notre enfance révolue, nous marchions têtes baissées, cognant nos fronts volontaires aux puissantes bourrasques de vent, dans les rues de la ville endormie, sur les avenues désertes, les places engourdies dans la lumière blafarde de quelques réverbères anémiés, pour gagner le port de pêche où nous espérions trouver un boulot à notre portée, comme débarquer, déglacer ou laver les caisses et les paniers, dans le brouhaha de la nuit portuaire, les couinements des grues, les invectives, les gueulantes et les goualantes lancées par les dockers ou les trieuses, toute la faune énervée des hommes et des femmes qui s’activaient sur les gros rafiots ventrus, les quais ou la criée.
Nippés comme des clodos, des hobos, des brûleurs de dur, des poètes beat , des Kerouac, des Cassady, fonçant à tout berzingue dans la grande nuit américaine ou remontant la Troisième Avenue pour aller se jeter dans les volutes et les chorus d’un Harlem sauvage et passionnel, emmitouflés dans nos blousons et nos parkas, avec la même audace, le même désir fougueux, la même énergie surmultipliée, nous arpentions le pavé de l’Avenue de La Perrière, ombres mouvantes précipitées dans l’univers frisquet, pour accomplir notre grand destin aventureux.
Vers minuit, dans la cohue et le brouhaha , commençait l’embauche des dockers professionnels, puis celle des occasionnels et de quelques ados, manutentionnaires volontaires comme nous, lorsqu’il y avait suffisamment de boulot pour tous. Les yeux rivés sur le tableau des tonnages annoncés, nous tirions sauvagement sur nos gauldos puis recrachions de longues fumerolles bleutées, comme le faisaient tous ces mecs, ces durs à cuire aux trombines burinées par les vents, le sel et le jaja aigrelet de l’existence, en écoutant défiler les noms des heureux gagnants, puis les postes et les bateaux qui leur étaient attribués.
Parfois, dans les nuits de gros arrivages, nous nous retrouvions au pied des grues ou aux tables de triage, puis en fin de vente, la matinée bien avancée, à laver les caisses et le sol de la criée, vannés, lessivés, mais toujours satisfaits de l’effort fourni au sein du groupe , toute cette fratrie frappée que nous nous plaisions à fréquenter, en nous foutant bien de toutes ces médisances et mésestimes dont elle faisait l’objet, de tous les qualificatifs méprisants, injurieux, dont l’affublaient les bourges et les culs bénis de la cité.
En plus des quelques biffetons, l’argent de poche durement gagné, pour nous payer quelques toiles, bouquins, vinyles ou soirées dans les troquets bruyants du centre-ville, nos jeunes corps ,bouillant de fougue et de désir, exultant au contact des formes dévergondées de nos petites amoureuses d’un jour , nous avions l’impression de faire notre révolution en trimant avec les zonards et les loubards du port, toute la populace des marginaux de l’époque. Nous étions neufs, vrais, sincèrement éblouis et gourmands de vie, et nous pensions différemment, autrement mieux que nos parents.
Je n’ai pas oublié ces années où les navires étaient encore si nombreux que les derniers arrivés pour la vente du Pan coupé devaient attendre qu’une place à quai se libère pour pouvoir débarquer leur pêche, ou glisser leur étrave entre deux coques et mettre les gaz en puissance pour les écarter dans les craquements de bordés, afin d’aller coller leur proue au béton balafré.
Non plus l’ambiance survoltée qui régnait sous la criée, les appels et plaisanteries des mareyeurs et poissonniers agglutinés derrière les barrières en attendant le coup de sifflet annonciateur de l’ouverture de la vente de 5 heures. La ruée sur les caisses convoitées et les négociations houleuses qui s’en suivaient avec les patrons de rafiots pour décrocher le produit au plus bas prix.
Ni les vociférations et coups de gueule impressionnants, les rixes et bastons pour un emplacement, une caisse chavirée accidentellement ou un chariot subtilisé sournoisement. Le brouhaha, l’excitation, l’énervement et les corvées d’après-vente pour livrer les acheteurs, les magasins de marée ou les poissonniers ambulants avant qu’ils ne se trissent et embouquent l’avenue de la Perrière pour aller se jeter un grand crème, un verre de rhum ou de blanc, selon l’ appétence de chacun, avant de gagner leurs points de vente attitrés ou les chemins vicinaux de leurs tournées campagnardes.

Conservé aussi en mémoire la précipitation des navires à quitter à nouveau le port, dans la nuit encore bien opaque, la boucaille ou les vents tonitruants, les intempéries ou les calmes plats, la froidure des hivers pince sans rire ou la moiteur des étés facétieux, pour atteindre les zones de pêche avant le lever du jour.
Pas oublié non plus les ventes de fin de semaine, les samedis surchargés lorsque toute la flottille se retrouvait bord à bord, pour inonder le marché de la manne grouillante et frétillante. Les tonnes débarquées, larguées à prix raisonnable ou bradées, selon l’humeur des acheteurs et les envies de leur clientèle, l’éternel problème de l’offre et de la demande.
La rage aux tripes et l’amertume au cœur parfois de voir le fruit de tant d’efforts et prises de risques finir dans les tinettes ou partir à la congélation pour un prix dérisoire. Mais comment prévoir ? (Je laisse aux gommeux des hémicycles et prétentiards des officines décisionnaires le soin de répondre à cette épineuse question . Ils ont sûrement quelques solutions toutes prêtes dans leurs attachés-cases , genre diminution de quotas ou destruction de quelques navires en sus, en omettant bien sûr d’aborder le problème de la concurrence des produits d’importation en provenance de pays où les marins sont payés à coups de trique pour naviguer sur des rafiots plus pourris que ceux qui se délitent depuis des décennies dans nos cimetières marins).
Emu aussi au seul souvenir de ce vieux qui trimballait son ennui sur les quais, un après-midi que nous rentrions de marée, ce vioque avec ses yeux bleus mouillés , sa voix cassée et son crâne déplumé, qui nous observa longuement avant de se décider à l’ouvrir et tenter d’instaurer le dialogue, posant quelques questions sur l’actualité du métier avant d’ évoquer ses propres années de navigation tandis que nous débarquions notre pêche. C’était un ancien bosco des chalutiers, qu’avait passé toute sa carrière, débutée à 15 ans, terminée à 55, à trimer et morfler dans le nord de l’Atlantique, entre Ouest Bretagne, Ouest Ecosse et Mer d’ Irlande. Un vioque bourlingueur à la carcasse usée par toutes ses années de galère, qui ne parvenait pas à réprimer ses émotions lorsqu’il me racontait son port de Keroman des années 50 et 60, comme « c’était grouillant de vie et débordant d’activités à l’époque », alors « qu’aujourd’hui, c’est tellement triste cette criée craspec et ces bassins sans navires ! » . Ca me touchait âpre ses propos et regrets. Je sais, la nostalgie c’est jugé plutôt nase par les temps qui courent où il est de meilleur ton de sprinter après la rentabilité, sans sentiments ni états d’âme surtout. N’empêche, j’oublierai jamais la conversation que j’eus en cet après-midi d’un certain mois de mai avec le vieux bonhomme nostalgique. Je comprenais tellement bien ce sentiment qui l’étreignait, cette si désagréable sensation de spoliation, toujours le même manque obsédant, la même impression de disparition absurde et le temps qui filoche sans espoir de retour, la vie qui nous fuit et toutes ces choses qui changent ou disparaissent autour de nous, qui mutent ou s’évanouissent pour nous rappeler à quel point nous sommes fragiles et périssables.

Milliers d’heures égrenées à l’horloge de la criée depuis cette brève conversation. Bien des choses ont encore changé. La vente s’est informatisée. Le plus gros des acheminements se fait par camions. Les magasins de marée ont été transformés, modernisés, mis aux normes européennes. L’époque est férue de conformité, d’uniformisation et de normalisation. Honnis, exclus, broyés, soient ceux qui ne peuvent ou ne veulent se fondre dans le moule ! «Inconcevable ! Intolérable ! Comment peut-on tenir propos aussi rétrogrades ? » Beaucoup de navires ont été vendus ailleurs, offerts en pâture aux pelleteuses massacreuses, débités à la tronçonneuse ou au chalumeau, sabordés et coulés en loucedé dans un secteur choisi, sans concertation avec la profession, par les autorités du quartier, abandonnés à la vase des cimetières marins ou déposés sur des ronds-points au milieu de parterres de fleurs et de chiures de piafs citadins. Le vioque doit être mort aujourd’hui et c’est tant mieux pour lui. Il était déjà tant usé, déprimé, pas la tronche ni le cœur à faire un centenaire. Heureux qu’il n’ait assisté qu’au début de l’action de bouleversement et d’éradication .
Adaptés, intégrés, sortis bon an mal an de la marginalité, les survivants de la « filière pêche » ont dû serrer les dents, faire des concessions, s’asseoir sur certaines libertés pour conserver leurs permis de navigation et leurs licences d’exploitation. Restent les plus coriaces et suffisamment passionnés, ceux qui parviennent à oublier toutes les mesquineries et directives iniques pour continuer à naviguer leur vie sur l’océan géant. Ceux qui vivent le présent, sans souci du danger, avec la même passion que ceux qui les ont précédés. Sachant fort bien qu’une fois le port quitté, plus rien ni personne, même le plus pointilleux des inquisiteurs tourmenteurs, ne parviendra à leur pourrir le rêve ni altérer un seul instant leurs plus folles et somptueuses émotions. Une façon de raisonner, d’éprouver, de se comporter, qu’aurait certainement plu au vieux bosco nostalgique.

Coincées entre la coque et le vivier, les couchettes s’imbibent et mouillent leur paillasse à chaque coup de roulis. Les paquets de mer et les embruns roublards, s’immiscent, pénètrent partout, sous les cirés, les vareuses, les pulls, les jeans et les sous-vêtements, s’écoulent le long des corps transis, assiègent le poste-avant, glissent sur les barrots de pont, imprègnent allègrement les duvets, les couvertures, les frusques de rechange et les taies bricolées.
Trempées, salées, craquelées, violacées, les chairs exsudent à leur tour leur excédent d’humeurs et de douleurs muettes. Trop exténuées pour se défaire de leurs enveloppes de toile et de tissus grossiers, ratatinées comme des sardines dans la saumure, usées, blasées, elles frémissent brièvement avant de s’écrouler dans l’humidité, les effluves de fond de cale et la froidure intruse qui investissent leur couche.

Le crépuscule dissout toutes les esbroufes et tracasseries de la journée. Contrairement à tous ces gens qui redoutent l’ombre et l’opacité des nuits sans lune, il me plaît de naviguer à l’aveuglette, de tâtonner de l’étrave dans la vague fantôme qui vient froufrouter du suaire contre la coque errante, de sentir, pressentir, deviner, imaginer l’espace et me l’approprier sans aucune influence, le gérer à ma guise et contrecarrer au débotté.
Excitant aussi d’être bigleux lorsque tout s’agite et bourbouille dangereusement autour de soi. Plus angoissant pour certains, plus fascinant pour d’autres. Tant qu’à se colleter avec le spécieux des éléments, autant le faire dans les plus enivrantes conditions.
L’agressivité et la furie de mer trempées dans le brou de la nuit , n’ont plus les mêmes prestance ni transparence. Plus sournoises, plus insidieuses, elles peuvent paraître encore plus redoutables, ou captivantes, selon la façon que l’on a d’apprécier les qualités de la prestation.

Refouler toutes les aigreurs et amertumes passées. Se refaire un faciès, une dégaine, une démarche, un discours, une devanture, une manière d’être et de se reconstituer dans l’ailleurs farouche, juste pour pouvoir s’accepter et s’immiscer de temps à autre dans le moule ridicule de la conformité.
Après des années d’efforts et d’inconfort, de mistoufles et d’effritements, des marées de violences et d’écoeurements , d’émotions et de fascinations, avec tout le lot de petites joies dérisoires et de sentiments d’accomplissement poilants. On a eu beau dire et gémir, hâbler et s’emporter, médire et maudire, c’est pourtant sur la mer, seulement là, qu’on a pu goûter au chiche bonheur de se sentir entier. Pour vivre, pas mieux mais différent.
N’importe quel soliloque étranglé par le temps, le cri d’intempéries aux mœurs dissolues, l’hululement des vents et l’obsédante harangue du flot intransigeant.
N’importe quelle méditation sabotée par la clameur des orages gougnafiers, la méchante mélopée des nues exacerbées, le swing des ciels de grêle, le rut des foudres et des antiennes, les crissements, craquements, claquements de tons des ondes et des ondées, le tempo délirant des forces subversives.
N’importe quelles sensations affectées par la hardiesse des agressions, l’ampleur des dépressions, l’afflux de haute tension et le chahut énervant.
N’importe quel pet de plombs possible en n’importe quelles conditions de ciel et d’océan. Juste dit pour obtenir un chouia d’attention et de compréhension. Pour ne plus subir seul n’importe quelle déveine, naufrage ou débine de sentiments.

Lorsqu’on se trisse vers un ailleurs c’est toujours avec l’espoir de trouver un brin de bien-être ou de plénitude en sus, du moins quelque chose qui pourrait y ressembler, comme une espèce d’équilibre, de sérénité à deux balles, susceptibles de combler nos lacunes et lézardes existentielles .
Lorsqu’on se lance dans l’aventure, décide de tout laisser derrière soi pour entreprendre le voyage, on a toujours cette naïveté d’y croire. On imagine et magnifie. On occulte la fatigue et les embûches, se débarrasse de l’anxiété pour se berlurer le méningé, ne plus voir que le choucard côté des choses, les belles miches de la vie nouvelle qui nous attend à l’arrivée.
Lorsqu’on met son sac à bord d’un rafiot de pêche, c’est aussi pour se payer une bonne tranche de dépaysement, une espèce de dinguerie, de folie furieuse, susceptible de nous faire oublier tous nos emmerdes existentiels. On pourrait, à condition de ne pas craindre de passer pour un vantard ou un débile profond, comparer aussi cet embarquement-là à une espèce de quête d’évasion, de plénitude, avec quelque âpreté en sus, juste pour le fun et la beauté du geste.
Même le cerveau méchamment secoué et arrosé, ça reste quand même une somptueuse expérience, à condition qu ‘on ait suffisamment de résistance et d’obstination pour continuer à s’en persuader. L’illusion grassement nourrie pour triompher du maousse blues aqueux, c’est pas pour rien qu’on entretient la chose, qu’on continue à se leurrer et sublimer envers et contre tout. La seule façon sûrement de ne pas être définitivement largué.

Baratin du tintouin mutin dont il est de bon ton de s’extasier lorsqu’on a les pieds au sec et le cul bien calé dans le moelleux d’un canapé sis derrière la baie vitrée d’une villa ou la banquette d’une bagnole aux essuies-glaces actifs garée sur un parking du bord de mer.
Et aussi la démesure, le chaos hystérique projeté grandeur presque nature dans les cerveaux confits. Une salle obscur ou un écran de téloche, rien de tel pour se fader le grand frisson, le pif bien carré dans l’haleine d’infini et les châsses enchâssées dans le décolleté des vagues siliconées.
L’aventure à portée de main et d’esprit, par l’entremise de quelques clichés et scènes de pêcheries mouvementées. Décor ad hoc pour frimeurs en quête de sensations fortes. Rêveurs, chabraques mais pas téméraires, toujours en mal de sensationnel virtuel.
Le culte du héros ordinaire, le type un peu brindezingue, qui se collète avec un univers hostile, ça fait ardemment saliver, s’extasier les illuminés, beaucoup moins ceux qu’ont réellement endossé la défroque du fêlé.

Entretien avec Slaheddine Haddad publié le 30 septembre 2004 dans le quotidien tunisien Le Renouveau.
S.H. - En avant-propos de votre Carnet de bord, IKARIA LO 686 070, on peut lire les lignes suivantes : « puisse ce mince témoignage vous permettre de découvrir et connaître un peu mieux cet univers qui fut le mien durant toutes ces années, et le demeurera tant qu’il me restera une goutte de sang iodé pour faire naviguer le cœur en cet étrange et fascinant ailleurs »
C’est toute une vision du monde que vous nous révélez et on a comme l’impression que dans une mer le ciel n’est pas le seul à se refléter ?
A.J. - Oui, c’est toute une vision du monde, plutôt d’un monde, si peu ou mal connu, que j’ai voulu faire découvrir au lecteur, en relatant les faits et gestes, les attitudes et âpres aptitudes d’un univers mouvant et diantrement émouvant, fait de tumultes, d’affrontements, de douleurs et de violences, de fracas et de turbulences, mais aussi, de temps à autre, de bonaces, de quiétudes, de bonheurs paisibles et de sérénité suave, un monde qui, tour à tour, bouillonne et vitupère, s’exalte et exulte, roule et houle, miroite et ondule, chamarre et réverbère, pactise ou exaspère, loin les cités et le staccato des mouvements de la vie ordinaire.
C’est « cet étrange et fascinant ailleurs », ces étendues marines de l’Atlantique Nord, avec leurs frasques tempétueuses et sautes d’ humeur fréquentes, et toute la fascination qu’elles font déferler dans le cœur des hommes qui sont assez fous, passionnés et téméraires pour y fourvoyer leur vie, qui font la matière première de ce livre.
S.H. – Ce qui frappe dans vos écrits, c’est cet amour démesuré pour les choses et les hommes de la mer que la houle n’arrive pas à défaire.
A.J. – La résistance, autant physique que mentale, la maîtrise de soi et l’obstination sont les qualités primordiales dans notre métier, aussi le respect et la conscience permanente de la puissance des forces qui nous entourent. Il n’y a aucune chance de survie dans ce boulot sans un minimum d’humilité. C’est tellement disproportionné ! Il faut savoir se faire accepter, tolérer, par le flot. Pas de fanfaronnades ni d’esbroufe, surtout pas ! C’est une histoire de passion et d’attraction entre l’homme et l’élément, deux natures résolument ardentes et solitaires qui se confondent dans le fracas et la démesure.
On ne gagne jamais contre la mer, on observe, on soupèse, on évalue, on négocie, on agit et manœuvre du mieux qu’on peut et c’est toujours elle qui décide de l’issue de la partie. Lorsqu’elle veut engloutir et défaire, rien ni personne ne peut l’arrêter ni se soustraire à son étreinte meurtrière. Elle peut être particulièrement cruelle, implacable et injuste, et c’est à nous de composer et réagir en conséquence, à nous de nous adapter pour durer.
S.H. – Cette alternance entre la pêche et l’écriture (deux activités complémentaires) a été rompue depuis quelques mois puisque vous avez décidé de quitter une mer qui elle, ne vous a point quitté. Comment vivez-vous ce semblant de divorce ?
A.J. – Je ne pense pas qu’on puisse comparer ma cessation d’activité professionnelle à une espèce de divorce entre la mer et moi. J’ai seulement cessé de naviguer à la pêche, mais ne me suis pas éloigné d’un pouce du rivage qui m’a vu naître. Trop accro à cet environnement-là pour parvenir à respirer et exister ailleurs.
C’est très éprouvant ce métier, physiquement surtout. Le corps souffre de tous ces frimas, intempéries, coups de tabac, qu’il subit inexorablement. Au fil des années, la charpente craque et les articulations ont de plus en plus de mal à remplir leur fonction, le moindre effort peut se transformer en véritable calvaire. Passé le cap de la cinquantaine peu sont ceux qui peuvent se targuer de ne point souffrir de cette oxydation de la carcasse. Comme les vieilles coques, nos abattis rouillent et se détériorent sous l’effet de la corrosion, des embruns et des vents.
L’esprit aussi est souvent mis à rude épreuve. Non seulement la tension permanente causée par le poids des responsabilités à bord, la tenue du navire et la sauvegarde de l’équipage, le choix des zones de pêche, l’importance des captures à assurer pour préserver la rentabilité de l’entreprise, mais aussi le bras de fer constant avec les administrations et organismes communautaires européens, les contrôles en mer et à la criée, les décrets et directives iniques et inappropriés, ont eu raison de mes enthousiasme et détermination. Après une trentaine d’années consommées sur le flot déjanté, il m’a paru plus judicieux de jeter l’éponge que de m’obstiner à poursuivre une aventure exténuante qui m’apportait désormais plus de tracas que de joies.
Je m’investis un peu plus dans l’écriture à présent, tout en conservant un œil sur l’océan qui roule et gronde immuablement sous mes fenêtres.
S.H. – Prendre le large, c’est comme aller au front, pourtant il doit exister une différence, un sens ?
A.J. – A chaque nouvel appareillage, lorsqu’on largue les amarres pour gagner le large, comme l’environnement nos sentiments varient selon les saisons. Ce sont les conditions météorologiques et l’état de la mer qui déterminent l’état d’esprit de l’équipage.
En hiver, il est toujours difficile de devoir tout quitter pour aller mettre son existence en péril dans la nuit froide et venteuse, aller se colleter avec un océan particulièrement irascible et violent, mais une fois le cap affiché, le port laissé loin derrière, les souvenirs de quiétude et de confort estompés, lorsque l’étrave pioche dans la vague énervée, ce sont toujours l’excitation et le désir de surpassement qui reprennent le dessus.
Je n’oserais comparer la mer à un champ de bataille, car les risques de s’y faire tuer sont tellement moindres ! Au front, la mort peut survenir de n’importe où et à tout moment. Sur l’océan, même dans les pires conditions, lorsqu’on a suffisamment d’expérience et de vivacité, il est toujours possible de pressentir le danger, de voir venir la déferlante assassine, et de faire l’impossible pour lui échapper. En mer, il y a la vie, fougueuse, intempestive et majestueuse, qui peut de temps à autre se révéler dangereuse. Au front, il n’y a que la mort, sinistre, sournoise et répugnante.
S.H. – Toujours dans ce carnet de bord, vous dites : « La mer est une femelle exclusive et démonstrative, aguicheuse et embobineuse, embosseuse et dévoreuse. (p.43). Elle nous suce les sangs, nous vampirise et se nourrit de toutes nos forces vives ». En terminant la lecture du carnet de bord, on a quand même cette vive impression que la mer est plus que prenante pour le pêcheur que vous êtes, ne laisse aucune alternative ?
A.J. – Je me permets de comparer la mer à un personnage féminin, un être particulièrement présent, exclusif, absolu et véhément, parce que c’est ainsi qu’elle m’est toujours apparue. Lorsqu’elle m’a mis le grappin dessus, j’ai compris que c’en était fini de mes ternes insouciances et libertés factices. Pas de demi-passion possible, à la vie-à la mort dans la beauté sublime de ses galbe et rondeurs, ou le minable ennui dans les paysages mornes, frigides et figés de quelque campagne ou cité. J’avais le choix des épousailles, mais la mariée était si séduisante que je n’ai pas hésité un seul instant à m’embarquer avec elle. C’était la plus folle décision que je puisse prendre , mais je ne l’ai jamais regrettée.
S.H. – Qui est Alain Jégou, un pêcheur-poète ou un poète-pêcheur ?
A.J. – Et un pêcheur-pécheur aussi bien sûr, puisque avant tout humain parmi les humains, frère de tourments et de douleurs de tous les êtres égarés dans la folie des temps, luttant pour leur survie sur tous les continents et toutes les mers de la planète Terre.
22:45 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (2)
ESSAI NON TRANSFORMABLE
Notre P'tit Ballouhey Hebdo.....

11:45 Publié dans La vie des bêtes racontée aux enfants | Lien permanent | Commentaires (0)
17/09/2007
Kerouac en Bretagne (épisode 2)
par Alain Jégou

Pas d’autre solution que se rabattre sur Montparnasse et sauter dans l’express pour poursuivre sa valoche et l’aventure bretonne. L’ex serre-freins de la Southern Pacific s’installe peinard entre un curé de cambrousse et un biffin blondin sur la banquette verte du compartiment de 2e classe.
Terne des adjas et de réciprocité aventurière, l’ambiance croupit dans la mouscaille et le mutisme forcené. Il cherche le dialogue et ne récolte que quelques regards fuyants.
Le Paris-Brest n’est pas le Zipper d’Arizona. Pas de hoboes planqués derrière les pylônes en attendant de sauter sur les wagons en mouvement, pas de voyageurs glandeurs, de brûleurs de dur, de bhikkus en éternelle partance pour quelque horizon supposé plus clément. Rien que des bobonnes et leurs chiards grincheux, des matafs, des troufions, des étudiants studieux, des paysans rougeauds, des vacanciers pâlots et des représentants de commerce.
Prolixe et facilement liant, Jack s’acoquine avec un gars du cru, un rennais, un assoiffé chronique, aussi atteint que lui. Ils fraternisent et se pintent éperdument dans le wagon-restaurant.
Le gars descend à Rennes. Jack continue à boire en reluquant de son œil schlass les lumières éparses qui éclairent subrepticement la sombre et mystérieuse campagne bretonne.
Au terminus à Brest, il est sévèrement blindé lorsqu’il glisse sa carcasse lasse et titubante dans la sinistre nuit emboucaillée, une espèce de cinglé, avec un imperméable et un chapeau errant sur le bitume et les pavés trempés de la rue de Siam.
Les cafetiers lui tirent la tronche. Les hôteliers lui ferment la lourde au nez. No place to go. Même pas une boîte de jazz où boire du bon whisky, fumer quelques Lucky, en écoutant de la bonne, louf et poignante musique, où s’éclater en consommant le be-bop à même le pavillon du sax ténor ou le jeu cascadeur des doigts du pianiste. Aucun havre familier où larguer son spleen et relâcher en bonne et chaude compagnie, échanger quelques joints et chorus choucards, se sortir du suif existentiel en se plongeant la tronche dans des sons dingues, des trucs à la Lester Young, Thelonius Monk ou Charlie Parker, ce vieux Charlie, évadé de ses affres et déglingues, libéré de son Camarillo de merde, revenu de la mort pour souffler rien que pour lui, faire fuir tous les esprits sournois et malfaisants collés à ses basques en déroute, d’un seul flux de son saxo cool, niquant l’ambiance tocarde inhérente à la ville. Aucune chance de tâter de cette munificence-là. Ici, on n’a jamais vu personne ressurgir de la tombe pour des motifs aussi futiles que souffler dans une espèce de biniou coz en métal doré, faire la bamboula en se piquant le pif au lambig étoilé et en fumant des espèces de clopes bizarres qui font exorbiter les châsses et brouiller les idées. Ici, en ce pays dévot et respectueux des traditions, on a une bien plus noble idée de la résurrection.
Jack est donc condamné à passer sa première nuit bretonne dans la solitude des ruelles à apaches, effrayé par la brume océane et le calme troublant des quartiers louches qu’il traverse. Les rives de la Penfeld ne ressemblent en rien à celles de l’Hudson River et les réverbères anémiés de la place de Plougastel aux néons pétulants de Times Square. Les marlous qui y font michetonner leurs gueuses n’ont pas l’œil fellaheen des petites gouapes new yorkaises.
Il se croit victime d’une machination, d’un complot, que quelques malfrats bretons, dissimulés dans l’ombre des porches, projètent de l’estourbir pour lui dérober son fric. Désemparé, paniqué sur ce terrain lugubre et hostile, il court chercher assistance et refuge à la gendarmerie.
Ce poltron de Breton (moi) dégénéré par les deux siècles passés au Canada et en Amérique ! … ce farceur de blagueur des galeries d’art de New York qui s’en va pleurnicher dans les commissariats…se moque-t-il de lui-même dans le Satori à Paris.
Jack n’hésite jamais à dévoiler ses moindres faiblesses et étranges traits de caractère, faisant œuvre de toutes ses expériences et ne dissimulant rien , même des plus infimes détails, ne maquillant jamais ses réactions et sentiments en toutes circonstances, n’hésitant pas à rire et se moquer de lui-même lorsque ses attitudes et réflexes lui paraissent ridicules. Jusqu’au boutiste dans le don de soi, toute son œuvre est un strip intégral, une mise à nue sincère, en même temps qu’une mise à mort bouleversante.
Réfugié dans un hôtel de passe où l’ont conduit les cognes, Jack trouve enfin un peu de sérénité et de repos physique. Quelques heures seulement avant que les scènes successives de crapahutages torrides produites dans les chambres voisines ne viennent troubler son sommeil, et ses irritations du gosier lui rappeler sa proche bamboche passée.
Une mousse alsacienne et quelques tartines abondamment beurrées- salées en guise de petit dej. Et vl’à notre grand auteur canadien-français-breton-américain requinqué pour un temps, remis sur ses cannes d’ex footballeur universitaire, prêt à arpenter le pavé brestois. Visiter la ville ? Faire du tourisme ? Aucun intérêt ! Sa préoccupation immédiate : trouver un bar où s’approvisionner en cognac et le bureau de la compagnie aérienne où récupérer sa valise et prendre un billet pour le premier vol direction Londres ou Paris, se tirer de cette maudite city, aussi gaie que le mont de la Désolation et attirante que le Spectre de la Susquehanna.
Aussi séduisants que soient l’art et la culture, ils sont inutiles s’il n’y a pas la sympathie. – Toutes les joliesses des tapisseries, des terres et des peuples : - aucune valeur, aucune, sans la sympathie. Et Jack n’éprouve aucune sympathie, et n’en perçois aucune non plus émanant de cette ville frigide et indifférente à ses boires et déboires. Cependant, il a fait le voyage pour retrouver traces de sa famille, alors acceptant la proposition du bistrotier-bookmaker Fournier de prendre rendez-vous avec un certain Lebris, restaurateur de son état, choisi au hasard parmi tous les Lebris figurant sur le bottin téléphonique, il se rend à l’auberge du lointain cousin prénommé Ulysse.
Un curieux paroissien que cet Ulysse, qui le reçoit avachi sur son pieu, scotché entre une bouteille de cognac et un paquet de cigarettes. Jack délire sur la physionomie du bonhomme, l’approche circonspect, puis sympathise prestement dès qu’il l’invite à goûter à son cognac. Les deux hommes sirotent et papotent en toute amitié, comparent leurs généalogies et passions littéraires avec le même entrain. Lebris de Kerouac et Lebris de Loudéac, deux hobereaux à la mode de Bretagne, pareillement fascinés l’un par l’autre, délirant à plein tube sur le même ton enjoué, ironiquement châtié et drôlement élégant.
Ulysse Lebris de Loudéac n’aura aucune révélation capitale à faire à Jean-Louis Lebris de Kerouac concernant ses origines, mais les deux hommes auront certainement eu plaisir à se rencontrer.
Replongée houleuse dans la lumière et le flux bigarré de la rue de Siam. L’esprit échauffé et les guibolles flageolantes, Jack traîne sa valoche et ses pensées lourdingues, vers la gare fugueuse. Il voit trouble et la sueur lui fait palpiter le cœur. Il s’essouffle, clopine, peste et rate son train. Nouveau ratage pour un voyage raté, une quête manquée pour faute de sympathie et de reconnaissance mutuelle entre un pays et le plus désespéré de ses fils prodiges.
Dessin Yves BUDIN
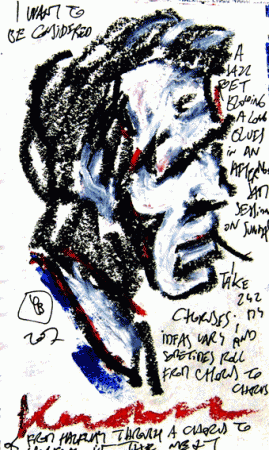
18:35 Publié dans La vie des bêtes racontée aux enfants | Lien permanent | Commentaires (0)
14/09/2007
la vie aux indes (5)

Photo: Bénédicte Mercier
Sa pile de dossiers posée à coté de lui, le fonctionnaire l’ignorait. Avec une lenteur inimitable, il souleva chacun des feuillets, les lus et appliqua son tampon sans produire de bruit. Le ventilateur pour ne pas éparpiller les dossiers ou pour garder l’allure de sérénité qui se dégageait du lieu tournait très lentement aussi. Punaisé au mur ; un portrait de Ganesh badigeonné de taches safran. Des toiles d’araignées s’y accrochaient ainsi qu’à chaque angle de la pièce. Aucun mobilier neuf, des meubles et des chaises en bois aux accoudoirs absents. Le sol était gris, les murs gris bleu passé. Pas de carreaux aux fenêtres, seulement des grilles.
Dans cette absence de mouvement son attention a été attiré par un tout petit insecte qui marchait sur le col de chemise du fonctionnaire. Il l’observait avec une telle insistance que cela incita le rond de cuir à regarder. Un pou s’y déplaçait lentement. L’homme le vit aussi, le pris entre ses doigts et l’écrasa entre ses ongles noirs sans autre façon.
08:55 Publié dans De la poésie au quotidien | Lien permanent | Commentaires (0)
11/09/2007
KEROUAC EN BRETAGNE (épisode 1)
Par Alain Jégou
N.B. Ce texte a été publié pour la première fois par les éditions Blanc Silex
“Little boys are angels crying in the streets waiting for green lights”
« Si qui que ce soit me dit que je me berce d’illusions ou que j’ai la « prétention de posséder un esprit supérieur » ou encore que j’essaie de « m’élever au-dessus du peuple », comme Le soutient Mon père, je leur dirai que ce sont Des idiots et je continuerai à écrire, à étudier, à voyager, à chanter , à aimer, à voir, à écouter et à sentir… »
Jack Kerouac

Les spécialistes ont déjà bien bossé, brossé Le portrait et trifouillé tout leur soûl en l’âme bizarroïde du pseudo « pape de la beat generation ».
Comme pour Rimbaud, Artaud ou Céline, ces déjantés géniaux et énigmatiques de la littérature mondiale, Des milliers de pages tentent de décortiquer Le pourquoi du comment et Le comment du bagout poignant de Jack, l’ex môme de Lowell Massachusetts, devenu par la puissance de ses proses et poésies, un Des plus grands auteurs du vingtième siècle. Pas un jour sans une ligne ou un article de presse consacrés à son phrasé époustouflant ou à son personnage déroutant.
« Alors, à quoi bon en rajouter ? » me direz-vous, avec la pertinence qui vous caractérise, cher lecteur taquin mais non moins adoré. Je n’en sais trop rien, je vous l’avoue sincèrement. Sans doute l’irrésistible besoin de paraître et faire à Mon tour Le malin en ajoutant Mon blaze breizheux à la longue liste Des amoureux de It Jean Le fondu fulgurant. Ou l’incoercible désir de remettre quelques cloche-
Tons et carillons à l’heure, de réagir à certaines affirmations et revendications irritantes Le concernant. Ou simplement de vous dévoiler, avec la maladresse et la fougue puérile qui me caractérisent, à quel point je me suis entiché de cet auteur et de son verbe poignant.
Je tiens, avant d’entamer Mon laïus broussailleux, afin de clouer Le bec à tout intégriste grincheux ou pointilleux notoire, soucieux de me chercher quelques poux en tête, à informer Le lecteur que je me suis permis quelques petites espiègleries en reprenant Le fil Des mésaventures brestoises du Sieur Jean Le Bris de Kerouac. Quitte à broder et m’éclater Le baragouin sur quelques faits et gestes du ci-devant baron, j’ai préféré m’engaillardir sur as prose du Satori à Paris plutôt que m’appesantir en quelque méticuleuse et ennuyeuse relation historiquement correcte. Les heureux protagonistes de cette rencontre historique me Le pardonnent.
Jack Kerouac et la Bretagne ? Quel curieux deal entre ces deux-là ? Quels liens étranges peut-IL y avoir entre l’écrivain nord-américain et la Terre de ses lointains ancêtres ?
Quel rapport entre nous, arrimez à Notre vioque caillou armoricain, et Jack Le hobo courseur de nuages et espaces amerloques ? Sûrement plus d’affinités et de passions communes qu’il n’en pourrait paraître au premier abordage.
D’aucuns NE voudraient de Jack retenir que la bio farfelue et ambiguë, ses frasques et attitudes contradictoires, son caractère fantasque et ses emportements lunatiques, ses débordements et comportements dérangeants, ses crises de mysticisme baroque, ses beuveries et décollages effrénés, oubliant ou occultant délibérément l’essentiel, as prose prodigieuse, son tempo convulsif, as rythmique fantastique.
Jack Kerouac EST avant tout un écrivain, et l’un Des plus grands. Il serait bon que certains cessent de vouloir Le faire passer uniquement pour l’auteur phare d’une génération, Le grand frère Des hippies, Le routard rebelle, chef de file de la contestation étudiante, de tous les mouvements mutins de l’Amérique postmaccarthyste, Le chantre de toutes formes de défonces artificielles et provocs sexuelles. Récup minable et réductrice, cette image racoleuse, arrangeante pour les fourgueurs de mythes juteux, les marchands de tee-shirts, posters et autres gadgets contre-culturels, comme pour certains biographes scrofuleux du bulbe ou producteurs-rappeurs de sitcom littéraires.
Des multiples ouvrages qui lui Ont été consacrés, ceux de Ann Charters, Gerald Nicosia , de Yves Le Pellec et de Victor-Lévy Beaulieu contiennent, à Mon Avis, les propos les plus intelligents et perspicaces qui aient été écrits sur Kerouac.
Ann Charters a rencontré Jack et travaillé avec lui sur as biographie. Gérald Nicosia a longuement enquêté auprès de tous ses proches. Il a recueilli une Somme considérable d’anecdotes et documents qu’il nous dévoile et fait partager en y incluant tout Le respect et l’admiration éprouvés pour l’écrivain Le plus novateur de son époque. Le Pellec et Beaulieu se sont baladés et engagés avec la même passion dans l’œuvre singulière, inclassable, erratique.
A gauche comme à droite, Kerouac EST vilipendé ou ridiculisé, dénoncé comme « barbare », « ignare », petit-bourgeois dépravé, dangereux délinquant, propagandiste subversif, agent de décadence, ferment d’obscénité, etc. Le caractère grotesque de tels jugements saute aux yeux de qui connaît un tant soit peu l’œuvre de cet auteur qui était Le contraire même de tout cela : romantique, timide, hypersensible, passionné de littérature, de bibliothèques et d’encyclopédies depuis l’enfance, et surtout solitaire, individualiste, étranger à toute théorisation. nous dit Yves Le Pellec.
Son succès grandissant, les mêmes qui l’accusaient de toutes ces turpitudes et infections mentales s’acharnèrent à glavioter sur ses écrits et dénigrer leur inventivité.
Les plus grands auteurs ont toujours inquiété et attiré sur leurs œuvres et personnalités les plus viles et violentes critiques. Pour les bien assis et les laborieux encartés, le talent est une tare, un défi qu’il faut réprimer, une provocation envers la bienséance et la reconnaissance officialisées.
Kerouac n’a pas échappé à la meute et ses attaques perfides. Barbare, ignare, dépravé… lui le plus ému, sensible, douloureux et passionné des êtres, Ti-Jean l’archange vagabond aux ailes alourdies par la poussière des highways, les escarbilles des locos, le poids de ses angoisses et visions, et l’agressivité permanente du monde, l’idéaliste convaincu, assoiffé d’absolu, bourré d’indulgence et de compassion, seulement désireux de témoigner, de s’expurger de tous ses démons et tristesses, de devenir l’égal des Melville, Céline, Emerson, Whitman, Thoreau, Dostoïevski…un auteur à part entière, reconnu pour tel et aimé par tous.
Pour obtenir ces reconnaissance et amour, il n’a reculé devant aucun sacrifice, cramant délibérément toutes ses forces vives aux braises corrosives de toutes formes d’ expériences , poursuivant sa quête d’absolu en vivant, à l’image de Rimbaud, « le long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens ». Alcool, benzédrine, cannabis, peyotl… Kerouac a tout expérimenté, et à forte dose, afin de produire et soumettre au monde son œuvre débridée. Des nuits et des jours sans sommeil ni repos, dopé au rythme saccadé de son Underwood, aux volutes concentrées de mégots inextinguibles et aux rasades de cognac et whisky vivement et régulièrement ingurgitées.
Douze livres écrits en seulement sept ans, des millions de signes arrachés aux multiples tourments et frénésies nocturnes. Tout cela dans le silence et le mépris général des éditeurs sollicités par lui ou son ami Allen Ginsberg , tous ceux qui ont sûrement regretté après coup d’avoir manqué le coche en refusant les écrits de cet auteur dont les ouvrages se vendent aujourd’hui à des millions d’exemplaires partout dans le monde, dont les manuscrits originaux atteignent des sommes considérables, indécentes, dans les ventes les plus courues de la planète. On the road , le manuscrit en rouleau de Jack et celui du Voyage au bout de la nuit de Louis Ferdinand Céline ont été vendus à quelques semaines d’intervalle, chacun pour plusieurs millions de francs ou dollars, dans des galeries huppées où ni Céline, ni Jack, n’auraient été autorisés à pénétrer en leur fin de carrière dérangeante, achetés par des peigne-cul bouffis de fric et de suffisance qui, croisant nos deux énergumènes sur quelque trottoir de Paris ou de New-York City se seraient vivement écartés de ces êtres craspecs et cintrés.
Lorsque vinrent enfin le succès et la reconnaissance, si longtemps attendus, Jack était épuisé, bouffé par ses années de dérives, défonces et travail de création intensive.
Il vécut très mal tout le cinoche imposé par les médias, ses éditeurs et ses lecteurs, tous excités par sa soudaine notoriété. Il essayait, tant bien que mal, de faire bonne figure et de ne pas décevoir. Il était trop chaleureux, trop cordial et attentif, soucieux de ne blesser personne, au point de préférer se détruire en ingurgitant d’importantes quantités d’alcool avant chaque lecture ou interview plutôt que de se soustraire à toute curiosité malsaine et marques de sympathie douteuse.
Venus trop tardivement, le tintamarre et la gloriole médiatiques, les feux de la rampe braqués sur son œuvre et sa personne, l’emmerdaient profondément. Embringué définitivement dans son trip solitaire, il était loin, très loin, de toute cette agitation excessive.
Et personne, surtout pas les mômes qui venaient le harceler jusque dans sa chambre à Saint Petersburg, Hyanis ou Lowell avec ses bouquins enfouis dans leurs poches de parka, leurs sigles peace and love peints sur le front ou tatoués sur leurs bras, ne comprit à quel point il aurait aimé qu’on lui foute la paix.
Et tous d’en rajouter sans cesse, de vouloir le rencontrer, le toucher, se pinter avec le grand écrivain, l’auteur d’ On the road, le célèbre Sal Paradise qu’ils souhaitaient associer à leur révolution festive.
Jack n’avait aucun goût pour les manifs, sit-in et autres longues marches contestataires. A l’opposé de son ami Ginsberg, qui paradait en tête de tous les cortèges bruyants et colorés, il se complaisait dans l’ombre et l’anonymat, subissant sans amertume ni colère les affres de son inexorable dégradation physique.
En plus il n’aimait pas, n’admettait pas, qu’on crache sur la bannière étoilée. Il croyait à la grandeur de l’Amérique, aux valeurs et vérités immuables prônées par ses Pères Fondateurs. Débordant d’admiration et d’amour, il ne pouvait croire que les hommes qui avaient fait l’histoire de ce pays, et ceux qui leur succédaient, puissent être mauvais. Il avait une foi inébranlable en eux comme en la religion de ses père et mère, en la parole de ses amis et l’infinie bonté de Dieu.
Jack n’était pas un vieux réac aviné, facho et raciste, comme certains ont voulu le faire croire. Il était un être fraternel, sensible, un bohème contemplatif et réceptif, qui s’est aussi souvent indigné face à l’injustice et la misère des hommes, de toutes origines et couleurs. Toute son œuvre est un plaidoyer pour l’individu et sa liberté, nous dit son ami Ginsberg.
Seulement il n’a jamais milité pour quelque cause ou mouvement politique. Ce combat-là ne l’a jamais intéressé. Il croyait fermement à la grande fraternité des peuples, mais n’éprouvait aucune sympathie pour toutes les théories et discours forcément pervers et aliénants. Tous les troubles et agitations sociales l’effrayaient et perturbaient âprement, d’où ce rejet viscéral, ses réactions et propos intempestifs, qui permirent à certains journalistes ignorants de le faire passer pour un être exécrable, un calotin obtus, un vieux poivrot atrabilaire et rétrograde.
Kerouac est avant tout l’ écrivain d’une certaine Amérique, celle des grands espaces, des cités tentaculaires comme des patelins glauques tapis au fin fond du désert, narrateur audacieux et infatigable de toutes les pulsions et dérives d’un continent immense et bourbouillant de vie, chantre de toute une faune d’êtres siphonnés, déchaînés, rebelles et débraillés, débordant d’énergie et de générosité, errant d’un océan l’autre, sur la terre rugueuse et l’asphalte rutilant, foulant au pied ou roulant à fond la caisse sur les pistes ouvertes par les pionniers, les héros mythiques de la grande saga nationale, conteur exalté de toutes les aventures, cocasses ou tragiques, déroulées frénétiquement sur le ruban de sa machine à écrire, avec le même rythme et la même effervescence que sur les voies sacrées de l’existence.
Jack Kerouac, écrivain sincèrement et profondément américain, témoin d’une époque, de ses débordements et bouleversements, embringué lui-même dans le flux démentiel du rêve déboussolé, en quête de sa propre vision extatique, cherchant dans le voyage, le partage, l’amour, l’amitié, la musique, la littérature, la religion, la drogue, l’alcool… une espèce d’échappatoire, de libération intérieure qu’il n’atteindra jamais.
Ecrivain du Nouveau Monde, Kerouac éprouvera cependant, durant toute son existence, une certaine curiosité pour le vieux continent, particulièrement cette terre d’Armorique d’où seraient partis les Lebris de Kerouac pour gagner les grands espaces canadiens.
Depuis sa plus tendre enfance, son père l’a toujours bassiné avec son identité bretonne, ce bout de terre aride planté de l’autre côté de l’Atlantique où reposeraient ses plus lointains ancêtres. « Ti-Jean, souviens-toi toujours que tu es breton ! » lui disait sans cesse Léo, comme si cette appartenance était un don du ciel, une qualité extraordinaire accordée à de rares élus. Toujours cette révélation sur ses origines a obsédé Jack. Il y revient fréquemment dans ses écrits, tout au long de sa vie d’errances et de pauses créatrices, il pense à cette Bretagne longuement et bizarrement imaginée. Déjà en 1941, écrivant à son ami Sebastian Sampas, il signait sa lettre Jean, BARON DE BRETAGNE.
Lorsqu’il décide de venir rendre visite à ses lointains cousins, en 1965, il est déjà au bout du rouleau. A quarante trois ans, il ne lui reste plus que quatre années à vivre. Incapable de trouver un semblant de quiétude et d’apaisement, il se déplace constamment, trimballant dans ses déménagements incessants sa Gabrielle de mère. Il ne sait plus où aller, vers qui, quel lieu se tourner. Franchir l’océan, découvrir la terre mythique tant de fois imaginée et évoquée, peut-être l’ultime façon de terminer le voyage au bout de sa nuit angoissante et dévastatrice.
Le premier juin 1965, il s’envole vers Paris avec mille cinq cent dollars en poche, une avance versée par son éditeur pour Les Anges Vagabonds, et la ferme intention de percer le mystère de ses origines.
Tout juste débarqué dans la capitale française, il s’enivre d’excitation et de boissons fortes en compagnie d’une prostituée qui le soulage de quelques démons affectifs et dizaines de dollars, avec la même remarquable dextérité.
Le lendemain, il rend visite à son éditeur français, Gallimard. Encore un peu pété il se fait rabrouer par la secrétaire, snobé par quelques écrivaillons à la mode, et éjecté manu militari du sérail vaniteux.
Mortifié par l’incompréhension et la réaction des snobinards littéraires, il décide d’entamer ses recherches généalogiques et se rend aux Archives Nationales. Là encore il ne rencontre qu’incompréhension, suspicion et rejet. Les bureaucrates, indisposés par son souffle aviné, lui refusent l’accès aux ouvrages rares.
Déçu et humilié, il traînaille longuement dans les bistrots bondés de pochtrons, plus abordables et conciliants que tous ces prétentieux précieux rencontrés dans les bureaux et bibliothèques austères.
Puis Le Petit Prince s’en va à la Petite Bretagne.
Dessin de Yves Budin

21:45 Publié dans La vie des bêtes racontée aux enfants | Lien permanent | Commentaires (0)
10/09/2007
Ciel de Lune (3)

Photo Bénédicte Mercier
On ne sait jamais à l’avance jusqu’où on va déchoir. Il faut être rendu au mot fin pour commencer à comprendre ce qui est arrivé. Bien sûr, cela aurait pu être autrement, mais comment l’envisager et pourquoi cela en est arrivé là ?
Avec le temps, on s’habitue à tout. Il suffit d’en avoir. Ce qui était inimaginable la veille devient une routine le lendemain. Et la capacité d’adaptation est sans limite aucune. Il reste la littérature pour faire le bilan de tout ce temps et se demander si tout cela a été bien réel. En me repassant le film, j’essaye de comprendre pourquoi je me suis accepté dans ce rôle-là. Les insomnies m’ont permis de me désengluer de cette violente impression d’avoir été bafoué.
L’histoire fait payer cash, et quand cela ne suffit pas pour connaître la suite du film, il faut y ajouter sa vie. Pour comprendre ce scénario, à la fin banalement triste, dans lequel je n’ai pas été metteur en scène, seulement un piètre acteur, il m’a fallu me remémorer les événements pour essayer d’en comprendre l’enchaînement.
Se repasser les prises de vues à l’envers et voir sur quelle image la balle percute la tête du président. Reprendre des séquences parmi ces milliers d’images et comparer celle qui peut se greffer avec l’autre. Chaque prise a été faite, celle-ci par un amateur, celle-là par la télévision, depuis la foule ou des hauteurs d’un balcon. Si, au rush final, on ne garde que la meilleure de chacune des prises ; en fouillant dans les essais, on peut écrire une dizaine de fois le même film. Avec des cadrages, des densités dramatiques diverses. Depuis le type débonnaire au premier plan qui suce une glace au visage inquiet du responsable du service de la protection rapprochée ou à celui désespéré de la femme du président. L’histoire racontée sera la même, mais l’angle, la focalisation et la tessiture dramatique seront totalement différents.
Il est étrange d’accepter l’idée de n’avoir pas vécu pendant dix ans… Comme si la violence avait consisté à se dépouiller et à ne plus s’appartenir. S’être aliéné au point de ne plus penser par soi-même. D’avoir laissé un autre prendre le contrôle de son cerveau. Envoûté par la fascination du serpent. Son venin loin de tuer sa proie l’endormait seulement. Cela ne fait pas mal. Quand l’anesthésie est parfaite, la torpeur qui s’ensuit remplace la réalité. Le cerveau est placé sous assistance, le peu d’oxygène qui y parvient permet à l’organisme de survivre, mais il ne pense plus et n’agit plus de lui-même.
Le réveil n’est ni brutal ni douloureux. Il se fait simplement comme après une anesthésie. Un envoûtement n’aurait pas produit un autre effet. J’ai beau ne pas vouloir croire aux gris-gris, j’ai fini par me demander quelles potions j’ai avalé. Dalila prétendait que son clan était issu d’une terre de marabouts, de guérisseurs, de sorciers, où même les rois se déchaussaient pour fouler le sol. Mais ça, je l’ai su quand il était déjà trop tard.
20:50 Publié dans Extraits de romans | Lien permanent | Commentaires (0)
Liberté j'écris ton nom

Photo Bénédicte Mercier
Dans le chant des townships ou la samba des favelas
Sur le visage ravagé des sans abris aux stigmates de Christ
Sur la peau des sans noms, des sans papiers
De ceux qui attendent et n’auront jamais rien
Sur le dos trempé des migrants noyés
Dans le détroit de Gibraltar
Au fond des gamelles de la faim
Sur les chèques en blanc et la peau des os
Sur l’effigie des billets de banques
J’écris ton nom :Liberté
Extrait de Chardons bleus.... Textes à paraïtre....
16:20 Publié dans De la poésie au quotidien | Lien permanent | Commentaires (0)
09/09/2007
La vie aux indes (4)

Photo Bénédicte Mercier
Cette chaleur moite provoque le renoncement à vouloir être. À quoi bon lutter, il faut laisser l'esprit aller, lâcher prise. C’est la seule issue pour ne pas perdre la raison. Car ici l’impression la plus forte est que plus rien ne peut rester intact, ni le corps, ni l’esprit effaré par tant de saletés, de mouches de puanteur, de folie concentrées en un seul point. Tout se décompose et devient sale, putride. L’être pris dans un intestin géant est réduit en une matière en voie de digestion qui fuit de son corps. Et il sent qu’il approche de l’état de décomposition. Qu’il va être happé, broyé et digéré avant d’être rejeté.
20:25 Publié dans carnets de voyages | Lien permanent | Commentaires (0)
05/09/2007
Les Crobards de Malnuit

On va republier Les crobards de Malnuit. Ce sera pour novembre probablement. C'est Bédé qui s'est mis au clavier pour exhumer ces textes devenus introuvables. Un rétrospective officielle de l'oeuvre de Malnuit est prévue à st Marcellin en décembre, avec Bacaze dans le rôle du chef d'orchestre. Mais pour commencer on vous donne juste des petits morceaux en lecture pour le plaisir, comme on lèche les plats. L'ouvrage sera en souscription dès novembre. D'ici là il faut mettre en place l'association... Pirot a été le prof de Malnuit quelques temps avant que Malnuit ne se fasse virer des beaux arts de Grenoble, à peine au bout d'un an.
Crobard : n.m. Dessin à main levée qui ne fait qu’esquisser l’image d’un être ou d’une chose. (Petit Larousse – voir : croquis)
On en voulait à Pirot de vendre à des bourgeois. – Comme si on pouvait vendre à ceux qui n’ont pas de fric ! Comme si fallait choisir l’acquéreur parce que l’argent pourrit tout ! – On trouvait qu’il peignait pour eux, que sa peinture était flatteuse de leurs goûts et de leurs idées. – Dieu lui-même avait l’air bourgeois – et c’est vrai qu’il l’est devenu, pour pas dire qu’il l’a toujours été ! Le problème c’est que tout appartient à ceux qui ont de quoi – Payez d’abord on causera ensuite, hé...
Héroïque parce qu’il résistait : héroïque l’art qui résiste à l’abandon de ses moyens (la peinture avec de la couleur si on veut) et à la prostitution de ses fins (l’exaltation de l’esprit et la louange de l’âme)...
L’art qui suit son idée à part, la sienne propre qui est rien qu’à lui et qu’il est seul, tout seul, à pouvoir préciser.
Un Martial Raysse – ce type qui fait du néon – il vous fait pas chier non ? Et un Vasarely ? La société est tellement oppressive et déshumanisée et aseptisée qu’elle a réduit à très peu – les plus forts – ceux qui tiennent le coup. Je n’en veux pas aux matériaux nouveaux, produits de la technique que rien n’empêche un artiste d’utiliser ! Le cuivre ou le papier d’Arches, ou le marbre, ou la toile de lin n’ont pas l’exclusivité de la noblesse ! Ce qui est noble ou pas, c’est le sculpteur, le graveur, le peintre ! Je sais, on l’a dit avant moi et mieux que ça, mais je le dis à mon tour. Même si c’est pas publicitaire !
Sale époque...

Tant qu’y a de la vie y a de l’espoir, on dit. Mais justement – et alors même qu’on fait des enfants pour la perpétuer – y a si peu de vie dans la vie que l’espoir, faut se lever tôt !.
J’ai su qu’il se levait tôt pour peindre, Pirot – comme pour être pris sur le fait par le soleil qui point –
Une grande capacité de travail. Mais il était dans la pleine force de l’âge : la pleine jeunesse, pour un peintre.
Son expo au dernier étage des Nouvelles Galeries : quand on sait comment il élaborait ses toiles, si petites soient-elles, avec croquis préalables et esquisses peintes à l’eau, qu’on l’a vu peindre ensuite, lentement, amoureusement, on mesure ce que représentaient 50 pièces faites en 2 ans. Une performance. Anachronique à notre époque (sale époque) peut-être, mais admirable.
Je mets un chapeau et je le tire, à celui qui sait ralentir, prendre son temps pour le bourrer de gestes lourds d’amour et de pensées, lents de réflexion et de ténacité.
Exprimer la vie prend du temps. L’art est long et d’un autre temps que la vie. Bien ignorant de sa nature celui qui le confond avec la chasse aux papillons.
C’est pas ce qu’il pensait ? Il n’a jamais dit ça ?
... peut-être...
Je suppose qu’il paraissait d’un autre temps parce qu’il était du temps long de l’art, ce temps qui jure avec le monde – le monde qui gesticule et s’essouffle, alors que l’art respire et agit –
Possible qu’en écrivant tout ça je parle à côté de Pirot. Tant pis. Il réussit à me faire parler, alors même qu’on s’est peu connus, et que, ne cherchant plus à le juger afin de me juger moi-même, je me sens plus compréhensif, et plus libre de parler peinture, poésie : la seule chose au fond qui compte.
Est-ce que je comprends mieux aujourd’hui ce mélange que je trouvais bizarre chez Pirot de la foi qu’on peut dire catholique et des idées dites de gauche ? C’était peut-être un mélange logique. En tous cas il avait sa logique ; mais comment le comprendre quand tu te fous de la politique et que la foi t’a abandonné ?
Voilà ce qui se passe : si t’aimes bien un mec et que ce mec a les mêmes idées une ou deux qu’un autre mec que tu aimes moins tu l’aimes mieux grâce à celui que tu aimes bien, c’est clair ?
Pirot c’était aussi Teilhard... (je me souviens qu’un jour j’ai bouffé chez lui, et il y avait 4 ou 5 bouquins sur un guéridon, c’était écrit par Tresmontand, « Très bien ce type » il a dit... J’avais lu son Introduction à l’œuvre de Teilhard mais pour être honnête ça m’avait rasé...). C’est Yvon justement, le père à Chomé, qui m’avait prêté le premier volume de Teilhard, quand j’étais encore au bahut. Parce qu’il faut dire que la religion j’y ai goûté jeune, quand j’étais encore tout tendre. Puis j’en ai soupé, de la pratique s’entend. Ouais, c’est comme ça que ça s’est passé : c’est quand j’en suis sorti que j’ai commencé à y penser, quand j’étais dedans je voyais que dalle. Mais je vais pas m’allonger là-dessus, ça suffira quand j’écrirai ma biographie !
Pirot ne pratiquait pas, que je sache, mais ses actions de grâce il les rendait en travaillant (paraît qu’il broyait lui-même ses couleurs, parfois. Paraît aussi qu’il ne se servait qu’une fois de ses brosses. vrai ou faux, c’est des bruits comme ça qui faisaient leur petit effet).
D’ailleurs qu’on y croie ou non, quand on est peintre on est religieux. Je vois bien que parler de Dieu c’est mettre un nom sur l’Innommable auquel l’artiste se frotte tous les jours, qu’il cherche à percer le Secret ou qu’il adore le Mystère. C’est la seule matière de son art, toujours insaisissable et toujours poursuivie ; le tourment qu’il ne peut trahir et qui le nourrit ; la raison profonde que la raison ignore. L’art disparaît quand cette raison profonde s’efface ou devient indifférente ; la flamme s’éteint ; l’âme se putréfie et n’est plus qu’une carcasse, un mot vide, comme sont vides les formes en vogue, vides les peintures, et les autres, tous les hommes, et leur vie, vide.
Maintenir la peinture en vie par le seul fait de peindre c’est déjà énorme. De cette manière Pirot soufflait sur la flamme, et à sa façon : peinture maîtrisée – et polie, comme s’il importait d’abord que la peinture, dans une époque « perdue pour elle », parle un langage propre et clair – On l’entendrait mieux peut-être, et elle pourrait sauver sa peau, sinon gagner sa cause – ce qui viendrait plus tard, la route est longue et le temps presse !
Trouver son langage sans perdre de vue l’idée maîtresse qu’on peint comme on parle, pour être entendu.
Je l’imagine à ses moments, déchiré de vouloir conserver une apparence de contact avec une réalité commune qui n’est pas la sienne profonde. Je le vois enrager de chanter le jour ou la joie alors qu’un puissant génie le retient vers le fond, ou l’emmène, ou le pousse à tout dire, s’exprimer totalement, ne serait-ce que l’espace d’une toile, celle-ci qu’il est en train de peindre justement, précisément. Je vois dans un coin du tableau cette rage en forme de crachat rouge sang, un vrai juron de peintre en colère qui n’en peut plus de se contenir et qui explose. Violence brève mais totale, dégoût de peindre et de penser, fatigue de se respecter et les autres, on n’est pas respectable et noble et digne, on est con.
J’imagine.
Donner de l’âme à ce qui n’a qu’une forme. Donner une forme à ça qui n’en a pas – l’âme ? – c’est peut-être aussi difficile à faire, et quand c’est fait, aussi miraculeux.

Pour découvrir le travail de Pirot cliquez ici
22:30 Publié dans Extraits de romans | Lien permanent | Commentaires (2)
02/09/2007
DU BAUME AU COEUR
J'ai trouvé ça sur le blog FRERETROC de Benoit qui ne m'en avait rien dit...
Un plaisir à peine croyable...
Un oxymoron on appelle ça, et je vous jure que c'est drôlement agréable...
Et puis ça aussi sur le site de la FNAC c'est réconfortant Cliquez ici et là par la même occasion... en cliquant ici...
20:10 Publié dans De la prétention littéraire | Lien permanent | Commentaires (0)
01/09/2007
Tanger-Port

Etait là, un cul-de-jatte ivre qui avait déclenché une bagarre sur le navire. Le commandant l'avait menotté et mis aux arrêts. Dans ce local attendaient quelques petites frappes ainsi qu'un homme venu d'Italie, vêtu d'un costume gris perle de la dernière mode. L'italien inquiet tremblait des mains. Le cul-de-jatte n'est pas parvenu à allumer sa cigarette. Sa jambe de bois posée à côté de lui, il s'est gratté le moignon. Une chaussette et une chaussure étaient enfilées sur sa prothèse. Il a attendu que son dossier soit complété pour être conduit à la maison d'arrêt. Un garde a imposé le silence. Un homme transportant des kilos de café, des cartouches de cigarettes blondes, des cassettes vidéo, des briquets, des montres est venu nous rejoindre. Il a offert quelques cartouches de cigarettes et des breloques à des flics en civil. Il connaissait bien son monde, était entré de son plein gré, et n'est pas resté longtemps.
On m'a reposé les mêmes questions dans un ordre différent. Je devenais nerveux. Ils s'en apercevaient. J'ai quémandé une cigarette au cul-de-jatte, et l'ai remercié de sa gratitude.
Né en France... De mère... En vacances… De l'argent... Traveller's chèques... Liquide... Travail...
Des policiers, avec des gueules de tueur, sont sortis d'une Mercedes crème. Un tenait une enveloppe de papier couleur saumon à la main. Il en a extirpé un fax. Je devinais qu'il était destiné à mon cas. Ce genre de situation stimule l'imagination.
Le chauffeur m'a fait signe de prendre place avec un policier dans la voiture. Je n'ai pas essayé d'ouvrir la porte de l'intérieur, pressentant qu'elle était fermée. Ce qu'il m'a confirmé lorsque nous sommes arrivés au dépôt central, en venant donner le tour de clef nécessaire. J'ai pris mon sac. On m'a conduit au troisième étage d'un immeuble crasseux et installé dans un bureau. Un homme a pénétré, costume bleu foncé, chemise rayures bleu ciel, cravate noire, chaussures vernies... Le deuxième bureau... Potentiellement je n'existais plus...
Activité... Lieu de destination... Numéro de téléphone... Adresse du père... Nom... Prénom... Des amis... Adresse... Un rituel.
La rapidité et la précision des réponses l'ont étonné. Il a cessé de noter. Il semblait visiblement contrarié et s'est excusé du dérangement, après avoir insulté un cerbère qui n'en menait pas large.
On m'avait confondu avec un terroriste qui travaillait pour un pays ennemi. Et on l'avait dérangé pour un simple touriste. Il suffisait de regarder la photo pour comprendre qu’à part le nom je ne lui ressemblait en rien. J'en ai été fort aise. Il n'y avait rien à redire à ce contrôle de routine.
Extrait de: Point de fuite publié dans la revue Propos de campagne
Explication de texte
Saïd Mohammed From Wikipedia, the free encyclopedia
Saïd Mohammed is a citizen of Afghanistan, held in extrajudicial detention in the United States Guantanamo Bay detention camps, in Cuba.[1] Mohammed's Guantanamo Internee Security Number is 1056. Joint Task Force Guantanamo counter-terrorism analysts estimate that Mohammed was born in 1977. Joint Task Force Guantanamo counter-terrorism analysts listed his place of birth simply as Afghanistan.
Pour connaître le dossier de cet homme Cliquez ICI
22:30 Publié dans carnets de voyages | Lien permanent | Commentaires (0)
Les Crobards de Malnuit
par Méze Malnuit

Photo Bénédicte Mercier
Heureux les affamés qui ont bouffé au Chaix car il n’y boufferont plus !
Dégueulasse mais pas cher. À midi c’était la flopée, et les coudes dans les côtes, et les haleines et les odeurs et la fumée et la couenne grillée, et les émanations plus ou moins audibles d’origine pas douteuse ; pot-pourri, art total, cour des miracles, messe rabelaisienne, symphonie fantastique pour mandibules en chaleur et grelots coincés et fourchettes à trois dents et à quatre dents, bouillon de culture et bouillon gras, synopsis crado-ubuesque, syzygie des sans-qualités, des sans-familles et des sans pécule, syndicat des sans intérêts, symbiose du bozart sans le sous et du sous smicard sous le signe de l’omelette baveuse et dans la reconnaissance du ventre, foire aux tics, kermesse du bœuf, mode, en morceaux, aux carottes, aux lentilles, au jus, à l’eskimo, à la mau-mau, à la mauritanienne et à la dauphinoise, mais surtout à la Chaixière qu’on appelait ça (recette : vous prenez les abats inutilisables de l’animal, vous les découpez en cubes anodins et vous faites bouillir deux jours durant dans une sauce vitrioleuse à la salive de syphilitique allongée de colle à bois ayant pour rôle d’intervenir au moment où l’esprit de corps menace de manquer au tout). Pendant que j’y suis, quelques autres spécialités de la maison : le chou farci, l’omelette aux fines herbes, l’omelette au jambon, l’omelette aux champignons, les tomates farcies, le gratin dauphinois, la salade niçoise etc. j’y renonce car sorti du chou farci, du bœuf aux carottes, de la verte, de l’omelette fines herbes et du fromage blanc, il fallait passer commande la veille et le Chaix ignorait la formule, non mais sans blague, qu’est-ce que vous croyez !
La Chaixière, une maîtresse femme s’il en fut, même si depuis l’exode elle avait oublié ce que c’est qu’être femme. Mais soyons juste : quand y’avait plus de bouillon et qu’elle montait sur la table pour rectifier le tableau noir, le génie du sexe, et bien malgré elle, révélait une grâce oubliée derrière les rotules, pas de la meilleure, ô non, mais une grâce, un reflet, un rien, là, à la saignée, à côté de la grosse veine bleue et méandreuse comme un affluent du Doubs. J’en connais qui jouaient aux fléchettes dans ce qui avait été sa paire de fesses, qui n’était plus bien sûr que larges crêpes retombées. Elle tournait pas souvent le dos à l’adversaire la vieille carne ; les dix secondes que durait la pirouette c’était feu à volonté ; les vieux vicelards se retrouvaient à la primaire…
— Tu le fais exprès de mettre ta fourchette sous mes pieds ? Attends un peu que je t’savonne.
Le pauvre bougre se ratatinait comme une figue sèche :
— C’est pas vrai, c’est pas moi
— Quoi tu rouspètes ? Allez et t’avises pas de rev’nir demain !
Mais dès qu’elle avait atterri sur le plancher des vaches la sanction passait au panier, à moins que l’autre ait une tête qui lui revenait pas – ce qui arrivait l’un dans l’autre une fois par jour.
Des copains se sont ainsi faits jeter et n’ont jamais osé y remettre les pieds, au Chaix, preuve que c’était des délicats et qu’ils s’étaient trompés d’adresse (exemple : un ancien qui se sentait béni parce qu’il seyait à côté du chef-cochon – c’était le cartel d’esbroufe chargé de contrarier notre mastication par sa présence intimidatoire
– La vieille : « On t’a versé un pot de peinture sur la tête ? Ça fait plus yéyé p’t’être ?
— Dommage que j’soye pas ta mère, tu l’aurais ta fessée. Non mais qu’est-ce que c’est qu’ces allures, tu crois que j’te reconnais pas pac’que t’as changé la couleur du poil ? C’est pas l’Moulin Rouge ici, allez, finis ta portion et que j’te r’voie pas avant d’êt’ passé au dégraissage ! » Le gars ne revint jamais au Chaix.
Quant aux calottes, si la vieille en menaçait un ou deux, je ne lui ai jamais vu en mettre une. Sauf à moi. C’était mon lot, mon privilège, personnel et exclusif. La première m’échut un soir au neuvième coup de 9 h. Sèche, précise, du plat de la main sur l’occiput. Le lendemain ou le surlendemain, quand elle remit ça, c’était déjà routine. Pour sûr, j’ai senti plus d’une fois que ces taloches portaient un message : c’était sa façon à la vieille de dire qu’elle nous aimait bien. Découvrir qu’elle pouvait calotter le client fut pour elle une révélation – à moins que ce ne fut mon crâne, puisque je dérouillais pour les autres ; comme qui dirait un vrai coup de foudre qu’elle eut pour lui, mon crâne, au point qu’elle n’en voulait pas d’autre, rapport au moule sans doute ! Car s’il s’agissait d’essuyer ses paluches il y avait des têtes frisées autrement adéquates ! Quand les fontaines de l’actualité étaient par trop arides pour qu’on se marre à leurs dépens, va pour la fourchette qu’on laissait tomber : simultanée la calotte, et j’avalais mon pain de travers – mais il est écrit que l’homme ne vivra pas que de pain, il lui faut l’occasion de rire, et peu importe le voltage, va pour la java des tripes et le tango des cordes vocales ! Le rire vaut de loin tous les bicarbonates et la cuisine à l’eau de source et la diète et la sauce tartare ; il épate les boyaux et resserre les selles ; riez un bon coup entre chaque bouchée et je vous fais bouffer n’importe quoi, de la soupe aux pneus et du gratin de chapeaux, et du confit de papier Canson et de la salade de parapluies et de la compote de ça-du-nez, n’importe quoi je vous dis… C’est bien pourquoi le Père a trahi son Fils et lui a préféré Rabelais : grâce à icelui il est descendu de son nuage, et les dignes et fades chrétiens peuvent toujours l’y chercher – Il est au Chaix, incognito. Au commencement était le Chaix, les Voies de Dieu sont impénétrables.
Le fils pourtant devait s’en douter. Il prenait ses repas dans son coin, à une table réservée à lui et à sa concubine, la première table au fond de la salle près des fourneaux. Depuis le début j’avais senti quelque chose, le type voulait faire anonyme mais n’y avait pas réussi tout à fait : un air flottait sur lui, facilement repérable bien que diffus, un air qui passait pour noble au regard moins perspicace mais je sais que c’était un air-de-sainteté. Le type avait vieilli, certes : on ne redescend pas parmi les hommes le cœur léger, le visage accusait quelques rides, le cheveu était gris ; mais malgré ça la tête était fière, c’était plus fort que lui sans doute, le menton était relevé, pointu comme la proue d’un brise-glace. Mais c’était les yeux surtout, des yeux d’aigle, habitués au ciel, habités de ciel, des yeux pleins d’espace, un regard de cristal surmonté d’un front gothique, un microcosme de la voûte céleste. Il entrait sans faire de bruit, il se glissait plutôt à l’intérieur. Quand il refermait la porte derrière lui son cœur se fendait en deux. Il posait son écharpe au clou, ouvrait son long manteau, et gagnait sa table à grands pas silencieux. Il saluait discrètement la patronne – il n’y manquait jamais – puis s’asseyait. Il attendait Marie-Mariole. La longue attente immobile, pleine de terreur et de prières. Peut-être dévisageait-il chacun des bougres ici présents, avec son œil du dedans ? Peut-être dévisageait-il chacun personnellement, lui fouillant le cœur et les reins ? Peut-être savait-il avant moi que je vendrais la mèche ?
Il cherchait son Père. Il savait qu’il était là, ou qu’il n’allait pas tarder. C’était peut-être lui, l’homme au béret basque, celui qui s’endormait systématiquement après deux cuillerées de soupe (tous les soirs le même bouillon de pâtes – des petites pâtes en forme d’étoiles ou d’amandes ou les lettres de l’alphabet)… La concubine faisait son entrée, pimpante, fringante, sautillant sur ses talons à ressorts ; elle rejoignait son homme en ligne droite, esquivant d’une hanche experte les angles meurtriers des tables. Ses lèvres peintes affichaient le bonheur. Sa trajectoire en balle de ping-pong faisait effraction dans la clientèle ruminante, les mâchoires s’immobilisaient et ne reprenaient l’exercice qu’une fois la femme assise. C’est alors qu’il souriait – et ce sourire chassait la fumée des cigarettes et des fourneaux, bleuissait l’atmosphère par absorption. Le vieux dormait sous son béret basque, la tête dangereusement inclinée, et la patronne lui criait dans l’oreille :
— Alors, pas encore finie cette soupe ?
C’était comme un clou enfoncé d’un coup sec dans la tempe.
— Ooooooh j’dors mêm’pas !!
Deux minutes s’écoulaient et les ronflements recommençaient sous le béret basque.
— Alors, pas encore finie…
— Ooooh j’dors mêm’pas !!
Deux minutes. Ronflements…
— Alors… !
— Oooooh j’dors mêm’pas !!
… Ronflements…
— Alors !!!
— Oooooh j’dors mêm’pas !!…
Il l’avait 1000 fois vouée au diable, elle l’avait 1000 fois réveillé :
— Alors !
— Oooooh !
— Alors !
— Oooooh !
— Alors ! Alors ! Alors !
— Oooooooooooooh !!!
Moi, Dieu, serai intraitable moi, moi, suis pas venu dans c’bouic pour me laisser distraire par une vieille harpie moi, je dors, est-ce que je suis Dieu oui ou non ? oui da j’le suis, et en tant que tel je dors et c’est pas cette charogne qui m’empêch m’emp m’em rrrrrrr
— Alors !!
— Ooooooooooooooooooooooooo… !
Pendant ce temps l’Autre tenait sagement l’écheveau et Marie-Mariole lui tricotait des écharpes – les yeux dans les yeux et les orteils dans les deltas.
Pendant que la vieille souillarde essayait d’extorquer à Dieu son pardon sous prétexte de lui faire manger sa soupe comme un petit garçon bien sage, Jésus goûtait au péché par dessous la table, le front toujours pur et l’œil céleste.
— Un chou farci un !
Pendant ce temps la terre tournait tant bien que mal sur son axe tordu et la race humaine continuait piano piano son évolution en ingurgitant du chou farci.
— Une finezerbe une !
Pendant ce temps y’avait plus de finezerbe et fallait voir à manger ce qu’y avait.
— Une omelette nature alors
— Une nature une !
— Moi aussi
— Et une qui font deux !
— Moi aussi m’dame
— Non mais vous vous foutez d’moi ?… Combien de nature ?
— Une pour moi
— Une pour moi
— Une pour moi
— Bon alors ça fait trois. T’es sûr que t’en veux pas une toi ? Trois nature trois !!
Pendant ce temps, la nuit allongeait ses grandes pattes noires sur le mur d’en face et sur la rue Millet et sur la ville tout entière et le sommeil poussait du coude les travailleurs éreintés et les rêveurs désespérés une fois de plus par la monotonie de cette saleté de vie.
Pendant ce temps, Nanou rangeait sa poussette rouillée dans l’encoignure de la porte et rentrait en bougonnant :
— Pas chaud jourd’hui, salut, pas chaud brrr...
Frottant ses mains l’une contre l’autre, elle gagnait sa place habituelle auprès du poêle à charbon auquel elle tournait le dos.
— Pas encore allumé c’bon dieu d’machin, pff !
(On l’appelait Nanou parce qu’elle lui ressemblait l’âge en plus ; une cinquantaine tassée, mais fonce-dedans, bien qu’un peu rabotée, et bougonneuse, et pas bégueule, tout ça sur un fond de pâte feuilletée).
— Qu’est-ce tu prends ?
— Potage
— T’as raison ça réchauffe
La patronne était de bon poil ; alors nouzôtres, on restait jusqu’à la fermeture, parce qu’on avait rien de mieux à faire ; la pendule égrenait les secondes qui coulaient sur le mur jauni et le jaunissaient plus encore, et par moment une planche craquait dans le plancher du balcon – le balcon où Calamity Jane avait fait ses gammes – c’était avant qu’elle connaisse Lucky – Elle forgea son nom en mordant la rambarde dès qu’elle fut en âge, tombant ses dents de lait l’une après l’autre au fur et à mesure qu’elles perçaient. C’est là aussi qu’elle contracta un dégoût farouche pour la gent masculine, à cause de Billy the Kid, de 4 ans plus vieux qu’elle.
À l’époque les chambrettes existaient – on s’en servait d’étendage à linge – mais c’est un peu plus tard qu’on leur adjoignit de petites portes individuelles… Ces petites portes me fascinaient. Tous les jours remontaient à la surface de mon esprit de petites questions pertinentes ; et si je ne l’avais pas eu si agile, l’esprit, et le nez aussi large, je n’aurais rien connu de leur histoire…
C’est le soir, pendant la demi-heure qui précédait la fermeture que ça suintait ; il suffisait alors de se vider les méninges par une torsion progressive, ce jusqu’à liquidation de toutes préoccupations étrangères ; alors, la tête vide et le ventre plein, on pouvait interroger les choses : le haut plafond, les murs pisseux, le bois des tables, des bancs et du balcon, et le passe-plats – qui en avait vu passer d’autres – et la caverne du cuistot – c’était le patron soi-même. C’était déveine ou atrophie cérébrale si la question ne trouvait pas la réponse.
Un soir que j’étais seul à table, j’éprouvai quelque chose de bizarre, un sentiment comme qui dirait insulaire et ondulatoire ; j’en compris le sens douze minutes après, en allumant ma clope : le Chaix avait quelque chose à voir avec l’énigme de l’Atlantide, à moins que ce ne fut avec l’arche de Noé.
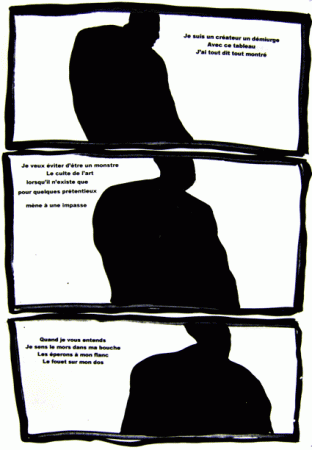
les illlustrations sont de Yves Budin qui vient de publier aux carnets du dessert de lune Visions of Miles
17:45 Publié dans De la poésie au quotidien | Lien permanent | Commentaires (0)


