30/11/2008
La Denise est passée à cinq heures...

Michel Malnuit autoportrait
Malnuit a publié de son vivant un certain nombre de textes dont La denise est passée à 5 heures. Mon intention est non seulement de rendre disponible toute l'oeuvre publiée de Malnuit, mais aussi de publier celle qui ne l'a pas encore été...
Pour certains manuscrits dont il a fallu corriger et revoir le texte- passages incompréhensibles écrits sous l'emprise de l'alcool- passages entiers à supprimer qui n'amène rien au lecteur... Ce travail je le fais sous le contrôle de Bédé, alias Françoise Malnuit.
Traduire Malnuit en français sans altérer le substantifique moelle c'est un travail absolument étrange qui se situe à mi chemin de la traduction et du rewriting. C'est de la traduction sans en être...
Du rewriting sans en être... Il suffit parfois simplement d' aérer le texte par des retours à la ligne, mettre des points, là où parfois il n'y a que des virgules qui en saccades finissent par plomber l'appétit du lecteur...
Terribles décision à prendre et à assumer... Cela a été étrange de découvrir la force du texte sous les scories qui l'encombraient... De redécouvrir cet auteur quasi inconnu et d'être persuadé là encore de toucher du doigt une grande oeuvre... Un peu comme celle de René Barde... ces deux là ne se connaissaient pas n'avaient rien en commun et pourtant...
un petit extrait
—Neige alors drue !
— Souaf souafeuse et faim de loup !
— De loup hou-hou,
— De fofifon et, hé hé : de ragoût ragoûtant !...
— Alors... à table !
Et que je te verse. Corbières. Rasades.
— Vin cuit pour celles qui…
— Oh oui bien volontiers merci !
— Santé !
— Conservation !
— Y avait longtemps !...
Nos aises... Taillées dans le fameux gros pain nos aises, taillées dans ce qui reste du pâté…
— A moinsse, qu’on en aye racheté...
Taillées dans les bavettes, des sur-mesure pour chaque une et chaque un. Et les toutous qui tournent et virent, et le fuego qui crépite, et dehors les flocons
— Dis-donque ce coup-ci c’est parti !...
Parti la neige... parti la daube... et les vins lourds, Bordeaux, Vieux Pape...
— Y a...vait pas un... ptit Minervois ?...
— M’inerve pas ac ton Minervois ...
Tournée aller tournée retour, je suis peu pour ces lourds je m’en reviens à ceux qui tachent. Et qu’à se tendre les plates et qu’à se tendre les vides et se remplir les vides et se vider les pleins et s’envoyer tout ça qu’assurément c’est pas dégueu…
— Pas plus haut que le bord merci et si tu veux savoir t’as qu’aller dire à Polbocu qu’il est venu pour lui le temps de le rendre son tablier ah si ah si !...
Et les douces effluves ondulantes me serinent à la serinette l’opulence et le dénuement... la blanche neige symbol... hic ! eee, j’entends « Mazio t’es un inquiet » fin de citation sans date et moult fois réitérée ni vraie ni fausse donc vraie, ou fausse... la solitude la communion... tu parapport à je... me sentais rien qu’un œil, pas voyeur mais voyant... petit peu voyeur quand même.
—Plaisir... de voir c’est boire des yeux !...
De boire...
En me dressant bien haut les antennes hors des gaines et j’avais l’air... ou pas... comme ça...
— Recul approche...
— Et recul et approche...
— Et re... cula... prrroche...
— Loin...
— Pas là...
— Où ça ? ...
— Ailleurs.
— Où ça ?...
— Qui quoi...
Bédé. Ma gauche. La joie... ou l’abrutissement. Jaja. Coucou.
— R’un coup de daube, cette...
— Vindieu !...
Moment... moment un tant soit peu durable un... tant soit peu total... un temps... soit peu qui fut !... rempli comme les estomacs ! Petit délire tant soit peu rien. Rempli de mots. Pas les ceux qui volaient bien sûr, ceux-là... perdus ! tous envolés !... qu’on retrouverait dans les murs... dans le lambris sous les dessins... dans le four à pain qui sert de sac à vin... dans les festons de la nappe blanche à festins... dans le paillon des chaises... dans la boîte à cigares, lesquels itou partent en fumée ! Mots morts sitôt qu’on les a dits, vivants tout juste l’instant des bouches et de ces goûts qui les tapissent, tissage ou modelage, ou sculpture d’air... et l’air qu’a le sculpteur souvent très convaincu pas toujours convaincant, jactant cette drôle d’histoire de bonhomme antérieurement cheval et en voici la preuve mais restez donc assis : ayant perdu un fer il s’en est souvenu précisément où ça... et il l’a retrouvé... Ou celle-ci encore plus bizarre tout autant authentique et qui dit que l’individu ici-présent pour le plaisir commun Couraudon Le Besset... serait, comment douter ? un des, pour pas dire ze ! unique survivant de l’hécatombe du Montségur... « enchanté, verse m’en un »...

photo Bédé
Et je m’allume un clopinet,
— Mmm, pas de doute là-dessus et de loin : j’me préfère le corbières des Corbières à ces velours d’Bordeaux et d’ailleurs qu’on sait même pas d’où j’vous les brade avèque « sans façon » le from des Pyrénées,
— Bien que ça j’aimerais l’aimer c’est pas d’blague
— Tu dis ça
— Mais c’est pas vrai
— Alors goûte-z-y
— ça veut pas »...
Et nia et nia
— Pas insister sinon je pique ma crise je vomis tout j’inonde je vous pleure dans l’assiette je vous renie définitif !...
Et je sais plus tant quoi vous narrer qui soit marrant de ces agapes, qu’ont pourtant bien duré leur couple d’heures à l’aise oh oui ! Sauf ça. Qui nous reviendra à tous à toutes en son temps... chacune... chacun... clair et net. Précis. Incisif. Comme un coup de trique. Comme. Un burin de Rembrandt. La Denise est passée à 5 h. Environ.
Sur le coup j’ai pas fait gaffe en tout cas peu importe sinon, que pour ma part, j’ai dit à ma voisine, Bédé
— Regarde, tu l’as vue ? c’est Denise, la fille à l’Émile...
et je suis sorti pour lui serrer la main bonjour,
— ça va ?
– ça va ...
Et elle a dit aussi :
— Alors ? revenu ? et peut-être aussi « voir les amis ? » et j’ai pu dire
— Oui, quelques jours »...
Alain était près d’elle et il parlaient du vilain temps, et elle avait un seau... fontaine chercher de l’eau oui, de l’eau à la fontaine... Rentré mézigue j’ai repris mon endroit à côté de Bédé
— Tu l’as vue ?
— Oui, pas beaucoup mais j’l’ai vue, oui »...
Parce qu’à Bédé je lui avais dit les deux ou trois choses... qu’elle vivait là avec son père qui l’avait élevée tout seul, sa mère était morte elle était tout bébé... et ça presque incroyable : elle était jamais descendue à Biert au village... toujours restée ici... trois choses à peu près tout. Quasi. Alors. Les questions les problèmes... quasiment le mystère ? mais non. Pas de mystère. Tout clair. Tout net ! Pasque là, ouais... déjà t’à l’heure la sécheresse, rapport à nos agapes... d’agapê qui veut dire amour c’est grec, c’est pas chinois... je pouvais plus. Qu’abréger tout. On est montés. Changer d’endroit et... écouter des musiques et, continuer à causer, fumer, boire se chauffer tout ça. Aux étages. D’où c’est vrai je suis redescendu pour pisser... puis... sur la tôle dressée à moitié à droite de l’entrée j’ai eu l’idée d’écrire au doigt dedans la neige épaisse d’une main « just maried » et « Alain ! ho Alain ! viens voir ! t’as un message !
– Quoi ?
– Un télégramme ! »
Et il a déboulé comme un fou incrédule, j’y ai dit monte là dessus où j’étais, dessus un tas ou la chèvre ou le pétrin qui traîne toujours là à l’envers... il est venu et il a vu et, m’a traité de tous les noms copieux en chipotant d’avoir l’air de se marrer, même ils sont tous radinés voir. On a bien ri. Sinon. Autour et à partir de là je vois que dalle... jusqu’à quand qu’Alain dégringole quatre à quatre on était là-haut... et en bas ça frappe ! Ç’aurait pu être ceux du Ramé ? Plus ou moins attendus vers les pâques rappliqués de leur Nantes, ou bien Rico le peintre... ou l’Émile c’était bien son heure, 7 ou 8 ?... et on bavardait avec Pierre mollo étendu trop bouffé la ceinture relâchée, « Mazio ! descends ! » j’entends, « vite ! »... ah... Isabelle a changé d’œil... elle a dit que c’est l’Émile... Mes godasses...
— Mazio ! t’arrives ? ...
— Et merde, de lacets…
Swann dans les jambes je déboule. Émile, Alain, nerveux les deux, j’ai l’impression,
— Queskia ?
— Denise a disparu... maison fermée de l’intérieur ...
— On y va.
L’Émile déjà là-bas, marmonne, nuit noire, Alain une torche. Rien. Marmonne... et que ça sentirait mauvais... Alain chercher une échelle... était pas aux brebis comme d’habitude tous les soirs... attendu un peu une demi-heure, et alors non y a quelque chose... venu voir, trouvé ça : fermé, c’est du dedans. L’échelle.
— Laissez l’Émile, j’y vais .
Et ça pleut neige gouttes dans les yeux...
— Regardez sur le lit ...
Fouille avec la loupiotte... «
— Y est ?... pas ? »...
— Là-haut
— Oui... y est
Et l’Émile
— Nom de dieu
— Grimpe.
— Attendez !
Déjà haut, près, la torche, Alain donne, passe en bas... son regard !... Là-haut bing ! le carreau badagling ! gling ! réflexe la tête le coude !... et tous les trois l’un après l’autre par la fenêtre et dans la chambre. Denise... sur le lit sur le ventre tête côté. L’Émile est allé tourner le bouton, et
Nom de dieu et va savoir et quelle idée pourquoi ce qui l’a pris
— Qu’est-c... qu’elle a fait ?...
— Qu’est-ce que tu as fait là, dis ! qu’est-ce que tu as fait ? »...
Et Alain et moi on la retourne sur le dos et
— Nom de dieu Mazio...
Il dégage le cou serré «
— Voilà ce qu’elle a fait, voilà !...
Et il sort son inséparable lame, la glisse fébrile mais sûr entre la peau et ce ruban et tchac !... et la Denise elle est bien chaude ! autant que toi ! que moi !...
— Allons, tant que possible, de la méthode...
— Voyons... si le cœur bat.
Je palpe. Et pas le moindre bruit. Retenir ma respiration. Malgré ça j’entends, je sens, que moi, que... dalle ! que... moi ou quoi... ?
Dans mon oreille dessus son sein y avait mon cœur et pas le sien s’il battait j’entendais le mien !... Alors, respiration artificielle. Traction du bras, gauche, droit, une, deux, une, deux, descendre, monter et... je monte descends à califourchon.
— De dieu de merdalors j’aimerais voir ça un peu tiens si t’as fait la conne !
Et han ! et han !... ça marchait pas des mieux. Terrible face à face que je venais d’entamer là. Avec qui ? qui es-tu ? pour nous faire comme ça me faire m’activer s’activer allez ! han !... Je sentais pas très… Je, j’étais pas à l’aise et rien disait sur sa figure si ça pouvait venir,
— Quéchose ?
— Non et non !!!
Redescendre. Entamer bouche-à-bouche. On sera plus en tête-à-tête... je... et... ses yeux mi-clos sur... mi-ouverts que j’ai pas su voir si quoi... Voyons. La bave. Une drôle de bave un peu verte, m’a semblé. Avec la main, j’essuie. Lèvres bleutées légèrement... lesquelles... sur lesquelles... peut-être que jamais... mais les miennes, et pour que ça vive ça nom de dieu,
— Deniiiiiise ! déconne pas !!...
Et qui pouvait me dire où c’est qu’on allait comme ça ? jusqu’où ? combien ? et si c’était utile ? vraiment ?... vraiment ?... Je plaquais bien ma bouche en, d’une main la gauche à deux doigts pouce index lui creusant les deux joues entre les deux mâchoires pour la faire se l’ouvrir et, de l’autre, à deux doigts pareils doigts et main droite je lui bouchais le nez, et l’air c’était le mien que... j’aspirais féroce et je lui donnais tout. Cet air. Que je respire, et qui me sert à quoi ? Qui pouvait tout pour elle. Que j’avais l’impression de sentir refroidir... et une voix, l’Émile :
— Regarde !...
J’ai regardé, très vite levé la tête accommodé mon œil... mais comme quoi tout ça c’était peine perdue. Une étiquette rouge sur un petit flacon minable de rien du tout.
— C’est fini ! c’est fini ! ... l’Émile.
Alain est revenu avec du lait d’abord... qu’est resté sur la table en bas où il a trouvé ce flacon... les filles ensuite , Bédé Isabelle... et Isabelle pour s’occuper d’Émile.
— Et toi Bédé tu viens m’aider.
Appuyer là-dessus les côtes pour sortir l’air que je lui souffle. Pendant ce temps, Alain taille jusqu’aux Jaques chercher la fille Rico que paraîtrait qu’elle est ici et étudiante en médecine à sa cinquième année ! Okay. Alors Bédé mézigue tout ce qu’on sait on croit savoir ! Continuer.
—Dedieu dedieu Denise... l’Émile...
— Isabelle tu t’occupes hein.

photo Bédé
Et mal aux reins bordel j’en peux plus, courber relever courber relever... souffler tout ! fort ! à y laisser pas que mon air ! tout mon être !... et elle est nettement plus froide ! merde... ça fait rien je m’accroche je la gonfle Bédé la dégonfle et la gonfle, la dégonfle, gonfle, dégonfle, et tant que y a de l’espoir y a de la vie la vie la vie... la vie... la mort... ? non pas la mort non... non... la vie !... la vie, même sans espoir même, sans espoir n’est-ce pas Denise... n’est-ce pas Denise... Denise... hé... tu m’entends ?... me sens ?... sens ?... tu sens ?... hé... dis... la vie... ma bouche... tous ses... tous ces baisers ?... à quoi tu joues... tu jou... is ?... au moins ?... ou mairde !...Denise !... sans blague... quoi... ‘niiiiise !!!... salope !... et chuis poli !... Et ... Oui... Tout ça.
Et bien beaucoup plus d’autres choses me suis je pensé avoir ressenti. Terrible. Époustouflant c’est bien le cas : de l’ancien françois « s’esposser » qui veut dire s’essouffler. J’y reviendrai peut-être... ou pas. Comme si... j’ai mal à dire... ma j’ai besoin... cette fille.
Denise. Trente huit ans, qu’avait tout l’air solide, certaine corpulence on dit, ça peut se dire, et vierge ça peut se dire, du moins ça pouvait que se croire... et fille de l’Émile, un chêne !... cette femme donc.
Comment dire ça. Que ça. Me devenait tout l’important c’est ça. Que ça. Qu’une femme peut devenir. Et qu’elle avait pas pu. J’ai parlé de mystère quand y avait rien qu’un drame... vrai. Et si simple et si plein et si brut. Dur comme c’est dur de vivre. Ici. Elle. Etcétéra et quoi ?... Quand ils sont arrivés j’étais sur le point d’abandon... exténué vidé. Flat !... Et de tout ce temps l’Émile ?...

Peinture Michel Malnuit: "Elle est partie" 140 x165 acrylique sur toile, rajout de tissu et de verre
16:06 Publié dans Extraits de romans | Lien permanent | Commentaires (0)
10/09/2007
Ciel de Lune (3)

Photo Bénédicte Mercier
On ne sait jamais à l’avance jusqu’où on va déchoir. Il faut être rendu au mot fin pour commencer à comprendre ce qui est arrivé. Bien sûr, cela aurait pu être autrement, mais comment l’envisager et pourquoi cela en est arrivé là ?
Avec le temps, on s’habitue à tout. Il suffit d’en avoir. Ce qui était inimaginable la veille devient une routine le lendemain. Et la capacité d’adaptation est sans limite aucune. Il reste la littérature pour faire le bilan de tout ce temps et se demander si tout cela a été bien réel. En me repassant le film, j’essaye de comprendre pourquoi je me suis accepté dans ce rôle-là. Les insomnies m’ont permis de me désengluer de cette violente impression d’avoir été bafoué.
L’histoire fait payer cash, et quand cela ne suffit pas pour connaître la suite du film, il faut y ajouter sa vie. Pour comprendre ce scénario, à la fin banalement triste, dans lequel je n’ai pas été metteur en scène, seulement un piètre acteur, il m’a fallu me remémorer les événements pour essayer d’en comprendre l’enchaînement.
Se repasser les prises de vues à l’envers et voir sur quelle image la balle percute la tête du président. Reprendre des séquences parmi ces milliers d’images et comparer celle qui peut se greffer avec l’autre. Chaque prise a été faite, celle-ci par un amateur, celle-là par la télévision, depuis la foule ou des hauteurs d’un balcon. Si, au rush final, on ne garde que la meilleure de chacune des prises ; en fouillant dans les essais, on peut écrire une dizaine de fois le même film. Avec des cadrages, des densités dramatiques diverses. Depuis le type débonnaire au premier plan qui suce une glace au visage inquiet du responsable du service de la protection rapprochée ou à celui désespéré de la femme du président. L’histoire racontée sera la même, mais l’angle, la focalisation et la tessiture dramatique seront totalement différents.
Il est étrange d’accepter l’idée de n’avoir pas vécu pendant dix ans… Comme si la violence avait consisté à se dépouiller et à ne plus s’appartenir. S’être aliéné au point de ne plus penser par soi-même. D’avoir laissé un autre prendre le contrôle de son cerveau. Envoûté par la fascination du serpent. Son venin loin de tuer sa proie l’endormait seulement. Cela ne fait pas mal. Quand l’anesthésie est parfaite, la torpeur qui s’ensuit remplace la réalité. Le cerveau est placé sous assistance, le peu d’oxygène qui y parvient permet à l’organisme de survivre, mais il ne pense plus et n’agit plus de lui-même.
Le réveil n’est ni brutal ni douloureux. Il se fait simplement comme après une anesthésie. Un envoûtement n’aurait pas produit un autre effet. J’ai beau ne pas vouloir croire aux gris-gris, j’ai fini par me demander quelles potions j’ai avalé. Dalila prétendait que son clan était issu d’une terre de marabouts, de guérisseurs, de sorciers, où même les rois se déchaussaient pour fouler le sol. Mais ça, je l’ai su quand il était déjà trop tard.
20:50 Publié dans Extraits de romans | Lien permanent | Commentaires (0)
05/09/2007
Les Crobards de Malnuit

On va republier Les crobards de Malnuit. Ce sera pour novembre probablement. C'est Bédé qui s'est mis au clavier pour exhumer ces textes devenus introuvables. Un rétrospective officielle de l'oeuvre de Malnuit est prévue à st Marcellin en décembre, avec Bacaze dans le rôle du chef d'orchestre. Mais pour commencer on vous donne juste des petits morceaux en lecture pour le plaisir, comme on lèche les plats. L'ouvrage sera en souscription dès novembre. D'ici là il faut mettre en place l'association... Pirot a été le prof de Malnuit quelques temps avant que Malnuit ne se fasse virer des beaux arts de Grenoble, à peine au bout d'un an.
Crobard : n.m. Dessin à main levée qui ne fait qu’esquisser l’image d’un être ou d’une chose. (Petit Larousse – voir : croquis)
On en voulait à Pirot de vendre à des bourgeois. – Comme si on pouvait vendre à ceux qui n’ont pas de fric ! Comme si fallait choisir l’acquéreur parce que l’argent pourrit tout ! – On trouvait qu’il peignait pour eux, que sa peinture était flatteuse de leurs goûts et de leurs idées. – Dieu lui-même avait l’air bourgeois – et c’est vrai qu’il l’est devenu, pour pas dire qu’il l’a toujours été ! Le problème c’est que tout appartient à ceux qui ont de quoi – Payez d’abord on causera ensuite, hé...
Héroïque parce qu’il résistait : héroïque l’art qui résiste à l’abandon de ses moyens (la peinture avec de la couleur si on veut) et à la prostitution de ses fins (l’exaltation de l’esprit et la louange de l’âme)...
L’art qui suit son idée à part, la sienne propre qui est rien qu’à lui et qu’il est seul, tout seul, à pouvoir préciser.
Un Martial Raysse – ce type qui fait du néon – il vous fait pas chier non ? Et un Vasarely ? La société est tellement oppressive et déshumanisée et aseptisée qu’elle a réduit à très peu – les plus forts – ceux qui tiennent le coup. Je n’en veux pas aux matériaux nouveaux, produits de la technique que rien n’empêche un artiste d’utiliser ! Le cuivre ou le papier d’Arches, ou le marbre, ou la toile de lin n’ont pas l’exclusivité de la noblesse ! Ce qui est noble ou pas, c’est le sculpteur, le graveur, le peintre ! Je sais, on l’a dit avant moi et mieux que ça, mais je le dis à mon tour. Même si c’est pas publicitaire !
Sale époque...

Tant qu’y a de la vie y a de l’espoir, on dit. Mais justement – et alors même qu’on fait des enfants pour la perpétuer – y a si peu de vie dans la vie que l’espoir, faut se lever tôt !.
J’ai su qu’il se levait tôt pour peindre, Pirot – comme pour être pris sur le fait par le soleil qui point –
Une grande capacité de travail. Mais il était dans la pleine force de l’âge : la pleine jeunesse, pour un peintre.
Son expo au dernier étage des Nouvelles Galeries : quand on sait comment il élaborait ses toiles, si petites soient-elles, avec croquis préalables et esquisses peintes à l’eau, qu’on l’a vu peindre ensuite, lentement, amoureusement, on mesure ce que représentaient 50 pièces faites en 2 ans. Une performance. Anachronique à notre époque (sale époque) peut-être, mais admirable.
Je mets un chapeau et je le tire, à celui qui sait ralentir, prendre son temps pour le bourrer de gestes lourds d’amour et de pensées, lents de réflexion et de ténacité.
Exprimer la vie prend du temps. L’art est long et d’un autre temps que la vie. Bien ignorant de sa nature celui qui le confond avec la chasse aux papillons.
C’est pas ce qu’il pensait ? Il n’a jamais dit ça ?
... peut-être...
Je suppose qu’il paraissait d’un autre temps parce qu’il était du temps long de l’art, ce temps qui jure avec le monde – le monde qui gesticule et s’essouffle, alors que l’art respire et agit –
Possible qu’en écrivant tout ça je parle à côté de Pirot. Tant pis. Il réussit à me faire parler, alors même qu’on s’est peu connus, et que, ne cherchant plus à le juger afin de me juger moi-même, je me sens plus compréhensif, et plus libre de parler peinture, poésie : la seule chose au fond qui compte.
Est-ce que je comprends mieux aujourd’hui ce mélange que je trouvais bizarre chez Pirot de la foi qu’on peut dire catholique et des idées dites de gauche ? C’était peut-être un mélange logique. En tous cas il avait sa logique ; mais comment le comprendre quand tu te fous de la politique et que la foi t’a abandonné ?
Voilà ce qui se passe : si t’aimes bien un mec et que ce mec a les mêmes idées une ou deux qu’un autre mec que tu aimes moins tu l’aimes mieux grâce à celui que tu aimes bien, c’est clair ?
Pirot c’était aussi Teilhard... (je me souviens qu’un jour j’ai bouffé chez lui, et il y avait 4 ou 5 bouquins sur un guéridon, c’était écrit par Tresmontand, « Très bien ce type » il a dit... J’avais lu son Introduction à l’œuvre de Teilhard mais pour être honnête ça m’avait rasé...). C’est Yvon justement, le père à Chomé, qui m’avait prêté le premier volume de Teilhard, quand j’étais encore au bahut. Parce qu’il faut dire que la religion j’y ai goûté jeune, quand j’étais encore tout tendre. Puis j’en ai soupé, de la pratique s’entend. Ouais, c’est comme ça que ça s’est passé : c’est quand j’en suis sorti que j’ai commencé à y penser, quand j’étais dedans je voyais que dalle. Mais je vais pas m’allonger là-dessus, ça suffira quand j’écrirai ma biographie !
Pirot ne pratiquait pas, que je sache, mais ses actions de grâce il les rendait en travaillant (paraît qu’il broyait lui-même ses couleurs, parfois. Paraît aussi qu’il ne se servait qu’une fois de ses brosses. vrai ou faux, c’est des bruits comme ça qui faisaient leur petit effet).
D’ailleurs qu’on y croie ou non, quand on est peintre on est religieux. Je vois bien que parler de Dieu c’est mettre un nom sur l’Innommable auquel l’artiste se frotte tous les jours, qu’il cherche à percer le Secret ou qu’il adore le Mystère. C’est la seule matière de son art, toujours insaisissable et toujours poursuivie ; le tourment qu’il ne peut trahir et qui le nourrit ; la raison profonde que la raison ignore. L’art disparaît quand cette raison profonde s’efface ou devient indifférente ; la flamme s’éteint ; l’âme se putréfie et n’est plus qu’une carcasse, un mot vide, comme sont vides les formes en vogue, vides les peintures, et les autres, tous les hommes, et leur vie, vide.
Maintenir la peinture en vie par le seul fait de peindre c’est déjà énorme. De cette manière Pirot soufflait sur la flamme, et à sa façon : peinture maîtrisée – et polie, comme s’il importait d’abord que la peinture, dans une époque « perdue pour elle », parle un langage propre et clair – On l’entendrait mieux peut-être, et elle pourrait sauver sa peau, sinon gagner sa cause – ce qui viendrait plus tard, la route est longue et le temps presse !
Trouver son langage sans perdre de vue l’idée maîtresse qu’on peint comme on parle, pour être entendu.
Je l’imagine à ses moments, déchiré de vouloir conserver une apparence de contact avec une réalité commune qui n’est pas la sienne profonde. Je le vois enrager de chanter le jour ou la joie alors qu’un puissant génie le retient vers le fond, ou l’emmène, ou le pousse à tout dire, s’exprimer totalement, ne serait-ce que l’espace d’une toile, celle-ci qu’il est en train de peindre justement, précisément. Je vois dans un coin du tableau cette rage en forme de crachat rouge sang, un vrai juron de peintre en colère qui n’en peut plus de se contenir et qui explose. Violence brève mais totale, dégoût de peindre et de penser, fatigue de se respecter et les autres, on n’est pas respectable et noble et digne, on est con.
J’imagine.
Donner de l’âme à ce qui n’a qu’une forme. Donner une forme à ça qui n’en a pas – l’âme ? – c’est peut-être aussi difficile à faire, et quand c’est fait, aussi miraculeux.

Pour découvrir le travail de Pirot cliquez ici
22:30 Publié dans Extraits de romans | Lien permanent | Commentaires (2)
31/08/2007
ciel de lune (extraits2)

— De quoi parles-tu ? lui ai-je demandé.
— Des saletés que tu as écrites sur moi ?
— Où ça ?
— Dans ton roman que tu as laissé sur mon ordinateur !
— Mince ! J’ai laissé une copie sur ton ordinateur !
— Oui, et je l’ai lue, espèce de salaud.
— Je suis désolé. C’est un acte manqué. Mais ce ne sont pas des saloperies, c’est simplement la vérité nue que je raconte. Ça te dérange ?
— Est-ce que moi je raconte ta vie à tout le monde ?
— Rien ne t’en empêche. Et je ne m’y opposerai pas. C’est simple, il suffit d’écrire. Malheureusement, c’est plus facile à dire qu’à faire…
— En plus, tu as laissé mon nom sur ce manuscrit. On me reconnaît.
— Tu te reconnais. C’est une nuance de taille. Pas de problème, je vais le changer. Que dirais-tu de Dalila, comme prénom. C’est joli, non ?
— Tu n’es qu’une ordure.
— Pas tant d’honneur, je t’en prie. C’est beaucoup trop.
— Je te préviens, je te mets un procès si tu publies ça.
— Ce n’est pas à moi qu’il faut dire que tu veux empêcher cette publication, mais à l’éditeur. À ta place, je lui téléphonerais pour le prévenir que tu vas lui foutre un procès. Qui connaît mon existence dans ta nouvelle vie ? Personne ! Alors, pourquoi veux-tu te mettre en évidence ? Si tu portes plainte pour diffamation, cela ne restera pas secret. Où sera la différence entre réalité et fiction ? Tu savais bien que je me sers de tout ce qui m’entoure pour écrire. Alors, pourquoi n’en aurais-je plus le droit, tout d’un coup ? Ce risque, tu le connaissais ? Si tu dis que je mens, donc cette réalité est fausse. Si elle est fausse, comment peut-on se reconnaître ? Pour rétablir la vérité ? Mais tout est inventé depuis le début ! Cruel dilemme, non ? Ceux qui nous ont connus tous les deux, combien sont-ils encore ? Les doigts d’une main ! Quel intérêt à venir au-devant de la scène, alors ?
J’ai senti un léger flottement sur la ligne. Sa colère semblait s’estomper. J’ai continué.
— Tout le monde peut porter plainte contre moi. La Mère, le Grand, le Petit, ou le facteur qui se reconnaît. Pourquoi pas ? Si je dis que quelqu’un a des varices, je me retrouve à Fleury-Mérogis. Tu peux te permettre tous les coups bas, puisque tu interdis au témoin de témoigner. Le déni parfait.
— Tu as vu comment tu me traites ? Comme une mégère, une marâtre, une dinde acariâtre. Tu bafoues mon honneur, et celui de ma famille.
— L’honneur quel grand mot. Il s’agit de réalité n’est-ce pas ? La perception de la chose est-t-elle plus importante que la chose elle-même ? Ne t’inquiète pas je n’ai pas continué à écrire n’importe quoi. Je suis suffisamment lâche pour ne pas me fâcher complètement avec toi. On a des intérêts en commun, non ? Et je n’ai pas du tout envie d’un procès malgré mes fanfaronnades. Mais je ne vois pas pourquoi tu m’interdirais d’écrire. J’ai le droit de témoigner, non ? Je vais minimiser, rester impartial. Suivant le principe de la ciguë. Si tu ne dis rien, c’est toi qui deviens la victime de mes exactions et de mon délire verbal…
N’importe quel pékin qui sait à peu près lire te dira que c’est moi le crétin dans cette histoire. Le hareng mal dessalé. Il fallait vraiment l’être pour se fourrer dans une telle galère. Adopter toute une famille alors que j’avais eu la chance d’avoir échappé à ce genre de contraintes jusqu’à présent. Toi, tu es une vraie héroïne que j’ai traînée dans la boue. Une victime des temps modernes qui se sacrifie pour aider sa famille issue du tiers monde. C’est beau comme un vrai mélo. J’ai été assez fou pour te proposer le mariage la première fois que je t’ai rencontrée. Par pur intérêt fornicateur. L’avantage dans notre relation c’est qu’elles est suffisamment stéréotypée pour avoir l’intérêt graveleux de l’anonymat.
— Tu as écrit sur moi toutes ces saloperies, alors qu’on était encore ensemble. Tu n’as pas honte ?
— Le papier comme une bande magnétique a enregistré les craquements de mon cerveau. Va savoir, si je n’avais pas écrit, peut-être qu’aujourd’hui je serais mort, un assassin, ou un dépressif chronique.
— C’est ça, comme tu es masochiste, le rôle de martyr te colle bien ! Tu l’affectionnes.
— Oui ! Comme tout explorateur de l’espèce humaine. Des gens vont au bout du monde pour en côtoyer d’autres, pendant quelques jours, et ils ne prennent pas le temps de les rencontrer. Pour connaître quelqu’un, il vaut mieux s’arrêter. C’est certainement du masochisme d’approcher des êtres qui repartiront avec tout ce qu’ils ont apporté.
— Tu te venges comme tu peux... Pour qui tu te prends? Monsieur croit que ses petites histoires vont intéresser les gens...
— Ça n’est pas mon problème, mais celui de ceux que cette histoire intéresse. Je ne suis pas assez prétentieux ni mégalomane pour croire qu’elle est unique. On est des milliers, des millions à nous être fourvoyés dans le mariage mixte. La seule excuse que l’on ait, c’est que le ministre de l’Intérieur ne nous a pas laissé le choix. C’est déjà plus drôle non ? Une fois la pulpe du mariage exotique consommée, il faut se farcir le noyau. Et là, on risque de s’y casser les dents. Si j’avais eu plus d’argent, je crois que tu m’aurais supporté plus facilement. Malheureusement je n’en ai pas.
20:45 Publié dans Extraits de romans | Lien permanent | Commentaires (0)
18/07/2007
Les Crobards de Malnuit

Les illustrations sont de Yves Budin qui vient de publier aux carnets du dessert de lune Visions of Miles
Si j’avais un talent de scribe proportionné au temps que j’ai passé à l’introspection, je pourrais raconter toute ma vie à partir de cette montre, comme si son absence à mon poignet en donnait le sens – différent des aiguilles d’icelle.
Est-ce qu’une montre a jamais empêché quelqu’un d’être étonné qu’il soit si tard, ou qu’il fasse encore jour, ou qu’il soit l’heure de manger et qu’il n’ait pas faim ?
Les montres c’est tic tac et toc. Pas comme le temps dont elles ont le souci, qui lui n’a guère souci d’elles ! S’il se laisse enfermer dans ces niaises petites boîtes, c’est pour mieux filer du coton à l’anglaise avec ses amoureux transitoires et gloire à Dieu au plus haut des cieux qui a su épater tout son monde en créant la Terre en 6 jours seulement !
Dans sa prodigalité il songeait avant tout à ces grise mines de théologiens à qui fallait bien donner de quoi passer le temps sans être obligé de se reconvertir. Time is money c’est américain, et les américains c’était pas prévu. Ils se vengeront : ils ont mis les premiers le pied sur la lune - Armstrong. (Son homonyme l’avait déjà mis, et au-delà, depuis belle lurette, mais il est vrai que c’était un nègre, comme qui dirait que ça comptait pas. Il vient de mourir, en laissant derrière lui une flopée de soucoupes volantes que ceux qui ont des yeux pour ne pas entendre croient voir flotter dans le ciel en ces jours bien sombres quand la nuit est claire) – en attendant de Lui mettre leur poing dans la gueule peut-être !... Alors, ils entendrons soudain la trompette de Louis, leur surdité cessant et leur cécité c’est sûr ils en verront l’or, ouf !
Quand je dis les ricains, on a compris que je parle d’une mentalité dont les ravages dans l’espace-temps qu’elle exploite n’ont d’égal que sa nullité. (C’est ce que pense grossièrement l’ermite Albéric Troducq, que je vais consulter épisodiquement parce qu’il a la vue basse et l’humour pesant – pas confondre avec Albert Ducrocq, que j’ai pas besoin de consulter pour connaître ses pensées, lesquelles m’affligent aussi profondément que sa vue est élevée, pouah.)
Donc je disais que j’ai le poignet aussi nu qu’un ver. De montre point, ni par conséquent d’horaires, pas de risques d’être en retard à mes rendez-vous, et quand la vie en société m’impose d’être exact, je m’arrange : j’entre dans le premier bistrot boire un coup et j’en profite pour jeter un œil à l’inévitable cadran.
D’ailleurs je saurais pas dire comment je m’y prends, ça m’est naturel. Je chie quand j’ai besoin et j’évite comme je peux d’être puni pour ça. Non mais si j’ai parlé de cette montre c’est que ça pourrait être amusant de démontrer ce qui en découle, rapport aux formations et déformations de mon caractère...*
Le temps et moi on fait ça sans mouchards. Si les flics me suspectent un jour, à la question rituelle « Que faisiez-vous dans la nuit du 17 au 18 ? » je me mettrai à cafouiller et je donnerai ma langue au chat. Faut pas.
Quand une époque ou une date s’inscrit en chiffre dans ma mémoire, c’est qu’elle a sa raison, tant mieux tant pis : tant mieux si je peux m’en servir, tant pis si elle me dessert. Quand je pense que le mec Rimbaud pondait ses trucs illuminés à 16 ans ? 18 ans ? (vérifier) et qu’au même âge je pataugeais dans les mots comme c’est pas possible – et pas n’importe lesquels attention, plus c’était abscons et plus je croyais ça bon et pas con et profond.
Mais Rimbaud, ce porc d’ Arthur, ce n’était pas mon modèle, mon modèle c’était Renoir, l’Auguste – Non Renoir c’était fini, c’était Vlaminck – Pas à 18 ans non, à 16 ans, oui c’est ça, à 18 ans c’était personne. J’aimais des peintres parce que je me voulais peintre, la poésie c’était pour rire. J’écrivais tout plein de trucs et de machins, des poèmes quoi, et aussi un journal, tiens où est ce qu’il est passé, ah oui, je l’ai brûlé dans le petit poêle en fonte que j’avais dans ma piaule. Je me souviens que mon père avait eu l’air fâché quand il a su la chose. Tu parles, ça dégageait, on se serait cru chez Vulcain ! – Il m’a dit « Pourquoi t’as fait ça ? » et ses yeux étaient durs, oh pas longtemps, mais ça m’est resté là dans le buffet avec un gros point d’interrogation , parce que vraiment je comprends pas, lui qui ne m’avait jamais paru se soucier de ça, que j’écrivais. – Pour rire et parce que je souffrais ?
Est-ce que je sais maintenant pourquoi j’écris ? – Pourquoi j’écris, c’était pour moi soit disant la question qu’il fallait que je me pose, et aussi « pour qui » et aussi « comment »... Pas moyen d’y échapper ; on ne pouvait pas écrire sans avoir la triple réponse, qui constituait en quelque sorte le « passeport pour l’écriture », m’avait dit monsieur Chépaqui des éditions Julliard. Il était bien intentionné et je l’en remercie, même si à l’époque ça m’avait fait de la peine, ouais, parce que je ne savais pas, déjà, et que je ne voyais dans ces trois questions qu’une sombre hérésie. Ceci dit ce n’était pas bon et fallait peut-être que je travaille un peu la matière avant de prétendre à la publication.
Une idée comme ça qui me vient à l’instant : Et si je ne montrais pas mes textes par peur qu’on me dise « C’est mauvais » ? Outre que je jugeais inaptes à les lire les gens autour de moi, je ne voulais surtout pas risquer de rougir et m’enfuir la queue entre les jambes et mes pages sous le bras. Je m’adressais directement aux éditeurs, qui, eux, étaient censément de bons juges ; s’ils n’aimaient pas, il y avait entre leur dire et moi l’épaisseur du papier où je pouvais à mon tour répondre, me défendre si le cœur m’en disait. J’étais lâche, timide et vaniteux je crois. Je suis resté lâche, faut dire ce qui est, bien que j’aie acquis un certain courage, mais qui n’en a pas pour ce qui lui plaît ? Je suis resté timide, on n’en guérit pas, mais j’ai diversifié mes masques. Enfin je suis plus vaniteux que jamais – au point de désirer ressembler à personne et que chacun me ressemble, afin que je ressemble à tout le monde, tralala –
Je ne voyais vraiment pas comment ce que j’écrivais aurait pu être différent une fois noir sur blanc. Ce qui est écrit était écrit, parole d’évangile. Aussi bien ce que je disais n’avait d’importance que parce que c’était ce que je cherchais à dire, c’est mal dit. Les tâtonnements de la parole, les multiples façons de parler m’intéressaient seules, et non pas les sentences ; une phrase maladroite avait plus de charme et de sens qu’une phrase bien faite, comme en ont les mots d’enfants plutôt que ceux des orateurs – mes tentatives étaient sincères et pleines de tripes et dénuées de ce savoir-faire qu’on me prônait ; faire des progrès c’était mon affaire, et si je ne savais que piétiner c’est que j’étais un piétineur – progrès dans quel sens hé ho hein ?
J’avais sûrement un peu ce désir largement répandu qu’on s’incline sur mon passage, et de préférence admiratif ; mais pas d’étiquette, pas de sceptre, et telle qu’en elle-même ma nature était nue, un désert où le soleil craquait, un rogaton d’êtrumin dans le nœud du Verbe.
Écrire fut sans doute une recette pour me replier, me défaire. Ou plutôt ça l’est devenu, dès que les rimes au bout des phrases sont devenues des machins factices, des casseroles pour faire du bruit. Que j’en savais des choses à cet âge et que c’est long de désapprendre !
Et le jeune dingo téméraire qui s’allonge le cou à ronger ses liens, ça le mène à quoi ? À en chercher d’autres. À croire qu’il lui faut répéter le schéma d’origine. Allez va, téter sa mère y a que ça de vrai.
Laisser les nœuds se faire et se défaire et les eaux stagner ou couler et le soleil envahir la cave, qu’est-ce que ça veut dire et LA PAROLE PARLER !
*Quand j’étais merdeux j’ai passé pas mal de vacances en Suisse où la montre est une industrie nationale et où mes parents sont nés – Ils y ont même vécu toute leur enfance. – Ça a rien à voir ?
15:00 Publié dans Extraits de romans | Lien permanent | Commentaires (0)
16/05/2007
Welcome in india, Sir.
Les photos sont de Bénédicte Mercier

-On m’avait prévenu, mais cela dépasse tout ce que je pouvais imaginer, maugréa-t-il.
Le seuil du hall de l’aéroport franchi, l’impression a perduré. Les impulsions qui lui parvenaient encore au cerveau l’informaient qu’il était à côté de la plaque. Sa garde-robe n’a pas été préparée à ce qui l’attend. Un togolais qui débarque en boubou à Moscou en plein hiver doit ressentir un pareil malaise. Déjà en eau, il sait ne pouvoir quitter ce hammam qu’avec le billet de retour et déjà, il a envie de faire demi-tour.
La douane présente la lenteur qu’il sied à tout le lieu de passage anthropométrique. Inspection de la photo : un coup d’œil pour vérifier que l’homme présent est bien le même. Pas ou peu de vérification de bagages. Aucune question. Mais pas de réponse à cette lenteur dans chaque geste, ce silence de recueillement. La file attend et lentement un à un les passagers passent de l’autre côté du contrôle. Six heures du matin et déjà la chemise trempée de sueur lui colle à la peau du dos. Pas de climatisation. Quelques ventilateurs tournent lentement, trop lentement eux aussi, comme s’ils avaient réglé leur vitesse sur celle de l’administration locale. L’austérité est de mise en ces lieux.
Son tour arrive. L’homme qui porte barbe et moustaches de maharadja l’hypnotise, il ressemble à un lancier du bengale coiffé d’un turban enroulé autour de la tête. Avec un regard de félin, d’un seul coup d’œil il perçoit le niveau de palpitation cardiaque de la victime qu’il observe. Il le voit en sueur et tamponne le passeport sans autre façon.
-Welcome in India, sir.
-Thank you, sir, osera-t-il timidement.
Plus loin un chauffeur attend dans la foule en levant devant lui une pancarte avec le nom mal orthographié de Norbert Carratini.
-Un seul r, comme dans baratin dit-il au chauffeur qui ne comprit rien.
Le chauffeur, un homme jeune, parle un anglais que l’accent local rend difficilement compréhensible. Il s’empare des valises, hèle un porteur et le conduit à une voiture dont le modèle antédiluvien semble directement sorti d’un roman de Somerset Maugham. A peine les valises dans le coffre qu’il soulève le capot et plonge le nez dans la jauge à huile.
-Mauvais présage. Tant pis je suis là, et je ne peux plus faire demi tour, pensa Norbert.
C’est sur la route du transfert, entre l’aéroport et la ville de destination, qu’il a commencé à prendre conscience que rêve et réalité sont comme le corps et l’esprit, deux choses séparées. Cette impression, il a commencé à la ressentir à l’instant de toucher le sol. Ce corps oublié, qui va l’empêcher de dormir, il va le redécouvrir et rentrer dedans, pourtant chaleur et fatigue cumulées, auraient dû l’assommer.
Le spectacle de bon matin est paisible. Nulle part au monde, il ne doit en exister un semblable. Le long de la route des gens accroupis observent les voitures qui passent de si matinal horaire. Ils semblent attendre. Ce n’est qu’après plusieurs kilomètres qu’il comprendra que ces gens répandent le contenu de leurs entrailles sur ce qui a été des trottoirs. Une ribambelle de rachitiques est occupée à se soulager les tripes de son bol de riz épicé et cague le long de l’avenue. Les étrons qui sortent de ces corps efflanqués ne peuvent guère rivaliser de taille avec la moindre crotte joufflue d’un caniche européen. Ces minuscules déjections n’auront pas le temps de refroidir que déjà ils s’inscriront au menu de petits cochons noirs qui déambulent en hordes libres dans les rues. Avec un régime aussi vitaminé, ils ne peuvent être que bien portants. Comme rien ne se crée, ni ne se perd et que tout se transforme, ils finiront à leur tour dans l’estomac des Chrétiens autochtones, les seuls qui cuisinent cette viande. La poésie du cochon de lait à la broche ne survit pas sous ces latitudes.
Le spectacle ahurissant lui a fait oublier quelque temps la conduite intempestive et hasardeuse du chauffeur. Les pupilles rivées sur la route, il s’adressa à lui avec insistant:
-Quiet, sir. Quiet. We have the time. Don’t drive so quickly, please .
Et le chauffard mi-compatissant, mi-amusé jettera un œil dans le retro-viseur visiblement agacé par ce blanc-bec qui lui somme de tempérer son utilisation intempestive du klaxonne, du frein et de l’accélérateur…
-Yes, yes… We have the time. We can arrive toworrow. I préfère that, than never …
-Ok, sir répondra le chauffeur.
Il sera alors rassuré. Pour quelques instants seulement.
-Mais il est dingue. Il ne va pas doubler là. Mais, si, Bon dieu. Mais qui m’a foutu un abruti pareil.
En triple file, alors qu’un attelage de zébus était en train de doubler un bus à l’arrêt, il est passé allégrement à travers tout ça et dans un virage, sans aucune visibilité, au mépris des règles minimum de sécurité. Klaxon bloqué, phares allumés, dans une embardée, il a mordu le bas coté et soulevé un nuage de latérite rouge obligeant piétons, vélos et rickshaws à se jeter dans le fossé. A cet instant il a compris que le seul code de la route qui s’applique ici est celui de la jungle. Le plus volumineux et le plus cinglé a raison, férocement raison. Emettre un doute c’est abréger sa durée dans cet univers.

Cramponné au fond de son siège, il n’ose plus élever la voix, tellement il sait déjà que toute protestation sera inutile. Alors remettant son destin entre les mains de la providence, il tentera de s’endormir. Cette tentative restera vaine malgré douze heures d’avion, une nuit blanche, un déménagement éreintant et des préparatifs épiques qui ont duré des mois. Prendre une telle décision se prépare. Pensez donc, faire un long séjour dans un pays au nom aussi exotique que Pondichéry. Tout le monde a entendu parler, des comptoirs français des indes. Vos parents se souviennent de leurs noms appris par cœur au lycée. Cochin, Chandernagor, Mahé, Karaikal, Pondichéry. L’Alsace et la Lorraine des tropiques, perdus corps et bien.
Pondichéry… Rien que le nom lui a ravi l’âme. La mystique du voyage… Les aventuriers du golf du Bengale et la cote du Coromandel face aux Nicobar Islands, plus loin la Birmanie et le Vietnam. Sur la carte, ça faisait joli. Il n’y a pas à dire. Les amis en bavaient d’envie, lorsqu’il évoquait devant eux son départ. Pas besoin d’en rajouter pour épater la galerie, car ce n’est pas tous les jours qu’un inconscient ose se jeter à l’eau du haut de ces falaises. Personne n’avait osé le prévenir qu’il y aurait peut-être des difficultés de compréhension. Pensez donc, tout le monde parle encore français a Pondicherry, avec deux r et un y pour l’épellation anglaise, du moins c’est ce que semblent vouloir encore croire les irréductibles francophones. Le fait qu’habituellement le voyage se fasse en sens inverse n’a pas éveillé en lui le moindre soupçon, trop occupé à préparer le départ.
Il décharge dix litres d’adrénaline par minute… Combien de cheveux blancs a-t-il attrapé en deux heures. En regardant son visage dans le rétro, il remarque son teint blafard, ne sachant pas s’il est du à la seule fatigue ou si la peur se lit à ce point sur son visage. Par moments, il n’a pas pu s’empêcher de fermer les yeux, tant paraissait éminente sa fin. Mentalement il écrivait son testament : ça je le donne à untel ; il sera content. Ça à un autre, ça lui plaisait bien. Il est persuadé que dans ce jeu de massacre il ne pourra pas atteindre vivant son lieu de destination. Et pourtant, en pilant, allumant les phares, faisant hurler le klaxonne, mordant le bas coté, donnant des grands coups de volants pour rétablir la situation, ça passe. Il ignore comment, mais il est encore de ce monde. Plus pour longtemps certes, car au régime de deux cents pulsations minute, le cœur va lâcher. Des sueurs froides lui parcourent l’échine. Il manque d’air. La fatigue, les bouteilles vidées et les émotions des derniers jours risquent de le faire flancher.

S’il avait su qu’un chauffeur encore jeune n’était pas une garantie pour arriver à bon port, en voyant celui-là il lui aurait interdit de toucher le volant et n’aurait pas abandonné sa vie entre les mains de ce kamikaze dont le karma va devenir le sien pendant une paire d’heure. Question d’expérience, lui, en son karma, il y croit moins. Et ce type, il aurait préféré ne l’avoir jamais rencontré. Il l’effrayera plus que n’importe quelle autre situation louche dans un bas quartier. Des chauffards, il en a pourtant croisé par le passé, tous plus inconscients les uns que les autres. Mais là tout le pays semblait mépriser le danger. Les chèvres aussi croient en leur karma et elles traversent en troupeau entier la nationale se foutant éperdument des véhicules. Comment être le même après une telle frayeur ? Il ne pouvait espérer meilleur comité d’accueil pour lui donner envie de fuir ventre à terre.
-Si après cela on désire rester en Inde, c’est qu’on est un foutu pervers. Et si on y survit, alors on peut s’adapter à bien d’autres situations, car on est aussi blindé que ces Ambassador.
Norbert Caratini maudissait déjà l’entreprise pour laquelle il allait travailler. Sachant leur expérience et leur connaissance du problème, il les jugera criminel de n’avoir pas pensé à lui épargner de telles émotions. Car eux ne pouvaient, ne devaient pas ignorer l’étendue de sa frayeur et le cauchemar de ces deux heures de transfert entre l’aéroport international et son lieu de destination.
-« Plus rien ne sera pareil et vous ne pourrez plus voir le monde avec les mêmes yeux. Plus rien n’aura de sens… Plus rien auquel vous raccrocher, alors qu’un vide vertigineux s’installera sous vos pieds. Pendant tout ce temps, il vous faudra tenir en funambule sur le fil ténu du peu de raison qu’il vous restera. Ce sera le bain de révélateur de vous-même dans lequel vous serez plongé en permanence qui fera qu’un autre naîtra de vous, sur vos décombres. Un être hybride jaillira de cette carcasse, façonné avec les restes de l’ancien. Les couches du passé vont se décoller les une après les autres, ce qui vous provoquera un trouble intense », lui avait prédit une connaissance bien intentionnée, avant de partir.
-Mais qu’est ce qu’il me raconte ?
Norbert l’avait alors regardé avec des yeux de mérou apoplectique. Il ignorait le sens de ses paroles et le prenait pour un type gentil, mais légèrement dérangé avec ses encens thérapeutiques et ses flux énergétiques. Lui et ses prédictions à la mord-moi. Il l’avait écouté d’un œil compatissant. En pensant qu’un bon Tranxene lui serait plus qu’utile, bien qu’il ne soit pas vraiment agité.

Fini les petits paysages aux bosses sages, aux formes douces, plantureuses et maternelles des contreforts pyrénéens. Tout dans ce nouveau monde semblait chaotique, violent, cruel, terrible. L’univers des hommes est ainsi, il n’en doutait pas, mais il ignorait qu'il pu l'être à ce point. Tout lui paraîtra crasseux, et ce ne sera pas une simple impression. Tout est crasseux, poussiéreux, sale, infect, déglingué ou mal entretenu.
Malgré le choc, il trouvait encore de la beauté dans ces temples décorés de spots lumineux et de guirlandes électriques qui clignotent et sont censés mettre en valeur les laques brillantes des statues polychromes, dont le bestiaire oscille entre le tombeau de Toutankamon, Disneyland et une fête à neu-neu en technicolor.
Le sacré, les dieux monos ou polygames, les religions pluridisciplinaires ou polymorphes tout cela n’aura aucun sens et lui apparaîtra comme un décor de théâtre auquel, quoi qu’il apporte comme connaissance livresque et comme raisonnement, il ne comprendra rien.
-Pour appréhender ce qui se passe ici, il faut se contenter de lire le travail des érudits, qui n’ont pas été assez fous pour vérifier leurs dires sur le terrain. Ils avaient bien raison à l’abri de leur forteresse en bouffant d’édition… Mais surtout ne jamais mettre les pieds sous ces maudites tropiques.

08:55 Publié dans Extraits de romans | Lien permanent | Commentaires (0)
Un enfant de coeur (extrait)

Près de l’entrée, la crèche des gosses abandonnés à la naissance ou des enfants de parents incarcérés. Ils attendaient là une solution qui tardait à venir, ou une éventuelle famille d’accueil. Tous s’entassaient dans cette cour des malédictions, ce cul de basse-fosse. Tous étaient des gosses d’ivrogne, à de rares exceptions. Tous des cas d’urgences ou comme nous des cas sans solution immédiate. Le Père buvait, mais on était bien vivants et en bonne santé.
La dame en blanc nous a indiqué nos dortoirs respectifs. Le Petit résidait chez les petits, qui ne sont pas tenus de faire leur lit. Nous deux, dans une autre pièce. Hauts plafonds, huit lits par chambrée, en deux impeccables rangées de quatre. Couvertures blanches au carré, murs blancs, draps blancs, cela nous changeait du pensionnat.
Les couloirs, on les traversait en rangs, pour aller au réfectoire, aux douches, aux dortoirs ou à la télé. Partout, interdit de parler. Dans la cour, ne pas crier. Obsédant silence. Fuir, fuir ces murs, cette porte verte, la longueur des jours, le blanc. Le monde était derrière cette porte verte. Ailleurs… Loin de ces couteaux dentés à bouts ronds en inox, de ces verres et de ces assiettes transparentes, de cette odeur de Javel, d’éther, de produits d’entretien. Le monde n’a pas cette couleur, cette odeur. Il sent, il pue, il transpire. Chaud, froid, tendre et cruel, tout à la fois. Mais pas ainsi, blanc, blanc, blanc. Du blanc pour le personnel. Des blouses grises, des shorts marrons, des baskets bleues pour les pensionnaires. On ne risquait pas de nous confondre avec eux, une fois nos tenues de bagnards enfilées. L’administration ne connaît pas la fantaisie. Le règlement et l’uniforme sont ses seuls lots.
Le monde et la vie ne pénétraient pas en ces lieux. Pour y goûter au monde, il aurait fallu posséder l’énorme trousseau de clefs de Mlle D. Accroché comme suspendu à sa hanche, ou enfoui dans la poche de sa blouse, il la déformait par une bosse, au niveau de sa cuisse. Elle tournait ses clefs nerveusement sur leur anneau pour se donner un air. Il y avait la grosse clé de la grande porte, et les petites des bureaux ou des dortoirs. Au total, un bon kilo de ferraille. Chaque instant de l’existence était régi par ce concert de métal.
Pour tout, il fallait lever le doigt. Demander l’autorisation. La cour étant dépourvue de w.-c. on y pénétrait par le perron d’entrée du bâtiment, mais cela relevait du règlement. En dehors des temps autorisés le surveillant nous interdisait l’accès aux toilettes. Son veto était irrémédiable et il avait les moyens, dissuasifs et persuasifs, pour nous apprendre à ne pas trépigner d’impatience. Il arrivait qu’une subite envie doive attendre l’heure du repas. Les urinoirs étaient regroupés dans la même pièce que les lavabos et douches où l’on se lavait les mains avant d’aller au réfectoire. Alors, si on ne pouvait plus tenir, on urinait discrètement dans le parterre de géraniums.
On est devenus des champions du sport intérieur en serrage de sphincters ou rétention de vessie. On a rapidement appris à reconnaître les moments stratégiques pendant lesquels on devait impérativement penser à nos besoins pour s’éviter ce genre de désagrément. C’était vital ! L’administration doit pouvoir tout contrôler, y compris l’intérieur. Il faut obéir à ses sacro-saintes lois, qui ont été mises en place pour notre bien, et surtout ne jamais douter un instant qu’elles ont été faites pour ça. Sinon c’est à devenir fou.
Le règlement, l’administration nous l’a fait pénétrer jusqu’au plus profond de nous-mêmes. Et on peut leur faire confiance aux agents zélés de l’administration. Ils se démènent pour justifier leur salaire. Stoïque et hautaine, Mlle D. demeurait de marbre face aux incontinences des pensionnaires. Rien ni personne, ni larmes de crocodile, ni supplication ne la faisait fléchir.
Les après-midi pluvieux, on descendait dans la salle de jeux au sous-sol. Étaient mis à notre disposition une table de ping-pong quatre raquettes, un jeu de petits chevaux, un autre de dames, et des cartes dépareillées. Pas de livres ni de revues, rien à lire, à regarder ou à découvrir. Il fallait attendre que passe la journée, que s’écoulent cruellement les minutes martelées au carillon du désœuvrement et de l’ennui, que les jours fuient. Par beau temps, on restait dans la cour avec pour tout décor le bitume, deux balançoires et, là-haut, le ciel bleu où j’aurais voulu me perdre.
Souvent, entre les grands, éclataient des bagarres. Elles n’avaient pas le temps de dégénérer. Le surveillant qui traînait toujours dans les parages y mettait de l’ordre, au hasard des têtes qu’il rencontrait sur son passage. Il se frayait un chemin à coups de pied et des claques. À part se battre pour s’occuper, le Tatoué , un pensionnaire, ne connaissait aucun autre métier. Proche de la majorité, il avait déjà passé les trois quarts de sa vie en foyers, fuguant de l’un avant d’être transféré dans un autre. Il ne s’est pas éternisé et a été expédié dans un centre d’adaptation par le travail. Il a dû atterrir dans un hôpital psychiatrique ou en prison.
Il n’aurait pas dû être agressif. La dose de calmant qu’il avalait chaque jour avait de quoi abrutir un troupeau de mammouths. Il parlait lentement, avec une légère mousse blanchâtre au coin de la bouche. Même le plus violent poison ne le calmait pas, tellement il était accoutumé aux tranquillisants.
08:34 Publié dans Extraits de romans | Lien permanent | Commentaires (0)
25/04/2007
Orage sur les Pyrénées
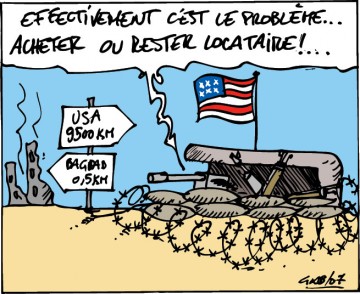
Parfois, une farine ocre transportée directement du Sahara, par strato-cirrus ou cumulo-nimbus, tombe là, au milieu du maïs, des vaches, des haricots, et souille tout d’une couche rose. Comme si cela ne suffisait pas, le ciel déploie une palette qui s’étend du vert au rouge, en passant par le jaune, le bleu, le noir et le violet. Un vrai bazar à coloristes. À part quelques rêveurs, ça n’impressionne plus personne. Ici, les orages ressemblent à une guerre que se livrent ciel et terre. Il décoche d’immenses flèches de lumière, pendant que se répercutent les coups sourds du canon dans le fond des vallées succédant à des flashs de tungstène. Puis tout ce raffut se calme pour ne devenir qu’un simple roulement de tambour lointain qui annonce la fin des hostilités.
20:30 Publié dans Extraits de romans | Lien permanent | Commentaires (1)
09/04/2007
Un homme parmi d'autres...
Il était assis au café penché en avant sur sa tasse. Il avait bien vieilli, son dos s’était voûté. Il m’a regardé comme s’il s’adressait à un inconnu. Quand je me suis assis à sa table, j’ai eu un instant de doute. Non, ça ne peut être que lui, étant donné sa stature, son pouce coupé. Son visage était tout couperosé et bouffi, son regard absent.
-Salut je t’amène le roman dans lequel je parle de toi, je lui ai dit tout de go. Je préfère que ce soi moi qui te le remette en mains plutôt que tu apprennes son existence par la bande. Comme ça tu pourras me casser la gueule si tu en as envie… Tu ne peux plus porter plainte le délai légal est passé…
Le vieux en face de moi a gardé le silence, puis il a articulé difficilement
-Qui tu dis ?
-Moi tu ne me reconnais pas?
-Excuses-moi j’avais confondu avec quelqu’un d’autre… Et depuis ces accidents au cerveau, j’ai du mal avec la mémoire…
La terreur de la ville était là, devant moi, incapable de se souvenir du passé. Avec dans le regard autant d’intelligence qu’un âne qui vient de bouffer sa merde… L’alcool, les nuits blanches, les femmes, les amphétamines avaient eu raison de sa santé, physique et mentale…
Il l’a bien utilisé notre argent et a laissé des ardoises dans les bars, les restaurants, les boites de nuit, les hôtels où il emmenait ses pépés.
Un beau jour sa femme n’a pas fait qu’amener ses valises et ses fringues devant la porte de l’imprimerie… Elle a demandé le divorce et changé les serrures de la maison… Le soir même il partageait sa chambre d’hôtel avec une nouvelle maîtresse danseuse de flamenco, maquettiste, ouvreuse de cinéma… Une compagne de tendresse tout simplement…
Les banques ont fermées le robinet quand sa femme a revendu ses parts de l’entreprise… Alors les dominos se sont effondrés. Je n’étais déjà plus chez lui quand c’est arrivé. A l’époque, quand il avait besoin d’une machine neuve il emmenait sa femme une semaine en vacances dans des palaces exotiques. Elle ne lui garantissait en retour le crédit auprès des banques… En son absence la secrétaire annonçait :
-Le vieux est parti à la sucursale, pour désigner le café d'en face....
Comment lui en vouloir de nous en avoir à tous autant fait baver. Toute sa fortune volatilisée en bagnoles, bamboches et donzelles. Il avait revendu l’imprimerie pour éponger les dettes. Ne lui restait que sa retraite, l’ennui et plus assez de souvenirs pour en rire. Son cerveau aussi l’avait lâché. Il ne m’inspirait pas de pitié, ni de haine. J’ai détourné le regard pour ne pas lui montrer ma peine. Je préférais encore le voir saoul et hurlant comme un macaque plutôt que minable et tout poisseux de déveine échoué sur une plage, mazouté avec les autres piafs. Il n’aurait pas dû vieillir et crever d’un seul coup, d’une angine de poitrine, ou d’une durite qui claque au moment sublime d’une étreinte… Qu’il ait le droit de crever comme on pisse… Debout la bite à la main et le nez dans les étoiles…
17:35 Publié dans Extraits de romans | Lien permanent | Commentaires (0)
15/12/2006
Bruits d'humains

Photo: Bénédicte Mercier
15 mai 1975
Barcelone barrio Chino.
Habituellement quand il descendait dans le Barrio Chino il passait la nuit dans une pension familiale où il prenait ses aises. La patronne une grosse femme dont les bourrelets graisseux du fessier débordaient de chaque coté de la chaise en assurait l’accueil. Elle appartenait à la race des déesses mères, sortes de vierges des temps primitifs dont les poignées adipeuses dégoulinaient les unes sur les autres, comme une bougie à moitié consumée dont le suif aurait beaucoup suinté. Elle n’en bougeait guère de sa chaise qui avait fini par sembler devenir un appendice de son gros-cul et elle dormait probablement sur place. Il ne se serait pas aventuré à affirmer le contraire.
La première fois, il avait choisi cet hôtel pour son aspect anonyme. Les suivantes parce que la patronne lui rappelait cette maîtresse maquerelle, dont il avait gardé un souvenir ému. Depuis il avait eu accès à d’autres initiations plus tordues, mais rien ne pouvait effacer le souvenir de la première fois.
La matrone assise sur sa chaise ne comprenait pas la signification du sourire si sympathique qu’il lui adressait, mais il s’en foutait. L’odeur du lieu aussi était identique, un mélange de naphtaline, de livarot, d’encens et de créosote. Il ne manquait que le bidet au milieu du patio.
-Le romantisme ça vous fait crever un homme debout, pensa-t-il en constatant un début d’érection.
Il avait choisi aussi cet hôtel parce qu’il se trouvait prés des Ramblas, et il aimait s’en approcher pour sentir battre le cœur de cette ville. C’est là qu’il rentrait en contact avec son agent. Jamais le même. Parfois il devait attendre plusieurs longues journées, enfermé dans sa chambre.
-Vous dites ?
-Oh, rien. Ce sont des souvenirs qu’on aurait pu avoir en commun c’est tout. Il arrêta là son monologue craignant d’être pris pour un dingue ou de devenir un type vraiment suspect.
Il décida de passer son temps en restant le plus possible enfermé dans cet hôtel. Déambuler dans les bars aurait pu attirer l'attention ou favoriser une malencontreuse rencontre. Trente ans s’étaient écoulées, mais il avait été trop connu ici pour se permettre ce genre de fantaisie et sa tête malgré les années n’avait guère changé. Toujours aussi mat de peau, un visage osseux, une gueule qui les faisait toutes se pâmer de la catin à la bourgeoise. Il avait toujours été étonné qu’on s’intéresse autant à sa sale gueule.
Il était peu probable qu'il verrait son contact pendant ce Week-end pascal et cela lui augurait de longs jours d'ennui.
-L’Espagne est toujours aussi catho… Putain, ça ne changera jamais, ça.
Il régnait une chaleur lourde comme seul il peut en exister à Barcelone, et un taux d’humidité à coller les enveloppes entre-elles. Il aurait juré que s’il avait laissé ses chaussures dans un coin, il les aurait retrouvées couvertes de champignons avant la fin de la semaine. Tout aurait moisi. Les perroquets verts qui voletaient de palmiers en palmiers jactaient autant que des pies. Impossible de fermer l’œil pendant la sieste.
Allongé sur le dos dans l’air irrespirable de sa chambre, il regardait les volutes de ses Fortuna s’envoler au plafond. Il pensa qu’il n’aurait jamais dû arriver si tôt. Mais les correspondances des vols ne lui avait pas permis de partir plus tard. Il ne put s’empêcher de repenser à cette femme. Elle le hantait encore, trente ans après. Des parties de jambes en l’air comme celles-la, il n’en avait jamais revécu de semblables. Il tâta son membre à travers l’étoffe légère de son pantalon et senti une raideur.
-Putain de pays de merde… J’ai le feu au cul et pas moyen d’aller voir une petite femme. Qu’est ce qu’elle a bien pu devenir depuis tout ce temps ?
Lorsqu'il avait quitté le pays, plongé dans l'obscure dictature du généralissime, elle travaillait pour les renseignements de la police et exerçait aussi son métier à domicile, source inépuisable d'informations.
Elle avait probablement bien mal tourné et, couverte de bijoux elle devait régner sur tous les bordels de la ville, et toucher de l’argent de tous ses bourgeois qui voulaient encore s’accorder un coït dominical entre hostie et billet de loterie. Il lui savait gré de l'avoir tiré du pétrin quand il avait été si recherché par la police. Elle l’avait hébergé sans rien lui demandé d’autre que de la baiser et tant d’années avaient passé...
Bravant l’interdiction qu’il s’était fixé et taraudé par la curiosité il pensa rendre visite à cette vieille amie à qui il devait d’être encore en vie.
Le heurtoir de la lourde porte n'était plus en place, un digicode l'avait remplacé. C'est à ce genre de détail, que l'on s'aperçoit qu'un pays change. Il attendit que quelqu'un rentre et s'engouffra à sa suite, la femme le regarda avec suspicion, comme pour prévenir les questions il amorça la discussion.
-"Je vais chez madame Esmeralda au troisième!"
La dame le regarda interloqué et lui répondit:
-Je crois que vous faites erreur monsieur. Il n'y a personne de ce nom ici!
-Mais, si, voyons, une cinquantaine un peu forte, elle habite au troisième!
-Impossible
-Pourquoi donc,
-C'est nous qui y habitons!
-Depuis longtemps?
-Une dizaine d'années!
-Je suis à la recherche de cette dame, sa fille qui vit en Argentine est décédée. Peut-être pourrez-vous m’aider à la retrouver!
La dame parue très embarrassée. Elle réfléchit un instant avant de répondre.
-Ecoutez, venez à la maison, quelques instants, mon mari inspecteur de police, vous renseignera.
A la photo du caudillo dans le couloir; au crucifix au-dessus de la porte du salon, il savait que la moindre information qui pourrait lui être transmise ne lui serait qu'après un méticuleux interrogatoire.
-Je suis le père de son gendre, nous vivions en Argentine. Nous n'avons plus de nouvelles d'elle depuis si longtemps!
Le flic paraissait terriblement embarrassé.
-C'est que, Madame est décédée depuis si longtemps que, l'appartement a été réquisitionné par décret et l'argent des loyers placé chez notaire!
C'était donc ça le nœud du problème.
-Vous avez l'adresse du maître?.
Ils se jetèrent des regards inquiets, les deux du petit couple.
-Je ne pense pas que vous le trouverez à son cabinet aujourd'hui. Comme tout le monde, il a déserté Barcelone pour le Week-end pascal.
Par tout le monde, il entendait certainement les gens de sa caste. Les autres continuaient à vaquer à leurs occupations quotidiennes.
-Ce n'est pas grave, j'ai le temps!
-D'ailleurs ma femme et moi allions quitter la maison!
Rien ne semblait pourtant l'indiquer, ni panier à pique-nique, ni valise dans le couloir. Sentant le regard inquisiteur, il précisa.
-Nous aimons nous rendre à l'hôtel!
-Bien sûr on y est tellement plus à l'aise, leur dit t-il, comme pour les réconforter et estomper le soupçon qu'il sentit dans le regard de l’homme.
Il le photographia de mémoire. Oui, c’était bien lui. Ce ne pouvait être que lui. Cette cicatrice sur la joue gauche… Obtenue lors d’un combat au sabre à l’école de police… Oui, pas de doute à avoir…
Il plia le papier et le glissa dans son portefeuille. Il se rendit à l'adresse. A son niveau une voiture s'arrêta, trois types en descendirent deux l'alpaguèrent et le troisième le poussa sur le siége arrière où deux autres sbires l'entourèrent.
-Alors garçon, on est en visite au pays?
Il ne pu les reconnaître. Mais leurs voix, il s'en souvenait… Il les entendait à travers la serviette mouillée qu'on lui avait mis sur le visage et sur laquelle on versait de l'eau. Il s’était juré qu’un jour ces enfants de putains et leur chef, allait payer pour toutes ces souffrances quand il se réveilla le dos trempé de sueur. Tremblant de peur. Maintenant il savait qu’il ne reviendrait plus jamais sereinement à Barcelone. Il attendit son contact, claquemuré dans son hôtel, son billet de train en poche.
Il souleva l'oreiller et retira de dessous son parabellum, il enleva le cran de sécurité et recompta les diamants. Il s'assura qu'on ne le suivait pas et ne retourna pas de suite à l'hôtel. Dans la poche de son pantalon, il tâtait les pierres à travers le tissus.
-Encore heureux que j'ai pris mon calibre, pensa-t-il. En tout cas je ne construirais pas un château en Espagne.!
Dans son travail, on ne mélangeait pas les affaires et les sentiments, et il venait de faillir à cette règle.
Les pales du ventilateur découpaient l'air au plafond. Allongé sur le dos, il fuma un paquet de Ducados. Il pensait qu’il n'aurait pas dû essayer de renouer le contact avec Esmeralda. Sa libido lui avait joué un sale tour. Elle avait dû l’aimer vraiment pour prendre autant de risques et le protéger aussi longtemps. Mais elle détestait ces types du renseignement et leur méthode. Elle avait fini par tomber comme tant d’autres.
En refermant la porte il pensa que ce nouveau modèle de silencieux pour son P38 était d'une redoutable efficacité. Il a allumé sa cigarette en se jurant que ce serait la dernière. Depuis le temps qu’il s'était promis d'arrêter de fumer et qu’il avait sans cesse reporté sa décision. Il savait bien qu'il se mentait. Malgré les risques encourus pour sa santé, il continuait. N'ayant jamais put résister à la tentation, il avait accepté cette faiblesse comme toutes les autres. On s'habitue à tout, avec un peu de résignation. Il pensait vite, par à coups. Des images se superposaient sur des ralentis. Tout revenait comme une aigreur, après un repas trop lourd. La vie est difficile à digérer. Il savait bien qu'il n'avait pas choisi d'arrêter de fumer, cela il l'avait compris, probablement c'était la seule chose qu'il avait accepté. Il lui semblait faire ce geste pour la dernière fois comme lorsqu'il avait tourné la clef dans la serrure de sa chambre en interrogeant son chek list. Tout était parfaitement en ordre, comme il l'avait prévu. Il ne lui restait plus qu'à laisser la clef en bas, avant de se rendre à l'aéroport...
Il se revoyait sur le tarmac de kinchassa avec son bagage à main. Il était un autre, barbe rasée, cheveux coupés très courts. Il se sentait léger dans ce costume. Bien qu'il sache qu’en Argentine ce soit l'hiver, il s'en fichait. L’escale prévue était à Barcelone. Il ne savait pas qui serait son contact. Il ne l’avait jamais vu ne le reverrait jamais. Il recevait un coup de téléphone, il se rendait à un autre hôtel, de grande classe celui-là. Il attendait encore, puis recevait un autre coup de téléphone. On lui apportait l’argent, il laissait les diamants et il retournait à son hôtel.
Les liasses de coupure dans sa mallette, il héla un taxi, mais avant de se rendre à la gare, il demanda au chauffeur de faire un léger détour. Il lui laissa un billet et lui demanda de l’attendre. Sa valise à la main, il s'engouffra dans le porche à la suite de la jeune fille. Il sonna au troisième étage. Quand le couple apparu dans l'encadrement du couloir, ils s'affaissèrent l’un après l’autre, dans un bruit mat.
- De la part d’une amie, dit-il!
Et il referma la porte.
19:45 Publié dans Extraits de romans | Lien permanent | Commentaires (0)
11/12/2006
Malnuit, vous avez dit Malnuit...
Quand dans sa vie on a eu la chance de cotoyer de tels personnages, aprés tous les autres vous semblent mornes, fades, sans réelle envergure.
Les autres, ils ne brûlent pas la chandelle par les deux bouts, ils s'économisent.
Ils vont lentement et sûrement, mais pour aller où?
Tous ceux qui l'ont cconnu se souviennent de ses crises de folie quand il avait trop bu. Sa carcasse n'encaissait pas beaucoup non plus. Il ne croulait jamais sous la table et ne buvait que de la bière.
Jamais de vin, breuvage trop puissant pour son humble constitution.
Cet espèce d'ange avait les ailes engluées dans un quotidien cruel qui n'était pas fait pour lui.
Bref, sans jouer les anciens combattants, je reste persuadé du style de l'écrivain Malnuit, comme si celui de peintre ne lui avait pas suffit à mi-chemin entre celui d'un Bukowski, d'une Duras, d'un Céline, d'un Djian.
Un peu tous ceux-là à la fois, mais tellement lui, forcément lui...
Ce texte: Stop sur papier jauni, jamais publié, jamais présenté non plus à un éditeur, écrit pour le plaisir, comme beaucoup d'autres textes; c'est BALLOUHEY dit Bacaze, le filochard de l'expédition qui m'a scanné les pages du manuscrit...
En voici quelques pages pour vous mettre l'eau à la bouche...
Un jour, je vais me remettre à l'édition et ce sera lui mon premier et ancien auteur publié...
Et il y en a bien d'autres que j'aimerai republier, Morin, Longchamp, Amina Saïd , Baglin...
Le temps passe trop vite....
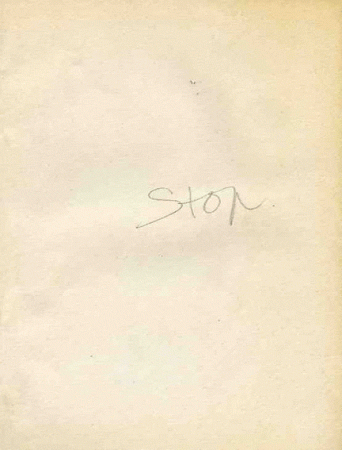
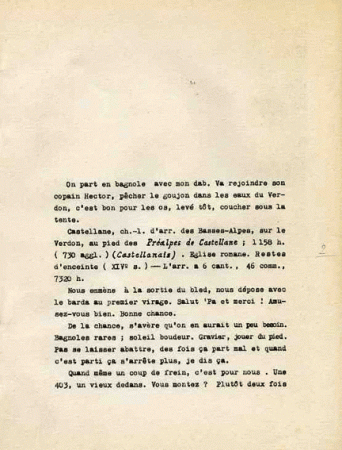
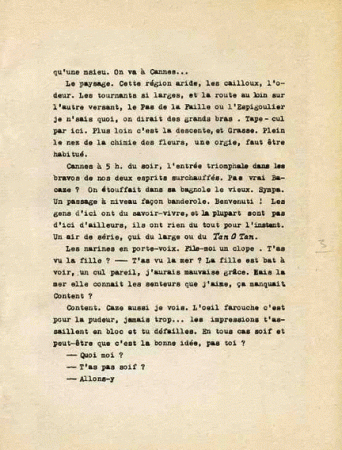
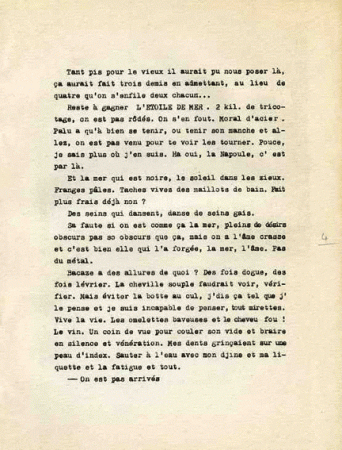
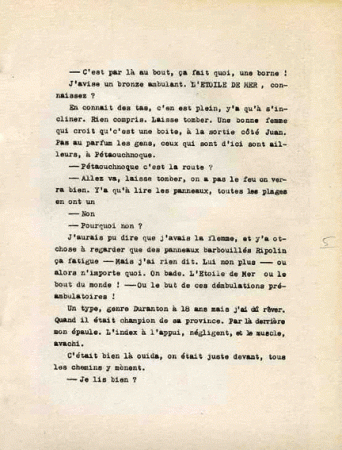
17:20 Publié dans Extraits de romans | Lien permanent | Commentaires (0)
03/12/2006
MALNUIT à Fleur de Peau
Ce texte Fleur de Peau de Michel Malnuit a été publié par le passé aux éditions Ressacs. Je vous en redonne aujourd'hui le début.
Faudra ressaisir toute l'oeuvre de Malnuit, cela prendra du temps, de l'énergie. plus de 5000 pages pour le journal sans compter tous les romans, publiés et les inéditss, comme: Corbu's book, Fromage de tête, Totem.
C'est qu'il était prolixe le Sapiens... Autant pour la peintuure...
Ausssi sans attendre je vous donne dés à présent des extraits de Fleur de Peau...
Tu te moquais des enfants. Un petit garçon était là, flanqué d’une nounou aride et visiblement idiote. Tu prédis qu’il ne vivrait pas longtemps, qu’il mourrait bientôt. Et je riais. Chaque passant avait droit à tes injures. Tu n’épargnais personne. Et je riais. À ton tour tu te ridiculisais d’un mot. Et je riais.
Une idée cherchait un mot où se couler, mais aucune en convenait. Tu disais n’importe quoi, et au bon moment, un mot particulier suscitait une idée, que tu développais. Ainsi tu éloignais les silences. Peut-être y avait-il une raison à cela, je ne sais trop laquelle.
Je ne peux pas me défendre d’un sentiment morbide. Et m’en accuser le prolonge. Tant pis pour moi, je ne tiens pas assez à me taire… J’ai bien le droit de croire que je te parle encore, que nous pouvons encore nous moquer des gens. Tu ne m’as rien ôté.
Je ne suis pas résolue à n’attendre plus rien de toi. Tu ne m’offrais rien, mais j’ai beaucoup reçu. C’est ainsi. Les rares élans qui savaient t’échapper ne m’étaient pas destinés, non plus qu’à personne. Tu les disais gratuits, " comme ça ". Insolent. Ne rien donner, jamais. N’obliger personne. Oh je n’ai pas d’amertume. Celui qui donne un peu m’assoiffe. Mais tu ne me donnais pas, que pouvait-on attendre ? Je me perds en mots creux ( un terme à toi, non ?)

Gouache de Malnuit Format 80 x 120 cm
16:05 Publié dans Extraits de romans | Lien permanent | Commentaires (0)


