28/02/2009
Au quotidien....
Des assistantes sociales et de la première d(r)ame de France
Par Mouloud Akkouche
Le 25 février 2009 dans une gare française, je croise un gosse d’environ sept ans. Un dépliant publicitaire à la main, il marche très à l’aise dans la foule. Pourtant son visage porte des traces de coups dont deux yeux au beurre noir.
Il suit un homme qui lui ressemble beaucoup, sans doute son père ou un autre membre de la famille. Je les observe et pense évidemment que cet homme ou un autre adulte maltraite cet enfant.
Que faire dans la cohue? Alerter l’un des flics flanqués de jeunes bidasses promenant leur fusil mitrailleur? Aller demander des explications au type avec l’enfant? Si je me trompais? Comment intervenir sans aucune preuve?
Et, finalement pressé comme tous les autres passants -d’autres l’avaient aussi remarqué-, je continue mon chemin. Lâche et impuissant, incapable de lui apporter la moindre aide. Après tout je ne suis pas éduc de rue, me dédouane-je en accélérant le pas.
Aujourd’hui, je me rappelle cette expression qu’il m’arrive parfois d’employer en rigolant: "Fais pas ton assistante sociale" ou "Arrête de nous la jouer éduc". Facile à dire quand on passe sa journée à écrire, protégé de la boue du monde par un écran.
Ce jour-là, face à un regard vide, j’ai compris réellement la nécessité des travailleurs sociaux. Heureusement que toutes ces petites mains de la République sont présentes au quotidien dans nos villes et campagnes.
Contrairement à un célèbre porteur de sac de riz, ces travailleurs sociaux ne passent pas leur temps devant des caméras ou à cirer les pompes de dictateurs africains ou grand ponte de l’industrie pétrolière. Après la perte d’un maroquin de ministre lors d’un changement de gouvernement, Bernard Kouchner s’était plaint à un journal télévisé de son sort de nouveau chômeur. Aussi bon comédien qu’un autre Bernard.
Pas assez rentables ces feignants!
Peu après son arrivée à l’Elysée, la nouvelle première dame de France déclarait:
"Je voudrais aider les femmes, les enfants, lutter contre l'ignorance et contre l'exclusion."
On ne peut qu’applaudir à une telle initiative humaniste. Apparemment moins portée sur l’argent que son mari qui se fit augmenter de 170 % et qui, pendant un certain temps, cumula salaire de ministre de l’Intérieur et de président de la République, sans parler du reste, dénoncé par quelques journalistes.
Mais la façade sympathique s’effaça très vite; en excellente pro pour son actu, elle n’hésita pas à faire l’article de son nouveau disque en l’offrant aux ministres qui, ravis d’une dédicace élyséenne, s’en firent immédiatement l’écho sur le petit écran.
Mais, très altruiste, notre première dame distribuera une grosse somme à une association caritative. Un geste qui la rend désormais intouchable. Comme une autre première dame avec ses pièces jaunes. Danielle Mitterrand ou Claude Pompidou, même si je ne partage pas du tout leurs idées politiques, ont une autre envergure.
Des milliers de postes qui ne seront pas renouvelés dans la fonction publique
Tandis que madame la Présidente officie donc dans son rôle de dame patronnesse, son époux décide de supprimer -de ne pas renouveler passe mieux- des milliers de postes dans la fonction publique. Pas assez rentables, ces feignants qui interviennent pendant les tempêtes ou vous soignent à l’hôpital public…
Certains énarques, critiquant sans cesse le manque de rentabilité du service public et les impôts trop lourds, oublient que leur années d’étude dans une école publique ont été financées par les impôts de tous. Mais l’écrire ou en parler vous relègue aussitôt dans le clan des horribles poujadistes.
Bref, parmi cette charrette de fonctionnaires, il y aura des assistantes sociales et éducateurs: professionnels -sans disque à vendre- qui, jour après jour, s’échinent sur le terrain. Pas des citoyens qui, comme moi et d’autres, se contentent de constater et dénoncer après une bouffée d’indignation. Puis on passe à autre chose.
Peut-être que, en ce moment, un éducateur de rue rescapé du dégraissage tente, lui, d’apporter une aide réelle à ce gosse paumé dans une gare. Un gosse sans Rolex qui n’a pas attendu 50 ans pour rater sa vie.
publié pour la première fois par Rue 89
21:18 | Lien permanent | Commentaires (0)
Passage des Indes (2)

Andréa a penché un peu la tête sur le coté, et m’a regardé comme pour me gronder.
— Dis donc tu vas bien toi, tu maigris trop me lança-t-elle ?
— Oui, je sais mais je me suis attrapé deux ou trois diarrhées de suite.
— Tu as pris des médicaments au moins.
— Oui, mais ça s’arrête et puis ça recommence.
— Faut bien soigner ça. Tu n’as pas de sang ? Pas de fièvre ?
— Non.
— Bon. Alors Intétrix ou Imossel c’est le meilleur. J’en ai plein la pharmacie. Et puis j’ai ça aussi dit-elle ouvrant la porte de la réserve. Elle en revint avec une bouteille de pastis.
— Ce sont des amis qui me l’ont rapporté de France. Il faut que tu en boives un ou deux fonds de verre sans eau Et il faut que tu manges plus. Tu maigris à vue d’œil c’est pas bien. Il ne faut pas que tu tombes malade. Ici le climat est très dur, comme tu t’en es aperçu.
Elle se préoccupait de ma santé comme s’il s’était agi d’un de ses enfants tout en faisant fi de la sienne. Étrangement cela me rassurait aussi, de savoir que j’avais été adopté par la vieille soeur. Car l’orphelinat était un lieu où je comprenais ce qui se passait contrairement à tous les autres où je pouvais aller dans ce foutu pays. J’avais pensé que grâce a elle j’apprendrais beaucoup de l’Inde. Moi aussi j’y avais trouvé refuge.
— Depuis que je suis ici les choses ont bien changées. Je me souviens qu’on allait en vélo et ça faisait rire les Indiens. Il n’y avait qu’une seule route empierrée et peu de voitures. C’est étrange de voir comment la vie a évolué. Tout cela est vraiment proche, le temps ne se déroule pas comme en Europe, tout ici est plus lent ; le temps s’écoule d’une façon si paisible qu’il en paraît étrange. Je ne veux pas retourner en France. Pourquoi faire ? Ma vie est ici, auprès des enfants.

matin de Noël 2003 à l'orphelinat. les plus jeunes découvrent leurs cadeaux et embrassent leur maman Andréa...
16:26 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : soeur andréa, orphelinat, pondicherry
27/02/2009
Au revoir Andréa !
Soeur Andréa in memoriam.

soeur Andréa décembre 2003
Un mail est tombé envoyé par Devi probablement, la plus âgée des filles de l'orphelinat..... maman a ete hospitalisee et maintenant elle est morte.
J'ai eu le chance de croiser soeur Andréa lors de mon séjour en Inde et d'habiter à l'orphelinat pendant six mois entre septembre 2003 et mars 2004... Je m'étais promis de retourner rapidement à Pondicherry, la vie en a décidé autrement. Andréa déjà affaiblie par sa maladie, continuait à diriger sa grande maison parfois depuis son lit où il lui arrivait de rester allongée toute la journée. Malgré son état de santé elle faisait preuve d'un charisme et d'une attention de tous les instants aux enfants. Les amis, tous laïcs, qui sont passés nous voir en Inde, ont été subjugué par cette femme qui avait réussi à convaincre et à construire cette maison pour les enfants.
Biographie extraite du site de l'orphelinat:
Arrivée en Inde à l'age de 29 ans, Soeur Andréa consacre sa vie au service des pauvres : d'abord auprès des lépreux pendant 12 ans, puis comme bénévole au service social du consulat français de Pondichéry pendant 12 autres années alors qu'elle travaillait au lycée français.
Ces années au consulat lui ont permis de réaliser l'importance de la misère et l'insuffisante scolarisation des enfants.
En 1981, à l'age de 50 ans et avec l'accord de l'archevêque de Pondichéry, elle décide de créer une institution pour accueillir les enfants des rues, orphelins ou abandonnés : c'est la fondation de P.A.V.O.
Les dix-huit premiers enfants sont accueillis dans une maison en location.
Dès 1985, l'orphelinat dispose en propre de son premier bâtiment, dans le quartier Venkata Nagar au sein de la ville indienne. Grâce à des dons et au financement de l'association A.A.V.O., des locaux annexes viennent progressivement compléter le bâtiment principal.
Aujourd'hui l'orphelinat accueille environ 75 enfants, certains dès leur naissance, et jusqu'à leur autonomie vers 21-23 ans, l'age de la majorité étant fixé à 21 ans en Inde.
L'orphelinat aide aussi à l'extérieur de l'orphelinat plus de 80 enfants issus de familles très défavorisées : ces enfants peuvent ainsi continuer à vivre chez eux.
Si vous voulez en savoir plus sur Andréa et son oeuvre et contribuer à sa pérennité Cliquez Ici
Passage des Indes.
Extraits du roman à paraître.
Dans cette pièce toute sombre, éclairée seulement par deux fenêtres peu lumineuses car recouvertes d’un fin grillage censé en interdire l’accès aux moustiques, on ne distinguait pas immédiatement en venant du dehors la masse allongée du corps sur un lit au fond. Le ventilateur brassait efficacement l’air. La vieille sœur dormait sur un lit en bois dont l’armature soutenait des lanières de corde qui lui servait de sommier. Depuis son antre où elle semblait à l’agonie, elle surveillait l’orphelinat. Sa chambre, lieu stratégique de passage entre les bureaux et le réfectoire lui permettait d’entendre tout ce qui se passait.
Andréa ne s’était pas levée de la journée. Elle récupérait de sa nuit blanche. Son taux de sucre anormalement élevé la faisait terriblement souffrir des jambes. Elle se réveillera quand elle aura faim où lorsque la douleur sera trop importante. Parfois elle pleurait, autant par souffrance que par désespoir de se voir affaiblie alors qu’il y avait encore tant à faire. Pourtant elle ne prenait pas son insuline régulièrement prétextant que la veille son taux de glycémie était très bas et qu’elle se sentait bien. Cela lui faisait sur les jambes des marques à l’endroit où elle appuyait, comme un mastic mou qui aurait gardé l’empreinte du doigt.
Les jours où sa santé lui permettait, elle trottinait et d’un œil vigilant et inspectait tout. Des bureaux aux cuisines, elle donnait de la voix et sermonnait, râlait, pestait, tempêtait. Depuis son opération, comme elle ne pouvait plus monter à l’étage dans les dortoirs des grandes filles pour constater l’état de propreté, elle se contentait de vérifier si toutes les assiettes et les verres en inox étaient bien à leur place dans les étagères, ce qui lui donnait une indication sur l’état de rangement des dortoirs. Les plus grandes tentaient de faire régner l’ordre, certaines y arrivaient, à coups de décibels et de torgnoles ; ce qui est bien plus efficace.
Les assiette et les verres portaient le numéro de l’enfant. Pas de couteau ni de fourchettes prévues dans l’équipement ; simplement une cuiller. Et ceux qui avaient égaré la leur mangeaient à la main, ce qui la mettait en colère.
Les grandes, censées aider à maintenir le cap, étaient les plus souvent absentes au réfectoire. Elles se faisaient apporter leurs repas dans les dortoirs par une plus jeune. Quand la sœur inspectait les gamelles, chacun devait avoir son matériel au complet devant lui. Elle vérifiait le numéro de quelques-uns. Comme ce n’était jamais les bons, il fallait organiser un loto pour que chaque propriétaire retrouve son matériel. Loi du genre oblige, les plus grandes dérobent aux plus petites, les leur. Ils partaient à la chasse au trésor récupérer dans les dortoirs sous les lits ou dans les armoires, les assiettes manquantes.
— C’est pas possible d’être aussi indiscipliné. Vous faites n’importe quoi. La nourriture est interdite dans les dortoirs. J’ai trouvé la porte d’entrée grande ouverte cet après-midi et un rat énorme dans le dortoir des petits. Vous savez bien qu’il faut la fermer à cause des rats. Et en plus vous montez la nourriture qui les attire. Vous faites n’importe quoi… Les petits dorment en bas, il aurait pu les mordre. Un rat gros comme un chat et il était très agressif. Il a fallu se mettre à plusieurs pour le chasser. Rien ne va plus dans cette maison…
Puis il fallait attendre que la prière soit finie pour passer à table.
Quand le réfectoire bruyant résonnait des cris des gosses, cela ne manquait pas d’attirer la sœur qui arrivait de son antre en râlant :
— Non mais, c’est quoi ce bazar ? Vous faites n’importe quoi...
Elle menait sa nombreuse famille comme elle pouvait. Son autorité remise en cause par les plus grandes, les plus retors aussi, l’obligeait à des colères tonitruantes dont elle se serait bien passée. Elle arrive encore à régenter tout son monde, bien qu’elle sache que depuis sa maladie, la maison ne tournait plus comme elle l’aurait voulue.

Joseph, c’est un petit maigre, ingénu, chez qui toutes les misères du monde, se sont données rendez-vous. Pas un jour sans une chute, ou un coup de poing généreusement offert par un plus grand. Une sorte de clown triste qui ne peut exister qu’en faisant des bêtises. Et il en fait, dans le cadre de la loi de l’emmerdement maximum, appelée aussi loi de Murphy. À Dipawali, fête ô combien pétaradante qui consiste pendant deux jours à faire exploser des pétards en ribambelles, tous plus dangereux les uns que les autres, d’énormes détonations retentissent dans toute les quartiers. Tirs de mitrailleuse, claquements solitaires ; depuis les terrasses on pourrait croire que les combats d’une guerre civile à l’arme légère se déroulent en ville. Et ce n’est pas la mousson qui calme les pétaradantes joies, bien au contraire. Plus il pleut, plus les autochtones redoublent d’allégresse explosive. C’est qu’il faut les honorer les dieux ; alors ils y vont de leurs pétards. Dipawali c’est le jour où les services d’urgence sont débordés, tympans crevés, doigts brûlés, oeil énucléé...
Dipawali c’est aussi le jour où les enfants désargentés tirent leurs pétards de seconde qualité; ceux ramassés dans la rue parce qu’ils n’ont pas explosé. En dépiautant les couches superposées de papier il est possible de retrouver le bout de la mèche et de tirer dessus pour en obtenir une. Avantage ; ils sont moins cher. Inconvénient ; la mèche est bien plus courte, voire quasiment inexistante et le pétard explose très vite et bien plus fort... En réunissant les divers éléments : l’orphelinat, des pétards à mèche très courte, Joseph et Dipawali : les conditions de l’application de la loi de Murphy étaient réunies.
L’idée absolument lumineuse du petit Joseph a été de mettre un pétard dans un sac plastique après l’avoir allumé. Il a bien réussi, mais l’explosion a fait fondre le plastique et lui a douloureusement endolori la main. Un des garçons est venu me chercher pour lui porter secours. Joseph pleurait et tenait la main plongée dans un pichet rempli d’eau.
— Mais qu’est ce que tu as foutu ? Fais-moi voire ta main...
— Faut pas le dire à maman.
— T’occupe ouvre ta main ?
— Je peux pas, gémit-il.
J’ai essayé de regarder l'état de la plaie, j’ai vu des cloques, du plastique fondu, mais la poudre brûlée recouvrait tout d’une couche grisâtre et grasse.
— Désolé mon vieux mais je ne peux rien pour toi. Il faut nettoyer ça avec de l’alcool, et voir si rien n’est cassé. C’est pas normal que tu ne puisses pas bouger tes doigts. Je t’accompagne chez Dolorès.
Il ne voulait pas le bougre.
— Elle va me punir, parce que j'ai fait une bêtise.
— Mais non, mais non, elle ne va pas te punir. De toute façon tu es obligé d'aller la voir... Tu n'as pas le choix...
Il me suivait et gardait toujours la main plongée dans le pichet. Quand Dolorès nous a vu, elle a compris. Elle n’a pas réfléchi et s’est levée comme elle a pu, a réclamé ses deux grandes filles pour l'aider et venir avec elle. Son ami médecin et propriétaire de la clinique ne l'a fait jamais payer ni pour elle ni pour les enfants. Et ça fait du monde son orphelinat.
Sans hésiter elle l’a emmené à la clinique, vérifier qu’aucune fracture ne l’avait estropié, le piquer contre le tétanos... Considérant que la leçon avait suffisamment était douloureuse il n’a pas eu droit à sa paire de baffe bien méritée. Elle se contenta de le regarder avec un léger sourire narquois et de le traiter d’andouille; son insulte préférée.

l'heure du départ après six mois à Pondy, mars 2004
11:44 Publié dans un peu de poésie dans ce monde.... | Lien permanent | Commentaires (5)
10/02/2009
SŒUR PERDUE
Soeur perdue
Une nouvelle de Mouloud Akkouche

Sur la nationale, elle ralentit le rythme et se détendit. Douze kilomètres la séparait du village. Un moteur ronronna et elle leva le pouce. Le conducteur accéléra en la reconnaissant. Elle ôta son blouson qu’elle roula en boule dans le sac et reprit la route, T.Shirt collé au dos et nuque brûlante.
Une voiture freina d’un coup sec. La radio allumée à fond. Un jeune type au crâne rasé la dévisageait. Son sourire dévoila un piercing à la langue.
-Tu me reconnais ?
- T’as le permis toi maintenant ?
Il baissa le son.
-Je t’emmène.
Elle monta. L’habitacle empestait la sueur. Il démarra dans un crissement de pneus.
-C’était comment ?
Elle soupira.
Quinze jours avant, elle sortait de prison. Seule dans une ville inconnue avec quelques billets en poche. Et plus du tout envie de remonter sur un braquage. Après avoir trouvé un hôtel minable, elle poussa la porte de plusieurs boîtes d’intérim, sans succès. Mais chaque jour, on lui proposait de vendre son cul ou de la came. Elle quitta la ville.
-Tu veux pas en parler ?
Il dévorait des yeux la poitrine de Béatrice.
-La route, c’est devant.
Elle pencha la tête dehors, cheveux plaqués contre le visage, paupières closes et bouche ouverte. Elle poussa un cri et tendit l’oreille. Pas un bruit. Elle gueula plus fort. Les falaises lui répondirent. Elle sourit.
-Dépose-moi là.
-Tu veux pas que je t’emmène là-haut?
Elle claqua la portière.
*
Le cimetière était désert. Elle s’accroupit devant la tombe : Le Boiteux 1901-2007. Elle avait gardé toutes ses lettres. Le seul à lui avoir écrit.
Le jour où elle débarqua à ‘’La ferme des Pierres‘’ avec une éducatrice, il la détailla des pieds à la tête et lui tourna le dos. « Tu peux pas avoir de gosses, c’est comme ça ! engueula-t-il ma future mère, pourquoi t’es allé adopter cette gosse-là qui parle même pas notre langue ? Une gitane amnésique trouvée sur la route ».
Il en voulait à sa fille d’avoir forcé le destin. Des mois durant, il ignora l’adoptée, refusa de manger à la même table qu’elle, ne lui adressait jamais la parole. Jusqu’au moment où elle déboula dans la cuisine, une perche de 24 cm à la main. Dès la sortie de l’école, elle le rejoignait dans sa maison isolée à l’orée d’une chênaie. Le bougon solitaire l’emmenait à la chasse et la pêche. Elle assimilait très vite les noms des animaux, des fleurs, des arbres, connaissait la moindre sente, lisait les traces sur le sol, interprétait vents et nuages, déchiffrait les vols d’oiseaux... Rien ne lui échappait. Le boiteux, soulagé de transmettre ce que sa fille méprisait, lui légua un héritage de gestes et sensations. Le seul à pouvoir lui arracher des sourires.
Un matin d’hiver, tous deux chassaient sous la pluie. Après des heures, trempés jusqu’aux os, ils réussirent enfin à localiser un chevreuil au bord de la rivière : très jeune. Il leva la tête, pattes tendues. Ses nasaux frémissants sondaient l’air. Il bondit et courut. Ils se lancèrent à sa poursuite. Soudain, talonné par les chiens, l’animal se roula frénétiquement sur le sol. Les aboiements très près. Il se releva et reprit sa course, le corps couvert de boue. Truffes au sol, les chiens reniflèrent. En vain. Il ne pouvait être loin. Légèrement en hauteur, Béatrice et Le Boiteux examinèrent chaque bosquet. Les chiens piétinèrent sans succès. « Je le vois ! » murmura-t-elle, l’index replié sur la détente. Son premier gros gibier. Le vieil homme leva le canon et la balle se perdit dans les frondaisons. Elle se fâcha. Il siffla les chiens avant de tourner les talons sans explication. Le chevreuil rejoignit ses congénères. Jamais Béatrice ne comprit le geste du Boiteux.
Deux mois plus tard, il se barricada avec son fusil de chasse, prêt à défendre sa peau contre des ennemis invisibles, ennemis dégueulés par le passé. Il tirait au moindre mouvement. Béatrice, seule autorisée a pénétrer dans l’étable, réussit à le calmer. Fusil cassé en deux sur l’avant-bras, il sortit sous l’œil des gendarmes. Pour finir dans une maison de retraite.
Et elle commença à dégringoler.
*
Elle les retrouva comme elle les avait laissés. Son père, attablé devant un journal ouvert, et sa mère, l’œil dans le vague, assise dos à la cheminée. Pas l’air surpris. Son arrivée avait dû déjà faire le tour du village.
Après un échange de regards gênés, elle posa son sac et les embrassa.
-Quatre ans, souffla sa mère, c’est long…
-Tu paieras pas plus cher assis, fit son père.
Elle s’installa sur le banc.
La cafetière siffla sur la gazinière. Sa mère se leva aussitôt et éteignit le feu.
-Ma fille, répéta-t-elle en lui tapotant la main, ma fille… Tu es revenue.
-Quoi de neuf ici ?
-Que du vieux, souffla sa mère.
Béatrice détestait cette phrase.
-Regarde-moi un peu. Qu’est-ce que tu as changé ! Une vraie femme. Encore plus belle que sur la photo du journal.
Elle désigna un cadre posé sur un meuble : Béatrice à 15 ans sur la première marche d’un podium, une médaille autour du cou. Visage fermé.
-Tu vas faire quoi maintenant ?
Elle se tourna vers lui. Pas de réponse. Cette interrogation ne l’avait pas effleurée. Trop préoccupée à larguer le passé, elle n’avait pas songé au reste… Et au lendemain…
-Elle vient à peine d’arriver. Laisse-lui le temps de reprendre ses marques.
Béatrice la remercia d’un hochement de tête.
-J’ai pas pu ouvrir la maison du boiteux. Vous avez changé les serrures ?
Son père marmonna :
-On l’a vendue.
Elle pâlit.
-Pourquoi ?
-Pas le choix.
-Qui l’a achetée ?
-Un type de la ville. Il est venu qu’une fois. Il a tout laissé en état. Je crois qu’il va en faire un gîte.
-Le Boiteux est mort comment ?
-De sa belle mort, répondit sa mère.
-Comment ça ?
-Ben, il est mort dans son sommeil…
Béatrice se rappela sa dernière lettre.
‘’ Dans cet hospice de merde, même le ciel n’a plus d’odeur. ‘’
-Tu dois mourir de faim.
Pendant le repas, son père lui expliqua que, trop vieux, il ne pouvait plus s’occuper de l’exploitation. Sa voix tremblotait. Il baissa les yeux. Sa mère semblait soulagée, elle avait toujours détesté le travail de la terre. Ils voulaient vendre et prendre un appartement pour leur retraite. Bien sûr, elle pourrait les suivre.
Sans un mot, Béatrice se leva et alla devant la fenêtre. Le cèdre du Liban avait beaucoup plus résisté que les autres arbres. La fierté du Boiteux.
- Je voudrais reprendre l’exploitation.
Son père sourit.
*
La porte ne résista pas au coup de pied. Elle reconnut aussitôt l’odeur. La cave était toujours aussi encombrée. Elle grimpa l’escalier. Beaucoup de meubles avaient disparu. Pas le fauteuil abîmé devant la cheminée, le fauteuil où elle lui racontait ses cauchemars : les gosses -toujours- sans regard, le blond frisé jouant du saxo au bord d’une piscine, le type lui donnant des coups dans une caravane. Elle n’en avait parlé qu’à lui.
Les têtes de sangliers fidèles au poste à l’entrée de la cuisine. Comme à chaque fois, elle les salua d’une geste machinal avant d’entrer. Rien n’avait bougé.
Elle s’assit à sa place habituelle : face au siège du Boiteux. Elle ravala une larme. Après un rapide tour de la maison, elle monta au grenier.
Personne d’autre qu’elle ne connaissait sa cachette. « Quand je serai mort, tu pourras aller voir. Pas avant. Tu me le promets ? ». Elle poussa un meuble et s’ agenouilla. Les lames ôtées, elle plongea la main et remonta une boîte en métal.
Après une hésitation, elle l’ouvrit. Ses médailles de guerre, des photos de son épouse, lui au volant de son premier tracteur. Beaucoup de lettres à sa femme, la plupart pendant la seconde guerre. Allait-elle les donner à ses parents ? Pendant qu’elle les rangeait, une enveloppe plus récente attira son attention. Elle lui était adressée, l’expéditeur ne lui disait rien. A l’intérieur : une lettre et une photo. Une gamine de six sept ans, sourire aux lèvres, portait un bébé. Près d’elle, un panneau de signalisation avec un nom de village.
15 juin 1995
Délia,
Autant commencer par ça : votre vraie prénom est Délia. Je ne connais pas votre nom. Il ne reste plus de votre passé que cette photo de vous trouvée dans vos vêtements. Vous ne vous en sépariez jamais, même pour dormir. Difficile de remuer ce passé…
Vous avez été retrouvée le 6 mai 1986 par l’un de nos employés près de la clinique. Fauchée par une voiture, vous étiez grièvement blessée. Pendant une semaine, votre père et les autres membres de votre groupe ont fouillé partout et interrogé les commerçants. Une femme est venue me voir à la clinique ; elle répétait : « Délia, Délia ». Cette femme était debout devant l’entrée, votre chambre au-dessus d’elle. Une petite fille l’accompagnait, elle vous ressemblait beaucoup. Je lui ai répondu que je ne vous avais jamais vue. Quelques jours plus tard, tous levaient le camp. Sans même une main courante à la gendarmerie.
A l’époque, le patron de la clinique avait un ami dont le fils requerrait en urgence d’une greffe de rein. Quand il a su qu’une gosse du voyage sans identité était arrivé dans le coma, il m’a demandé de prendre un rein et le greffer sur le fils de son ami. Je vous mentirai en disant que j’ai hésité longtemps. Non, j’ai tout de suite accepté quand il m’a annoncé la somme pour l’intervention. Je ne pensais qu’à ouvrir ma future clinique. Bref, 14 jours après l’opération, nous vous avons endormie et déposée sur le bord d’une route. Le lendemain, un article de la presse local annonçait que vous aviez été trouvée par des chasseurs et confiée à la DASS. Entre temps, j’ai ouvert ma clinique dans une autre région. Quelques années plus tard, j’ai vu un reportage télévisée sur l’athlétisme. Jamais je n’aurais pu vous reconnaître. Mais votre mère adoptive raconta au journaliste votre trajectoire et j’ai tout de suite compris. Aucun doute. Après des mois d’hésitation, j’ai fini par venir dans votre village. Je vous ai vu plusieurs fois mais jamais je n’ai osé vous parler. Incapable. Aujourd’hui, sur mon bateau loin de tout et près de la mort, je veux que vous sachiez la vérité. Je vous ai sauvée après l’accident pour, deux jours après, voler votre rein et votre mémoire. Maintenant vous savez tout Délia.
Vous trouverez ci-dessous le nom et l’adresse de l’homme qui vit avec votre rein. Même si cette greffe lui a évité une mort certaine, il n’a aucune responsabilité dans cette affaire. Le seul vrai responsable de ce crime c’est moi. Si je n’avais pas accepté, jamais vous n’auriez subi ce prélèvement sauvage.
Bien sûr, je suis conscient que cette lettre et ce chèque n’effaceront rien du tout. Rien ne pourra remplacer un rein arraché à une petite fille. Je le sais bien.
Bernard Lefort
Adossée au mur, elle lut et relut la lettre. Abasourdie. La photo à ses pieds, retournée sur le parquet. Pourquoi le Boiteux lui avait-il caché ce courrier ? Sans doute par peur de la perdre. Elle lui en voulait d’avoir décidé à sa place.
La colère monta d’un coup. Aujourd’hui, ses fantômes portaient des noms. Elle grimaça et ferma le poing. Le chirurgien, trop facile de pleurnicher, boufferait le chèque et la lettre. Ensuite elle irait cracher sa douleur au transplanté. Elle les haïssait tous, lui et tous les autres qui lui avaient volé un rein et dévié le cours de son histoire. Plus question de souffrir seule. Elle hurla, cris mêlés de rage et douleur. Impuissance. Elle boxa un placard.
A bout de souffle, elle se laissa tomber sur un fauteuil. Elle resta un long moment immobile. Remonter jusqu’à cette gamine sur la photo ? Se retrouver ? Tirer un trait sur le passé ? Se venger ? Trop abattue pour prendre une décision. Jamais aussi coincée.
Elle comprit le geste du Boiteux.
La dernière parution de Mouloud.

Et un petit morceau musical de la petite famille Rodinka de Limoux, de Drahomira qu'on croirait directement sortie d'un film d'Emir Kusturica...
09:06 | Lien permanent | Commentaires (0)
06/02/2009
Pélieu de profondis
article paru dans le numéro de février du Mensuel Littéraire et poétique (Bruxelles).
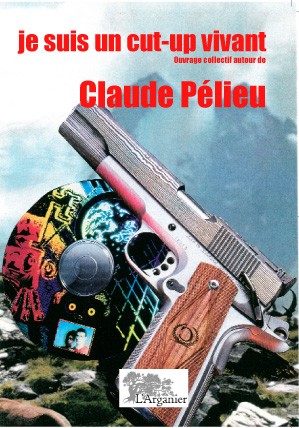
À la veille de Noël 2002, Claude Pélieu a fait sa dernière pirouette, lui qui ne croyait plus au Père Noël depuis longtemps. Il laissait de part et d’autre de l’Atlantique, des amis fidèles consternés par sa disparition. Parmi eux, Alain Jégou a eu à cœur de projeter un ouvrage collectif consacré à Pélieu. L’entreprise nécessita une pleine année occupée à rassembler textes et témoignages des derniers témoins de la « constellation Pélieu ». Il fallut aussi trouver suffisamment de souscripteurs pour financer l’impression de ce volume redevable d’aucune aide publique dans une indépendance que n’eût pas désavouée Pélieu. Le résultat est à la hauteur de l’attente. Je suis un cut-up vivant constitue sans doute le plus bel hommage à ce poète extravagant qui n’obtint en France qu’une reconnaissance timide malgré le soutien de quelques éditeurs et de poètes conquis. Fort de 282 pages l’ouvrage réunit plus de 40 participants, auteurs, artistes, musiciens aux nationalités multiples. Témoignages, lettres, collages, textes de Pélieu composent ce sommaire alléchant qu’il serait trop long de détailler ici. Je suis un cut-up vivant, un titre qui reflète parfaitement l’œuvre éclatée de Pélieu. Il s’explique d’ailleurs, dans des notes préparatoires à un entretien avec Bruno Sourdin, sur sa conception du « collage » : si la peinture est une plaie ouverte le collage est un pansement sur le film de notre culture et de l’histoire. Le collagiste est un moine, un sage, c’est l’infirmier du vide, du tout, du rien. Un moine lumineux et déviant voyageant, immobile, entre nulle part et ailleurs. La coupure est là pour marquer sans doute un réel insaisissable dans es émiettements, tel un puzzle jamais rassemblé. Claude Pélieu a mené jusqu’au bout une révolte dénuée de toute complaisance. Il a rendu à la poésie toute sa liberté, vomissant au besoin ses lettres de noblesse. Son dernier texte, la Crevaille, est offert à tout souscripteur du présent volume. Alors, même si, de sa tombe, vous entendez Pélieu ricaner : n’achetez pas ça, c’est que des conneries, n’en croyez pas un mot.
Alain Helissen
23:59 Publié dans Des écrivains qui vous bousculent | Lien permanent | Commentaires (0)
René Barde- paysan poéte
Quand l'écho du pas de Calais rend compte de la soupe à la chaussette
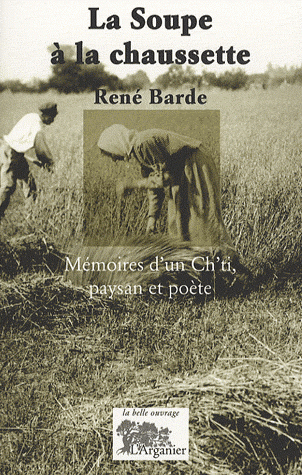
Raymond Besson, lecteur internaute arrageois a eu le « coup de foudre » pour un livre récent : « La soupe à la chaussette. Mémoires d’un Ch’ti paysan et poète ». Il nous présente sa « fiche de lecture ».
« Prenez le petit dernier d’une famille de paysans âpres au gain, mettez-lui la tête dans les étoiles et un poil dans la main… Gageons que vous en ferez un enfant mal dans sa peau, souffre-douleur de la fratrie, puis un adulte instable et hyperesthésique. En l’occurrence, certains enfants rentreraient dans le rang ; René Barde, lui, va se replier sur lui-même et faire de sa vie une étrange aventure faite de paresse, de mysticisme contrarié, de pudeur maladive, de rébellions incongrues, d’ascétisme outrancier… et de littérature. Car l’enfant n’a qu’un seul rêve : devenir écrivain. Hélas ! Sa condition misérable dans un Paris hostile, exacerbée par la faim, le froid, l’humidité, la promiscuité…, va transformer l’existence de René Barde en un vrai calvaire : les joies seront rares, l’amour absent, l’amitié déçue, le succès inexistant. Et l’homme, comme l’avait fait l’enfant, va se recroqueviller dans un dénuement qui finira par altérer sa santé, mais jamais il ne doutera qu’il a choisi le bon chemin : « L’abandon est la marque de mon destin, et c’est sans crainte que je vois le présent approcher l’autre rive. Oui, vraiment, j’ai gagné la partie. » Lourde introspection qui met parfois le lecteur mal à l’aise, doutant que l’on puisse vouloir la misère, en marge des siens et de la société. Il en vient souvent à pester contre cet homme qui aurait pu être heureux si, ici ou là, il avait su vaincre son défaut majeur : la peur de vivre.
Ce livre change de ce qu’on lit traditionnellement, en matière d’autobiographie. Et puis, cette volonté incompréhensible de « réussir ses échecs » peut fasciner. Comme l’homme est étrange ! Quelle débauche d’énergie pour rater sa vie ! Cela tient de la folie ou du mysticisme, ou des deux. Par ailleurs, au plan de l’atmosphère, on peut avoir une petite pensée pour Céline dans Mort à crédit et, parfois, pour ces auteurs bouffis de souffrance comme Violette Leduc ou Albertine Sarrazin. L’ouvrage est émouvant, partagé qu’est l’auteur entre le récit d’une enfance où l’on découvre un pays, un village (Marles-les-Mines), une famille, leurs mœurs, et une réflexion permanente quasi philosophique (masochiste et perverse) sur la volonté de n’être point de ce monde-là ou de quelque autre monde, même quand la bonne fortune semble vous tendre la main. Et puis, souvent, jaillissent de très belles pages de littérature : le jeu que la fratrie pratique en proposant aux chats – comme le pompon d’un manège – les oiseaux capturés dans leur sommeil ; la saillie et le poulinage de la jument Marmotte ; les rencontres de Barde avec tous les fous furieux qui passent à portée de voix ; les épisodes de mysticisme qui émaillent sa vie ; le saindoux pourri qu’il donne à son ami, en toute connaissance du danger présenté… Un style d’écrivain, assurément. S’il l’avait voulu ! »
« La soupe à la chaussette », de René Barde, est publié chez L’Arganier ; 378 pages ; 19 euros dans toutes les librairies ; ISBN 978-2-912728-70-8.
Légende : René Barde est mort dans la misère en 1963. Il avait côtoyé le peintre Édouard Pignon lui aussi de Marles-les-Mines.
23:34 Publié dans Des écrivains qui vous bousculent | Lien permanent | Commentaires (0)
Une vie d'artiste
23:29 Publié dans Les copains d'abord | Lien permanent | Commentaires (0)


