31/08/2007
Ciel de lune (extraits)
VIENT DE PARAÎTRE
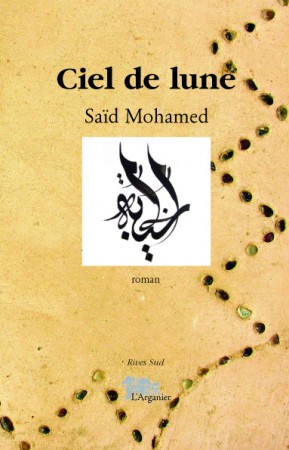
Chapitre 1
Le soleil chauffait à peine et le ciel bleu timidement allumait une tendre lumière rose sur la ville rouge. Sur l’avenue, parmi les nuages de gazole mal raffiné crachés par des véhicules au trois quart épaves, circulaient des calèches tirées par des chevaux qui n’en avaient plus que le nom. Certaines de ces cagnasses asthmatiques portaient des plaies béantes sur le côté, à l’endroit où le charretier aiguillonne la bête. D’énormes mouches féroces se repaissaient de la lymphe qui coulait de cette blessure jamais refermée. Depuis la gare jusqu’à la médina de Marrakech, la route à pied m’a paru longue.
Devant Bab Doukala, des hommes alignés le long du trottoir attendaient qu’un éventuel travail de terrassiers à la journée leur soit proposé. Presque desséchés, ils prenaient la pose sur des carreaux noirs et blancs disposés en damier. La maigreur de ces hommes, leur dos voûté, leur regard perçant, leur façon de tousser m’étaient étrangement familiers. J’ai cru reconnaître, recopiée à des dizaines d’exemplaires, la silhouette du Père. Une inquiétude indéfinie m’a oppressé, et j’ai ressenti une vraie panique. Le renard qui vient semer le doute dans les grandes décisions est toujours impressionnant.
La porte d’entrée de la médina franchie, le réseau des venelles se resserre et devient plus oppressant. Ici, la lumière ne pénètre qu’au zénith trois mois par an. Il faut s’écarter sous le porche d’une maison pour laisser passer le marchand d’ail qui passe avec son âne en criant Touma ! Touma !
La bâtisse, atteinte de gale, était la dernière au fond de l’impasse. Quand j’ai frappé du heurtoir, le bruit a résonné dans le derb paisible. Tout semblait indiquer que la maisonnée dormait encore. J’ignorais ce qui m’attendait chez Dalila. Un monsieur d’allure noble est venu m’ouvrir. Je ne m’attendais pas à être reçu par son père. Après la porte et le long couloir d’entrée, sorte de sas entre la rue et l’intimité familiale, j’ai découvert la maison. Il m’a accompagné au salon, à l’étage. Une tortue, symbole de paix et de bonheur dans une maison digne de ce nom, traînait sa lourde carapace sur le carrelage du patio.
Ces murs de guingois, au crépi peu reluisant, cachaient une vaste demeure séculaire où les volumes, les formes, les couleurs composaient un ensemble harmonieux. Dans le passé, cette maison, un bâtiment de deux étages, n’avait pas été un palais, tout au plus une maison de maître, mais sa taille imposante en faisait une demeure agréable. Les ferronneries des fenêtres, de simples bouts de ferraille tordus et assemblés entre eux, donnaient la seule touche de légèreté.
La construction à l’ancienne avec de hauts plafonds, le matériau employé, du pisé tout de blanc chaulé, maintenait un peu de fraîcheur même par une journée torride. J’aurais bien aimé circuler dans la maison. Ce n’est que lorsque l’intimité de la demeure m’a été acquise que, dans les moindres recoins, j’ai découvert les surprises qui s’y cachaient. Depuis le dernier étage, on pouvait apercevoir au loin l’Atlas et survoler du regard les autres terrasses de la médina.
Tout partait de traviole. Les encadrements des portes étaient distordus, les murs ventrus. Aucune colonne du patio n’avait la même taille, ni la même forme. Le carrelage à angle droit révélait et accentuait le manque de rectitude dans le tracé des murs. Pourtant tout était beau. Loin de l’exactitude. On s’adonnait à la rêverie, on folâtrait en pleine poésie. Le maalem qui s’était penché sur le problème avait trouvé une solution bien originale. Le brave homme avait dû s’aider, pour accomplir sa tâche, de quelques pipes de kif qui lui auront plus permis d’accepter la solution germée dans son cerveau que de résoudre le problème de façon pragmatique.
Restons humbles et acceptons nos faiblesses. Aucune marche n’était de la même hauteur. Certains dessins des carreaux du sol étaient posés à l’envers. Les ferronneries qui entouraient le balcon du patio étaient scellées indépendamment dans un sens ou dans l’autre. La peinture avait coulé, le plâtre débordé. Des tuyaux empruntaient des parcours farfelus. Des fils pendaient. (...)

(...)
Même si je n’avais pas vécu auparavant parmi eux, ils étaient ma famille, je le croyais. Je sentais qu’on s’était perdu de vue quelques jours seulement ou une génération entière, mais comment faire la différence ? Quand on voyage, on sait quand on part. Jamais comment, ni quand, ni si on reviendra un jour. Comme les migrateurs, on passe d’un continent à l’autre, au fil des saisons de la vie, et on revient parfois mourir à la case départ en suivant la trajectoire des saltimbanques comme un trapéziste, un musicien volage, un chemineau tricard, un voleur de poules. En partance pour l’espoir, à fond de cale ou au bord d’un quai, ces clandestins aux dos mouillés du Rio Grande, ces rouliers qui filent en direction de l’ouest, traversent rivières et deltas, marais et montagnes pour découvrir un autre possible. Le nez rivé sur le fil de l’horizon. Dans cette maison, j’avais eu l’impression d’y revenir après un siècle d’errance, pour m’enraciner à nouveau dans ces terres quittées par obligation.
Aux nôtres, ce pays n’a laissé que la peau sur les os et a offert la fuite comme seul salut. Et depuis, avec ceux de ma tribu insoumise à tous les pouvoirs depuis tant de siècles, nous errons. Parce que les nouveaux arrivants nous ont chassés de nos terres. Hommes de terres arides, irriguées par les sources venant des hauteurs enneigées. Il n’y a pas pire climat que sur ces terres-là : sec et venteux, brûlant et froid. Quand la pluie tombe, c’est seulement un peu, parfois. Par endroits émergent des failles vertes, dans le repli des collines, de petites parcelles en espaliers, arrachées et défendues dans ce paysage lunaire, irriguées par un filet d’eau chichement partagé.
L’administration coloniale ne s’est pas sali les mains pour mettre les nôtres au pas. Elle s’est contentée de sous-traiter le travail au pacha de Marrakech, le Glaoui, dont tous vantait l’efficacité de la méthode. Le monde civilisé a fermé les yeux, seul importait le résultat. Il a levé sa harka à Tazert en mille-neuf cent vingt et un et il est monté dans le haut Atlas faire régner l’ordre des temps modernes. Il s’est approprié les terres, a laissé mourir les vieux, envoyé les femmes dans ses bordels, réduit en esclavage les plus jeunes. Les têtes des nôtres ont pourri sur une pique place Jemaa el Fna. La nostalgie est inutile. Elle ne donne rien de bon. De la rancune, sur le temps passé… Un jour, il faudra bien pourtant aller chercher par-là pour comprendre ce qui s’est passé. Ecrire l’histoire des nôtres. Laisser une trace sur le papier et leur redonner la noblesse de la fierté qui leur a été volée. Ecrire, encore écrire, contre le mensonge.
À quoi sert-il d’avoir un passé quand il faut à nouveau partir ? Accepter de n’être qu’un rhizome qui dérive au gré des fleuves et des courants pour prendre racine dans chaque coin de terre, dans chaque espace le permettant. Tel est devenu notre destin. Ici aujourd’hui, demain là-bas. Avancer tant que la vie le permet. Des nuages dans les yeux, des mirages dans le ciel et des miracles à portée de la main.
Devant Bab Doukala, des hommes alignés le long du trottoir attendaient qu’un éventuel travail de terrassiers à la journée leur soit proposé. Presque desséchés, ils prenaient la pose sur des carreaux noirs et blancs disposés en damier. La maigreur de ces hommes, leur dos voûté, leur regard perçant, leur façon de tousser m’étaient étrangement familiers. J’ai cru reconnaître, recopiée à des dizaines d’exemplaires, la silhouette du Père. Une inquiétude indéfinie m’a oppressé, et j’ai ressenti une vraie panique. Le renard qui vient semer le doute dans les grandes décisions est toujours impressionnant.
La porte d’entrée de la médina franchie, le réseau des venelles se resserre et devient plus oppressant. Ici, la lumière ne pénètre qu’au zénith trois mois par an. Il faut s’écarter sous le porche d’une maison pour laisser passer le marchand d’ail qui passe avec son âne en criant Touma ! Touma !
La bâtisse, atteinte de gale, était la dernière au fond de l’impasse. Quand j’ai frappé du heurtoir, le bruit a résonné dans le derb paisible. Tout semblait indiquer que la maisonnée dormait encore. J’ignorais ce qui m’attendait chez Dalila. Un monsieur d’allure noble est venu m’ouvrir. Je ne m’attendais pas à être reçu par son père. Après la porte et le long couloir d’entrée, sorte de sas entre la rue et l’intimité familiale, j’ai découvert la maison. Il m’a accompagné au salon, à l’étage. Une tortue, symbole de paix et de bonheur dans une maison digne de ce nom, traînait sa lourde carapace sur le carrelage du patio.
Ces murs de guingois, au crépi peu reluisant, cachaient une vaste demeure séculaire où les volumes, les formes, les couleurs composaient un ensemble harmonieux. Dans le passé, cette maison, un bâtiment de deux étages, n’avait pas été un palais, tout au plus une maison de maître, mais sa taille imposante en faisait une demeure agréable. Les ferronneries des fenêtres, de simples bouts de ferraille tordus et assemblés entre eux, donnaient la seule touche de légèreté.
La construction à l’ancienne avec de hauts plafonds, le matériau employé, du pisé tout de blanc chaulé, maintenait un peu de fraîcheur même par une journée torride. J’aurais bien aimé circuler dans la maison. Ce n’est que lorsque l’intimité de la demeure m’a été acquise que, dans les moindres recoins, j’ai découvert les surprises qui s’y cachaient. Depuis le dernier étage, on pouvait apercevoir au loin l’Atlas et survoler du regard les autres terrasses de la médina.
Tout partait de traviole. Les encadrements des portes étaient distordus, les murs ventrus. Aucune colonne du patio n’avait la même taille, ni la même forme. Le carrelage à angle droit révélait et accentuait le manque de rectitude dans le tracé des murs. Pourtant tout était beau. Loin de l’exactitude. On s’adonnait à la rêverie, on folâtrait en pleine poésie. Le maalem qui s’était penché sur le problème avait trouvé une solution bien originale. Le brave homme avait dû s’aider, pour accomplir sa tâche, de quelques pipes de kif qui lui auront plus permis d’accepter la solution germée dans son cerveau que de résoudre le problème de façon pragmatique.
Restons humbles et acceptons nos faiblesses. Aucune marche n’était de la même hauteur. Certains dessins des carreaux du sol étaient posés à l’envers. Les ferronneries qui entouraient le balcon du patio étaient scellées indépendamment dans un sens ou dans l’autre. La peinture avait coulé, le plâtre débordé. Des tuyaux empruntaient des parcours farfelus. Des fils pendaient. (...)

(...)
Même si je n’avais pas vécu auparavant parmi eux, ils étaient ma famille, je le croyais. Je sentais qu’on s’était perdu de vue quelques jours seulement ou une génération entière, mais comment faire la différence ? Quand on voyage, on sait quand on part. Jamais comment, ni quand, ni si on reviendra un jour. Comme les migrateurs, on passe d’un continent à l’autre, au fil des saisons de la vie, et on revient parfois mourir à la case départ en suivant la trajectoire des saltimbanques comme un trapéziste, un musicien volage, un chemineau tricard, un voleur de poules. En partance pour l’espoir, à fond de cale ou au bord d’un quai, ces clandestins aux dos mouillés du Rio Grande, ces rouliers qui filent en direction de l’ouest, traversent rivières et deltas, marais et montagnes pour découvrir un autre possible. Le nez rivé sur le fil de l’horizon. Dans cette maison, j’avais eu l’impression d’y revenir après un siècle d’errance, pour m’enraciner à nouveau dans ces terres quittées par obligation.
Aux nôtres, ce pays n’a laissé que la peau sur les os et a offert la fuite comme seul salut. Et depuis, avec ceux de ma tribu insoumise à tous les pouvoirs depuis tant de siècles, nous errons. Parce que les nouveaux arrivants nous ont chassés de nos terres. Hommes de terres arides, irriguées par les sources venant des hauteurs enneigées. Il n’y a pas pire climat que sur ces terres-là : sec et venteux, brûlant et froid. Quand la pluie tombe, c’est seulement un peu, parfois. Par endroits émergent des failles vertes, dans le repli des collines, de petites parcelles en espaliers, arrachées et défendues dans ce paysage lunaire, irriguées par un filet d’eau chichement partagé.
L’administration coloniale ne s’est pas sali les mains pour mettre les nôtres au pas. Elle s’est contentée de sous-traiter le travail au pacha de Marrakech, le Glaoui, dont tous vantait l’efficacité de la méthode. Le monde civilisé a fermé les yeux, seul importait le résultat. Il a levé sa harka à Tazert en mille-neuf cent vingt et un et il est monté dans le haut Atlas faire régner l’ordre des temps modernes. Il s’est approprié les terres, a laissé mourir les vieux, envoyé les femmes dans ses bordels, réduit en esclavage les plus jeunes. Les têtes des nôtres ont pourri sur une pique place Jemaa el Fna. La nostalgie est inutile. Elle ne donne rien de bon. De la rancune, sur le temps passé… Un jour, il faudra bien pourtant aller chercher par-là pour comprendre ce qui s’est passé. Ecrire l’histoire des nôtres. Laisser une trace sur le papier et leur redonner la noblesse de la fierté qui leur a été volée. Ecrire, encore écrire, contre le mensonge.
À quoi sert-il d’avoir un passé quand il faut à nouveau partir ? Accepter de n’être qu’un rhizome qui dérive au gré des fleuves et des courants pour prendre racine dans chaque coin de terre, dans chaque espace le permettant. Tel est devenu notre destin. Ici aujourd’hui, demain là-bas. Avancer tant que la vie le permet. Des nuages dans les yeux, des mirages dans le ciel et des miracles à portée de la main.
20:50 | Lien permanent | Commentaires (0)



Les commentaires sont fermés.