06/06/2007
Un Enfant de Coeur
VIENT DE PARAITRE
Un Enfant de coeur
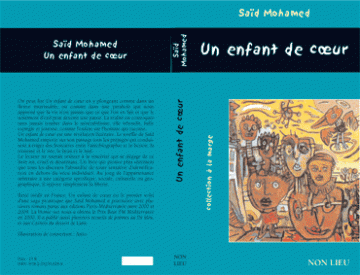
en librairie mi juin...
Avec une Illustration de couverture de ANTO
ISBN 978-2-35270-028-9
Quatrième de couverture.
On peut lire ce premier tome d'une saga en y plongeant comme dans un fleuve intarissable, ou comme dans une parabole. Elle nous apprend que la vie n'est jamais que ce que l'on en fait et que le sentiment d'exil peut devenir une patrie. Car si la réalité est convoquée elle ne tombe jamais dans le misérabilisme. Elle rebondit balle espiègle et joueuse comme l'enfant en l'homme qui raconte.
Le lecteur ne saurait résister à la sincérité qui se dégage de ce livre nu cruel et désarmant. Ce livre prouve plus sûrement que tous les discours l'absurdité à laquelle aboutit toute tentative d'identification en dehors du vécu individuel.
Un enfant de coeur est une révélation littéraire. Le souffle de Saïd Mohamed emporte sur son passage tous les préjugés qui consistent à ériger des frontières entre l'autobiographie et la fiction la tristesse et le rire, le beau le laid. Comme un certain nombre de ses homologues, il oppose la liberté au joug d'une appartenance arbitraire à une catégorie spécifique, sociale culturelle ou géographique.
Kristina Briaudeau
Resté inédit en France, Un enfant de cœur est le premier volet d'une saga picaresque. Saïd Mohamed est l’auteur de plusieurs romans parus aux Éditions Paris-Méditerrané entre 2000 et 2004. Son premier titre La Honte sur nous a obtenu le Prix Beur FM Méditerranée en 2000. Il a publié aussi plusieurs recueils de poèmes au Dé bleu, et aux carnets du dessert de Lune.
Dur et nu mais non dénué de poésie, ce roman nous lègue une belle leçon de vie.
"Femmes du Maroc".
Ce récit est à la fois d'une sobriété et d'un éclat tout particulier. Car tout dans ce livre est simplement transcrit avec dignité, humour et coeur.
Jean Michel Bongiraud

Chapitre un
Très tôt j’ai su que les parents allaient me poser problème. Si je ne comprenais pas tout, je voyais bien que chez les autres ça ne se passait pas comme chez nous. La Mère ; elle ne rentrait à la maison qu’après le départ au travail du Père et le soir elle se réfugiait chez des voisins. Heureusement, qu’il a toujours ignoré où elle se cachait. S’il l'avait attrapée, il lui aurait cassé les pattes, pour ne plus qu'elle traîne.
Une voiture s'est arrêtée à notre niveau, alors qu’on revenait d’une balade dans les champs. La Mère en est descendue, précédée d'un type du coin que j'avais déjà vu venir minauder autour de la frangine. En voyant leurs têtes, j'ai su qu’ils n’allaient pas à la noce. Ces derniers jours avaient tellement tourné au vinaigre que le pire était à prévoir. Trouver la Mère sur la route, en train de plier bagage, embarquant ce qu'elle pouvait n'avait rien d'extraordinaire.
Avec la Mère, on ne s'est pas causé. On n’avait pas non plus matière à se raconter un roman.
Elle a dit simplement :
" Bon, les gars, je m'en vais !..."
On ignorait où elle allait, et avec qui, mais elle s’en allait. Depuis un bout qu'elle en parlait de partir. On ne peut pas tout le temps voir la fumée et pas le feu.
La voiture touchait presque le sol tellement elle était chargée. On s'est mis à courir derrière. J'ai eu l’impression que pour nous ça tournait vraiment mal. Rien n'est venu contredire ça. Même le Petit qui était trop petit pour comprendre ce qui se passait n’a pas pleuré.
—Tu lui presses sur le nez, il en sort encore des limaces, avait l’habitude de dire de lui le Grand.
On a attendu que le Père rentre du travail. Le Grand s'est chargé de lui raconter les événements de la journée. Le Père assommé par sa ration quotidienne de vin ne s'était pas encore rendu compte qu'il manquait quelqu'un. Il n'a pas réagi. Se bouchant une narine, il s'est mouché en soufflant dans ses doigts. Il a gardé le silence et il a achevé la deuxième bouteille de la soirée. Des mouches se poursuivaient autour de l'ampoule de la cuisine. Des gouttes s'écrasaient dans la vaisselle sale. Le père s'est levé pour aller chercher dans le clapier, au fond du jardin, un lapin qu'il a tué, et il l’a préparé comme il a pu.
Il me suffisait de regarder le Grand pour savoir s'il fallait être prêt à tout. N'importe quel objet, entre nos mains, pouvait devenir un moyen de défense. Le Grand était sur ses gardes, quand il l'a vu prendre le couteau.
On venait d'achever le plat mal cuisiné, quand le Grand m'a fait un signe de la tête en m'indiquant la direction de la chambre. Je devais le suivre. La soirée était trop calme. On aurait préféré entendre crier. Au moins, là on savait où on en était. On redoutait le silence parce qu’en général il présage le pire. Le lendemain matin, le Père est reparti au travail, comme à l'accoutumée, en vélo. Il nous a laissé de l'argent pour acheter du pain et une tablette de chocolat noir à croquer pour le goûter. Le midi, on a mangé les restes du lapin.
Chaque jour, le Père partait le matin de bonne heure, et il rentrait le soir vers sept heures. Il avait trouvé son vieux vélo dans une vente. Des enchères, il ramenait n'importe quoi. Sa bicyclette était surmontée d'un énorme phare. Sur la roue à l’avant, une dynamo qui le ralentissait plus qu'elle n'éclairait, ronronnait. Mais il connaissait bien le chemin. Le freinage se faisait en inversant le pédalage. La roue arrière se bloquait même quand il pleuvait. Dans la région, il valait mieux avoir ça. Il flottait tout le temps, une sorte de bruine qui dégoulinait lentement. Une lavasse, qui vous abonnait le ciel à l'hiver pour l'éternité. Dans ce pays, tout le monde avait des rhumatismes et toussait à cause du froid et de l’humidité. La terre à chaque pas s'enfonçait d'un centimètre et lâchait des bulles d'air. Même l'été, tout restait vert, comme conservé dans du formol. Le vélo était notre seul moyen de transport. Le matin, deux cars passaient, l'un ramassait les ouvriers de l'usine de caoutchouc, l'autre les élèves du lycée.
On approchait de l'automne, et déjà les hirondelles se rassemblaient sur les fils. Quelques mois auparavant, j'avais soufflé mes neuf bougies. Façon de parler. Chez nous, les fêtes et les anniversaires, on ne les fêtait pas. Il restait deux semaines avant la rentrée scolaire, le Petit et moi, pour ne pas traîner à la rue, on a partagé un peu le bac à sable avec les gosses du facteur.
Le Grand s'est bagarré avec un de ses gamins. Lorsque le facteur est venu en personne lui demander des explications, à l’heure du dîner, la situation sur le terrain a tourné au désavantage du Grand. La claque que le Père a mise au Grand aurait pu assommer un cheval. Même lorsque les autres nous cherchaient, on ne devait jamais répondre.
J'avais peur du facteur parce qu’il ressemblait au Fantôme noir du Journal de Mickey. Vêtu d'une grande veste noire en cuir, coiffé d'un casque avec des grosses lunettes, il parcourait toute la région en moto. Je l'évitais aussi parce que je lui avais flingué un carreau en voulant tirer une bouteille posée sur le rebord de la fenêtre. La pierre avait fait un trou rond et bien net, sans que le verre ne vole en éclats. Il savait que c'était moi, mais il n'avait rien dit. Il me laissait jouer chez lui, avec ses gosses.
Les hirondelles s'impatientaient sur les fils et on traînait par le village, livrés à nous-même. Pour une fois, on s'est retrouvé avec les autres gamins, dans leurs jeux. Une baraque abandonnée à la toiture inexistante nous servait de château fort. Le village était séparé en deux: nous d'un côté et, de l'autre, ceux du bourg qui craignaient le Grand. Ce qui restait de la baraque n'a pas tenu longtemps à ce régime. En trois jours, il ne restait plus qu'une partie des murs. Il manquait la fumée pour parfaire le décor d'un western après l'assaut des Indiens. Les attaques se succédaient, et on les repoussait à coups de bâtons, de flèches, de javelots. Un front bleui, une oreille décollée, c'était le bilan du premier jour du combat. On en a profité, au passage, pour régler nos comptes...
Au bruit mat, comme un paquet de chiffes molles qui s'écrase, suivi d'un cri hoquetant, le Grand a compris qu'on venait de dépasser le simple accrochage. Le Petit avait chuté du mur. Il avait la bouche ouverte, sa langue pendait, et il crachait beaucoup de sang. Les autres ont pris peur et se sont enfuis.
— Bande de salauds! On est dans la merde! Le vieux va gueuler! a râlé le Grand.
— Ça devait arriver!
Le père n'a rien dit de plus. Il en avait déjà tellement vu, que ça en plus ou en moins, ça ne changeait pas grand-chose. Il voulait avoir la paix en rentrant du travail, pour réfléchir à l'avenir, mais il en devenait de moins en moins capable, à mesure qu’il vidait ses bouteilles. Il a marmonné:
— Quelle honte!
Et, comme le Petit pleurait, il lui a dit :
— Viens là, que je t'achève!
Ce qui lui a enlevé toute envie d'en rajouter. Cette expression avait les faveurs du Père. Un fils d'homme ne pleure pas. Il suffit de se mettre ça dans le crâne et ça va déjà mieux. La vie a recours à des certitudes auxquelles il faut se soumettre, ou crever. Pleurer n'a jamais été une preuve de force. Alors, plutôt que d'encourir la colère paternelle, il valait mieux avaler sa salive. Depuis, à cause de sa langue à moitié coupé, le Petit zozotte en parlant. Il ne veut pas qu'on le fasse "sier avec les sossettes de larsi dussesse qui sont pas sésses".
Une voiture s'est arrêtée à notre niveau, alors qu’on revenait d’une balade dans les champs. La Mère en est descendue, précédée d'un type du coin que j'avais déjà vu venir minauder autour de la frangine. En voyant leurs têtes, j'ai su qu’ils n’allaient pas à la noce. Ces derniers jours avaient tellement tourné au vinaigre que le pire était à prévoir. Trouver la Mère sur la route, en train de plier bagage, embarquant ce qu'elle pouvait n'avait rien d'extraordinaire.
Avec la Mère, on ne s'est pas causé. On n’avait pas non plus matière à se raconter un roman.
Elle a dit simplement :
" Bon, les gars, je m'en vais !..."
On ignorait où elle allait, et avec qui, mais elle s’en allait. Depuis un bout qu'elle en parlait de partir. On ne peut pas tout le temps voir la fumée et pas le feu.
La voiture touchait presque le sol tellement elle était chargée. On s'est mis à courir derrière. J'ai eu l’impression que pour nous ça tournait vraiment mal. Rien n'est venu contredire ça. Même le Petit qui était trop petit pour comprendre ce qui se passait n’a pas pleuré.
—Tu lui presses sur le nez, il en sort encore des limaces, avait l’habitude de dire de lui le Grand.
On a attendu que le Père rentre du travail. Le Grand s'est chargé de lui raconter les événements de la journée. Le Père assommé par sa ration quotidienne de vin ne s'était pas encore rendu compte qu'il manquait quelqu'un. Il n'a pas réagi. Se bouchant une narine, il s'est mouché en soufflant dans ses doigts. Il a gardé le silence et il a achevé la deuxième bouteille de la soirée. Des mouches se poursuivaient autour de l'ampoule de la cuisine. Des gouttes s'écrasaient dans la vaisselle sale. Le père s'est levé pour aller chercher dans le clapier, au fond du jardin, un lapin qu'il a tué, et il l’a préparé comme il a pu.
Il me suffisait de regarder le Grand pour savoir s'il fallait être prêt à tout. N'importe quel objet, entre nos mains, pouvait devenir un moyen de défense. Le Grand était sur ses gardes, quand il l'a vu prendre le couteau.
On venait d'achever le plat mal cuisiné, quand le Grand m'a fait un signe de la tête en m'indiquant la direction de la chambre. Je devais le suivre. La soirée était trop calme. On aurait préféré entendre crier. Au moins, là on savait où on en était. On redoutait le silence parce qu’en général il présage le pire. Le lendemain matin, le Père est reparti au travail, comme à l'accoutumée, en vélo. Il nous a laissé de l'argent pour acheter du pain et une tablette de chocolat noir à croquer pour le goûter. Le midi, on a mangé les restes du lapin.
Chaque jour, le Père partait le matin de bonne heure, et il rentrait le soir vers sept heures. Il avait trouvé son vieux vélo dans une vente. Des enchères, il ramenait n'importe quoi. Sa bicyclette était surmontée d'un énorme phare. Sur la roue à l’avant, une dynamo qui le ralentissait plus qu'elle n'éclairait, ronronnait. Mais il connaissait bien le chemin. Le freinage se faisait en inversant le pédalage. La roue arrière se bloquait même quand il pleuvait. Dans la région, il valait mieux avoir ça. Il flottait tout le temps, une sorte de bruine qui dégoulinait lentement. Une lavasse, qui vous abonnait le ciel à l'hiver pour l'éternité. Dans ce pays, tout le monde avait des rhumatismes et toussait à cause du froid et de l’humidité. La terre à chaque pas s'enfonçait d'un centimètre et lâchait des bulles d'air. Même l'été, tout restait vert, comme conservé dans du formol. Le vélo était notre seul moyen de transport. Le matin, deux cars passaient, l'un ramassait les ouvriers de l'usine de caoutchouc, l'autre les élèves du lycée.
On approchait de l'automne, et déjà les hirondelles se rassemblaient sur les fils. Quelques mois auparavant, j'avais soufflé mes neuf bougies. Façon de parler. Chez nous, les fêtes et les anniversaires, on ne les fêtait pas. Il restait deux semaines avant la rentrée scolaire, le Petit et moi, pour ne pas traîner à la rue, on a partagé un peu le bac à sable avec les gosses du facteur.
Le Grand s'est bagarré avec un de ses gamins. Lorsque le facteur est venu en personne lui demander des explications, à l’heure du dîner, la situation sur le terrain a tourné au désavantage du Grand. La claque que le Père a mise au Grand aurait pu assommer un cheval. Même lorsque les autres nous cherchaient, on ne devait jamais répondre.
J'avais peur du facteur parce qu’il ressemblait au Fantôme noir du Journal de Mickey. Vêtu d'une grande veste noire en cuir, coiffé d'un casque avec des grosses lunettes, il parcourait toute la région en moto. Je l'évitais aussi parce que je lui avais flingué un carreau en voulant tirer une bouteille posée sur le rebord de la fenêtre. La pierre avait fait un trou rond et bien net, sans que le verre ne vole en éclats. Il savait que c'était moi, mais il n'avait rien dit. Il me laissait jouer chez lui, avec ses gosses.
Les hirondelles s'impatientaient sur les fils et on traînait par le village, livrés à nous-même. Pour une fois, on s'est retrouvé avec les autres gamins, dans leurs jeux. Une baraque abandonnée à la toiture inexistante nous servait de château fort. Le village était séparé en deux: nous d'un côté et, de l'autre, ceux du bourg qui craignaient le Grand. Ce qui restait de la baraque n'a pas tenu longtemps à ce régime. En trois jours, il ne restait plus qu'une partie des murs. Il manquait la fumée pour parfaire le décor d'un western après l'assaut des Indiens. Les attaques se succédaient, et on les repoussait à coups de bâtons, de flèches, de javelots. Un front bleui, une oreille décollée, c'était le bilan du premier jour du combat. On en a profité, au passage, pour régler nos comptes...
Au bruit mat, comme un paquet de chiffes molles qui s'écrase, suivi d'un cri hoquetant, le Grand a compris qu'on venait de dépasser le simple accrochage. Le Petit avait chuté du mur. Il avait la bouche ouverte, sa langue pendait, et il crachait beaucoup de sang. Les autres ont pris peur et se sont enfuis.
— Bande de salauds! On est dans la merde! Le vieux va gueuler! a râlé le Grand.
— Ça devait arriver!
Le père n'a rien dit de plus. Il en avait déjà tellement vu, que ça en plus ou en moins, ça ne changeait pas grand-chose. Il voulait avoir la paix en rentrant du travail, pour réfléchir à l'avenir, mais il en devenait de moins en moins capable, à mesure qu’il vidait ses bouteilles. Il a marmonné:
— Quelle honte!
Et, comme le Petit pleurait, il lui a dit :
— Viens là, que je t'achève!
Ce qui lui a enlevé toute envie d'en rajouter. Cette expression avait les faveurs du Père. Un fils d'homme ne pleure pas. Il suffit de se mettre ça dans le crâne et ça va déjà mieux. La vie a recours à des certitudes auxquelles il faut se soumettre, ou crever. Pleurer n'a jamais été une preuve de force. Alors, plutôt que d'encourir la colère paternelle, il valait mieux avaler sa salive. Depuis, à cause de sa langue à moitié coupé, le Petit zozotte en parlant. Il ne veut pas qu'on le fasse "sier avec les sossettes de larsi dussesse qui sont pas sésses".
07:25 Publié dans De la prétention littéraire | Lien permanent | Commentaires (0)



Les commentaires sont fermés.