21/10/2008
Bernard Hugues (Le Refus)

Le Refus
Ce texte devenu introuvable; il doit rester un ou deux exemplaires chez des libraires de livres anciens, publié par mes soins en 1983, va être republié dans son intégralité pour la rétrospective de l'oeuvre peinte de Bernard Hugues qui aura lieu en mai 2009 dans les Cévennes...
Les toiles et dessins qui illustrent sont de Bernard Hugues
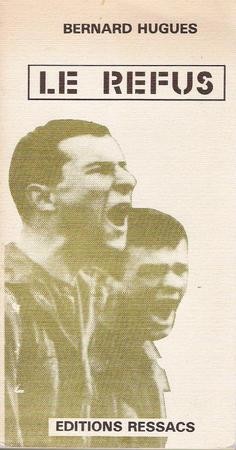
Je ne parlais pas, je ne disais rien. Lui me racontait que c’était agréable. Que c’était très bien. Que je serais content. Que j’étais bien tombé.
Moi je le regardais quelquefois comme ça, vaguement, sans trop lui répondre. J’étais dans la voiture et j’attendais. Je savais qu’il fallait y aller mais je n’imaginais pas plus.
On a suivi une route qui m’a semblé pareille à toutes les routes de plaine, avec ses platanes, ses grandes lignes droites et ses champs ; mais je ne faisais pas vraiment attention au paysage, je ne pensais pas que c’était la première fois que je voyais la Crau, ni même que cette plaine sous le vent, en début d’hiver, était assez triste.
Je me souviens d’un tronçon de route plate et parfaitement rectiligne sur plus d’un kilomètre avec trois dos d’âne successifs qui semblaient être là sans raison, comme si ceux qui avaient construit la route avaient voulu en rompre la monotonie.
On a croisé quelques militaires avec des sacs et de grands manteaux bleus, puis on est arrivé.
Je m’étais déjà fait une idée de ce que ce serait, je crois que je ne m’étais pas tellement trompé. C’était comme ça. Je suis sorti de la voiture, j’ai payé le chauffeur qui m’a dit : « A bientôt », il a ajouté : « Vous aurez l’occasion de la revoir, cette route. » Je lui ai simplement répondu d’un signe de tête, j’ai fermé la portière et j’ai regardé.
Devant moi il y avait deux grands bâtiments jaunes. Sur la droite et sur la gauche, de hauts murs qui s’en allaient assez loin, surmontés de barbelés, et dont la crête était ornée de débris de verre pris dans le ciment. Je me souviens que le soleil levant jouait avec. Entre les deux bâtiments, l’entrée. Un grand portail ouvert mais de suite après barré par une barrière qu’un militaire en faction montait et abaissait chaque fois qu’un véhicule se présentait. De part et d’autre du portail, deux grandes portes ouvertes et que rien n’obstruait.
Un drapeau claquait sec sous le mistral. Je n’ai pas attendu plus longtemps, j’y suis allé carrément.
Je suis passé à côté du grand bâton rouge et blanc et je me suis assis à l’intérieur de la caserne, sous un porche, à côté d’une porte.

Il y avait du vent. J’étais entré avec mes papiers à la main ; dès que je me suis assis sur le sol, je les ai posés à côté de moi, j’ai mis un doigt dessus pour que le vent ne les emporte pas, et j’ai commencé à attendre.
Les voitures passaient devant moi, des voitures de militaires, des voitures de gradés, des camions. Le militaire au grand bâton rouge et blanc m’a regardé, étonné, je le comprends. IL était étonné – moi aussi – pourtant pas tout à fait, j’étais là assis par terre à l’entrée de la caserne, c’était normal pour moi et surtout c’était simple. C’est simple de s’asseoir et de ne rien dire.
J’ai attendu quelques minutes. Toujours le militaire devant, intrigué. Ceux qui passaient ne me regardaient pas. Deux militaires avec de grands sacs, qui partaient en permission peut-être, sont passés tout près de moi. Ils ne m’ont pas vu.
J’avais toujours le doigt sur les papiers, j’attendais toujours, et le vent soufflait toujours. Mes cheveux voltigeaient dans tous les sens, je n’avais que ma main à soulever pour les mettre en place. Le soleil passa l’angle du bâtiment et vint sur moi. J’avais un peu envie de rire mais pas trop. Ça allait. J’étais décontracté, j’étais là, tout seul, je savais qu’on allait arriver, j’attendais.
Un militaire est sorti de la porte près de laquelle j’étais assis. J’ai vu ses pieds qui s’approchaient de moi. « Qu’est-ce que tu as ? » Je n’ai rien dis. Je suis resté là, toujours assis, je l’ai regardé une fois puis je n’ai plus fait attention à lui. Il n’a pas compris, pas du tout compris. Il est rentré et d’est là que tout a commencé.
J’ai entendu des bruits de téléphone, des gens qui parlaient. J’ai vu le militaire qui faisait bouger son bâton rouge et blanc aller dans sa petite guérite et prendre le téléphone. Il parlait derrière ses vitres et en même temps il me regardait. Il semblait assez perplexe, ou embarrassé peut-être, comme si aux questions qu’on lui posait il ne pouvait pas trouver de réponse satisfaisante ou raisonnable. J’avais envie de lui sourire, de lui faire un petit signe… mais non, il était là, j’étais de l’autre côté.
Et toujours les voitures passaient, les voitures de civils, les voitures de militaires. Je m’étais aperçu, depuis un moment, que les gros bruits qui venaient des bâtiments en face étaient ceux de moteurs d’avions. Des bruits monstrueux qui, avec le vent, vous donnaient l’impression d’être près de quelque chose d’extraordinaire, quelque chose qui faisait tout vibrer et qui en même temps aurait produit ce grand vent. Ça ne me dérangeait pas outre mesure.
Quelques minutes s’écoulèrent encore – elles me paraissaient longues parce que je m’attendais à ce que tout de suite on me prenne et m’emmène – avant qu’un autre militaire ne sorte et ne me dise : « Qu’est-ce que tu as ? qu’est-ce que tu as ? » Je ne lui répondis pas, je ne le regardai lui aussi qu’une fois, sans avoir même la peine de lever la tête car il s’était accroupi près de moi et me dévisageait. Il me mit la main sur l’épaule : « Qu’est que tu as ? qu’est-ce que tu veux ? » il vit mes papiers, il les prit, les feuilleta. Pendant ce temps deux autres militaires étaient sortis par la même porte et étaient venus le rejoindre. Ils s’étaient mis entre le soleil et moi. Je ne voyais que leurs pieds. Ils sont rentrés tous les trois avec les papiers et j’ai attendu encore.
Mais cette fois-ci ils sont revenus plus rapidement. Le même militaire m’a dit : « Il faut rentrer, il ne faut pas rester là. Tu t’appelles Guesnard ? » Je n’ai rien dit, je n’ai pas bougé. Je savais qu’ils se regardaient. Ils m’ont dit : « Il faut rentrer. » Aucune réaction. Il y en a alors un qui m’a pris par le coude et fait comme pour m’aider à me mettre debout. Je me suis relevé. Il m’a guidé, je me suis laissé guider. Il a ouvert la porte, celle d’où ils étaient sortis, et m’a fait entrer.

C’était une pièce petite et sale. Un bureau, deux tables, un téléphone, des papiers, trois ou quatre chaises, un poêle. Et des militaires, bien sûr. Au mur, dans un râtelier, enchaînées, des armes.
Il m’a guidé jusqu’à une chaise près du poêle et m’a fait asseoir. Mais la chaise n’était pas pour moi, j’étais mieux par terre et je m’y suis remis.
Je voyais des chaussures de militaires, de gros souliers qui montaient jusqu’au-dessus des mollets, étroitement lacés de bas en haut cirés impeccable. Personne ne parlait, du moins à haute voix. Ils s’étaient tous regroupés dans le coin opposé de la pièce et je les entendais chuchoter sans comprendre ce qu’ils disaient – mais de quoi pouvaient-ils parler sinon… Un noir se tenait à l’écart. Assis sur une table, il balançait ses pieds croisés. Il ne parlait pas avec les autres, il me regardait et je crois même qu’il m’a souri.
Des militaires et des civils entraient et sortaient. Tous semblaient un peu gênés par ma présence. Il y avait d’imperceptibles temps morts, des regards interrogateurs et, en réponse, de curieuses mimiques esquissées mais vite défaites. C’est que ce n’est pas tous les jours que dans la salle de garde, à l’entrée de la caserne, on se trouve en compagnie d’un mec barbu, chevelu, assis par terre les jambes croisées, et qui ne dit pas un mot.
A un moment, je me souviens, deux femmes sont entrées. L’une, en robe assez courte, avait de belles jambes. Elle s’est assise sur la chaise près de moi, elle ne semblait pas étonnée – moi j’étais un peu gêné maintenant. L’autre portait des pantalons. Elles parlaient de voitures. Ce devait être des femmes de militaires, de gradés même – pas à cause de leur sujet de conversation mais parce qu’elles semblaient à l’aise dans cette salle et en même temps assez hautaines envers tous les militaires qui se trouvaient dans la pièce et qui étaient certainement pour la plupart des appelés. Quelqu’un leur offrit des cigarettes ; je vis qu’il allait m’en offrit une aussi, je sortis mon tabac pour le lui montrer et le rentrai aussitôt. Je n’avais pas envie de fumer.
On téléphonait sans arrêt à l’adjudant de service, qui restait introuvable. On avait envoyé plusieurs fois des militaires dans tous les coins de la caserne, en vain. Enfin, on réussit à le joindre au téléphone et je compris qu’il n’allait pas tarder à arriver. Le poêle ronflait et refoulait de temps en temps, lâchant de gros pets de fumée qui firent tousser deux ou trois fois la femme en pantalon. C’était un poêle à charbon, la fumée était rousse et âcre.
Quand j’ai vu que les pieds s’arrêtaient de bouger, que toute conversation cessait, que même la femme assise se levait et que l’autre venait près d’elle, j’ai compris que l’adjudant arrivait. Il n’y avait que moi qui était resté assis, qui n’avait pas bougé de place, changé d’attitude. Il est entré, il avait des chaussures bien cirées. Je ne l’ai pas regardé parce que je n’avais pas envie de le voir, parce que je le connaissais déjà, parce qu’on les connaît tous, à quelque chose près. J’ai entendu :
- Ah, je vois ce que c’est ! un non-violent ! Il faut évacuer la pièce. Allons sortez. Il a ajouté gentiment – à l’intention des dames sans doute – excusez, je vous prie.
Tous sont sortis, l’adjudant compris. J’ai entendu quelqu’un dehors qui disait : « Il ne faut pas le laisser là… on ne peut pas le questionner ici. » La porte s’est refermée. Par la fenêtre, j’ai vu l’adjudant pénétrer dans le bâtiment en face, et, à nouveau, j’ai attendu.
Les bruits d’avion se sont us d’un coup. Le silence soudain a envahi la pièce. Le ronflement du poêle a redoublé d’intensité. Mes oreilles bourdonnaient. Dans la pièce à côté j’entendis grincer des lits, le silence subit dérangeait les dormeurs. J’ai d’abord été étonné que des militaires puissent dormir à côté, à neuf heures du matin… faire la grasse matinée ! puis j’ai pensé que ce devait être ceux qui avaient monté la garde pendant la nuit. Déjà les bruits d’avion reprenaient, encore plus agressifs semblait-il. Et, au même instant, comme si on avait attendu volontairement que les moteurs se remettent en marche, la porte s’est ouverte violemment, la poignée est allée buter contre le mur et le battant est revenu sur l’adjudant, qui l’a repoussé d’un coup de coude. Il s’est approché de moi, m’a pris le bras et m’a soulevé à moitié en disant : « Allez viens, sous-moi. » Sa voix n’était guère engageante.
Il m’a fait passer la porte et m’a mené vers le bâtiment en face de celui-ci, de l’autre côté de l’entrée de la caserne et dans lequel je l’avais vu pénétrer quelques instants plus tôt. Il y avait toujours du vent, toujours le militaire qui soulevait et abaissait son bâton rouge et blanc, et toujours ces bruits de moteur qui ne semblaient gêner personne.
L’adjudant m’a dit : « Je temmène à la police, à la gendarmerie. » il me disait cela avec l’intention manifeste de me faire peur, mais c’était raté. Je l’ai suivi dans les escaliers, il n’a pas eu à me prendre par le bras mais je marchais à mon pas, sans me presser, et lui devait m’attendre. Il montait quelques marches puis s’arrêtait, le temps que je le rejoigne – mais nous n’allions qu’au premier étage.
Dans les escaliers on voyait une raie de crasse contre le mur, à hauteur du coude, et de la crasse aussi dans les angles de chaque marche. Visiblement la serpillière n’allait pas dans les coins, elle devait au contraire y repousser la saleté. De la crasse de plusieurs années. Les murs étaient nus et d’un jaune pisseux.
Une fois au premier étage il m’a mené devant la porte et m’a dit : « Tu vois. » il y avait écrit : gendarmerie. Je ne disais rien, lui devait penser : on va mettre le paquet, on va l’impressionner avec ça, gendarmerie ça devrait lui foutre les jetons, lui rappeler la prison… Il me mena devant une seconde porte : bureau du capitaine de gendarmerie, avec le nom en dessous, un nom corse je crois, avec plein de i. Il m’a fait entrer ; visiblement j’étais attendu. (à suivre....)

Ce texte devenu introuvable; il doit rester un ou deux exemplaires chez des libraires de livres anciens, publié par mes soins en 1983, va être republié dans son intégralité pour la rétrospective de l'oeuvre peinte de Bernard Hugues qui aura lieu en mai 2009 dans les Cévennes...
Les toiles et dessins qui illustrent sont de Bernard Hugues
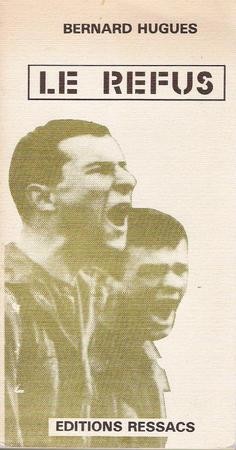
Je ne parlais pas, je ne disais rien. Lui me racontait que c’était agréable. Que c’était très bien. Que je serais content. Que j’étais bien tombé.
Moi je le regardais quelquefois comme ça, vaguement, sans trop lui répondre. J’étais dans la voiture et j’attendais. Je savais qu’il fallait y aller mais je n’imaginais pas plus.
On a suivi une route qui m’a semblé pareille à toutes les routes de plaine, avec ses platanes, ses grandes lignes droites et ses champs ; mais je ne faisais pas vraiment attention au paysage, je ne pensais pas que c’était la première fois que je voyais la Crau, ni même que cette plaine sous le vent, en début d’hiver, était assez triste.
Je me souviens d’un tronçon de route plate et parfaitement rectiligne sur plus d’un kilomètre avec trois dos d’âne successifs qui semblaient être là sans raison, comme si ceux qui avaient construit la route avaient voulu en rompre la monotonie.
On a croisé quelques militaires avec des sacs et de grands manteaux bleus, puis on est arrivé.
Je m’étais déjà fait une idée de ce que ce serait, je crois que je ne m’étais pas tellement trompé. C’était comme ça. Je suis sorti de la voiture, j’ai payé le chauffeur qui m’a dit : « A bientôt », il a ajouté : « Vous aurez l’occasion de la revoir, cette route. » Je lui ai simplement répondu d’un signe de tête, j’ai fermé la portière et j’ai regardé.
Devant moi il y avait deux grands bâtiments jaunes. Sur la droite et sur la gauche, de hauts murs qui s’en allaient assez loin, surmontés de barbelés, et dont la crête était ornée de débris de verre pris dans le ciment. Je me souviens que le soleil levant jouait avec. Entre les deux bâtiments, l’entrée. Un grand portail ouvert mais de suite après barré par une barrière qu’un militaire en faction montait et abaissait chaque fois qu’un véhicule se présentait. De part et d’autre du portail, deux grandes portes ouvertes et que rien n’obstruait.
Un drapeau claquait sec sous le mistral. Je n’ai pas attendu plus longtemps, j’y suis allé carrément.
Je suis passé à côté du grand bâton rouge et blanc et je me suis assis à l’intérieur de la caserne, sous un porche, à côté d’une porte.

ACTE PREMIER :
chez les militaires.
chez les militaires.
Il y avait du vent. J’étais entré avec mes papiers à la main ; dès que je me suis assis sur le sol, je les ai posés à côté de moi, j’ai mis un doigt dessus pour que le vent ne les emporte pas, et j’ai commencé à attendre.
Les voitures passaient devant moi, des voitures de militaires, des voitures de gradés, des camions. Le militaire au grand bâton rouge et blanc m’a regardé, étonné, je le comprends. IL était étonné – moi aussi – pourtant pas tout à fait, j’étais là assis par terre à l’entrée de la caserne, c’était normal pour moi et surtout c’était simple. C’est simple de s’asseoir et de ne rien dire.
J’ai attendu quelques minutes. Toujours le militaire devant, intrigué. Ceux qui passaient ne me regardaient pas. Deux militaires avec de grands sacs, qui partaient en permission peut-être, sont passés tout près de moi. Ils ne m’ont pas vu.
J’avais toujours le doigt sur les papiers, j’attendais toujours, et le vent soufflait toujours. Mes cheveux voltigeaient dans tous les sens, je n’avais que ma main à soulever pour les mettre en place. Le soleil passa l’angle du bâtiment et vint sur moi. J’avais un peu envie de rire mais pas trop. Ça allait. J’étais décontracté, j’étais là, tout seul, je savais qu’on allait arriver, j’attendais.
Un militaire est sorti de la porte près de laquelle j’étais assis. J’ai vu ses pieds qui s’approchaient de moi. « Qu’est-ce que tu as ? » Je n’ai rien dis. Je suis resté là, toujours assis, je l’ai regardé une fois puis je n’ai plus fait attention à lui. Il n’a pas compris, pas du tout compris. Il est rentré et d’est là que tout a commencé.
J’ai entendu des bruits de téléphone, des gens qui parlaient. J’ai vu le militaire qui faisait bouger son bâton rouge et blanc aller dans sa petite guérite et prendre le téléphone. Il parlait derrière ses vitres et en même temps il me regardait. Il semblait assez perplexe, ou embarrassé peut-être, comme si aux questions qu’on lui posait il ne pouvait pas trouver de réponse satisfaisante ou raisonnable. J’avais envie de lui sourire, de lui faire un petit signe… mais non, il était là, j’étais de l’autre côté.
Et toujours les voitures passaient, les voitures de civils, les voitures de militaires. Je m’étais aperçu, depuis un moment, que les gros bruits qui venaient des bâtiments en face étaient ceux de moteurs d’avions. Des bruits monstrueux qui, avec le vent, vous donnaient l’impression d’être près de quelque chose d’extraordinaire, quelque chose qui faisait tout vibrer et qui en même temps aurait produit ce grand vent. Ça ne me dérangeait pas outre mesure.
Quelques minutes s’écoulèrent encore – elles me paraissaient longues parce que je m’attendais à ce que tout de suite on me prenne et m’emmène – avant qu’un autre militaire ne sorte et ne me dise : « Qu’est-ce que tu as ? qu’est-ce que tu as ? » Je ne lui répondis pas, je ne le regardai lui aussi qu’une fois, sans avoir même la peine de lever la tête car il s’était accroupi près de moi et me dévisageait. Il me mit la main sur l’épaule : « Qu’est que tu as ? qu’est-ce que tu veux ? » il vit mes papiers, il les prit, les feuilleta. Pendant ce temps deux autres militaires étaient sortis par la même porte et étaient venus le rejoindre. Ils s’étaient mis entre le soleil et moi. Je ne voyais que leurs pieds. Ils sont rentrés tous les trois avec les papiers et j’ai attendu encore.
Mais cette fois-ci ils sont revenus plus rapidement. Le même militaire m’a dit : « Il faut rentrer, il ne faut pas rester là. Tu t’appelles Guesnard ? » Je n’ai rien dit, je n’ai pas bougé. Je savais qu’ils se regardaient. Ils m’ont dit : « Il faut rentrer. » Aucune réaction. Il y en a alors un qui m’a pris par le coude et fait comme pour m’aider à me mettre debout. Je me suis relevé. Il m’a guidé, je me suis laissé guider. Il a ouvert la porte, celle d’où ils étaient sortis, et m’a fait entrer.

C’était une pièce petite et sale. Un bureau, deux tables, un téléphone, des papiers, trois ou quatre chaises, un poêle. Et des militaires, bien sûr. Au mur, dans un râtelier, enchaînées, des armes.
Il m’a guidé jusqu’à une chaise près du poêle et m’a fait asseoir. Mais la chaise n’était pas pour moi, j’étais mieux par terre et je m’y suis remis.
Je voyais des chaussures de militaires, de gros souliers qui montaient jusqu’au-dessus des mollets, étroitement lacés de bas en haut cirés impeccable. Personne ne parlait, du moins à haute voix. Ils s’étaient tous regroupés dans le coin opposé de la pièce et je les entendais chuchoter sans comprendre ce qu’ils disaient – mais de quoi pouvaient-ils parler sinon… Un noir se tenait à l’écart. Assis sur une table, il balançait ses pieds croisés. Il ne parlait pas avec les autres, il me regardait et je crois même qu’il m’a souri.
Des militaires et des civils entraient et sortaient. Tous semblaient un peu gênés par ma présence. Il y avait d’imperceptibles temps morts, des regards interrogateurs et, en réponse, de curieuses mimiques esquissées mais vite défaites. C’est que ce n’est pas tous les jours que dans la salle de garde, à l’entrée de la caserne, on se trouve en compagnie d’un mec barbu, chevelu, assis par terre les jambes croisées, et qui ne dit pas un mot.
A un moment, je me souviens, deux femmes sont entrées. L’une, en robe assez courte, avait de belles jambes. Elle s’est assise sur la chaise près de moi, elle ne semblait pas étonnée – moi j’étais un peu gêné maintenant. L’autre portait des pantalons. Elles parlaient de voitures. Ce devait être des femmes de militaires, de gradés même – pas à cause de leur sujet de conversation mais parce qu’elles semblaient à l’aise dans cette salle et en même temps assez hautaines envers tous les militaires qui se trouvaient dans la pièce et qui étaient certainement pour la plupart des appelés. Quelqu’un leur offrit des cigarettes ; je vis qu’il allait m’en offrit une aussi, je sortis mon tabac pour le lui montrer et le rentrai aussitôt. Je n’avais pas envie de fumer.
On téléphonait sans arrêt à l’adjudant de service, qui restait introuvable. On avait envoyé plusieurs fois des militaires dans tous les coins de la caserne, en vain. Enfin, on réussit à le joindre au téléphone et je compris qu’il n’allait pas tarder à arriver. Le poêle ronflait et refoulait de temps en temps, lâchant de gros pets de fumée qui firent tousser deux ou trois fois la femme en pantalon. C’était un poêle à charbon, la fumée était rousse et âcre.
Quand j’ai vu que les pieds s’arrêtaient de bouger, que toute conversation cessait, que même la femme assise se levait et que l’autre venait près d’elle, j’ai compris que l’adjudant arrivait. Il n’y avait que moi qui était resté assis, qui n’avait pas bougé de place, changé d’attitude. Il est entré, il avait des chaussures bien cirées. Je ne l’ai pas regardé parce que je n’avais pas envie de le voir, parce que je le connaissais déjà, parce qu’on les connaît tous, à quelque chose près. J’ai entendu :
- Ah, je vois ce que c’est ! un non-violent ! Il faut évacuer la pièce. Allons sortez. Il a ajouté gentiment – à l’intention des dames sans doute – excusez, je vous prie.
Tous sont sortis, l’adjudant compris. J’ai entendu quelqu’un dehors qui disait : « Il ne faut pas le laisser là… on ne peut pas le questionner ici. » La porte s’est refermée. Par la fenêtre, j’ai vu l’adjudant pénétrer dans le bâtiment en face, et, à nouveau, j’ai attendu.
Les bruits d’avion se sont us d’un coup. Le silence soudain a envahi la pièce. Le ronflement du poêle a redoublé d’intensité. Mes oreilles bourdonnaient. Dans la pièce à côté j’entendis grincer des lits, le silence subit dérangeait les dormeurs. J’ai d’abord été étonné que des militaires puissent dormir à côté, à neuf heures du matin… faire la grasse matinée ! puis j’ai pensé que ce devait être ceux qui avaient monté la garde pendant la nuit. Déjà les bruits d’avion reprenaient, encore plus agressifs semblait-il. Et, au même instant, comme si on avait attendu volontairement que les moteurs se remettent en marche, la porte s’est ouverte violemment, la poignée est allée buter contre le mur et le battant est revenu sur l’adjudant, qui l’a repoussé d’un coup de coude. Il s’est approché de moi, m’a pris le bras et m’a soulevé à moitié en disant : « Allez viens, sous-moi. » Sa voix n’était guère engageante.
Il m’a fait passer la porte et m’a mené vers le bâtiment en face de celui-ci, de l’autre côté de l’entrée de la caserne et dans lequel je l’avais vu pénétrer quelques instants plus tôt. Il y avait toujours du vent, toujours le militaire qui soulevait et abaissait son bâton rouge et blanc, et toujours ces bruits de moteur qui ne semblaient gêner personne.
L’adjudant m’a dit : « Je temmène à la police, à la gendarmerie. » il me disait cela avec l’intention manifeste de me faire peur, mais c’était raté. Je l’ai suivi dans les escaliers, il n’a pas eu à me prendre par le bras mais je marchais à mon pas, sans me presser, et lui devait m’attendre. Il montait quelques marches puis s’arrêtait, le temps que je le rejoigne – mais nous n’allions qu’au premier étage.
Dans les escaliers on voyait une raie de crasse contre le mur, à hauteur du coude, et de la crasse aussi dans les angles de chaque marche. Visiblement la serpillière n’allait pas dans les coins, elle devait au contraire y repousser la saleté. De la crasse de plusieurs années. Les murs étaient nus et d’un jaune pisseux.
Une fois au premier étage il m’a mené devant la porte et m’a dit : « Tu vois. » il y avait écrit : gendarmerie. Je ne disais rien, lui devait penser : on va mettre le paquet, on va l’impressionner avec ça, gendarmerie ça devrait lui foutre les jetons, lui rappeler la prison… Il me mena devant une seconde porte : bureau du capitaine de gendarmerie, avec le nom en dessous, un nom corse je crois, avec plein de i. Il m’a fait entrer ; visiblement j’étais attendu. (à suivre....)

21:21 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peintre contemporain, écrivain, sagesse, pacifisme, ermite


